On trouve cette phrase en forme de question dans mon « carnet » Actes d’une recherche (Z4éditions) : « Créer un petit recueil de notes sur le cri ? (22 octobre 1998) ». J’avais quitté l’université depuis un peu plus de trois ans où avait muri ce qui deviendra Écrire le cri : Sade, Bataille, Maïakovski… (L’Écarlate, 2000) et étais en pleine réécriture de l’essai. Je me suis vite rendu compte lors de ce re-travail, que toutes mes idées et notes accumulées sur cette question de « l’écriture du cri » ne pourraient rentrer dans ce corpus.
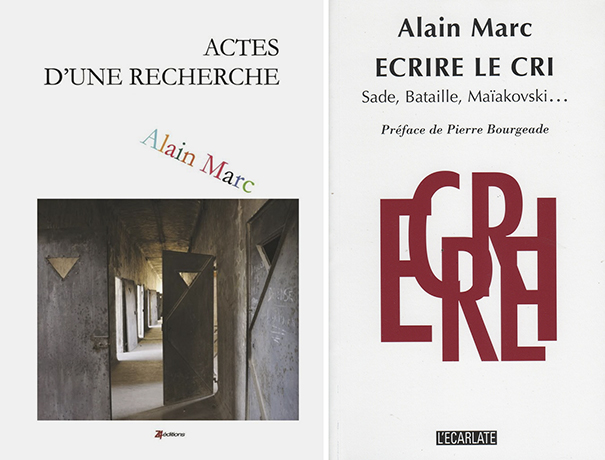
Nombre de « notes » déjà étaient entrées dans Écrire le cri. Se posaient alors plusieurs questions pour La Vie du cri (Unicité, 2024) : celle, déjà, de publier les notes premières entrées dans Écrire le cri séparément dans un carnet au risque de donner au lecteur à lire des doublons ? Car les notes, non lissées par le discours théorique avaient/gardaient toute leur impulsivité et leur beauté. L’autre question concernait la constitution de ce deuxième livre : autant Écrire le cri avait été rédigé avec l’objectif sous-jacent de défendre ma vision de la poésie et mes poèmes à dire et à crier notamment, autant je sentais que certaines idées commençaient à cerner une nouvelle écriture qui ne demandait qu’à naître. Un sujet émergeait également : celui de prendre le cas Sade en étude. Sujet que je reléguais pour un futur livre à venir. Une part de la deuxième partie de la Vie du cri, celle qui suit « La Vie du cri : notes métaphysiques », correspond donc aux notes intermédiaires de cette écriture du cri qui commençait à poindre dans mon esprit. Autant dire que je n’arriverai jamais à atteindre toutes les idées et la complexité qui m’occupaient alors. Le temps se chargeant comme un goulot nécessaire, linéarisant la pensée et le chaos qui était le mien à ce moment, la nécessité de « gagner sa vie » se chargeant en plus de ralentir grandement son avancée. Aucune vision définitive donc, dans ce corpus, où au fil du temps sont venus rejoindre des entretiens, articles nouvellement rédigés, et notes réactives en réponse aux questionnements et propositions qui affluèrent après la parution de Écrire le cri.
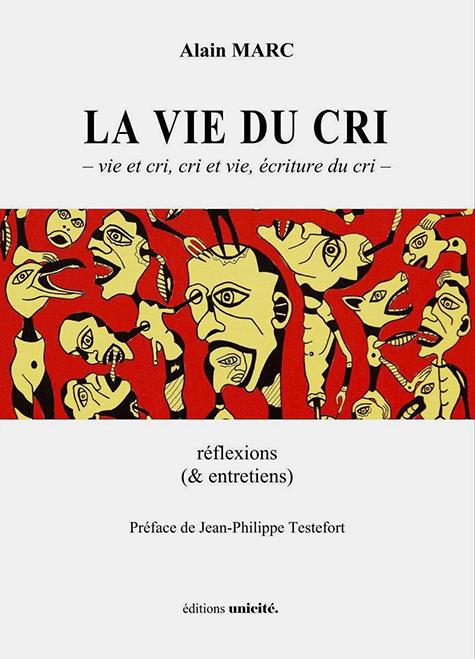
La structure de ce deuxième livre – je viens un peu déjà de l’esquisser – mêle en même temps des notes qui ont précédé Écrire le cri et des notes qui ont surgi, parfois bien longtemps après, hiérarchisées par les quelques axes et problématiques esquissées plus haut. « L’Écrit du cri », correspondant aux premières et « L’Écrit du cri, Suite » aux deuxièmes. « Précisions sur un concept » correspond évidemment à expliciter, apporter des précisions sur ce que j’entends par cette notion d’écriture du cri développée dans Écrire le cri. « Cri et société » a été créée vers la fin suite à la rédaction de l’article « La Littérature est bourgeoise », et la réunion de divers entretiens.
Temporalité complexe donc, liée, issue, de la temporalité intrinsèque du cri et du chaos de son surgissement ? Mais à quoi reconnaît-on et catégorise-t-on cette temporalité du cri, d’une littérature de cette force ? C’est quand ça sort, c’est quand le cri sort ! Il me semble que j’aborde cela dans mon entretien avec le peintre Éric Froeliger. Le « ça » de « quand ça sort », qui lance vers la psychanalyse, n’est pas anodin. Quelques notions amalgamées dans Écrire le cri s’approchent de notions psychanalytiques (comme l’abréaction des psychanalystes qui répond à la catharsis d’Aristote et de la tragédie grecque associée à l’excès et la démesure – l’hubris). L’inconscient est un peu abordé dans La Vie du cri, mais somme toute assez peu. En ce point Julia Kristeva m’a été d’un grand appui, qui rapproche dans La Révolution du langage poétique et son œuvre théorique des débuts, langage et psychanalyse. Et à cela s’ajoute la temporalité particulière de ce livre de La Vie du cri, raison de mon dire et appel à Georges Bataille – plus particulièrement à L’Expérience intérieure que j’ai inscrite en exergue du livre – et à son impossibilité à clore et conclure son livre et ce livre. Revoir en cela le début de ce présent texte. Et ce n’est pas pour rien, comme Henri Meschonnic qui a suivi mon premier travail, mais aussi comme Freud, que dans Écrire le cri, j’aborde le cri à travers le langage et des notions comme l’injonction, l’invective, l’interpellation, l’apostrophe, l’objurgation et l’admonestation. Mais aussi comme l’injure, l’insulte, et l’incantation chère à Antonin Artaud. Tout cela se retrouve dans La Vie du cri, peut-être plus en sous-main, dans les différentes notes et entretiens réunis. Structuration de La Vie du cri et écriture de Écrire le cri qui suggèrent, aussi, que j’ai toujours préféré l’écriture, approcher la théorie par l’écriture, à la théorisation pure et structurée (l’écriture de Écrire le cri a été travaillée et mise en rythme et peut se lire du coup oralement).
Oui, il y a eu une forte opposition à mes dires sur l’écriture du cri : de multiples notes et réflexions en témoignent dans La Vie du cri. J’ai même vu une personne, très active sur les réseaux, finir par m’attaquer avec violence à toute occasion, et obsessionnellement. Ce n’est pas la seule – mais force est de constater que se mêlent alors regard critique des plus normaux et relations personnelles… Mais il y a heureusement eu bien d’autres manifestations et réactions des plus positives, que ce soit par des publications en revues ou par des entretiens publiés. Cela a été jusqu’à un plagiat pur et simple de nombreux passages de Écrire le cri dans un mémoire de l’UFR Arts plastiques et sciences de l’art, de l’université Paris I Panthéon Sorbonne ! La solution ? Peut-être me lire et me relire encore… Et surtout lire le prochain essai, encore inédit, sur le même thème, mais en partant de Sade.
Et puis, il y a ces « Notes métaphysiques » qui ouvrent le livre, dont certaines sont assez scandaleuses, il est vrai. Sorte de monstrations de la théorie par le réel. Raison, aussi, de mon « Avant lire » et de sa première phrase : « Le je est-il vraiment un je ? ». Et de son développement. Tellement la notion de narrateur – et encore plus lorsque celui-ci écrit au « Je » sous la forme du journal – est absolument non perçue !
Tout cela nous amène au titre de La Vie du cri, mais surtout à son sous-titre « – vie et cri, cri et vie, écriture du cri – ». Les lecteurs avertis ne manqueront pas de remarquer déjà la grande séparation de cet essai, à savoir celle de « La Vie du cri : Notes métaphysiques », c’est-à-dire du cri dans la vie, avec la plus grande partie du livre qui suit, entièrement consacrée à l’écriture du cri, et son dernier chapitre, à l’écriture du cri au sein de la société. Ce lecteur remarquera également, s’il scrute mes publications, l’opposition du titre du recueil de poème(s) Le Monde la vie (Zaporogue, 2010) où quatre séquences sont consacrées à « la vie », et de l’essai de société Du monde suivi de « … la Vie se dégrade… » ou de quelques considérations actuelles et inactuelles (Oxybia, 2023). La vie d’un côté, et le monde de l’autre. C’est un premier point. Mais précisons : « vie et cri » fait référence à la vie et au cri, à la relation de l’un avec l’autre ; « cri et vie » fait davantage référence au cri perçu dans la vie, donc dans le monde ; le troisième terme étant sans ambiguïté. Toujours la séparation entre soi et le monde, entre l’individu et la société. Et son jugement, voire sa censure. Oui : le cri a mauvaise presse, il est caricaturé, non pensé, moqué, synonyme de faiblesse ou provoquant malaise ou rire. Alors que le cri est une force, qui peut être ô combien salvatrice. Impensé du cri, qui confond encore véritable cri puisé des profondeurs et bouche ouverte, qui confond encore le personnage du Cri de Munch – qui ne crie pas, mais fuit – avec le tableau qui lui, crie. Qui confond également cri et profondeur (Cf. mon essai De la profondeur, Douro, 2021). Non, les écrits de Marguerite Duras ne crient pas !
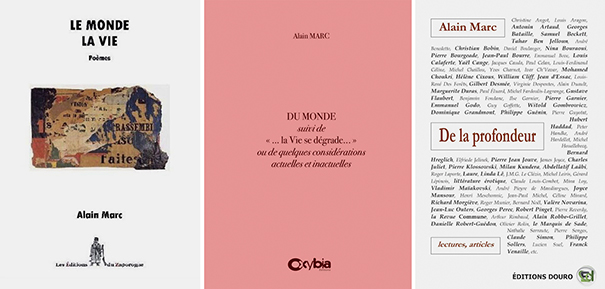
J’ai longtemps dit que si j’écrivais, c’était parce que j’avais quelque chose à dire. Ne m’a-t-on pas tout jeune intimé de me taire, que je n’avais pas le droit de dire cela, de dire ce que je ressentais étant gamin qui me faisait souffrir au plus haut point ? J’ai aussi dit quelque part qu’il me semble que tout ce que j’écrivais était autobiographique. En forme de provocation, bien sûr. Ce qui est vrai et faux en même temps, puisque toute écriture fantasme son sujet. Je n’ai donc aucune peur à me livrer, puisque toute bonne écriture digne de ce nom atteint l’universel. D’où mon qualificatif de « métaphysique » ? Et oui, les rejets qu’a reçus ce travail – que j’ai appelé écriture du cri – réside aussi dans ma critique, acerbe (violente ?), de la littérature et de sa récente histoire, surtout depuis le début des années soixante. Et par-là même, de la défense de mon écriture, comme je l’ai déjà signalée. Ne m’a-t-on pas dit, au début de mon parcours, que ce que j’écrivais n’était pas de la poésie ? Ou même, j’en ris encore à plein goulot, que c’était du journalisme ? J’aime tant les dires de Georges Bataille – encore lui – sur la poésie, tellement efficients aujourd’hui encore, pour ne rien avoir à ajouter… Réactions, rejets, qui m’auront fait passer par le monde du théâtre pour lire et produire les lectures performées de mes textes en public. Réactions, rejets, qui me font effectuer un important travail de mise en ligne sur Internet, de vidéos, de sons et de photographies. Mais l’œuvre semble encore beaucoup trop fraîche…
Texte © Alain Marc – Illustrations © Kej Painter & DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
