HÉLÈNE LING s’entretient avec XAVIER BOISSEL à l’occasion de la publication de son roman, OMBRE CHINOISE (Rivages, 2018) :
1 – Hélène, je commencerai pas une question sur l’origine, car il me semble que c’est l’axe central de ton livre. Souvent, au cours de ma lecture, j’ai songé à cet aphorisme de Karl Kraus – cité par Walter Benjamin dans ses Thèses sur la philosophie de l’Histoire : « L’origine est le but » (Urspung ist das Ziel) ; il y a en effet une dimension presque « archéologique » dans ton livre, dans cette façon que tu as d’explorer l’enfance de tes personnages. Ton écriture ne cesse d’aller à rebours du temps historique, linéaire, homogène, s’arrache à lui par un jeu de correspondances, d’échos mais aussi de détours et d’excavations. Sans chercher à rabattre la part biographique sur la part fictionnelle, peut-on dire que ce livre est un roman (si tant est que c’est un roman…) des origines, pour pasticher le titre d’un célèbre essai qui a fait date ? Et quel statut la fiction conférerait-elle à l’origine ? Quelque chose de l’ordre de la rédemption ? Ou plus prosaïquement, serait-elle une manière d’en finir avec non pas avec l’origine elle-même, mais avec l’assignation à l’origine, qui s’accorde avec une hystérie identitaire, très dans l’air du temps ?
Oui, il s’agit bien d’un récit orienté vers « l’origine », mais il faut l’entendre comme un lieu éclaté, un lieu non situé dans la chronologie. J’y ai pensé un moment comme à une « utobiographie », tendue vers un intervalle vide d’où jaillirait la nécessité de l’écriture, aiguillonnée par le sentiment d’une rupture originelle. Cette enfance était pour moi un fondu au noir, une zone d’ombre. Pour y revenir, il me fallait préserver le processus de remémoration, sous forme de fragments singuliers, éclatés en îlots, aiguisés par l’écriture. Chacun d’eux, dérivé du passé, est animé par le mouvement même de regard en arrière, comme par une énergie propre. L’ensemble ne peut donc reconstituer une évolution sur le mode linéaire, un jeu supposé de causes et d’effets, calqué sur un certain modèle d’écriture de l’histoire. C’est bien plus l’urgence, la nécessité de donner forme à chaque fragment qui prime, de le faire apparaître avec son relief, son mouvement de dérive, dans un ensemble en archipel.
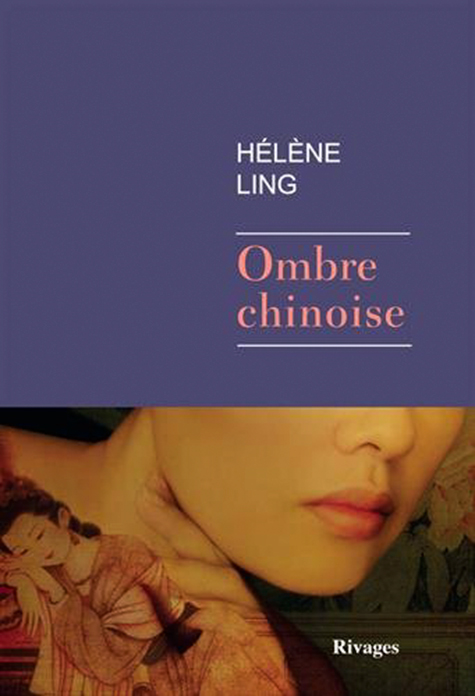
La banale histoire d’immigrée de ma mère, par ailleurs, ne s’y prêtait pas – elle se nouait autour de sauts et de ruptures successives. L’exil d’abord, puisqu’elle était passée de Taïwan à Paris dans les années soixante, traversant les Trente Glorieuses pendant lesquelles son rêve d’aventure avait peu à peu fait naufrage dans la dépression et les somnifères. Vers 2010, surtout, Alzheimer avait provoqué une abolition générale des perspectives. Une lente déperdition des traces et des mots, biffés à rebours, dans un processus d’auto-éradication du langage, de la langue apprise d’abord (le français), puis du chinois, à mesure que le corps perdait lui aussi tout moyen de faire signe. Au point qu’Alzheimer lui-même aurait pu devenir un système d’écriture aléatoire, une loterie d’abord de souvenirs erratiques, de raturages, d’abolitions ou de répétitions mécaniques folles, jusqu’à la refonte intégrale du passé aspiré dans l’entonnoir du néant. Par le collage de fragments hétérogènes, j’ai voulu faire sentir ces processus de déracinements successifs, de plus en plus radicaux, ces changements de langues et de seuils. A ce titre malgré tout, malgré la violence du phénomène, l’origine peut coïncider avec la fin, le but. Ainsi la photo d’enfance qui clôt le récit : c’est l’image qui l’a fait surgir et l’a appelé à elle dès le début, et c’est celle que le récit a permis d’atteindre. Peut-être enfin parce qu’écrire ce qui s’est passé n’a pas pour priorité de le rendre intelligible, mais plutôt de le « sauver », et d’abord, comme l’écrit Georges Perec, d’ « essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survire quelque chose ». De laisser une trace soustraite à la momification et à l’état-civil, et surtout, une trace qui se renouvelle chez le sujet par l’acte de remémoration (l’inverse, donc, de la commémoration, funérailles en grande pompe des enjeux du passé). C’est aussi pour cela que la part intime du déracinement s’ouvre sur un second récit et sur un processus collectif et historique : la dérive de Betty Jones, Indienne cherokee, sur le continent américain entre 1839 et 1913, de la Piste des Larmes au Wild West Show. Ce second récit suggère que l’exil est aussi et surtout une traversée historique – c’est une métamorphose et une décomposition de mondes qui embrasse des populations entières, jetées dans un devenir industriel capitaliste à l’échelle globale. Ce qui nous amènerait peut-être à l’assignation identitaire que tu évoques, un symptôme aigu de la période actuelle. Elle provoquait chez moi, dès l’enfance, une répulsion spontanée : dans le mythe nationaliste chinois des « Han », que mon père relayait avec une fierté naïve, ou dans la propagande du Guomindang que nous subissions à Taïwan. L’ « identité » ethnique ou culturelle m’est apparue sous la forme du fantasme et de la manipulation nationalistes. A l’inverse, du côté français, c’était plutôt une curiosité avide d’altérité ou d’exotisme que je rencontrais chez certains jeunes bourgeois bien-pensants, à l’imaginaire encore colonial. Des deux côtés, c’était pour moi une réification absolue, et la négation de ce que j’essayais de vivre. En tout cas, toute tentative d’écriture me semble s’inscrire à rebours de la notion d’identité telle qu’on l’entend aujourd’hui, une essence subjective affiliée au groupe.

2 – Ce que suggère en fait ton livre est que la question de l’origine est indissociable de la question de l’identité. Dans son essai, Entre-deux, l’origine en partage, le psychanalyste Daniel Sibony montre que le rapport de ce que l’on a avec son origine se manifeste et se lie aussi dans la suite de ce que nous vivons ; l’origine s’articule avec l’identité, mais une identité qui n’est jamais pleine, close, une identité « entre-deux », qui serait comme un espace entre ce que l’on a été et ce que l’on sera. L’identité est une dynamique, un tressage. C’est ce qui me frappe particulièrement dans ton livre, ce jeu sur des identités croisées. On suit trois figures dans ton récit, une indienne, un scénariste et une jeune femme d’origine asiatique, qui a le même prénom et le même nom que toi… Tu parles « d’utobiographie »… Mais on pourrait parler aussi bien de fiction, car c’est bien elle qui fait vaciller l’identité. Ceci induit à la fois une question sur l’écriture et une autre sur le genre littéraire : quel est ton rapport à la fiction ? Comment te situes-tu par rapport à l’autofiction ?
Pour ma part, je ne parlerais pas d’autofiction. Même si l’on retrouve une figure de l’auteur-personnage, nommée « Hélène Ling ». Elle est en partie fictionnalisée, mais seulement par jeux de miroirs et par contiguïté avec ses doubles imaginaires. La parenté avec l’autofiction serait plutôt, selon moi, le fruit de l’expansion de la formule de Doubrovsky, inventée en 1977, mais qui recouvre désormais aussi bien La Divine Comédie que Sujet Angot. Comme beaucoup d’autres textes, mon récit tente surtout d’instaurer son propre rapport entre écriture de soi et accès au réel. J’aurais préféré qu’il s’inscrive dans la lignée des expériences de l’écriture de soi qui ont vraiment fécondé le genre, à la façon dont Perec, pour revenir à lui, l’a désarticulé et transfiguré en 1975, dans W ou le souvenir d’enfance. Réussite exceptionnelle, unique, à la mesure de l’Histoire sur laquelle il garde le silence. À une tout autre échelle, Ombre chinoise articule trois récits distincts : « Je », « Hélène Ling »/ »elle », Betty Jones, Indienne cherokee/ »le scénariste », Johan Karlson. Trois personnages, et au total, autant d’ombres et de doublons biographiques, trois fils narratifs au statut équivalent, sans préséance « ontologique » absolue de l’un sur l’autre. Juste des effets d’échos, des analogies, un collage. La part chinoise d’Hélène Ling, réduite à celle de l’ombre, n’a au fond pas plus de substance que Betty Jones, rêvée à partir de rares photographies d’Indiens au 19e siècle. Le scénariste, lui, n’est que le témoin de la réalisation catastrophique d’un fantasme toujours en sommeil, celui du retour à l’origine. Dans une première version, le livre s’ouvrait d’abord sur la rencontre du scénariste et du producteur, d’où jaillissait un second fragment, le souvenir d’enfance à la première personne, puis un troisième, peut-être mis en abyme, Betty Jones en 1838. À travers le collage, j’ai tenté de relier le récit de soi aux deux trames fictives par un système d’analogies, de les placer à une même distance indéterminable de ce qu’on nomme le réel. Alzheimer, l’oubli et le refoulement laissant la place à l’imaginaire, je voulais créer une contiguïté entre les trois niveaux, une contamination qui procèderait à distance et sans confusion. Imaginaire, remémoration et cauchemar se font écho, perturbant l’assise du sujet et le vieux dualisme fiction/transparence qui sous-tend l’auto-fiction. Longtemps reniée, la part chinoise ne ressurgit pas comme un ressort secret, mais comme un blanc initial, propice aux projections. Certains fragments oniriques (visage de ma mère, vision de la Zone), flottent d’ailleurs librement sur le seuil. Pour aboutir peut-être à cette « utobiographie », délestée du a- initial comme d’un référent stable. Peu à peu s’esquisse un ensemble, une identité modulée dans le mouvement pendulaire, tournant entre bribes d’enfance, traversée de l’Amérique au 19e siècle et mise en scène du fantasme régressif. C’est le déploiement de l’annonce initiale du scénariste « Toute enfance est un western ». Le montage aurait d’ailleurs pu s’aventurer vers une sorte d’Atlas Mnémosyne, une coupe à travers bribes du passé, images de guerre, traces, documents, qui tente de recomposer la vivacité spectrale d’un chaos intérieur. Pour revenir à cet « entre-deux » de l’identité que tu mentionnes, le collage juxtapose aussi des temporalités hétérogènes : le regard en arrière construit la genèse du désir de fiction, et la fiction s’offre ainsi comme un long détour pour arriver à un autre soi. Peut-être rejoint-on ici la fameuse notion d’identité narrative de Paul Ricœur, ce « tissu d’histoire racontées » qui se trame à travers les possibles, les marges et les doublons fantasmés de la chronologie.

3 – Tu parlais au début de cet entretien à juste titre de « seuil », de « collage », « d’hétérogénéité ». On pourrait tout aussi bien appliquer ces termes aux différents régimes d’écriture qui traversent ton livre. Nous venons parler de l’autofiction, mais nous pourrions tout autant évoquer le western et le roman noir, qui se situent, eux, du côté de la littérature de genre. Peux-tu nous éclairer sur les rapports que tu entretiens avec cette dernière ?
Je connais très mal, je dois l’avouer, la littérature de genre. Mais j’ai pu lire avec un bonheur sans mélange quelques œuvres fondatrices, comme celle de Jean-Patrick Manchette, de J. G. Ballard ou de Philip K. Dick, qui m’ont paru remettre en question l’espace propre des genres littéraires traditionnels. Ce n’est en tout cas pas à vous, que je vais apprendre quelque chose sur Manchette ou sur les autres… Mais ce qui me paraît particulièrement fécond, c’est leur démarche parfaitement consciente d’elle-même, qui permettent de repenser un rapport complexe entre code et création. De fait, elles embrassent tout le champ du réel, font ressurgir ses mécanismes objectifs, son potentiel de cauchemar, à travers une immense créativité imaginaire et verbale, mais tenue dans l’espace d’un code d’écriture, dans un jeu en devenir avec le lecteur. Le polar, par exemple, nous l’avons déjà évoqué, recueille l’héritage du réalisme balzacien, mais en ayant intégré la donnée de l’industrie de masse, dont il est lui-même issu, et qu’il transforme ironiquement en paramètre du code d’écriture. La SF feint de naturaliser le débordement de l’imaginaire, repris dans une perception critique hallucinée du monde contemporain. À travers le code, il s’agit donc aussi de court-circuiter les conventions d’un pseudo-naturalisme dramatique, devenu une immense usine à produire de la fiction à jets continus, sans aucune démarche réflexive. En alternant l’écriture de soi, le western indien (déjà transposé d’un langage cinématographique), et les emprunts au roman noir, je voulais à ma manière décentrer le champ assigné à chacun, provoquer une contamination des référents. Dans Ombre chinoise, on trouve par exemple une femme fatale et peroxydée, fille du tycoon chinois, mais qui fait autant écho à l’androïde manga, au cliché hollywoodien, qu’à Gena Rowlands dans Une femme sous influence, associée à ma mère, Florence Wang. C’est surtout un objet de désir mutant par lequel le scénariste cherche à passer du côté de l’autre camp, du camp asiatique occidentalisé. Il s’agit sans doute de ma propre relation de désir et de répulsion pour l’image fantasmée de mes origines chinoises, telles qu’elles ont été transformées à travers l’industrie culturelle, le cinéma d’auteur et les permutations du rêve. Par ailleurs, on trouve un autre jeu de réminiscences visuelles dans le western indien de Betty Jones : des fragments d’une évolution de la photographie – albums d’anthropologie coloniale, scènes rêvées du western de Buffalo Bill, qui rejoignent ma propre photo d’enfance. Mais pour reprendre votre question – on sait aujourd’hui combien les codes de la littérature de genre ont été investis par les écrivains et les cinéastes comme des terres de renouvellement. Ils y font apparaître le travail de la forme, ils mettent en évidence le processus d’interrogation du réel à travers le code. On pourrait mentionner des auteurs aussi différents et singuliers que Bukowski et son polar Pulp, que bien sûr, Volodine, de sa première trilogie à Terminus radieux. Inutile de citer le cinéma de Cassavetes, de Kubrick, de Lynch ou le Stalker de Tarkovski, comme preuves éclatantes de cette frontière mutante des codes et de leur puissance de renouveau expérimental.
Texte © Hélène Ling & Xavier Boissel – Illustrations © DR
(Paris, juin 2018)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
