Voilà qu’un matin, vous rêvez si fort une scène que vous vous décidez à prendre quelques notes, pour voir, ou pour rire (ou pour jouir, si vous préférez). Trois semaines plus tard jour pour jour, vous êtes devant un manuscrit de plus de deux cents pages qui ressemble manifestement à un roman. Vous quittez La Villa du Jouir (Serge Safran, 2015) d’un point final comme on descend d’un train de nuit, à l’aube. Sans savoir où vous êtes, où vous en êtes, sinon que le monde a une drôle d’allure, ici bas, ça tangue, et que vous êtes épuisé. Positivement épuisé. C’était le but, l’épuisement ?
La Villa du Jouir est de ces livres totalement inattendus qui littéralement vous tombent dessus, sans que rien ne les ait annoncés. Certes, tous les livres sont pour une part inattendus, sinon ce ne serait pas la peine de les écrire – mais là, c’est différent. Je n’avais jamais pensé que j’écrirais quoique ce soit qui ressemble à ça. À ce truc ! Mais c’est quoi, ça ?
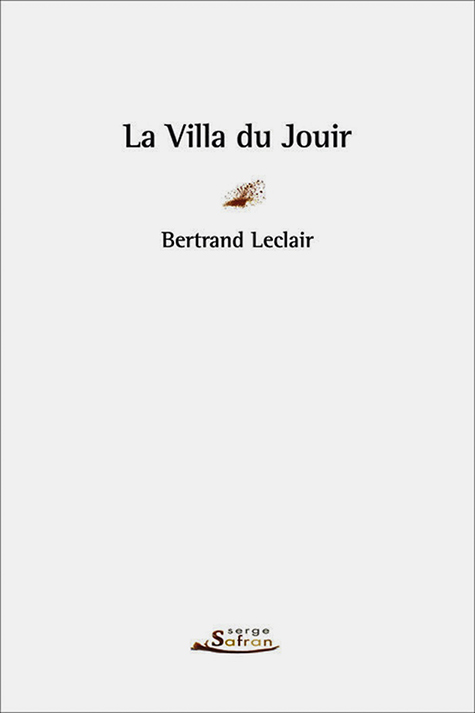
C’était au printemps 2013. Je m’apprêtais à reprendre enfin le chantier romanesque que j’avais dû laisser de côté quelques semaines pour cause d’écriture radiophonique, chantier qui allait donner Le Vertige danois de Paul Gauguin, paru depuis, et dont je devais rendre le manuscrit fin juillet, trois mois plus tard. S’y remettre devenait urgent. C’était le programme, donc, on ne peut plus simple en apparence, avanti. Un programme tout à la fois promesse de joie, la grande joie d’écrire sans entrave, et facteur d’effroi, est-ce que j’ai quoi que ce soit à formuler qui ne l’ait pas déjà été, vanité des vanités ?
Ce programme, au bout d’un certain nombre de livres, on commence à le connaître. On sait, que la difficulté est de l’ordre d’un passage ; on sait, ce qu’il faut traverser à chaque fois avant de retrouver, peut-être, l’espace de l’écriture. Ce serait comique si ce n’était laminant. Des heures, des jours à refaire les mêmes gestes apparemment stériles…. S’asseoir à sa table, poser un mot sur la feuille comme on épinglerait un papillon encore vibrant d’indignation, se relever aussi sec, soit que le mot paraît exsangue, haut-le-coeur, soit qu’il est si soyeux qu’on est comme piqué d’électricité, aussitôt debout à respirer enfin son bol de joie, allez, du calme, une petite cigarette, cinq minutes au balcon et, hop, le tour est joué, on a perdu le « la », tout est désaccordé, tout est à refaire quand on retourne s’asseoir épingler les papillons qui font couac..
C’est qu’on n’entre pas comme ça dans un texte, en tout cas pas moi. Il faut se laisser tomber, et ça n’est pas le plus simple, se laisser tomber soi-même, en espérant qu’il existe bien, qu’il existe encore une « couche du dessous », comme disait Michaux. Se laisser tomber, et ses habitudes, ses convictions ses certitudes… S’abandonner, au sens littéral : « a ban donner », « lâcher, laisser le lien qui attache un animal », d’où « laisser en liberté » (Furetière), loin du carcan des rôles et des identités qui nous tiennent debout au quotidien des jours, père, mari, fils, amant, voisin aimable, ami attentif, membre du club des informés, auteur cotisant des sommes délirantes à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et à la Sécurité sociale des artistes-auteurs, ce que vous voudrez… Parce qu’on n’écrit pas comme ça, on n’écrit pas dans la cage mordorée du quotidien, frais et dispo à la manière d’un comptable impeccablement coiffé ouvrant le livre du jour après avoir fait son petit tour d’Internet – exactement comme mon grand-père faisait le tour du quartier jusqu’au kiosque à journaux où glaner les ragots rassurants ré-assurants.
C’est le sas, la difficulté : passer le sas, passer d’un état à un autre ; passer du temps socialisé, horizontal, à l’autre, le temps vertical, c’est-à-dire ouvert à la joie (d’écrire, je n’en connais pas de plus grande) comme au vertige de l’angoisse (de ne pas écrire tandis que le monde passe, j’en connais peu de pire). Le sas, tout est bon pour tourner autour ; tailler les crayons, cirer les chaussures, répondre à des courriers si vieux qu’ils n’en demandaient plus tant, ranger les dictionnaires et jeter les papiers timbrés, lancer une machine de linge, s’accorder une sieste brève… On n’est pas vraiment le maître, de toute façon. On commence à le savoir, au bout d’un certain nombre de passages.
Ce que j’ignorais encore, en revanche, au printemps 2013, c’est qu’un sas peut en cacher un autre. À force de tourner autour de celui que je tâtais du bout du pieds comme un baigneur en mer du Nord, c’est dans un autre que je suis tombé, et à une vitesse folle, par surprise, et pas du tout là où je m’espérais moi-même, tout à fait à côté de la plaque en somme.
Ce jour-là de mai 2013, donc, de cigarette en cigarette à tourner en rond autour du chantier Gauguin, de pure procrastination en siestes impossibles, voilà que je rêve une scène érotique. Je la rêve si fort que je ne peux m’empêcher de prendre des notes, ce serait trop bête de la laisser s’enfuir, cette scène de rêve aux allures de revenante : je dis revenante, parce qu’elle est hantée par le souvenir, non pas d’une situation vécue, mais d’un fantasme partagé des années plus tôt dans le corps à corps amoureux, murmure magique de ces instants suspendus où les phrases se bousculent et accélèrent dans le souffle qui les relance encore et encore, éclat des corps précipitant le désir immédiat de se parler en appelant le métadiscours, et cette sensation de toucher l’autre au plus intime, au plus secret, là où tout sécrète, de toucher de mots l’idée du corps de l’autre à y confondre la sienne propre – jusqu’aux confins de l’âme en somme, si l’âme est bien cette insaisissable et inconnaissable « idée du corps » qu’on lit chez Spinoza.
Voilà donc que « ça me revient », voilà donc que j’en rêve, des années plus tard, beaucoup d’années, quinze peut-être. Je commence de prendre des notes, pleinement conscient que, dans ce fantasme murmuré, et c’est peut-être là le plus renversant à la distance du temps, la femme n’est plus l’objet du désir qu’en fait la représentation érotique commune (disons, l’érotisme à la va comme je te pousse…) : elle devient le sujet du désir, entendez-le comme vous voudrez, ce mot de sujet, puisque le désir est roi, dans cette affaire.

La scène est précise, lumineuse, vraie. Je note, et aussitôt les notes tournent à la mise en scène, parce qu’il en va ici comme dans tout récit de rêve : la note manuscrite n’est rien tant qu’elle n’attrape pas les phrases susceptibles de saisir autant le sentiment que ce qui l’a fait naître. Alors les phrases s’appellent, se tirent l’une l’autre, se tissent, se trament, toutes plus performatives l’une que l’autre, jouissance à l’état pur. L’écriture va vite, d’autant qu’à côté de l’ordinateur le carnet se remplit dans le même temps d’autres notes plus brèves : ce qui pourrait précéder et justifier la scène, ce qui pourrait la suivre et l’expliciter. Le texte s’emballe, me prend la main et même les deux, n’allez pas croire, rivées au clavier de l’ordinateur portable. Je ne maîtrise plus rien, je ne sais plus rien et ne cherche pas même à savoir, porté vers une mêlée de mots de plus en plus inextricables. Elles ont quelque chose du cheval de Fabrice à Waterloo, ce jour-là, mes mains, le cheval qui sait bien, lui, où est la vraie bataille, quoi qu’en pense l’hurluberlu qui croit tenir les rennes et cherche encore à en voir une, de vraie bataille, c’est par ici qu’on meurt, vous croyez, vraiment ?
Évidemment, l’écrivant je me demande bien ce que c’est que cette chose, sur le coup. Une simple diversion ? Ce que je vais en faire, de ces notes, sinon rien comme tant d’autres ? Je continue d’écrire, pourtant. Je me laisse jusqu’au soir, bien décidé à retrouver mon chantier au réveil.
Mais après une nuit sèche de rêves, à peine je pose le pied par terre que je vois comme on trébuche une autre scène très scandaleuse, ça alors ! Jamais pensé un truc pareil ! Sinon que je tiens tout à la fois la suite et la raison de ce qui précède. C’est en Grèce, forcément, sur une île au bord du mythe, origine du monde et réminiscence d’une description de Paul Nizan qui m’avait ébloui à l’adolescence, les orangers en fleurs dévalant jusqu’au bleu de la Méditerranée où puiser d’éternelles renaissances. Qu’est-ce que je peux faire contre ça ? J’y cours, forcément. Je fonce à ma table non pas tant écrire que copier à toute allure dans l’espoir de n’avoir rien perdu en route. C’est dès le café, c’est avant même le départ des enfants à l’école, et comme je n’ai pas de bureau isolé, jamais eu de bureau tel une chambre à moi hélas, comme j’écris dans un coin de la salle commune, la tension monte – déjà que d’ordinaire je supporte mal que l’on s’approche de mes écrits en cours, là je passe les bornes de la décence, je hurle, périmètre de sécurité, aucun enfant à moins de quatre mètres de l’ordinateur.
Cette scène inaugurale est désormais pile au milieu de la Villa du Jouir – c’est la seule grande scène écrite au présent, puisque dans l’espace du roman le narrateur ne fait que la recopier, dit-il : ce seraient là les seules pages qu’il ait réussi à écrire durant son séjour à la Villa du Jouir.
Trois semaines plus tard, donc, et sans en avoir encore touché le moindre mot à qui que ce soit, je donne le manuscrit à une éditrice en laquelle j’ai toute confiance, et confiance d’abord dans sa capacité à respecter le pseudonyme que j’ai décidé très vite d’adopter – parce que j’ai écrit sous pseudonyme, si j’ose dire (je ne sais plus qui m’a proposé récemment une théorie qui liait le préservatif et le pseudonyme, c’était un peu tiré par les cheveux, assez juste pourtant, le pseudonyme préserve de quelque chose ou préserve quelque chose – et l’un comme l’autre ils peuvent donc craquer, puisque me voilà avec un livre bien à moi qu’il s’agit de reconnaître, à défaut de pleinement s’y reconnaître…).
C’est une donnée importante, le pseudonyme, et pour deux raisons distinctes. D’abord, et au plus simple : autant j’assume complètement ce qui est écrit, puisque ce qui est écrit est écrit, on ne va pas le changer, autant je ne suis pas sûr que j’aurais été capable de l’écrire aussi librement si j’avais pensé que ce serait publié sous mon nom. Mais il y a plus important, peut-être : cette sécurité que procure le pseudonyme, cette mise à distance a été aussi celle d’une certaine idée de la littérature. On a beau vouloir s’en défausser, des idées, quand on écrit (rien de plus vulgaire que les idées, disait Céline), elles nous tiennent bien, en général, aussi branlants soient les échafaudages qui les constituent. Écrivant la Villa du Jouir à toute allure sous une identité libérée de la mienne, j’avais tout à fait autre chose à foutre que me préoccuper de littérature, si j’ose dire, je ne pensais qu’à une chose : être efficace. Je n’avais aucun souci de littérature, je ne voulais pas faire de la littérature, je voulais raconter ce truc inracontable et que «ça» marche. Je me suis autorisé – pour prendre un exemple précis – beaucoup de dialogues directs, avec tirets et passages à la ligne, et peut-être même des « dit-il » ou autres « répondit-elle » (non, là, j’exagère, je ne crois pas quand même), ce que je n’ai jamais fait dans mes romans précédents. De la même manière, je n’ai pas souvenir d’avoir éprouvé une seule minute le sentiment d’une progression libératoire mais âpre et difficile, lente comme une ascension, celle que je connais d’ordinaire systématiquement, écrivant un livre, à remâcher des semaines ou des mois durant les dix ou les cinquante premières pages jusqu’à voir éclore enfin un ton et un rythme, une sonorité accordée au thème du livre, c’est-à-dire une forme. Cette fois, la forme n’était pas un souci non plus : si La Villa du Jouir s’est écrit aussi facilement, si le roman a coulé de source, c’est aussi qu’il a spontanément adopté une forme ancestrale et efficace, facile, sans la prétention d’en rien modifier – un narrateur qui se situe lui-même dans l’après coup d’un événement entreprend de raconter cet événement dans le respect de la chronologie et depuis un unique point de vue, le sien. C’est au fond le caillou qui dévale la pente au rythme des obstacles qui relancent sa course dans les étincelles : ni plus ni moins que le roman selon Schopenhauer, en somme, et c’est – en l’occurrence – très bien ainsi.

Quelle surprise, du coup, en écoutant la réaction de l’éditrice dont j’ai parlé, qui la première a eu connaissance de ce manuscrit – éditrice dans une grande maison très respectable et très soucieuse de son image de marque, hélas : jamais je ne réussirai à imposer ça au sein du groupe, disait-elle, trop trash, trop ceci trop cela, vous n’avez pas conscience du retour de puritanisme que connaît l’édition, mais c’est renversant, et vraiment, alors là, si c’est de la littérature ! Elle était prête à m’aider à le publier, mais pas chez elle, il fallait songer au contraire à des éditeurs clairement identifiés comme « littéraires », surtout pas viser des collections grand public.
De la littérature, cette chose ? Exactement le contraire de ce que je pensais. Je l’ai regardé d’un drôle d’air, du coup, ce manuscrit. Pas mécontent, évidemment, mais très fâché tout de même. Adieu veaux, vaches, cochons (!), édition commerciale et rêves d’a-valoirs ad hoc… Retour à la case littérature et donc aux soucis d’argent, fin de la parenthèse enchantée ou du séjour prolongé à la Villa du Jouir, en somme. Passons.
Si j’ai retravaillé les détails, ensuite, lissé, huilé, de fait, trois semaines après avoir inopinément lâché le premier mot, le roman existait bel et bien, toutes les scènes, tous les personnages, tous les lieux, toutes les histoires dans l’histoire, y compris, d’une part, la légende fondatrice d’Adonis, « l’éphémère » adoré des déesses immortelles, et, d’autre part, l’intrigue politique qui, demeurant en toile de fond, est d’autant plus importante en tant que rapport de force qu’elle assure la tension du récit. Le titre aussi, était là, comme une réminiscence coupable du chantier Gauguin : la Maison du Jouir est le nom que le peintre avait donné à sa dernière habitation, sur l’île d’Hiva Oa, aux Marquises.
Ces trois semaines ont été de jubilation féroce, mais aussi de rage, j’y reviendrai. À dire vrai, j’en ai un souvenir hirsute. C’est un moment d’écriture dont je suis, sans doute, voué à garder une nostalgie perpétuelle, quand bien même l’euphorie n’allait pas sans s’accompagner d’un vent de panique – panique, on peut l’entendre du dessous, évidemment, que l’on fasse sonner distinctement les deux premières syllabes du verbe paniquer où que l’on convoque le dieu Pan. Joyeuse, troublante, exubérante panique.
Est-ce qu’on sait ce qu’on fait, quand on écrit ? Et quand on enchaîne les phrases à ce rythme, à ne rien faire d’autre sinon dormir un peu, manger un peu et boire trop de toute façon ? Dix, quinze, vingt pages d’un matin l’autre ? Je n’étais plus que l’enchaînement du récit dans le déchaînement de l’histoire. Histoire qui m’effrayait moi-même, par moments – cela allait trop loin. Jamais je n’ai gommé, pourtant. J’ai introduit des ruptures en jouant d’effets de théâtre, masques et surgissement de déesses ex-machina, pour ménager l’espace de l’illusion, interrompre la narration pour la mieux relancer et lui permettre, sous couvert de fiction dans la fiction, de s’aventurer au-delà de mes propres petits fantasmes.
J’étais tout à la fois extrêmement lucide, calculant les effets, et hors de moi. Ce que j’écris sachant bien que l’on n’est jamais autant soi-même, à son insu, que lorsqu’on est hors de soi, comme l’homme dévasté de colère, comme l’enfant plongé corps et âme dans son jeu solitaire, aussi bien. Lucide, je l’étais sur la progression du récit, le jeu récurrent dans mes romans avec le vraisemblable, et surtout ce que je pensais alors être l’enjeu principal du récit : viser à bouleverser, démonter ou à tout le moins renverser les clichés érotiques pour retrouver une capacité à en jouer – ne serait-ce que pour leur donner du jeu, les rendre au jeu, aussi bien, à rebours du triste spectacle omniprésent de la pornographie contemporaine, cette aporie du cinéma (on peut désormais tout montrer, absolument tout, mais plus on montre, plus on lève le voile, plus on prétend dévoiler, mieux la vérité se dérobe à son tour. On ne voit rien, dans le porno, rien de l’invisible que la plupart des consommateurs ne savent même pas chercher désespérément, allant du côté d’une production d’amateurs qui serait gage d’un brin de vérité – c’est la fuite en avant dans la quête pornographique : le gros du public consomme du film amateur au grain de plus en plus épais, à l’éclairage de plus en plus défaillant, va vers ce qui retrouve faute de moyens techniques un halo d’invisibilité, ce qui retourne vers l’obscurité pour tenter d’y saisir un éclat de vérité – y chercher l’invisible sans jamais le trouver, cet invisible à quoi la littérature accède, parfois : « Je ne crée rien, écrivait Malcolm de Chazal. Simple greffier, je n’interprète pas, je décris. Je ne suis qu’un cinématographe de l’invisible »).
Je reprends. Sortir les personnages des rôles assignés pour mieux jouer du trouble considérable que nous éprouvons tous, aujourd’hui, dans les rapports entre les hommes et les femmes, ce n’est assurément pas nier ou gommer la D.S., comme Hélène Cixous nomme la Différence Sexuelle, c’est se risquer à l’interroger librement, au contraire, jusqu’au vertige, se risquer à la remettre en jeu, la rouvrir au jeu. Si l’écriture de La Villa du Jouir a été aussi jubilatoire, c’est précisément grâce à ce renversement (ou cette illusion de renversement… lecteur, auteur, l’important est d’y croire, non?) du carcan des stéréotypes dominants qui enferment autant les hommes que les femmes dans des rôles amoureux si prédéterminés qu’ils confinent à une absurde mécanique, reproduction mécanique de la mécanique de la reproduction, maman, quel émoi !…
Pour y atteindre, je savais bien que le roman devait aller crescendo. La rencontre amoureuse racontée aux premières pages n’est qu’épicée d’érotisme, respecte les codes, mais c’est elle qui précipite le narrateur dans une aventure de plus en plus radicale, une fois qu’il est invité à partager le quotidien de la Villa du Jouir, cet étrange phalanstère moderne – à moins qu’il ne s’agisse plus prosaïquement d’un bordel au centre d’enjeux politiques et économiques internationaux, on ne saura jamais, au bout du compte. Ce qui est sûr, c’est que la maîtresse des lieux est déterminée à tirer le meilleur des hommes qu’elle désire pour en jouir : à les libérer d’un idéal factice de la virilité et de leur stupide orgueil de mâle occidental (Stupide orgueil de mâle occidental ? voilà encore une citation détournée de Kerouac, tiens donc). Sur le chemin d’un échange véritable, peut-être, sur le chemin de l’amour, qui sait, puisque le narrateur s’est vu attribuer le beau nom d’Adonis dès son arrivée, promis à la jalousie des Dieux mais à une éternelle résurrection amoureuse. Le chemin de l’amour ? Sinon que La Villa du Jouir n’étant pas indemne du monde tel qu’il tourne, hélas, les liens d’argent que la princesse entretient avec les cercles de pouvoir ne pouvaient que faire un violent retour dans la dernière partie du roman. Quand l’économie et le politique s’invitent au pays des plaisirs amoureux, c’est tout une mécanique pornographique qui se dévoile à son tour.
Voilà pour le côté lucide, pour ce qui était pensé dans le temps de l’écriture. Mais une fois dit tout ce qui précède, ce n’est évidemment pas suffisant. Pour que le roman aille en ces dernières pages jusqu’au carnage, au sens propre du terme qui renvoie à la chair dévastée, pour que l’érotisme s’abîme dans des scènes qui pourraient aussi bien convoquer le Carlton livré aux amis de Strauss-Kahn que la villa d’Arcore aux pires heures du Berlusconisme, il a bien fallu qu’il y ait d’autres enjeux. Ce n’est qu’a posteriori, pourtant, que j’en ai pris conscience ; ce n’est qu’a posteriori que j’ai pris la mesure de la rage qui hante ce texte, qui aura hanté son mouvement d’écriture en tout cas. C’est d’autant plus curieux que la rage est une catégorie sur laquelle je travaille de longue date, dans mes interventions critiques ou théoriques. La rage, qu’il faut distinguer ici de la colère. La colère possède une adresse. Elle s’adresse ; on se met en colère contre, serait-ce contre Dieu, et c’est bien ce qui fait de certains écrivains catholiques de grands écrivains de la colère. La rage est un état bien plus nu : il n’y a plus de dieu qui tienne, l’enragé n’a pas d’adresse, il y perd même toute forme d‘adresse, tout entier son cri et la caisse étanche où résonne ce cri. Écrire, alors, c’est aussi déchirer la camisole de mots, de phrases, d’idées dont on se couvre, au quotidien des jours tramés de lieux communs. Déchiqueter pour exprimer enfin plutôt que d’étouffer sur pied. Je fais mienne, résolument, avec la pointe de mauvaise foi qui implique d’oublier que la plupart des traductions françaises recourt au mot «colère» à la première ligne de l’Iliade, je fais mienne la sentence de Philip Roth, lorsqu’il note qu’au commencement de la littérature, en français comme en anglais, c’est le même mot que l’on retrouve – « chante la rage, déesse, du fils de Pélée, Achille… », à la source, la rage, oui, une rage grecque, évidemment, une rage antéhistorique qui hante notre histoire.
La rage face à la perte, au désenchantement. Tout part d’une scène fantasmée que j’ai dit une revenante, tout part de l’inouï souvenir d’un enchantement érotique du monde qui n’est plus qu’un souvenir, à l’heure où j’écris. Pas de hasard, si le livre s’écrit dans l’après. « Écrire », dit le texte, « écrire est ma dernière chance, peut-être, je veux le croire, y croire encore, écrire pour revivre l’histoire à défaut de la vivre toujours ». Façon Casanova vivant deux fois, dans la vie d’abord, dans le texte ensuite ?

La rage et la perte. La perte d’une illusion, peut-être, qu’importe : quand le verbe, vecteur d’amour, quand le verbe s’assèche, quand l’univers déchante, quand l’on sombre dans une mélancolie impuissante face à la finitude, éprouvant le sentiment irrationnel et pourtant si réel d’avoir la mort aux trousses – ce sentiment qui vous interdit de vous retourner, marchant dans la rue, de peur de vous rendre compte que derrière vous tout est mort, tout est mort sur vos pas, et les fleurs fanées, les feuilles tombées -, c’est alors, peut-être, que le réflexe vital entraîne à l’écriture que l’on dit érotique, ou transgressive, ou ce que l’on voudra. Arracher le verbe à la communication ordinaire où tout l’enferme, quitte à déchiqueter ses atours.
Et si l’érotisme visant à la transgression (pour l’auteur d’abord) était, au fond, une forme d’élégance du désespoir de ceux qui croient ou veulent encore croire à la puissance du verbe ? Ça ne vous fait rien, la littérature ? Ça ne vous fait rien, ce que j’écris ? Vraiment ? Et là ? Non plus ? Et si j’accouple ce mot très cru et celui-ci très habillé, et si de cette union de deux mots je génère cette phrase – si donc j’écris … ça… Ça ne vous altère pas, ça, ça ne vous fait toujours rien, vous ne voyez toujours que des mots sur une page comme des insectes morts, vraiment ?
Il faudrait encore parler du contexte, platitude contemporaine, critique sans boussole… Du sentiment d’asphyxie économique, aussi. Mais, pour pasticher Aragon, il n’est pas venu, le temps que je m’explique au sujet de ce qui restera donc le secret de ce texte, un secret que moi seul peut y voir – que je dise simplement qu’il s’est construit aussi comme une métaphore, ce texte, une métaphore filée du début à la fin et dont j’avais parfaitement conscience mais qui m’importait peu dans le temps de l’écriture, une métaphore que je crois idoine, celle d’une toute autre histoire, une histoire éditoriale, quand les histoires d’édition sont toujours des histoires d’amour, elles aussi, quand il n’est pas étonnant que les plus passionnelles soient condamnées à finir en carnage, dans notre bel aujourd’hui.
Texte © Bertrand Leclair – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
