Ce texte critique sur Martin Heidegger n’apprendra rien de bien nouveau à ceux qui suivent l’actualité heideggerienne de ces dernières années. J’aurais envie de dire qu’il s’adresse en priorité aux lecteurs que le jargon philosophique de Heidegger rebute au point que ses livres « leur tombent des mains », mais également, à ceux qui s’interdisent de lire Heidegger pour les raisons « politiques » que l’on sait. Ceci pour conforter le choix en l’occurrence des uns et des autres, en l’étayant et contribuer à mieux expliciter l’une et l’autre de ces formes de rejet. Cependant, je n’exclus pas que ce texte critique sur Heidegger puisse, comme la lettre enfermée dans une bouteille jetée à la mer, trouver un destinataire à qui cette missive n’était a priori pas destinée. Les cartes étant en ce début de 21e siècle redistribuées, ces lecteurs improbables y trouveront peut-être de quoi reconsidérer, maintenant, le jeu qui se présente à eux avec d’autres yeux, pour reconnaître finalement que, auparavant, les cartes avaient été truquées.
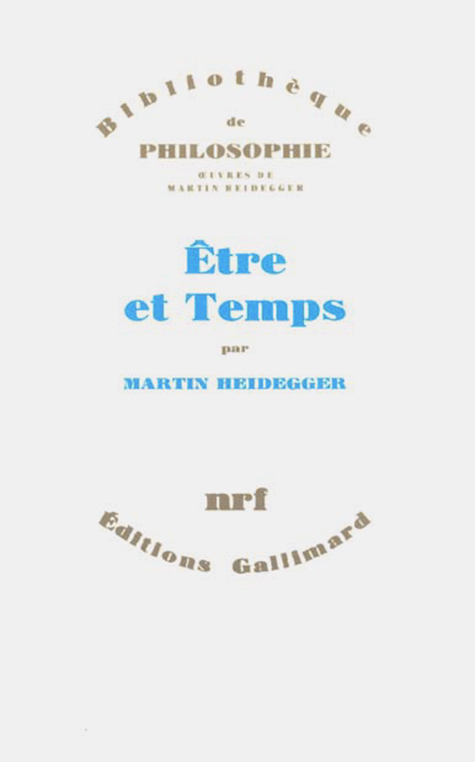
Quoi qu’il en soit, il importe dans ce genre d’exercice, qui s’apparenterait ici au travail du monteur au cinéma, de bien choisir l’ordre des séquences au travers desquelles s’organise le film Heidegger, celui d’une imposture intellectuelle et philosophique sans équivalent au 20e siècle (l’imposture n’étant pas uniquement imputable à l’auteur de Être et temps, mais aussi, aux heideggeriens de toute obédience). Heidegger fut incontestablement un nazi et cette qualité perdura bien au-delà de la période dite « du rectorat ». La faction heideggerienne minimisait encore récemment l’antisémitisme du Maître quand elle ne le récusait pas. Depuis la parution des Cahiers noirs, il n’est plus possible d’émettre le moindre doute. À la question de savoir si Heidegger, malgré tout, reste le « grand philosophe » que d’aucuns prétendent, ce texte s’évertuera à répondre de manière oblique, sans se laisser entraîner sur le terrain de la pure spéculation philosophique. Cela pour des raisons liées à la réception du corpus heideggerien, très problématique comme on le verra. Mais, on peut d’ores et déjà affirmer pour résumer en une phrase tout ce qui suivra que, une pensée qui s’est identifiée en grande partie avec ce qu’il y a eu de pire au 20e siècle, ne peut en aucun cas avoir la « grandeur » que le ban et l’arrière ban des heideggeriens persistent à lui prêter.
Sans doute, pour aller dans ce sens, faut-il préalablement faire une distinction entre la place prise par la philosophie de Heidegger depuis un demi siècle, les enjeux qui y sont liés – principalement en France – et une pensée qui, les moeurs ici s’améliorant, perd progressivement de sa superbe devant les assauts critiques d’une nouvelle génération de philosophes, de philologues et d’historiens. On peut raisonnablement penser que les fissures de l’édifice heideggerien vont s’accentuer dès lors que la honte, les détails de l’imposture dirais-je, se trouvent ainsi livrée à la publicité. À ce titre, il faut saluer tout d’abord les travaux d’Emmanuel Faye (Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie), et celui des contributeurs de l’ouvrage qu’il a ensuite dirigé (Heidegger, le sol, la communauté, la race), et plus particulièrement, Sidonie Kellerer, Robert Norton, Gaëtan Pegny, Julio Quesada et François Rastier. Signaler la parution (fin 2014) d’un instructif numéro de la revue Critique (Heidegger : la boîte noire des Cahiers). Et l’existence du blog Le PhiblogSophe2 (chroniques sur « Heidegger et le nazisme ») dont la consultation se révèle précieuse pour rechercher des documents de première main, parmi les très nombreux articles mis en ligne. Sans oublier, pour sortir de cette actualité, de mentionner deux ouvrages devenus « classiques », qui se complètent : Le Jargon de l’authenticité d’Adorno, et L’Ontologie politique de Martin Heidegger de Pierre Bourdieu. À cette liste, on peut joindre la biographie de Rüdiger Safranski, aujourd’hui dépassée, mais qui permet de se repérer dans la vie et l’oeuvre d’Heidegger. Safranski y relate « le véritable roman d’une pensée qui, jour après jour, se constitue en monument » (4e de couv.). Un monument qui se lézarde, ostensiblement : processus auquel cette contribution – la mienne – entend apporter quelques coups de pics supplémentaires. Y compris pour se livrer à un inventaire critique des différentes factions heideggeriennes, avec Philippe Lacoue-Labarthe en guest star.
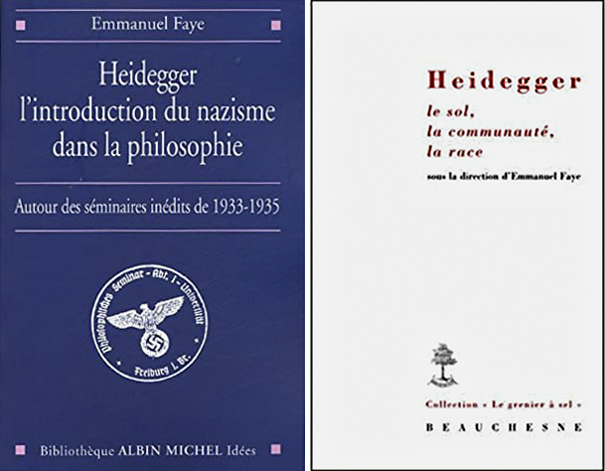
Un témoignage – se rapportant aux débuts de Martin Heidegger dans la philosophie – décrit, au lendemain de la guerre de 14-18, l’assistant d’Edmund Husserl comme « un homme de peu d’apparence, qu’on prendrait comme un électricien venu pour contrôler l’installation plutôt que pour un philosophe ». Une dizaine d’années plus tard, l’épouse d’Ernst Cassirer brosse un pittoresque portrait de Heidegger dont elle vient de faire la connaissance. La même expression, « homme de peu d’apparence », vient sous la plume de Toni Cassirer. Là, dans le salon bourgeois des Cassirer, le philosophe devenu célèbre depuis la parution de Être et temps, « entra dans la salle, intimidé comme un petit paysan qu’on aurait poussé par la porte du château », mais qui se révèle, dans le courant de la soirée, un redoutable débatteur. Toutefois, l’essentiel dans ce portrait est l’indication finale : « Pour moi, ce qui apparaissait le plus inquiétant, c’est son sérieux mortel et son manque total d’humour ».
La portraitiste note que Heidegger était habillé ce jour-là « d’un costume noir démodé », et non de « l’habit existentiel » dont se moquaient les étudiants. Il s’agissait d’un vêtement que le philosophe se faisait tailler à Marbourg, semblable à celui du peintre Otto Ubbelohde, lequel militait pour le retour aux costumes folkloriques. Ceci n’a rien d’anecdotique puisque, dès les années 20, la pensée de Heidegger s’enracine dans le sol allemand et oppose la simplicité du paysan, la ruralité, l’archaïsme et les valeurs du monde pré-industriel, « l’authenticité » donc (notion cardinale chez Heidegger) au déracinement, à la mobilité de la conscience émancipée, à la modernité, mais également, au citadin, à la figure de l’intellectuel sans attaches et sans racines, le Juif par conséquent (ceci et cela signant « l’inauthenticité » dans le langage heideggerien). Une opposition redoublée par celle mettant en présence le conservatisme (y compris à travers la « révolution conservatrice ») et les expressions démocratiques et socialistes.
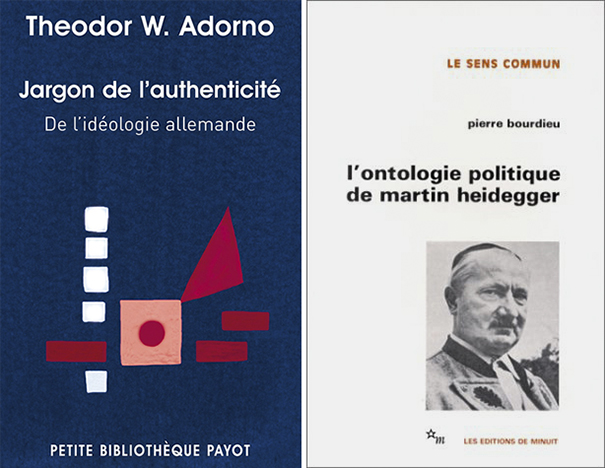
Encore faut-il, pour parfaire le tableau, se replacer dans le contexte de cette époque troublée, celle des dernières années de la République de Weimar. En mettant de côté la montée du nazisme et les phénomènes qui y concourent, l’ouvrage d’Oswald Spengler, L’Homme et la technique, paru en 1931 (moins connu que Le Déclin de l’Occident, mais plus significatif ici), évoque le climat intellectuel du début des années 30 en Allemagne en des termes qui font écho à l’idéologie du mouvement völkisch (terminologie encore utilisée par Heidegger à l’époque, à partir de 1933, il lui préfèrera celle de völkisch aux connotations plus raciales). La cité « totalement antinaturelle » y est condamnée en raison, par exemple, des divisions sociales « totalement artificielles », lesquelles développent et entraînent une survalorisation de la raison et de l’intellect, au détriment de « la vie de l’âme ». Contre ce modèle inspiré des « théories plébéiennes du rationalisme, du libéralisme et du socialisme », Spengler prône le « retour à la nature », « le droit naturel », la restauration des valeurs paysannes et du patriarcat. Signalons que dans ces milieux associés à la « révolution conservatrice », le concept d’aliénation prend un tout autre sens que ce qu’il signifie chez Marx puisque, il se rapporte au « déracinement » de ceux qui sont soumis aux diktats de l’intellect, du rationalisme et du matérialisme. La désialiénisation correspond ici à « l’enracinement » dans le sol natal et la communion avec la nature et le peuple. Heidegger reprend sur le plan philosophique cette distinction dans son inimitable style ontologique. Pierre Bourdieu remarque justement que « faire de l’aliénation ontologique le fondement de toute aliénation, c’est, si l’on peut dire, banaliser et déréaliser à la fois l’aliénation économique et le discours sur cette aliénation par un dépassement radical, mais fictif, de tout dépassement révolutionnaire ».

Les premiers témoignages de l’adhésion de Martin Heidegger aux idées et à la politique du NSDAP remontent à 1931. On peut encore admettre qu’il s’agit, à ce moment-là, d’opinions que Heidegger justifie devant ses interlocuteurs par son aversion pour la politique de la République de Weimar et la démocratie bourgeoise, et plus encore, par le danger d’une révolution communiste. Selon l’un de ses anciens étudiants, Heidegger ne comprenait « pas grand chose à la politique », mais se disait prêt à « accepter une dictature » qui ne craigne pas d’employer les grands moyens pour éviter « une dictature pire encore, celle du communisme ». L’année suivante Heidegger vote pour le NSDAP. Au début de l’année 1933, il se déclare publiquement en faveur du national-socialisme lors de l’accession d’Hitler au pouvoir : « Il faut s’engager », écrit-il à son ami Karl Jaspers. Ce dernier, lors d’une visite un mois plus tard, trouve « Heidegger transformé, métamorphosé, s’investissant totalement dans sa nouvelle mission ». À la question désabusée de Jaspers (« Comment un homme aussi inculte que Hitler pourrait-il gouverner l’Allemagne ? »), Heidegger répond par ces fortes paroles : « La culture ne compte pas […]. Regardez donc ses admirables mains ! ».
Texte © Max Vincent – Illustrations © DR
L’Imposture Heidegger est une série sur le mensonge philosophique en 13 épisodes.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
