DAVID LESPIAU s’entretient avec JEAN-NOËL ORENGO à l’occasion de la publication de NOCTURNE (D-Fiction, 2012) :
1 – David, tu t’inscris tout entier dans le champ de la poésie. L’ensemble de tes livres est publié chez des éditeurs de poésie contemporaine comme L’Attente, Spectres Familiers, Héros-Limite, Les Petits matins, etc. Peux-tu simplement revenir sur tes débuts et cet engagement dans la poésie ? Quels étaient le contexte et les enjeux de la scène poétique à cette époque, la fin des années 90, la fin du XXe siècle en fait ?
J’ai commencé à publier en 1996, dans la Revue de Littérature Générale, publiée chez P.O.L ; ma vision de la poésie était parcellaire, et plus radicale qu’aujourd’hui. Les deux numéros de la RLG illustrent très fortement le débat d’alors, littéralité contre lyrisme, disons, et tentent en même temps de faire se rencontrer des régimes de discours et d’écriture très différents, de la littérature mais aussi de la sociologie, de la philosophie… , donnant la part belle au formalisme, aux expérimentations et aussi à une certaine forme d’humour, ou du moins à une dédramatisation du statut d’écrivain. Ce qui se met en place chez P.O.L à ce moment-là est assez excitant, et les livres d’Emmanuel Hocquard, Pierre Alferi, Olivier Cadiot, Anne Portugal, Jean-Jacques Viton, Pascalle Monnier… sont alors des chocs, et des sas d’entrée pour poursuivre l’exploration, aussi bien de la lecture que de l’écriture. Tout ça est vu depuis Bordeaux — où il y a une petite mythologie liée aux éditions Quffi & Fluk (Eric Audinet, Olivier Cadiot, Pascalle Monnier) ; je travaille avec Claude Chambard au Centre Régional des Lettres d’Aquitaine, croise Emmanuel Hocquard puis Juliette Valéry qui teste Format Américain sur nos imprimantes… —, puis de Lyon et de Grenoble où je circule, change de boulots, avec sous le bras, également, Une difficile expédition d’Eric Audinet chez Spectres, Le Grand incendie de Londres de Jacques Roubaud au Seuil, les livres superbes des éditions Fourbis — Spicer, Duncan, Esteban, Waldrop, Jabès… —, qui publient aussi la revue Fig. de Jean Daive… Ce sont les éléments que j’ai en main à ce moment-là. Il y a en d’autres que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas ; je pense aux revues Java ou Nioques par exemple, ou aux débuts d’Al Dante. Mais bon, ce que j’avais devant les yeux était déjà suffisant pour commencer… C’était une époque de découverte, mais pas plus passionnante qu’aujourd’hui — où le débat lyrisme/littéralité a fait long feu ; plus personne ne peut soutenir un lyrisme qui ne soit pas mixé avec des apports contemporains qui le tordent, le biaisent ou le saturent ; je pense par exemple à Dominique Fourcade, qui a inventé un lyrisme mutant, sidérant. C’est aussi un moment où la poésie contemporaine s’est rapprochée de l’art contemporain, dans son écriture, sa théorisation, ses protocoles… Un moment où l’on rencontre de plus en plus d’auteurs de poésie qui ont fait des études d’art, voire qui ont découvert l’écriture poétique dans ce cadre, d’une façon plus ou moins directe, ce qui change pas mal de choses.
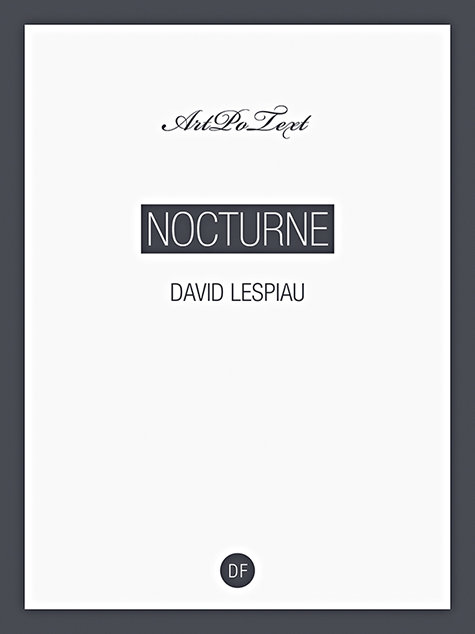
2 – Ton premier livre, Opération Lindbergh (Contrat maint, 2002) consiste en 80 décasyllabes, organisés en 8 dizains, 1 par page. On y distingue plusieurs traits de ton travail d’auteur que l’on retrouvera par la suite : la référence, parfois implicite, à des figures, des situations historiques ; la citation ; le mimétisme entre le référent choisi et l’écriture ; l’acceptation d’un langage qui crypte le réel… Peux-tu nous parler de ces différents paramètres qui caractérisent ton œuvre ?
Opération Lindbergh est le premier livre publié, mais son écriture est postérieure à L’Épreuve du Prussien (Le Bleu du ciel, 2003) ou à La Poursuite de Tom (Farrago/Léo Scheer, 2003). C’est une forme brève qui a mis beaucoup de temps à se cristalliser, à se boucler. Tout part d’une anecdote, le choix de Charles Lindbergh, durant la construction de son avion, de remplacer un siège confortable de pilote par une espèce de chaise en bois, de peur de s’endormir pendant la traversée au-dessus de l’océan. J’ai adoré cette idée, cette organisation concrète d’une intranquillité pour mener à bien un projet. Et je me suis mis à projeter des perceptions, des sensations liées à cette drôle de posture, à son espèce de solitude combative avec les moyens du bord. L’effort de Lindbergh de rester éveillé passe aussi par la voix, le monologue à voix haute relayant le discours intérieur. Et bien sûr tout cela en vol, en l’air — ce qui pour moi résonne avec la parole, avec le vers, et disons avec une forme de sens que permet la poésie. Lindbergh est par ailleurs une figure ambiguë, fasciné par l’armée allemande, pacifiste, puis engagé dans la guerre ; on a découvert récemment qu’il avait mené une double vie, avec femme et enfants en Allemagne… Il a réalisé une traversée en aveugle, il n’y avait pas de pare-brise, juste un périscope latéral. Autant d’éléments qui composaient un motif parfait, autour duquel s’est construit un texte très dense, à contraintes, et en même temps ludique, comme on tourne autour d’un nouveau jouet, d’une figurine, en se projetant totalement dans l’aventure qui peut s’articuler là, instantanément. Sans réel cryptage, comme vous le dites. Plutôt selon un réglage spécial, une distance, qui fait que l’aventure traitée n’est pas plus importante que le langage qui la traite, jusqu’à ce que les deux termes trouvent un équilibre, une forme d’échange.
3 – Ton deuxième livre, L’Épreuve du Prussien (Le Bleu du ciel, 2003), se présente comme une suite de versets savamment organisés : il y a une alternance de vers libres longs et d’alexandrins. Parle-nous de ce vis-à-vis particulier et original qui créé le rythme de ce livre.
L’Épreuve du Prussien est lié au temps d’une année, reconstituée, et à la dilution. L’alternance d’alexandrins et de vers de taille variable aménage une lecture triple : continue, alexandrin par alexandrin, ou vers non compté par vers non compté. C’est une tresse, ou une spirale double, qui pour moi mimait la mouvement d’un liquide tournant, le café dans une tasse par exemple, liquide tournant dans lequel une dilution aurait lieu, dilution de sucre en l’occurrence, ou dilution d’éléments biographiques dans du temps en rotation, fluide, telle que peut le vivre et le rejouer la mémoire. Avec des impulsions, liées au début de chaque vers ou à l’emploi de l’infinitif ; et des associations, des échos, des résonances, un mouvement d’ondes concentriques, que l’emploi des tirets organise. Au-delà des contraintes, qui étaient très utiles pour engager ce premier travail d’écriture poétique, l’alternance des décomptes correspondait ici, je crois, à la perception intuitive de certaines questions : comment et jusqu’où traiter un matériau ? Vers le contrôle absolu d’une forme, ou en maintenant des aspects bruts, non contrôlés, qui introduisent du déséquilibre, du hasard ? Le livre lui-même, dans ce jeu de tressage, parle de matériau et de protocole en mouvement, et de ce type de questionnement en perpétuelle reformulation.
4 – La structure de L’Épreuve du Prussien est décentrée : on s’aperçoit, après les deux premières pages, qu’il s’agissait de la partie 8. La véritable partie 1 commence page 26. Parle-nous de ce « non-réalisme » de la pagination et de cette volonté de créer des décalages.
Je ne vois pas comment un livre peut commencer, et je ne vois pas comment il peut finir, réellement ; je ne crois pas en ça. D’où ma méfiance pour la capitale du premier mot d’un livre, comme du point final de sa dernière phrase. Devant ce problème, j’ai au moins deux solutions, que je pratique parfois : écrire des fragments, eux-mêmes sans début et sans fin marqués, comme suspendus, mais qui intègrent de vraies phrases ; ou, comme ici, imaginer des objets cycliques, suspendus, en rotation. Tout le matériau de L’Épreuve est un journal tenu sur une année — le découpage est littéralement celui des mois —, mais une année type, qui peut donc recommencer ; dès lors, je voulais que l’on démarre cette année au milieu, c’est-à-dire n’importe où, embarqué dans du temps en révolution. Tout le livre traite du temps vécu par la pensée, de son comptage, des mouvements qu’il effectue, de son aspect liquide aussi, de sa prédisposition à la dilution et au changement. L’Épreuve parle d’un changement, opéré dans un cycle.

5 – Le référent premier de L’Épreuve du Prussien est le sucre. Le titre est expliqué en quatrième de couverture avec une citation d’un article tiré du journal Le Monde. Là encore, le travail sur le référent peut se lire comme une métalepse du fonctionnement de l’écriture. Comment se passe la fabrique – pour reprendre le lexique « pongien » de ce genre de texte ?
La fabrique est d’abord intuitive, puis elle est validée si le protocole utilisé fonctionne, ne faiblit pas dans le temps, ne s’épuise pas. Cette histoire démarre vers 1994, parce que ce motif me permet d’amalgamer des sensations d’enfance, des micro-récits de toutes époques, des lectures, toutes formes de représentation, en étudiant le lien étrange entre savoir et dévoration, incorporation, condensant des sensations physiques et mentales. Très vite se met en place le projet d’un livre en trois parties, dont chacune mimerait les trois états du sucre ; avec des choix formels précis, dans lesquels se répartiraient des éléments thématiques. Une première version a circulé chez des éditeurs, puis le livre n’a cessé de se poursuivre, de se diviser. De la poudre, un chapitre de la première version du livre, est publié dans la RLG en 1996. Comme son nom l’indique, il est lié à la dissémination, et donc essentiellement à l’espace et à l’ubiquité. Formellement, il s’agit de 12 poèmes de 12 vers, chaque vers comptant successivement de 1 à 12 pieds — soit une présentation en 12 tas, monticules, petites pyramides, sabliers… L’Épreuve du Prussien (2003), comme on vient de le voir, est lié essentiellement à la dilution, et donc au temps (son titre, ce nom donné à un broyeur qui s’achève en tamis, est un faux indice) ; ce livre marque le début du travail avec les éditions Le Bleu du ciel, avec lesquels ce projet va se poursuivre. Quatre morcellements ou l’affaire du volume restitué (2006) s’intéresse au volume, à la cristallisation, à la solidification, et aussi au plaisir, corporel ou textuel, mental. Formellement, il mime des faces d’un domino — un volume de 4 x 6 x 12 — que l’on tournerait entre les doigts, une fois dans le sens de la longueur, une fois dans le sens de la hauteur, soit une lecture en 8 faces, dont les dimensions (nombre de vers sur nombre de pieds dans chaque vers) varient selon cette combinatoire. J’adore cette forme. Le tout, recommencé quatre fois (quatre parties du livres, quatre expériences), est lié essentiellement à la lecture, et pioche chez Spicer, Stein, Faulkner, Burroughs, Broodthaers… ou Anne Morrow Lindbergh…, entre autres, et réalise des prélèvements, des compressions, des connexions à partir d’eux. Ce livre a été traduit en américain par Keith Waldrop, et publié chez Burning Deck en 2011. Enfin, un nouveau livre est en projet avec Le Bleu du ciel, qui reprend les principes de De la poudre mais les applique à des fragments de prose, des bribes d’aventures réelles et intellectuelles, liées au langage et au regard.
6 – On peut voir dans ce livre à la fois l’influence de Ponge, de Whitman et de la pratique du verset dans la poésie américaine du XXe siècle, le genre épique appliqué à des détails quotidiens liés à la vie domestique, au travail. Quels sont tes repères, ton arbre généalogique dans cette affaire ?
Il n’y a pas d’arbre. Cette généalogie, je ne cherche pas à la saisir — s’il y a vraiment quelque chose à saisir, au moins une branche — parce que je crains de figer quelque chose. Je suis un lecteur de Ponge, pas du tout de Whitman. L’Épreuve est un livre de formation, très ancré dans le quotidien, et sans doute un peu romantique ou micro-épique, très mental aussi. Avec beaucoup de contraintes d’écriture, mais aussi un protocole précis dans la façon dont tout le matériau de départ a été traité, littéralement brisé dans Word, mis en colonnes et réécrit horizontalement pour composer de nouvelles phrases. Comme dans La Poursuite de Tom, il y a la notion d’aventure qui est très importante, une aventure liée au savoir, à la façon dont on le construit et on le vit. Je ne crois pas qu’il y ait d’influence américaine ici. Quand est sorti La Poursuite de Tom, une amie allemande m’a dit que ce ne pouvait qu’être un livre écrit par un auteur français, ce qui m’a beaucoup vexé. C’est insupportable d’être ramené à une nationalité ; c’est le contraire de ce que doit produire la langue. Dans tous les cas, je ne suis pas à la bonne place pour dresser une carte, ou une généalogie…
7 – Avec La Mort dans l’eau l’âme download, 85 polaroïds de plage (Spectres Familiers, 2003), on assiste à la mise à jour d’une autre composante très importante de ton travail et que l’on voyait déjà dans tes premiers ouvrages, à savoir un très fort rapport à l’image. En l’occurrence, le livre consiste en une alternance d’un polaroïd et d’un bloc carré de huit octosyllabes qui se font face. Le lecteur peut à sa guise construire des correspondances entre les deux registres, lire séparément l’un et l’autre, etc. Là encore, l’écriture est mise en scène : c’est le procédé du polaroïd qui devient une contrainte d’écriture. Parle-nous aussi de ce rapport aux images photographiques et cinématographiques.
Tout part d’une fascination assez courante pour le polaroïd, son format, la formation de l’image devant les yeux en quelques secondes, etc., mais aussi pour les lunettes de vision en relief, verre bleu et verre rouge, leur côté kitsch. Avec encore une fois la joie de transposer des dimensions, le carré 8 x 8 de l’image, en une forme textuelle précise. L’aspect graphique est de même important, puisque chaque vers est justifié dans le carré de la mise en page, ce qui éloigne les mots les uns des autres, les sépare chacun en tant qu’élément actif d’une révélation qui sera celle du sens en formation, dans le vers puis dans le poème. La vision en relief est mimée par la stéréoscopie naturelle de la double page. Puis les choses se tordent encore par l’intégration de vraies images, issues d’une vidéo tournée parallèlement à l’écriture. Un élément sur deux, texte ou image, se répète — avec, pour le texte, de légères variations dans la ponctuation —, tout en permettant la lecture linéaire de l’ensemble. Le livre entier essaie de se débarrasser de la plage, du sable, du ciel, des moments de vacance (au singulier) liés à ce genre de chromos, à les compresser, à les réinventer. Est-ce qu’on peut télécharger tout ce fichier-là et le nettoyer ? La question serait celle-ci. Ce livre est liée à des images mentales, des souvenirs, et non à des images photographiques ou cinématographiques. Quant à l’intégration des captations vidéo, elles sont, au même titre que le texte, des transpositions de la magie polaroïd ou relief… Ici, tout est faux ; mais je tente d’atteindre avec ces procédés des formes d’écart qui soient, quant à elles, d’une certaine façon, justes… Pour vous répondre, et ceci concerne plutôt d’autres livres, le cinéma serait pour moi une réserve privilégiée de récits ; et la photographie, ou le photogramme, une table de travail.
8 – Ta poésie part souvent d’un phénomène moderne mais que le temps présent a rendu quasi « archéologique », comme le vol à hélice, la fabrique de sucre dans de petites manufactures, le Polaroid, la production artisanale d’électricité… Plutôt que les mythologies d’aujourd’hui chères à Barthes, il y a comme une esthétique « vintage » dans ton travail, une nostalgie qui se manifeste dans ces figures du passé moderniste, qui symbolisaient à l’époque le progrès.
Oui, parce que la dimension technologique est alors lissée, distanciée, par le temps, l’évolution des pratiques, des discours qui lui sont liés ; une fois les pratiques et les discours tombés, les techniques redeviennent seules, isolées, et elles réapparaissent pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire des formes relativement arbitraires, absolument étranges, un peu dérisoires. C’est là qu’elles deviennent les plus intéressantes, à mon sens. Ce n’est pas de la nostalgie, mais de l’intérêt pour l’enfance. Or les technologies ne grandissent pas, elles sont dépassées par d’autres, et stoppées. J’aime la photo de cet arrêt. À partir de cette solitude, de ce mutisme (ou de cette surdité ?), il devient possible de se réapproprier un discours et une pratique en décalage, et donc de refaire fonctionner la machine, différemment, directement dans la pensée personnelle, et de l’articuler à du langage neuf ; de la réarticuler.
9 – On l’a dit, beaucoup de tes textes réintroduisent le vers régulier, non rimé certes – quoiqu’il y a certaines rimes parfois, mais jamais tout au long d’un seul texte. Qu’en est-il pour toi de cette histoire-là, de ce rapport au vers, à la coupe, au passage à la ligne, à la régularité ?
Chaque livre est une expérimentation, une tentative de construire un texte qui fonctionne selon un régime poétique. Et à chaque livre le rôle du vers peut changer, occupant une place importante, ou réduite, ou inexistante. Je réfléchis davantage au livre qu’au vers ; c’est plutôt le livre mon unité de travail…, davantage que le poème ou la page, d’ailleurs. Dans mes premiers livres, la métrique occupe une place importante. Le nombre de pieds et le nombre de vers sont comptés pour Opération Lindbergh, L’Épreuve, La Mort dans l’eau, Quatre morcellements… selon des agencements simples, composant des figures (faces de dominos, carré, polaroïd), alternant parfois avec des vers ou des fragments non comptés (L’Épreuve, Ouija Board). Le décompte est un outil de composition et de contrôle, c’est aussi simple que ça ; compter empêche de faire des choix spontanés, et tord l’ensemble vers des solutions nouvelles. Et, comme dans toute écriture à contrainte, il y a un moment où, après avoir tordu l’ensemble dans tous les sens, une solution se dégage, résolvant le problème de façon presque magique, dans la grâce, comme s’il n’avait pas existé. La contrainte fond devant la forme qui l’a résolue et effacée en même temps. Mais beaucoup de mes livres ne répondent à aucune contrainte d’écriture, plutôt à des protocoles de travail, ou à une certaine vision d’un résultat poursuivi, à atteindre. Et, avec ou sans contrainte, le poème ne survit pas forcément au projet… Il y des cas où le travail d’écriture remonte littéralement du poème vers la prose… Des récits comme La Poursuite de Tom (Farrago/Léo Scheer, 2003) ou plus récemment Férié (Les Petits matins, 2010), ont démarré par de l’écriture versifiée, le choix de recomposer des phrases intervenant plus ou mois tard, à un moment où, de fait, tout le projet bascule. Et il y a des cas où l’écriture du poème se confirme, se solidifie, même dans des versions relativement libres, sans décompte particulier… mais souvent avec une règle de composition plus ou moins respectée : notamment la tentative d’écrire des segments qui fonctionnent à la fois seul, en tant que vers, mais aussi comme complément du segment précédent, et comme déclencheur du segment suivant… Dans ce dernier cas, le sens varie à chaque ligne, et certains mots changent de nature grammaticale au fur et à mesure de la lecture ; ce qui finit par entraîner une espèce de scintillement de l’ensemble, ce que permet le poème. D’une façon générale, je n’aime pas la polysémie, qui est une espèce de carrefour peu intéressant ; j’aime l’ambiguïté, c’est-à-dire le moment où l’esprit prend plusieurs directions en même temps, et tient quelques secondes ainsi, suspendu entre des contraires, les fusionnant. C’est là que l’on touche quelque chose de neuf, dans l’appréhension d’un sens… Mais il y a d’autres façons de travailler, hors de ce type de composition, qui ne vont pas vers la complexité, la densité, l’ambiguïté, mais plutôt vers la simplicité et le dénuement ; le dénuement littéral, qui va faire réapparaître les mots, non pas dans un réseau de sens, mais au contraire en deçà de ce réseau… Et puis on se rend compte que les deux directions ne sont pas contradictoires, et qu’un même mouvement peut se définir, en quelque sorte, par des polarisations mouvantes vis-à-vis de l’un ou de l’autre de ces aspects… Je vais vers ça, je crois.

10 – Dans Réduction de la révolution la nuit (Contrat maint, 2005), il y a une référence à La Révolution, la nuit lancée en 1946 par Yves Bonnefoy qui se voulait une tribune d’engagement poétique clandestine se réclamant du surréalisme et fustigeant par toutes sortes d’insultes assez âpres les tenants du nouvel ordre esthétique (alors l’Existentialisme) dont il n’aurait alors résulté aux yeux de Bonnefoy et de ses amis que « pourriture » et « désespoir grégaire » – entre autres. Quel est le sens de cette référence dans ton travail ?
Non non, aucun. Réduction de la révolution la nuit est un travail à partir des Œuvres cinématographiques complètes de Guy Debord (Champ Libre, 1978 ; rééd. Gallimard, 1994) —, un grand cut-up où, comme je l’écris en dernière page, sont « écartées les séquences documentaires ou de fiction traitant de la conquête de l’Ouest, la guerre de Sécession, la révolution russe, la seconde guerre mondiale, la guerre d’Algérie, la guerre du Vietnam, mai 1968, les émeutes de Watts, diverses personnalités politiques, des membres de l’Internationale Situationniste, l’action policière et militaire en général, l’action terroriste, une grande partie du monde du travail, ainsi que les dialogues, les cartons insérés et l’intégralité de la voix off de quatre films (…) » : Sur la passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, Critique de la Séparation, La Société du Spectacle, et In girum imus nocte et consumimur igni… Comme son nom ne l’indique pas, Œuvres cinématographiques complètes, 1952-1978 est d’abord un livre. Un livre où des lignes de textes sous-titrent d’autres lignes de textes. Les premières, en petit s caractères italiques, décrivent les scènes filmées ; les secondes retranscrivent le discours donné en voix off. C’est dire que les images sous-titrent la voix. Il y a autre chose : ces descriptions ne sont pas seulement factuelles, mais écrites, ce qui déclenche la projection. C’est cette écriture que j’ai voulu étudier dans Réduction… Je suis fasciné par ce livre depuis longtemps. De la poudre lui volait déjà une ligne : « L’île Saint-Louis, au crépuscule »… Quand on supprime, d’un texte, tous les signifiés les plus forts, ceux qui produisent immédiatement un contexte — social, historique, politique, géographique… -, on se retrouve avec des phrases simples qui rappellent l’apprentissage de la lecture ou de l’écriture. Du texte seul, de la grammaire, de la syntaxe, etc. On peut aller encore plus loin dans cette réduction, supprimer noms communs et verbes par exemple… Mais cette étape est déjà très lumineuse. Un sens clair y est préservé, et tous les éléments semblent jouer — au sens mécanique du terme -, c’est-à-dire bénéficier d’une marge, d’une place, d’une réserve… et donc d’une survisibilité en tant que simple mot… qui devient dès lors une zone d’intervention possible. Dans toute l’œuvre de Debord, la bascule est permanente entre deux types de sens du mot « révolution », prolétarienne ou terrestre, disons. Je renvoie ici à l’article écrit pour le dossier de CCP n° 9 (Farrago/cipM, 2005), entièrement consacré à cette question — où l’une de mes figures fétiches réapparaît, d’ailleurs, soit « l’avion tournant autour de la planète, ancien générique des films de la Universal, contre l’avion de l’aventurier, solitaire, suspendu dans de nouveaux réseaux de sens qu’il explore ». Voir l’ouverture de Monsieur Arkadin (Orson Welles, 1955), où un tel avion contraire est barré de la mention « Cervantes films » ! Pour le plaisir, je recopie la phrase clé de All the King’s men (Internationale Situationniste n° 8, 1963) : « Qu’est-ce que la poésie, si ce n’est le moment révolutionnaire du langage, non séparable en tant que tel de moments révolutionnaires de l’histoire, et de l’histoire de la vie personnelle ? »
11 – Dans Supplément Celmins (Little Single, 2008), tu travailles tes séquences à partir des œuvres de Vija Celmins, artiste américaine liée au courant hyperréaliste, dont les pièces orchestrent des variations infinies en noir en blanc autour d’images stellaires, de toiles d’araignées, de vagues, de nuages. À travers ce livre, peux-tu aussi nous décrire plus généralement ton rapport aux arts plastiques ? Ton travail rejoint d’ailleurs un peu celui de Vija Celmins, tu procèdes souvent par variation autour d’un thème, repris et amplifié.
Avec Supplément Celmins, je me rends compte que le travail sur les images matérielles accélère mon écriture. C’est une surprise. J’avais commencé à saisir quelque chose comme ça avec La Poule est un oiseau autodidacte (L’Attente, 2005) où une simple image mentale, dérisoire et assez drôle (pour moi) m’avait permis de collecter un ensemble de notations quasi-immédiates, je veux dire immédiatement formulées, alors que je sortais d’un travail de commentaire qui m’avait épuisé. C’était une échappatoire, et cela fonctionnait. Les choses se sont ensuite précisées avec l’écriture de Quatre morcellements ou l’affaire du volume restitué, où des morceaux de sections dérivent de catalogues de Broodthaers, de Jean-Pierre Bertrand… À chaque fois, l’écriture procédait d’un plaisir ressenti devant un livre contenant des œuvres plastiques, plaisir qui agissait comme un accélérateur dans la collecte des mots ou d’énoncés, à travailler ensuite. J’ai découvert par hasard le travail de Vija Celmins (catalogue Dessins/Drawings, Centre Pompidou, 2006), et Supplément s’est écrit très vite… Chaque page appelait du texte. Certaines images entraînent par réaction des formulations assez complexes, qui ne sont ni des descriptions, ni des commentaires, mais une sorte de rapt : rapt des mots liés aux matériaux, aux scènes représentées, aux mots eux-mêmes utilisés, aux réactions émotionnelles, mémorielles, associatives ressenties devant l’œuvre plastique, la page, le livre. Ce sont des rapts de segments, de fragments, de bouts d’énoncés, qui renferment le plaisir et l’énergie de l’opération. Ensuite commence le travail pour articuler ça, gommer, ajouter, agencer… Pour Celmins, comptaient effectivement ces variations sur le motif, ces représentations figuratives limites (océan, espace intersidéral…) et réalistes, au crayon et à la gomme ; mais les légendes étaient aussi très intéressantes, et le catalogue lui-même fonctionnait parfaitement, dans sa sobriété, pour un déploiement de la fiction. J’ai suivi ce type de protocole avec d’autres supports, notamment les photographies d’Emilio Araúxo pour les livres publiés par Amastra-N-Gallar (Scan de felo, 2008 ; Peliqueiros, prose, 2009)… Et avait déjà commencé, depuis 2006, le chantier d’Aluminium (Argol, 2012), où je cherchais à transposer l’énergie et le plaisir ressentis devant les œuvres de Rauschenberg — en abyme, puisque ces œuvres elles-mêmes sont des réagencements de matériaux divers, des recompositions à part entière, dans la couleur, et miroitantes…
12 – Dans La Fille du département Fiction (L’Attente, 2007), tu utilises la forme du carnet. C’est à la fois un journal d’écriture du livre, une suite de notations sur un quotidien en transformation, en gestation. Il y est d’ailleurs question de naissance, de maternité à la fin de l’ouvrage. La quatrième de couverture donne un quasi mode d’emploi du livre : il s’agit d’un retour au récit, après La Poursuite de Tom (Farrago/Léo Scheer, 2003). Le personnage principal, c’est un peu la parataxe…
J’ai une affection particulière pour La Fille du département Fiction. C’est un récit qui prend la forme d’un journal, retrouvé, d’une jeune femme. Et c’est un livre sur le pressentiment, sur la prescience, puisque effectivement, ces notes, qui pourraient ressemblaient à celles d’un journal intime, mais toujours assez mentales, intellectuelles, et peu anecdotiques, annoncent la transformation du réel en même temps qu’elles le réalisent. La transformation d’une vie. Le protocole est formidable parce que je peux écrire des notes, qui ressemblent à des fragments biographiques, mais qui sont tout près du statut de vers, des fragments à haute dose de densité et d’autonomisation, et qui de plus peuvent commenter ce travail de transformation. On est dans une fiction, pas dans un poème, mais son écriture avance vers la poésie, comme on avance vers un réel décillé, tout en commentant ce mouvement. La Fille du département Fiction a quasiment été écrit en même temps que La Poursuite de Tom, parallèlement et aussi un peu en réaction. C’est parce que je m’escrimais sur une trame que je voulais classique pour La Poursuite…, un récit d’aventure en prose, avec des chapitres, que La Fille… s’est fabriquée ainsi, avec beaucoup de plaisir, sur une forme fragmentaire, irrégulière, mimant l’improvisation. C’est un livre entier qui s’interroge sur le vers. Qu’est-ce que qu’un vers aujourd’hui ? À partir de quel moment une notation, ou un énoncé (pour reprendre un terme d’Emmanuel Hocquard), ou disons un segment d’articulation syntaxique et sémantique, peut-il devenir une forme de l’ordre de l’autonomisation, de la suspension, de la résonance ? Qu’est-ce qui permet ça ? Et faut-il chercher la réponse à chaque ligne ? Ou est-ce le livre qui, rétrospectivement, redéfinit certaines lignes en tant que vers ?
13 – Ouija Board (Héros-Limite, 2009) se passe à New-York. On y voit une suite de notules, chacune en trois langues : française, américaine (par Cole Swensen), allemande (par Cosima Weiter). Quel était ton projet avec ce livre trilingue ?
Ouija Board est une rencontre, un tissage complexe entre deux ensembles. Je travaillais au départ sur un poème alternant des vers de cinq et sept pieds, qui cherchait à saisir la structure d’un récit absent, hors champ – une aventure dont la tonalité devait être celle d’un polar. Un extrait était paru dans If n° 14 (1999). Mais l’ensemble posait problème, et j’avais finalement décidé d’utiliser une partie de ce texte pour en faire quelque chose d’autre (le solde de ce matériau devait par la suite dériver jusqu’au récit de Férié). Une connexion s’est faite en 2000, une rencontre avec un livre de photographies, le Weegee’s New York, Photographs 1935-1960, chez Schirmer Art Books, édition de 1992, avec ses 335 photographies légendées en américain, allemand et français. J’ai commencé à prélever les légendes de chaque photographie, dans leur succession, de chapitre en chapitre (les titres des chapitres du Weegee deviendraient les titres de ce livre), et à les incorporer au poème existant… ce qui a semblé fonctionner tout de suite, mais nécessiter beaucoup de réglages… Le tout à pris plusieurs années, et a été publié en feuilleton dans la revue Issue de 2002 à 2004 (avec un « résumé des épisodes précédents » par Tom Raworth). Alain Berset, qui dirige Héros-Limite, aimait cette série, et la revue. Il m’a proposé de publier cet ensemble, mais en respectant l’idée du livre de photographies original, avec ces trois sous-titrages ; il a eu très vite l’idée des trois couleurs… Cole Swensen et Cosima Weiter ont fait chacune un travail de traduction formidable, en respectant les contraintes du décompte syllabique, quitte à ce que l’équivalent sémantique ne soit pas calé exactement ligne par ligne, mais puisse glisser et se rattraper d’une ligne sur l’autre… Nous avons d’ailleurs expérimenté la lecture publique à trois voix, à Genève, sur quelques chapitres, en décembre 2009 ; l’expérience était superbe. Weegee, c’est un surnom que ce photographe mythique de la Prohibition s’était donné, une contraction de « Ouija Board » qui est un appareil pour prédire l’avenir, composé d’une flèche mobile au centre d’un alphabet… Ouija Board redonne la place aux lettres — l’impression typographique en trois couleurs est magnifique — et aux mots, aux vers, pour un poème narratif qui intègre contraintes d’écriture, hasard et aventure, tissage des voix, glissé du sens et des énoncés, réflexion sur l’écrit et le photographique.

14 – La poésie américaine est une référence constante, pour toi comme pour une grande partie de la poésie française depuis les années 70. Emmanuel Hocquard avait défendu l’idée d’une poésie américaine en français, plus intéressante à lire parfois que la poésie américaine en langue originale. Tu as toi-même traduit des auteurs d’outre-atlantique (plusieurs traductions de ta part à L’Attente ou pour la revue If ou encore dans le cadre du cipM/Un bureau sur l’Atlantique). À quoi correspond aujourd’hui l’influence de la poésie américaine dans la poésie française ?
Oui, il faut rappeler le travail de passeur et de traducteur de Jacques Roubaud, de Claude Royet-Journoud, d’Emmanuel Hocquard … Les anthologies 21+1 (Delta, 1986), 49+1 (Royaumont, 1991), les publications de Royaumont puis de Créaphis, Juliette Valéry et la collection Format Américain, l’association Un bureau sur l’Atlantique, son travail avec Royaumont puis au cipM… ; les choses se poursuivent aujourd’hui, se déplacent… Voir le travail de Double change, les collections américaines de Corti, de Joca Seria, de l’Attente, de Nous, de Héros-Limite… Et tout le symétrique de cette affaire, comment la poésie française est traduite et circule aux États-Unis… Notamment grâce au travail hallucinant des éditions Burning Deck de Keith et Rosmarie Waldrop, ou plus récemment de Cole Swensen… Sans parler du rôle des revues en France et aux États-Unis… Le dialogue et les apports mutuels fonctionnent parce que, à mon sens, il y a un accord évident sur une base du travail, c’est-à-dire une perception commune sur un état de la poésie à un moment donné, et sur les directions de travail possibles, imaginables, pour avancer. En mettant la notion de littéralité au premier plan, certainement, mais pas uniquement ; une tendance à la saisie brute du réel, au témoignage concret, sans fermer la porte aux expérimentations formelles, ou à une complexité éventuelle du sens ; l’ensemble produisant une énergie très vive, non engluée de psychologie, très immédiate, très inventive… Mais il est difficile de répondre globalement. Pour moi, deux chocs de lecture ont été fondateurs (et effectivement, en français) : Billy The Kid, de Jack Spicer, chez Fourbis, traduit par Joseph Guglielmi (1990), et Sun, de Michael Palmer, chez P.O.L, traduit par Emmanuel Hocquard et Christine Michel (1996) ; ces deux livres sont foudroyants. Puis, très vite après, s’ajoutent les Waldrop chez Spectres familiers et Fourbis, Reznikoff chez P.O.L, Creeley chez Gallimard, Ashbery au Seuil… Maintenant, est-ce que cela a une influence sur mon écriture ? Je n’en suis pas sûr. La distance fait partie de l’affaire. Distance géographique évidente, et distance donnée par la traduction, oui, encore une fois. Je vis ici ; et je ne serai jamais capable de lire directement et parfaitement de la poésie américaine en langue originale. Je crois que la double distance accentue le plaisir, ou l’attention, ou la surprise. Toujours sur cette base miraculeusement commune. Et c’est aussi ce que je ressens quand j’essaie de traduire, laborieusement, de la poésie américaine. En repartant de zéro, et en remontant vers une version possible, satisfaisante, je veux dire étrangement possible à atteindre, malgré tout.
16 – Tu publies ton premier eBook chez D-Fiction : Nocturne. Peut-être pourrais-tu présenter cet ouvrage d’images sous-titrées ?
C’est un fantasme de film. Nocturne est un texte et un montage récents, à partir d’images qui ont été tournées il y a une dizaine d’années. Ce montage de quelques secondes est ensuite redécomposé en 260 images fixes, soit autant de plages pour l’écriture, mais d’une ligne chacune, imaginées comme autant de sous-titrages — le tout composant concrètement un immense ralentissement, puisque chaque image se met fonctionner comme une table d’observation, un lieu de déploiement de possible, que le texte va tenter de rejoindre, ou d’accompagner. On ne sait plus la durée de chaque image, qui devient le moment d’un film autre. Mais c’est ce que produit la lecture, toute lecture, qui définit sa propre durée… Le titre Nocturne est volé à Gabriele D’Annunzio, un récit autobiographique publié en 1916 qui parle de lésion oculaire, de station prolongée dans le noir, de fausses lueurs produites par des pressions sur la rétine. Jean-François Bory a traduit ce livre, me l’a fait connaître. Mais ce Nocturne-ci parle plutôt d’enfance, et du temps passé la nuit, les yeux grands ouverts, à scruter l’obscurité ; ou à se concentrer sur ce que l’on voit une fois les paupières fermées. Il rejoint ainsi, d’une façon très inattendue pour moi, tout le paysage mental décrit dans La Poursuite de Tom…
Entretien © David Lespiau & Jean-Noël Orengo – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum
(Gironde, mars 2012 – Marseille, avril-mai 2012)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.