Dans la mesure où l’argent compense uniformément toute la variété des choses, où il exprime toutes les différences qualitatives entre celles-ci par des différences quantitatives, dans la mesure où l’argent, avec son absence de couleur, son indifférence, se pose en dénominateur commun de toutes les valeurs, il opère le nivellement le plus terrible qui soit ; il mine irrémédiablement la substance des choses, leur valeur singulière, spécifique, leur originalité.
(Georg Simmel)
American Psycho
Les Effondrés (Actes Sud, 2010, rééd. Babel 2013), le récit de Mathieu Larnaudie, s’inscrit dans une tradition littéraire assez rare, celle qui investit le champ (si trivial aux yeux de nombreux lettrés) de la spéculation boursière, dans l’héritage du Zola de L’Argent (1891), du Frank Norris de The Pit (1903) ou du J.R. (1975) de William Gaddis. Il se présente comme la chronique méticuleuse de la crise financière qui a ébranlé le monde il y a un peu plus d’an. Le livre est découpé en 24 chapitres, chacun se focalisant sur des personnages réels ou fictifs ayant trait au monde de la finance ou à la crise ; ainsi, le lecteur reconnaîtra facilement, dans l’ordre d’apparition, des protagonistes aussi différents que Allan Greenspan (l’ex-patron de la Fed, nommé à la tête de cette institution par Ronald Reagan après le krach d’octobre 1987), le plumitif Alain Minc, Richard Fuld (le patron de Lehman Brothers), l’homme d’affaire allemand Adolf Merckle (qui se suicidera après la faillite d’une opération boursière), le banquier Edouard Stern (ou plutôt, “l’affaire Edouard Stern”), Marcel Ospel (Président du Conseil d’administration d’UBS, la plus grande banque de gestion de fortunes d’Europe), Bernard Madoff, le financier français Thierry de La Villehuchet (qui se suicidera lui aussi), mais aussi des personnalités politiques comme Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy ; les autres protagonistes (fictifs) font figure d’archétypes : un homme d’affaire français, qui confie sa biographie à un étudiant marxiste, des yuppies et des traders ; tous ces personnages ont participé à la faste et euphorique décennie 1990 qui s’est achevée sur les sommets boursiers de la “Nouvelle économie”. Chaque chapitre expose donc non seulement les rouages de la financiarisation de l’économie, explorant les fortunes et les faillites, les passions irrationnelles qu’elles suscitent (“greed and fear”), mais encore, sonde les subjectivités qui ont participé à la spéculation boursière, mettant en exergue leur dessaisissement face à l’irruption brutale de l’événement que fut cette crise, “pastiche de toutes les crises” – pour reprendre la formule de l’économiste américain Paul Krugman – que nous vivons depuis trente ans (le premier choc pétrolier, le krach de 1987, la crise asiatique des années 90, etc.). L’acte de naissance de cette nouvelle ère est clairement la date du 15 août 1971, lorsque Richard Nixon décida de passer du régime des changes fixes au régime des changes flottants, mettant fin à la parité du Dollar et de l’or, inaugurant un nouveau règne, celui des marchés financiers et de la dématérialisation de la valeur : si, quand une monnaie gagne de la valeur, elle s’apprécie, et dans le cas contraire, elle se déprécie, depuis 1971, la Banque centrale n’a plus de latitude pour maintenir le taux de change dans une fourchette autour de la parité de référence. Certes, même en système de changes flottants (conforme au monétarisme) il y a des accords du G.7 (Plaza, Louvre) pour réguler les taux de change, mais cette décision de Richard Nixon inaugure un nouveau cycle, celui de la sortie définitive de l’économie du champ politique, et c’est cette autonomie irrationnelle que met au jour le récit de Mathieu Larnaudie, auscultant à sa façon le devenir symbolique de la valeur, dans ses dimensions à la fois subjective et immatérielle : plus la monnaie se dématérialise (par les réseaux, notamment), plus l’adéquation entre les sujets et le monde se creuse ; comme l’écrit Jacques Wajnsztejn de la revue Temps Critiques, “l’inconvertibilité du dollar consacre l’absence de limite au développement du capital fictif qui n’a plus désormais de référent objectif. Le dollar flotte à la baisse ou à la hausse mais il domine. Dès lors, la monnaie américaine s’affirme comme valeur fictive et ne repose plus que sur la confiance et non pas sur les taux de profit.” L’on perçoit ainsi facilement en quoi la crise économique récente a pu susciter un ébranlement de l’appareil psychique ; de fait, conséquemment, la brutalité de l’effondrement des marchés est proportionnelle à la violence de l’effondrement des psychés ; c’est exactement à la jointure de ces deux mondes, sur cette ligne de crête que se déploie la phrase de Mathieu Larnaudie. L’extrême originalité de ce récit réside dans son exploration de la solidarité structurale entre le processus d’autonomisation de la valeur et sa subjectivation : au-delà du procès d’auto-valorisation de la valeur (son pôle objectif, sur lequel un collectif comme Krisis a porté ses investigations théoriques), chaque méandre de phrase des Effondrés appréhende le versant subjectif de la valeur, dans un temps où l’individu – du haut de sa fatuité – a (croit-il) tranché tous les liens qui l’unissaient à la communauté des hommes pour se perdre dans les arcanes de notre monde réticulaire. Le devenir-fictif du Capital évoqué par Temps critiques a entraîné depuis une quarantaine d’années une inflation des signes et des représentations : c’est la débâcle de cette fiction qu’a entraîné la crise économique et ce sont ses ruines que fouille le récit de Mathieu Larnaudie. À la titrisation de l’économie fait écho le nivellement des sujets blasés, ceux qui jouissent du “superadditum” (Simmel), tous englués dans la poix du quantitatif, et dont la réelle misère est exhibée à chaque chapitre.
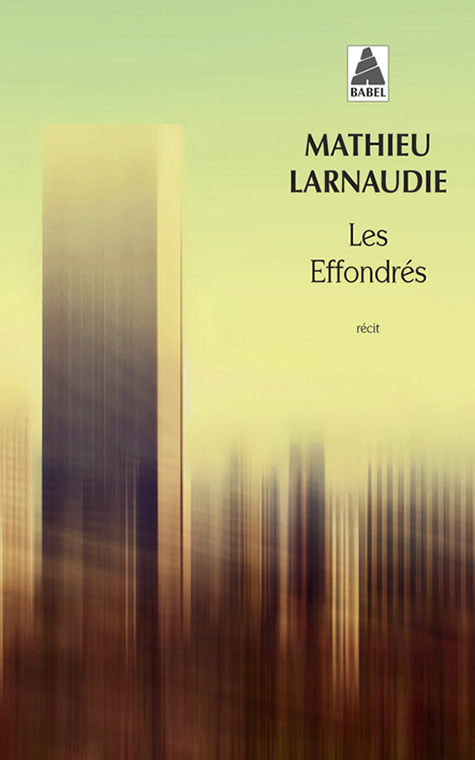
Barroco
L’écriture de Mathieu Larnaudie n’est pas sans rappeler un certain baroquisme, marquée par une certaine “outrance” stylistique : des phrases de trois pages, voire qui occupent un chapitre entier : le parallèle avec Proust est évident, ainsi que l’ont fait remarquer de nombreux observateurs ; comme dans la Recherche, c’est une phrase arachnéenne, qui se ramifie, tout en disjonctions et en adjonctions ; et l’on pourrait reprendre à notre compte les analyses de Spitzer à propos de Proust: les “éléments retardants” comme les parenthèses et les tirets, sont un procédé capital qui “rattache allusivement les faits entre eux, pour restituer la complexité des relations inhérentes à la vie réelle.” C’est exactement de cette façon que fonctionne Les Effondrés, dont la toile narrative dissémine au gré de micro-récits, en marge des moments et scènes édifiantes qui ont ponctué la crise financière, une série de détails fortement lestés sur le plan allégorique : ainsi, de cette montre de luxe (dont nous tairons la marque mais que chacun reconnaîtra), véritable punctum de la vulgarité de l’élite dominante, dont les aiguilles trottent sur trois chapitres, d’une publicité sur la quatrième de couverture du magazine Forbes au poignet de certain président ; comme le paléontologue qui reconstitue un dinosaure à partir d’un seul os, Mathieu Larnaudie embrasse l’événement à partir de presque riens significatifs, selon une syntaxe qui fonctionne par concaténation : le phrasé larnaudien, son rythme respiratoire, est à l’opposé de la période classique, harmonieuse et infaillible dans ses clausules ; tout dans son exubérance (la discontinuité syntaxique comme la préciosité lexicale) ressortit, il nous semble, à une forme inédite de baroquisme ; de fait, ces phrases-gigognes, risquant à chaque moment de perdre le lecteur, sans cesse menacé de dyspnée, énoncent à leur façon la difficulté d’enserrer un réel toujours plus évanescent, celui de notre monde où s’équivalent la frivolité de la forme-valeur et de la forme-signe ; à rebours de l’abstraction généralisée du capitalisme actionnarial, qui fait que tout se déréalise en chiffres, algorithmes et pixels, le récit de Mathieu Larnaudie redonne chair aux phénomènes dans une prose qui retisse le réel, étoilant dans ses rets les êtres et les choses, leur redonnant consistance ; il s’agit exactement de prendre le contre-pied d’une époque arrogante, vulgaire, saturée d’écrans et de petites phrases, et de lui opposer le Grand Style, ce phrasé fluide et luxuriant, à la lisibilité exigeante. Les Effondrés redonne son assise étymologique au mot “crise”, qui associe à la fois “décision” et “jugement” : Mathieu Larnaudie juge son époque, celle du présent perpétuel des consciences somnambules, d’un temps là encore spatialisé, et ses phrases labyrinthiques mettent au jour les apories et les impasses du capitalisme telles qu’elle se sont révélées lors du collapsus financier.
Wax Museum Song
Mathieu Larnaudie s’emploie lui enfin à recourir à la satire ; l’humour n’est jamais gratuit, mais orienté : que sont Les Effondrés, sinon une galerie de portraits à charge des hommes et des événements ? Ainsi, tel un Daumier des temps frivoles, Mathieu Larnaudie renoue avec l’art de la caricature d’un Alfred Grévin – caricaturiste et fondateur du Musée éponyme – lorsqu’il s’emploie à décrire la tête du Sénateur démocrate Henry Waxman (“l’homme de cire”) lors de l’audition au Congrès d’Allan Greenspan ; plus subtile encore, lorsque, se dispensant de nommer ses personnages, usant de périphrases ironiques pour les désigner, il suggère par de minutieuses descriptions physionomiques que chaque protagoniste est sa propre caricature, qui du play-boy viril “exerçant son put”, du trader “au front strié de mèches poivre et sel” ou du banquier “golden boy séducteur”. Mais la charge ne se limite pas aux hommes, ainsi c’est toute l’idéologie libérale conservatrice des Chicago Boys qui est fustigée, sa doxa mise à distance de façon récurrente par le pseudo correctif “ils disaient”/”ils diraient” (dynamitant le novlangue et sa prétention à énoncer le vrai), ses prophéties autoréalisatrices à leur tour passées au tamis impitoyable de l’antiphrase, de la rhétorique incantatoire et panglossiste de la “main invisible du marché” chère à Adam Smith à la liquidation postmoderne des grands récits, en passant par le délire de scientificité de l’utilité marginale et la grande farce de la gigantesque “Chaîne de Ponzi” élaborée par Madoff sur près de cinquante ans, donnant raison un siècle et demi après à un Marx d’outre-tombe : “L’or n’a pas, comme Peter Schlemihl, vendu son ombre, mais achète avec son ombre.” La satire, ici, met à nu la face subjective de la valeur, dans sa dimension passionnelle, sinon psychotique. L’effondrement est brutal lorsque le manteau du capital fictif se déchire : il n’y a de crise financière que fiduciaire. Sauf que le système monétaire mondial conçu comme un modèle exponentiel est parti en fumée et, comme la mer, le pétrole ou l’air que nous respirons, rien n’est inépuisable. Le marché est un sculpteur sans mains (invisibles) auquel il manque les doigts, et les hommes sont des petites choses, jouets prisonniers du marché manchot. D’où la charge virulente de Mathieu Larnaudie, lorsque les agents de la doxa libérale supplient l’État de les renflouer (le “cash for trash”, “l’argent pour les ordures” comme l’avait écrit Paul Krugman) : après l’effondrement, ce sont bien sûr les savetiers qui vont payer pour les financiers tout cousus d’or. Les Effondrés met le doigt sur le grotesque et l’indécence des situations.
La littérature réussit toujours là où l’économie politique a échoué, et c’est bien ce que prouve ce livre magistral : “Fumée le milliard, hors le temps d’y faire main basse : ou, le manque d’éblouissement voire d’intérêt accuse qu’élire un dieu n’est pas pour le confiner à l’ombre des coffres en fer et des poches. Aucune plainte de ma badauderie déçue par l’effacement de l’or dans les circonstances théâtrales de paraître aveuglant, clair, cynique: à part moi songeant que, sans doute, en raison du défaut de la monnaie à briller abstraitement, le don se produit, chez l’écrivain, d’amonceler la clarté radieuse avec des mots qu’il profère comme ceux de Vérité et de Beauté” (Stéphane Mallarmé, Divagations).
Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
