DENIS FERDINANDE s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de TOUTE LITTÉRATURE S’EFFONDRE (Atelier De L’agneau, 2010) ainsi que de LES FUSÉES DE C.B. (D-Fiction, 2013) :
1 – Denis, une première question d’ordre biographique : explique-nous ton parcours et ce qui t’a amené à écrire. Il semble que ton père, Guy Ferdinande, n’y soit pas pour rien… Peux-tu revenir notamment sur tes débuts et ton engagement dans la poésie ?
Avant toute chose, je vous remercie, de vous être penchés si justement sur mon travail. La tâche fut-elle si aisée que cela qu’en sais-je et qu’y puis-je, sinon le souhaiter ? Et puisqu’il faut commencer, que vous me faites commencer, l’un ou l’autre, au sujet de mon père évoqué d’emblée, je dirai l’évidence, la sorte d’évidence que mon « parcours de vie » eût sans doute été tout autre s’il avait lui-même [mon père] été tout autre. On peut parler ici d’écriture (je me rappelle ses incitations, alors régulières, à ce que je m’y attèle) mais aussi bien de musique – nous allions des années durant, en famille, de festivals en concerts de tous ordres -, ainsi que de peinture, de dessin, etc. Différentes voies constituant un bain qui aura été celui de l’enfance, d’une effervescence certaine, et que je ne cesse de prolonger, comme s’il n’était aucun autre parcours possible. Je veux dire aucun plus stimulant pour l’esprit. Et sans doute un rien périlleux, dès lors que l’on s’y engage de façon exclusive. Concernant l’écriture, divers recueils furent publiés alors, d’apprentissage, et tombés chacun, comme il se doit, aux oubliettes.

2 – Avant la publication de ton premier texte en ouvrage, Critères du cratère (L’Atelier de l’agneau, 2001), quelles étaient tes lectures, ton rapport à la langue, ton projet d’écriture ? À quelle « famille » d’écriture te rattachais-tu alors ? Tu publiais alors beaucoup en revue…
Plus d’une publication en revues en effet vit le jour, antérieure à la parution de ce texte. Et sans doute ne puis-je que mentionner ici la revue que j’animais dès dix-sept ans, au titre provisoire, Le Baron Samedi. Pour faire vite, la famille d’écriture en était encore mouvante et indécise, j’y publiais d’abord et avant tout mes amis (aujourd’hui réfugiés, pour trois d’entre eux, dans l’art contemporain je m’en réjouis) et les références en furent, de mémoire, Rabelais, Sade, Ducasse, Rimbaud, Mallarmé – place spéciale -, Corbière, Jarry. Quasiment le passage obligé. Le vingtième siècle n’apparut qu’ensuite, avec la découverte d’auteurs, pour ne m’en tenir qu’à la poésie, comme Francis Ponge, Henri Michaux, Maurice Roche, Pierre Garnier (non, je les vis tous deux lors des rencontres de Tarascon bien plus jeune, avec ma mère), Julien Blaine, organisateur desdites rencontres, Christian Prigent, Denis Roche, etc. Parallèlement, et je reviens ici à mes dix-sept ans, les cours à la faculté (dispensés par mon professeur, M. Fédi) autour de Walter Benjamin furent une découverte dont la portée n’agit tout à fait que plus tardivement. Encore que les cours en question cadraient de façon parfaite avec l’esprit de l’auteur. Rien de magistral, de dogmatique, de « volumentomineux » (Ponge), une entrée dans la philosophie (l’École de Francfort, notamment) par les bords, telle gravure de Granville circulant de table en table, Baudelaire, l’œuvre d’art, les passages parisiens, Blanqui, etc. Et puis ces titres, pas un qui n’ait sa résonance propre en accord avec le texte… Telle fut l’introduction à cet auteur vers lequel je me tourne de façon assez régulière, et dont il faudra par ailleurs que je rouvre le recueil de nouvelles [Rastelli raconte… et autres récits] qui constitue un autre versant, peut-être plus méconnu, de son œuvre.
3 – Ce premier texte, Critères du cratère, est publié au verso d’un livre qui comprend, au recto, un texte de Clémence Ferdinande, Manuel à l’usage des trompeurs de mort, texte qui t’est dédié comme le tien lui est dédié. Explique-nous la conception de cet ouvrage : le découpage spatial de l’écriture, la disposition spécifique des phrases et des mots sur la page, le jeu typographique, l’omission de lettres, de mots, etc. On est dans une quasi fabrique du texte. Ce livre ne doit-il pas être considéré finalement comme le document de « travail » de ta conception de la langue, la partition (la transcription sonore) même des lectures que tu effectues lors de performances publiques ?
La rétrospection est ici difficile, que sais-je encore de ce texte, Critères du cratère, pour ne parler que de ma partie ? Dois-je me relire ? Relire, même, l’autre partie afin de comprendre la mienne ? Se comprenaient-elles alors l’une l’autre il y eut partage en effet du livre je ne parlerai, si je le peux, si cela a un sens, que de ma partie. Laquelle éclairera peut-être ce faisant l’autre. Je n’en sais rien. La vérité est que ce livre sommeille en une caisse depuis des années, verrouillée à plus d’un tour depuis Noémie. Je peux certes faire comme si je rouvrais le livre, et commencer, de mémoire, par le commencement : une correspondance, ou plutôt un simulacre de correspondance, le destinataire y est pure fiction – qui répondra toutefois – et toute lettre, aux graphèmes épars comme effacés sous l’effet du temps. L’on ne se sait au juste ce qui s’échange. [Illisible ? Tel serait, soi-disant, le sort de tout ce qui se réclame de l’expérimental]. Ensuite, et je saute une séquence, telle autre titrée Amphorismes, je ne conserverais de ce livre — ou si l’on préfère de ma partie – qu’elle s’il le fallait, oubliant celles qui lui succèdent, et en laquelle s’effectue un éclatement textuel, d’une visée quasi « spatialiste » à laquelle il reste irréductible toutefois. Il fit en effet l’objet de nombreuses lectures en public ainsi que sur France Culture [émission de Mathieu Bénézet], toute dimension « sonore » ayant été travaillée à cette fin. Alors document de travail : oui en sorte de paradoxe, attendu qu’il me sera pour toujours comme impossible d’y retourner.
4 – L’exergue de Colette qui introduit le texte de Clémence Ferdinande est en lui-même très révélateur – nous pensons – de ta propre posture au monde : « Une seule fois dans ma vie j’ai sollicité un poste, on me l’a refusé ». Peux-tu revenir pour nous sur ton rapport à la société et au travail et, finalement, à cette décision de te consacrer uniquement à l’écriture ? Quel est ton mode de vie, ton rapport à l’argent depuis cette décision ? Quel genre de vie s’organise là de nos jours ?
Je modifierai légèrement la formule de Colette. Une seule fois dans ma vie j’obtins un poste, la boutique au final brûla. Étrange tour du sort, que je décryptai aussitôt de la sorte, comme s’il y allait d’un fatum : ce que l’on appelle « le travail » m’est d’un accès barré, que j’en prenne acte. La chance m’est donnée de n’avoir à charge que ce qui importe [résumable en la formule] toute activité créatrice (que je ne distingue pas en outre de son autre nom même de travail). La question de l’argent se pose sans doute, n’est-elle pas le contredon du temps qui se perd, donné mais à qui au juste ? Pauvreté dès lors ? Ce sera toujours elle ou compter, de fait, parmi la liste des écrivains-du-dimanche, que je respecte bien sûr, non d’ailleurs que de telle situation ne puissent survenir de très bons textes. Mais voilà. J’essaie de constituer une sorte d’œuvre, l’époque n’y est plus, presque, mais j’insiste, tandis que quantité d’autres se désistent, avec la société broyeuse (cf. Henri Meschonnic : « Les religions sont des broyeuses »). Je peux sans doute échouer, s’il est un sens de l’échec tant qu’il y a possibilité d’écrire, et il me faut écrire, plusieurs heures, chaque jour, telle est la tâche inoubliable que je m’assigne, faisant de surcroît chaque jour comme s’il y avait eu relâchement la veille, afin de redoubler de vigilance ainsi que d’exigence dans le présent jour. Exactement comme s’il importait, comme s’il importait plus que tout, de ne pas escroquer mon lecteur (il en aura pour son argent).
5 – Avec théoriRe, actes (L’Atelier de l’agneau, 2006) – soit cinq ans plus tard – nous trouvons un livre qui, au contraire du premier, offre une structure plus achevée – plus fonctionnelle également, dans la lecture qu’elle induit -, plus construite aussi. La mise en page est enrichie d’ajouts graphiques, elle invite précisément à « lire » par nous-mêmes la prose que l’on y découvre. L’ouvrage est accompagné d’un DVD du film que tu as réalisé avec Philippe Bouillet, Dolly ou les oies sauvages. Que s’est-il passé durant ces cinq années ? Pourquoi ce film ? Qu’est-ce qui t’en a donné l’idée ? Pourquoi avoir sous-titré également ce livre (essai)… L’écriture expérimentale et poétique est-elle pour toi davantage de l’essai que de la fiction ?
J’ouvre ce livre, un instant, ayant en cet instant parcouru en diagonale ses pages, et tout semble graduellement me revenir. Tels appels qui survinrent, antérieurs à toute écriture, de la part de plus d’un auteur / professeur, à l’attention des jeunes auteurs, afin que nous ayons pour préoccupation, parallèlement à tout « faire » littéraire ou poétique, sa réflexion critique, voire sa théorisation. Étais-je alors en retard ? Ayant fait une entrée déjà dans Barthes, Robbe-Grillet, Ricardou et quelques autres. Non sans une réserve toutefois, y observant qu’en fût chaque fois exempt quelque chose comme le rire — nom ici de l’ébranlement formel. Y voyais-je la marque d’une littérature laissée à ses seuls professeurs ? La sorte de prérequis semblait en être : l’on peut rire et tout renverser en littérature, la théorie, elle, restera indemne fût-elle contrée en interne, à l’occasion. Comme s’il y allait d’un intouchable. J’y touchai aussitôt engageant ce livre (au sous-titre, oui, d’« essai », qui peut s’entendre au sens littéral de tentative). La forme en serait des plus libres, fragmentaire, contenant rayures et astérisques ne menant nulle part, ruptures brusques de texte, trous, simulacres de cartes postales, croquis, plans, lancées lyriques, marges noircies décernées au lecteur, jeux typographiques de tous ordres, datations et heures impossibles, et ainsi de suite. Puis une coïncidence. Je faisais, parallèlement à l’écriture, de petits films en super 8, et parlai à mon ami Philippe Bouillet, réalisateur déjà de plus d’un film dans le Languedoc-Roussillon, de mon souhait de faire un film (comment dire, moins confidentiel). Souhait qui était alors également le sien, nous le réaliserions donc ensemble. Il aurait pour centre l’écriture, ce texte même, théoriRe, actes. Je précise ici qu’il était inachevé encore, ce qui facilita certaines interactions entre film et livre, impossibles dans le cas d’un texte achevé déjà (le livre parle du film qui parle du livre. Mais pas seulement). L’aventure fut assez folle.
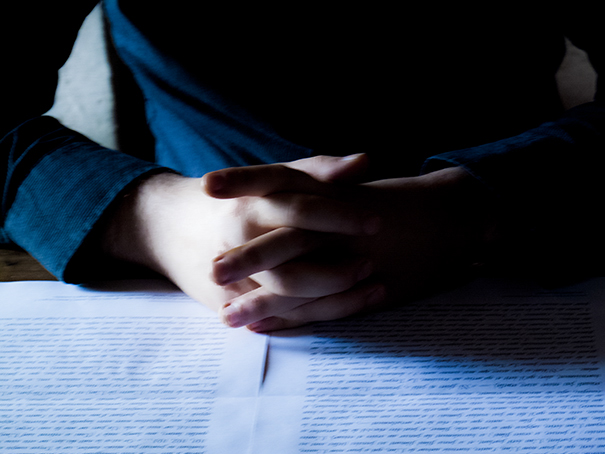
6 – La première phrase du livre, « Impossible, le premier mot est impossible », est en elle-même tout un programme et un écho au Ponge de Fable – « Par le mot par commence donc ce texte » – et Bataille – « L’impossible, c’est la littérature ». Quel est ton rapport à cette mécanique très précise des textes autoréférentiels ? On a lu ces textes comme des réductions, ne faut-il pas y voir au contraire un élargissement de l’acte d’écrire, qui non seulement dit quelque chose, mais dit encore la manière de le dire, et donc multiplie les sens de lecture et pratique ainsi des ententes multiples ? Enfin, et pour répondre à Bataille, quelle liaison se joue entre la littérature et l’impossible ?
Il est une phrase, lancée dans Toute littérature s’effondre et restée sans commentaire, que j’insère ici : « L’impossibilité de la littérature est sa condition de possibilité ». [Traduction, s’il n’en est qu’une]. Ça n’est qu’avertis, auteurs, de son impossibilité qu’elle peut redevenir possible. Possible, elle l’aura été, nous en avons des preuves, mais ne l’est plus par les temps qui courent. Or qu’est ici l’impossibilité ? Pas un aujourd’hui qui n’écrive. Le petit roman de sa vie. En un sens, ceci est parfait. À moins que tous les conditionnements du monde ne se révèlent à l’œuvre, la forme actuelle « roman », peu plurielle, et aux inquiétants modèles fort souvent, n’étant suspectée de rien. Roland Barthes est ici radical, l’on ne sait s’il s’énerve (non bien sûr, il est au contraire très posé) : « Être moderne, c’est savoir ce qui n’est plus possible » (cité par Jean-Pierre Bobillot, in La Momie de Roland Barthes). Pour en venir – que l’on excuse le désordre – à la première phrase du livre, celle que vous citez, elle signale l’échec aussi bien que la réussite, tandis qu’il s’agit d’introduire. Impossible, le premier mot est impossible (je ne saurais l’écrire) or ce disant je l’écris et il devient par conséquent possible, eût-il nom d’impossible. Au-delà du jeu de langage, il s’agissait alors de marquer l’inévidence d’un commencement. Quelle tâche plus harassante en effet, si l’on prend au sérieux l’écriture, que la recherche, sinon du premier mot, de la première phrase ? Ne donne-t-elle pas l’impulsion de l’ouvrage jusqu’à sa fermeture ? Mais aussi, quoi de la dernière phrase, du dernier mot ? N’importent-ils pas tout autant ? En fait, plus généralement, quel mot, quelle phrase sauraient être négligés ?
7 – Par ce livre, tu poses une réflexion sur ce qu’est la théorie du langage et de l’écriture, en fait sur ce que représente le « verbe ». Tu te demandes ainsi quelles sont les règles (souvent incompréhensibles et hermétiques) qui dirigent notre manière d’échanger par les mots et tu les confrontes à celles de la science (généralement tout aussi incompréhensibles et hermétiques) pour faire ressortir ce qui pourrait apparaître comme encore plus incompréhensible et hermétique si le parti-pris de transformer la théorie en « théoriRe » ne s’était pas opérée dans ton projet. Peux-tu revenir pour nous à la conception de ce livre-objet qui démonte par un savant procédé, ludique et habile, la manière de présenter l’écrit et de le décortiquer ?
« Texte autoréférentiel », pour ne pas oublier la question qui précède, théoriRe, actes n’en aura pas moins été tourné sur son entour, un entour choisi, et permanent, qu’il s’agît de textes théoriques ou philosophiques. Si ce livre n’était pas à strictement parler le prétexte à de telles lectures, l’occasion en fut donnée et je dois dire que certaines me demeurèrent parfois comme étrangères, non pas hermétiques, mais étrangères (étranger que j’étais, en retour, à leur lieu de production, l’Université ou ses parages). Et c’est cette étrangeté même qu’il m’avait semblé devoir être restituée. Nulle anti–théorie, une tenue contre, tout contre « le théorique » plutôt, par laquelle s’effectuerait, comme vous dites, sa transformation, en vertu de la lettre introduite – le R même -, d’une certaine efficience dans le discours. Celui-ci s’accordant un rire, dans l’intellection même, que le genre semble défendre par nature. Ainsi nulle objection quant au dit genre, mais au fond, pour reprendre de mémoire Jacques Derrida, quelque chose de plus grave (je souligne) qu’une objection. L’on ne s’étonnera pas soit dit en passant que ce rire en question, s’il est seulement explicite, s’il est seulement celui de qui cherche à faire rire, soit comme fécondé par cette gravité préalable instaurant l’écart. Donc contre, tout contre, mais écarté / écartant. Et se frayer ce faisant des voies nouvelles.
8 – Le genre épistolaire est très présent dans ces deux premiers ouvrages. Pourquoi ? Est-ce un genre qui permet d’exprimer ce qui ne peut l’être autrement ? Que te permet-il d’atteindre et de réaliser ?
Ce genre en question n’est pour ces deux ouvrages (mais aussi bien pour les textes non publiés encore Cylindres, et Après les Cylindres) qu’un genre « fictionné », il ouvre Critères du cratère et survient dans théoriRe, actes, à titre de rupture, au cœur du texte. Il m’intéresse en ce qu’il introduit en littérature une dimension confidentielle qu’on ne connaît en presque aucun autre de ses genres, sauf erreur. Précisément, et peut-être paradoxalement, ce genre compte désormais comme incontournable dans la littérature, quand bien même ses textes ne seraient pas – en dehors de cas où les auteurs en sont avertis de leur vivant – destinés à la publication. La destination n’en est censément qu’intime, qu’un regard extérieur s’y pose, fût-il post-mortem, n’en retourne-t-il pas d’une sorte, comment dire, de « voyeurisme » ? (J’ai à mes côtés la correspondance Artaud / Ferdière, ou encore la Lettre au père, de Kafka, la question peut se poser). Or n’est-ce pas toute la nécessité, s’il s’agit de se renseigner sur quelque point que ce soit concernant l’auteur ? Là où, pour ce qui me concerne, ce genre ne fut pas « fictionné » – ou plutôt il le fut mais il y avait un destinataire – une fois seule, c’est à l’occasion d’un texte paru aux Éditions Tarabuste (anthologie Triages) et intitulé Ode à Noémie Parant. Lequel texte s’ouvre en effet sur une série de trois lettres, passé l’avant-dire, adressées à Noémie que je ne connaissais pas encore, et en lesquelles j’établis une sorte de fiction de vie amoureuse, entre elle et moi. Ceci qui eût dû rester lettre morte dans-les-temps-que-l’on-sait, se révéla de façon tout autre (nous vivons désormais ensemble, et les lettres alors adressées trouveront réponse dans un livre qui paraîtra l’heure venue).
9 – De même, tes références sont truffées de citations de philosophes. Nous savons que tu es notamment un fervent lecteur de Walter Benjamin et de Jacques Derrida – entre autres. Comment la pensée philosophique nourrit-elle ton œuvre, ton écriture ?
Mes lectures philosophiques ne valent qu’à y puiser une exigence dans la pensée qui n’est que rare en littérature. Et qui se formule par ailleurs tout autrement. Il n’en va en fait à mes yeux pas moins nécessairement en philosophie qu’en littérature, d’une écriture, cuirasse protéiforme, et c’est elle sans doute, elle avant toute chose, que je me fais le plaisir d’observer, voire de scruter lorsque les textes l’exigent, en philosophie. Sans de telles écritures je ne saurais écrire. Ou alors mon écriture serait tout autre. Je n’oublie pas ce faisant, vous citez Walter Benjamin, Jacques Derrida, vers quels mondes, quelles autres écritures, de telles écritures mènent, dans le tissage des références : de Barthes à Baudrillard, de Lacan à Nancy, de Bourdieu à Rancière, etc. Autant de grands écarts dans ce séquençage (qui en l’occurrence, certes, ne prend pas à la lettre le nom de philosophie mais signale la lecture pour l’intellect que je tiens ici à lui substituer). Ceci pour ne m’en tenir qu’au vingtième siècle, et ses prolongements pour partie dans notre siècle. Plus d’une marque devrait ainsi avoir été portée sur mon écriture, marques irrégulières si l’on se figure que mes lectures en furent et demeurent comme obliques, l’autodidaxie certes relative réglant toute compréhension.
10 – Ton troisième ouvrage – celui qui nous a permis de te découvrir – est Toute littérature s’effondre (L’Atelier de l’agneau, 2009). Comme pour ton deuxième livre, plusieurs années se sont écoulées avant cette nouvelle publication dont on comprend qu’elles ont été importantes dans l’élaboration de cette œuvre qui se présente – à la différence des deux premières – dans une mise en page classique sans plus aucune insertion graphique complexe. Parle-nous-en.
L’écriture m’était alors plus difficile qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ce qui explique les délais, passant d’un texte à l’autre (une nuit seule suffit désormais). Il y a aussi que, cette fois, il me fallut compter avec une expérience intérieure des plus imprévisibles, des plus incroyables aussi, et que j’évoque plus ou moins directement dans Toute littérature s’effondre, à savoir la survenue de « voix » (2007-2008). Rien que je ne pusse m’expliquer alors, si ce n’est que ces dites voix me venaient du dehors, exactement comme dans le cas d’une télépathie. La conversation avec mes interlocuteurs, car il y en eut plus d’un, fut sans le moindre répit. Nuit et jour. Et cela des semaines durant, qui me mena in fine droit à « l’asile ». J’y rédigeai avec le plus grand bonheur – d’être parmi mes semblables – les pages d’un étrange carnet faisant l’état des lieux de la conscience après la folie, elle-même récapitulée (lequel carnet soit dit en passant fut laissé à d’anciens amis et qui eût dû être publié or qui sait, peut-être a-t-il fini au feu). Pour en revenir à Toute littérature s’effondre, d’aspect graphiquement plus sobre que théoriRe, actes, en effet, je tenais à laisser l’initiative au texte seul. Pensant qu’il se soutenait suffisamment de lui-même, tel.
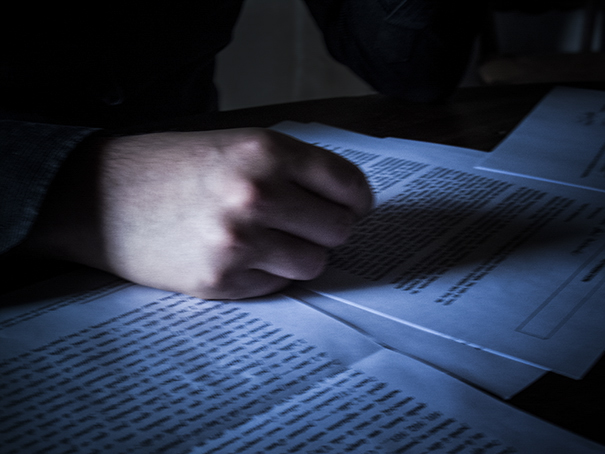
11 – Toute l’obsession de ce troisième livre – mais n’est-ce pas l’obsession même de ton projet depuis le départ ? – est celui de la « littérature » comme un possible avenir. En te lisant, on ressent même que ton obsession est davantage celle de l’écriture que de la littérature, c’est-à-dire de l’écriture comme seule alternative à ce qui s’effondre. Ton livre s’ouvre ainsi : « Science-Fiction, 27 janv.-09 : cinq semaines à faire circuler dans le cerveau autant de phrases nécessaires à la survenue de la première toutes d’entre ces phrases […] ».
Un possible avenir, comme vous l’écrivez, ou alors avenir aussi impossible que possible (R. Major). Les différents sens de lecture tiennent ensemble, de façon indécidable. De deux choses l’une, soit la littérature est, sauf exceptions, aujourd’hui en retard (sur tout projet visant à la rénover, or de façon significative la question ne se pose plus) ; soit l’est l’écriture dont je me revendique, qui n’aura pas cessé, et ne cesse pas, encore, de livre en livre, de (vouloir) se renouveler et cela avant tout formellement. La question pourrait être, de façon générale, concernant notamment le roman : pourquoi le choix des formes est-il aujourd’hui si restreint ? A-t-on oublié, pour l’exemple, que Maurice Roche sous-titrait en 1966 son Compact, « roman » ? En était-ce un, qu’est-ce qu’un roman ? Pourquoi sait-on si bien ce qu’est aujourd’hui ce genre, ce qu’il est devenu ? Retournement désagréable : ce genre a-t-il quoi que ce soit, encore, de littéraire ? (À quoi certains objecteront, à raison peut-être, que la « Rentrée littéraire 2012 » fut une bonne rentrée). Il se peut, en fait, que la coupure entre écriture et littérature soit intenable. Que l’on se figure seulement un texte littéraire (roman, récit ou autre) dont l’écriture serait négligée… Non qu’il n’y ait pas quelque intérêt, mais sous certaines conditions, à mal, à très mal écrire (voir le beau travail d’Armand le Poête). Or ce « très mal » signifierait-il « l’écriture négligée » ? L’effort pour y parvenir ne serait-il pas considérable, ayant franchi, dans l’écriture, quantité d’étapes ? Ce point est évoqué passé l’interlude, dont je n’ai pas encore pris toute la mesure. L’on ne sait de surcroît s’il appelle ou non le rire.
12 – Dans un entretien en février 2010, tu affirmes concernant ce livre que « quand on me demande le titre, j’ose à peine répondre ». Pourquoi ? Tu évoques également ce texte en expliquant qu’il est celui d’une seule phrase, étirée sur cent pages. Cette ambition renvoie à celle de Mathias Enard dont le roman, Zone, était lui-même caractérisé par une seule phrase… mais sur cinq cent pages. Explique-nous cette motivation, cette ambition, d’étirer ainsi une phrase. Qu’est-ce que représente, pour toi, ce geste d’écriture ?
Au sujet du titre, j’y aurai préféré, rétrospectivement, plus de discrétion. Peu tenant au fond de ces titres ayant le sensationnel pour visée. Mais voilà, composons avec lui. Alors le texte, et je dois rectifier ici une chose. Je fus invité dès sa sortie à en donner une lecture à Lille (librairie La Colombe d’Argent) or étant alors en pleine écriture de l’ouvrage suivant, Une phrase, juste, je fis l’impasse sur Toute littérature s’effondre ne lisant que les pages déjà écrites d’Une phrase, juste [qui s’intitulait encore La Terre est un dos de dinosaure glissant, quand il neige]. Ainsi, interviewé par tel journaliste, je parlai de ce futur livre, évoquant sa phrase étirée sur cent pages. Il ne s’agissait pas de Toute littérature s’effondre, quoiqu’une telle phrase soit évoquée dès l’introduction. La construction de Toute littérature s’effondre en est, comment dire, plus classique. Encore que ces textes mêmes d’une phrase unique, dont Zone, que je ne connais pas et que vous évoquez, constituent presque un genre, un classique depuis Joyce si ce n’est Mallarmé même (si l’on s’entend sur le nom de phrase) – voir son Coup de dés – en passant par Sollers. Il ne serait pas inintéressant d’en retracer l’histoire précise.
13 – Ce troisième livre se présente sous deux formes : celle de plusieurs textes aux paragraphes numérotés et que celle d’un journal intime qui démarre en mai 2008 pour s’achever le 11 septembre de la même année. Il se découpe donc en deux parties bien distinctes même s’il s’agit dans ces deux parties de cette même obsession, de cette même phrase étirée sur cent pages… Comment s’est imposée à toi la forme de ce livre ? Il émane de son titre tout comme de l’incroyable illustration qui en orne sa couverture, quelque chose de surprenant, presque annonciateur, dans tous les cas très accrocheur et interpellant pour le lecteur…
J’allais dire, quant à Toute littérature s’effondre – la forme s’est imposée d’elle-même. Dans l’irréflexion même. Première partie, diverses parties en elle numérotées, chacune. Un interlude, au centre (titré Projet d’un livre qui ne verra pas le jour). Presque tout l’intérêt du livre à mes yeux. Et que je remanierai volontiers un jour. Puis effectivement, afin de refermer sur cinquante pages le livre, une sorte de journal intime (dont je me demande aujourd’hui s’il était nécessaire, mais voilà, comment le faire disparaître ? Comment – sans rapatrier l’ensemble des exemplaires vendus et les enfermer en un coffre pour toujours – pour ne pas évoquer ici le pilon), daté chaque jour et contenant le rapport du jour depuis la double question qu’aura été ce jour ? Que puis-je en garder ? Ayant déjà évoqué, plus haut, son titre, je n’y reviens pas ici. La couverture, elle, est une photographie aérienne, assez surprenante en effet, de Pompéi, qui semble en tout cas ouvrir sur la dévastation. En un sens, celle-ci cadre à merveille avec le titre.

14 – Abordons ton nouveau livre, Une phrase, juste suivie de Hors-Livre (L’Atelier de l’agneau, 2012). Donc, avec ce texte, encore, toujours et sans cesse, cette obsession de l’écriture… La phrase – tel un personnage – est là, elle aussi, donnant son fil rouge à tout le texte et « gardant dans le présent de son inscription ce que fut ce futur ». Tu écris ainsi : « (secret S7 : la phrase sera le vaisseau en provenance de la terre pour rejoindre le quatrième monde s’il y subsiste un peu de place, les agents s’étant approprié la phrase règleront l’organisation du voyage et filtreront les passagers selon un ensemble de critères spécifiés dans le fichier L***) ». Nous imaginons que L*** est cette Littérature immense et infinie dans laquelle ta phrase évolue et se nourrit d’autres écritures ambitieuses – notamment celles de Derrida, de Mallarmé ou encore de Proust dont tu te réclames dans la seconde partie de l’ouvrage : Hors-Livre. Quel a été ici ton projet ?
Il s’agissait, avec Une phrase, juste, de passer à un projet d’écriture tout autre, consistant en l’élaboration, comme il fut dit, d’une phrase unique, que j’étirerais sur un nombre de pages alors indéterminé. Une fois encore, l’idée – la forme – n’en était pas nouvelle, on la retrouve notamment chez Joyce, dans son monologue illustre [en fin d’Ulysse], quoique non ponctuée, non virgulée dans son cas. Je m’autorisai en effet la virgule, et ceci aussi bien par soucis de rythme interne que de lisibilité fût-elle à l’épreuve quand bien même, une fois encore. Ainsi, expérimentant cette forme, je remarquai qu’elle affectait, qu’elle agissait sur l’écriture même, altérée par son absence de terme, indéfiniment suspendue au-dessus du vide – sans la moindre méthode dont Barthes rappelle l’étymologie comme étant le « droit chemin. » Vide qui était comme l’inquiétude même de la phrase, y compris si jamais n’en fut prononcé le nom. Peut-être certes celui d’abîme. Le point institue la halte, et apprivoise ce faisant ledit vide. La virgule – un répit provisoire. [Note : je trouve ce jour en exergue du Grabinoulor de Pierre Albert-Birot cette citation de Bergson, dans L’Énergie spirituelle : « Or je crois bien que notre vie intérieure tout entière est quelque chose comme une phrase unique entamée dès le premier éveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée par des points »].
15 – À la différence de tes trois premiers livres, celui-ci est un texte présenté sans aucune insertion graphique ni aucun découpage (sinon les deux parties). Il se présente donc, de la première à la dernière page, comme un texte imprimé en bloc, dont les mots se suivent à la file (dans la seconde partie, le texte comporte des paragraphes). Par ce minimalisme typographique, l’écriture est mise en avant pour elle-même, pour apprécier sa puissance, sa fluidité mais aussi, nous paraît-t-il, avec cette volonté qui semble avoir été la tienne de vouloir faire « récit ». En effet, ce texte est d’une nature surprenante : il s’agit d’un récit de science-fiction (nous sommes entre les années 7007 et 9147), d’une intrigue montée comme dans un roman policier (la poursuite effrénée d’une phrase à travers l’espace, le temps et l’histoire de l’humanité) mais aussi d’une réflexion philosophique (existentielle par rapport à ce monde) et d’une texture poétique (ton écriture même). On peut donc dire de ce texte qu’il est le tissage de trois genres littéraires au moins : la philosophie, la poésie et le roman, précisément trois genres qui ramènent aux trois auteurs dont tu te réclames. Parle-nous de la conception de ce texte et de son articulation avec les différents référents choisis : la phrase, la SF, les auteurs mentionnés plus haut.
La dimension de récit, non que je la dénie, ne m’était pas tout à fait apparue comme telle – y voyant surtout, comment dire, le poème -, vous l’éclairez ici. De science-fiction qui plus est. Alors telles dates, en effet. Et si tout s’était édifié en dehors de toute conscience à cet égard. N’observant alors, quasi aveugle, que la seule pointe de la phrase. La mémoire en tout cas n’y est plus tout à fait, et ne semblent me revenir de ce livre que de seules séquences [elles-mêmes souvenues, pour partie, de l’épisode des « voix » dont je parlais tout à l’heure]. Je discerne bien en revanche la séquence – d’une demi-dizaine de pages – précédant le Hors-livre, dont le genre pourrait s’affilier, en effet, au roman. Séquence reprise par ailleurs passé le Hors-livre, dans le passage final intitulé Hors hors-livre (ou le livre de l’aurore) pour ne s’arrêter nulle part, aucun point ne ponctuant le livre. Quant au Hors-livre, il s’agit d’un passage réflexif – philosophique serait trop dire – au cœur décentré du texte, qui interroge, notamment, la textualité même en tant que flux im-possible, du fait de sa non-limitation en tout cas tant que rien ne vient ponctuer (« le point équivalant au meurtre de la phrase ») ni rompre. La nécessité d’une rupture aura été éprouvée, qui aura pris corps, de façon si peu efficiente soit-elle, dans le Hors-livre même, via « l’accidentation » du flux par le vers, d’une présence comme intruse, destructrice. Est-ce une réussite ? Non, si l’on observe le retour à la forme initiale dans le Hors hors-livre. Oui, si la rupture introduite était le nécessaire détour.
16 – Il semble qu’avec Une phrase, juste, tu aies trouvé un ton, un style, une esthétique propres qui posent vraiment ton univers littéraire. Comment situes-tu ton travail dans le contexte de l’écriture actuelle ? Et quels sont tes projets ?
Inversant l’ordre des questions. [Projets]. Deux textes succèdent Une phrase, juste, non publiés encore, je les ai cités déjà : Cylindres et Après les Cylindres. Peut-être les fusionnerai-je en un unique livre afin de ne pas trop m’étendre. Par ailleurs, n’ayant comme je le disais plus haut pas ponctué Une phrase, juste, j’en aborde par conséquent possiblement la suite – deuxième partie -, laquelle devrait m’occuper un certain temps [plus d’une année sans doute]. Ma relation à l’écriture actuelle ? Régulière. Je peux ici déballer ma bibliothèque ou la seule double pile sur ma table, et voir ce que l’on y trouve, de Friederike Mayröcker – son excellent Brütt – à Bernard Noël en passant par Christophe Tarkos (je n’oublie pas non plus ici Jean-Luc Parant). Est-ce tout à fait actuel ? Des « inactuels » – il y faudrait plus que ces seuls guillemets – en tout cas s’y mêlent, suivant l’impossible séparation, de Paul Celan à Maurice Blanchot ou alors de Samuel Beckett à Georges Bataille. Enfin, ce sont là les « classiques » (en seule littérature de surcroît), traversant et travaillant sans doute mon écriture, de façon plus ou moins souterraine. Comment taire ce que je leur dois ?

17 – Tu effectues des lectures lors de performances publiques. Peux-tu nous parler de ton style de lecture, quel type de voix développes-tu là ? Comment t’y prépares-tu ? Ton rapport au gueuloir pour tes textes ?
Mon style de lecture aura évolué avec l’évolution de l’écriture, et l’aspect de performance y est sans doute moindre qu’aux débuts. Encore qu’Une phrase, juste me semble requérir un type de lecture tout sauf conventionnel au fond. En lequel se sera chaque fois [comme] perdu le souffle, où respirer si l’on suit le texte ? Il y a certes les virgules, autant de possibilités à cet égard, fussent-elles des moins sûres. Étrangement j’ajoute, une sorte de vitesse semble s’être imposée à l’occasion de ses lectures, décidée par l’absence de ponctuation même. Alors peut-être est-elle excessive, puis-je corriger cela ? Me préparer à cette correction ? Pour répondre succinctement à votre dernière question : aucun rapport avec le gueuloir. Pour l’anecdote tenez, me revient à l’esprit cet auteur dont la lecture succéda immédiatement celle, magnifique, de Bernard Noël à l’occasion de sa lecture de Paroles du Sage (trad. Henri Meschonnic) au Marché de la poésie il y a trois ou quatre ans. Affilié à ce genre que vous évoquez – si c’en est un – et contre lequel je n’ai rien « dans l’absolu », la prestation du second fit toutefois tout à fait flop à mes yeux, plutôt que d’établir un contrepoint pertinent. Mais je n’en tire aucune conclusion. Juste : le contexte n’y était pas.
18 – Tu publies ton premier eBook chez D-Fiction, Les Fusées de C. B. dans une collection où un auteur contemporain et un auteur « classique » voisinent dans une même filiation. Il y a donc les Fusées de Baudelaire et tes fusées. Raconte-nous donc…
Avant de répondre, je dirai le vif plaisir qu’aura constitué l’écriture de ce texte, y compris si le temps en fut bref, s’il fusa [une semaine]. L’occasion – comme il en manque tant – d’un petit travail intellectuel que je renouvellerai volontiers, parallèlement à l’écriture littéraire. La tâche en est-elle si distincte que cela ? Je n’y traite en tout cas pas, comme l’on en jugera, des Fusées de Baudelaire de façon classique, comment se pourrait-ce, et n’était-ce pas la clause ? Il se sera agi de s’y retrouver, parmi toute sentence ne procédant, notamment, dans leur ordre d’apparition, d’aucune règle. Et de lancer en retour, parmi les fusées, et avec le passage des siècles, une écriture qui pût, à sa manière, les appréhender, en retournât-il d’une imprégnation consistant à faire fuser à son tour. Dois-je en dire davantage ?
Entretien © Denis Ferdinande & D-Fiction – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum
(Argentan, juin-oct. 2013)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.