TRUDY BOLTER s’entretient avec nous à propos de son essai FIGURES DE L’ÉCRIVAIN DANS LE CINÉMA AMÉRICAIN (PUR, 2001) :
1 – Trudy, tu as publié un essai, Figures de l’écrivain dans le cinéma américain qui m’a longtemps accompagnée dans un long travail d’écriture que je viens d’achever et dont je peux dire qu’il m’accompagne toujours tant cet ouvrage est sans doute le plus précis et le plus brillant des essais jamais écrits sur la question de l’image de l’écrivain en Amérique et de sa « voix » dont tu étudies les multiples ressorts et qui définit le sous-titre de ton essai : Itinéraires de la « voix baladeuse ». Je tenais à avoir cet entretien avec toi, aujourd’hui, pour plusieurs raisons. La première est largement motivée par le fait que, de nos jours, la littérature et le cinéma semblent être perçus comme has-been face aux séries télévisées qui concentreraient à elles seules – de l’avis général – les pouvoirs de la littérature (le feuilleton du XIXe siècle) avec l’efficacité du cinéma (le rêve à l’écran) en ayant, en plus, la qualité d’être un médium qui se suffit à lui-même, c’est-à-dire en illustrant cette affirmation emblématique de McLuhan, à savoir que « le vrai message, c’est le médium lui-même » et non pas ce qu’il nous dit ni la manière dont il nous le dit. Face à la déferlante des séries contre lesquelles la figure de l’écrivain ne semble plus être en mesure de rivaliser, notamment par son subtil travail sur la langue et avec la langue (proche en cela du travail d’un réalisateur de longs métrages), penses-tu que cette figure singulière qu’il incarne, cette « voix intérieure de la conscience existentielle », a encore une chance d’être entendue ? En deux mots, la figure de l’écrivain – dans la vie réelle comme sur la toile – a-t-elle une chance de représenter encore une entité dans laquelle la société puisse se projeter à l’avenir ? Pourquoi ?
Merci ! Cette réception de mon livre correspond au rêve de tout auteur : provoquer une réaction ! Tes questions me stimulent et m’interrogent donc. Il ne me semble pas que la littérature et le cinéma soient à ce point perçus comme has-been face aux séries télévisées. Je ne vois d’ailleurs pas comment cela est possible : il n’y aura jamais de fin de la littérature – lire sur une tablette ne changeant pas grand-chose. Quant au cinéma, il ne mourra pas, pour la même raison : le fait de le visionner sur une tablette ou un téléviseur plutôt que sur « grand écran », ne change que des détails. Aussi, je pense que les séries télévisées ne remplacent rien et perpétuent tout : la littérature, le cinéma et la télévision d’hier. Les exemples diffusés aujourd’hui ne sont que la phase récente d’anciens phénomènes. Et puis, il y a déjà eu par le passé d’importantes séries télévisées : par exemple, Rawhide (1959-65) qui lança Clint Eastwood ou I Love Lucy (1951-57), sans parler de soap-operas comme As the World Turns (1956-2010). La sérialité en soi est agréablement addictive et, en plus de la littérature, elle fait depuis toujours partie de l’attrait du cinéma, voire même de la peinture et de la musique. Évidemment, ces derniers appartiennent à une conversation différente. Dans les séries, on aime la répétition, revoir les visages connus, suivre l’évolution d’une intrigue, goûter au rythme d’une narration découverte peu à peu, excité par les attentes forcées entre deux épisodes. Au 19e siècle, on prisait ainsi la forme des romans-feuilletons – ceux de Dickens par exemple – aussi bien que les serials des premiers temps du cinéma, dont l’un des mérites était de fidéliser les clients revenant chaque samedi pour découvrir la suite d’une histoire. Mais la « série » est un genre hybride auquel on peut donner un sens assez large : les personnages archétypaux récurrents (l’écrivain, le détective, le cowboy), ou même, la chaîne formée par tous les rôles d’une seule star (Clint Eastwood dans Rawhide, Dirty Harry, etc.) sont assimilables à une « série ». La « série » est une des clés pour comprendre la récurrence à l’écran du personnage de l’écrivain, toujours identique, mais aussi différent, comme dans tous les cas d’une grande figure archétypale. Et la chaîne formée par une œuvre et ses remakes, ou bien, ses échos repérés dans des films différents, est une autre forme de « série ». Ce qui est nouveau dans les séries télévisées d’aujourd’hui, c’est l’argent issu des chaînes câblées payantes ou autres, disponible pour la production, c’est-à-dire mis au service des « production values ». La qualité de la photographie, des décors, de l’écriture et de l’interprétation se rapproche de celle du cinéma. Il n’y a pas que l’argent qui permet ces avancées, mais aussi la technologie nouvelle du câble assurant une image détaillée très évoluée. La réception est faite sur des téléviseurs perfectionnés qui n’ont plus rien à voir avec les vieux écrans de douze pouces. Les séries sont disponibles chez soi, sur un écran porteur d’images comparables à celles du cinéma que l’on peut agrandir, enregistrer tout en changeant de langue. On n’est plus dépendant d’une diffusion saucissonnée par la publicité. C’est cette indépendance et cette créativité du spectateur face à l’œuvre filmée qui m’intéresse avant tout. Plus besoin de sortir (… et aucune envie de le faire !) quand un épisode d’une heure ou un peu moins peut distraire intelligemment. On peut en regarder deux, trois, faire du « binge-watching » – le dispositif « séries » est plus souple que la sortie cinéma. En plus, on peut parler, changer d’assise, arrêter la diffusion, y revenir… « Couch potato » passif ? Je ne suis pas si sûre… On peut être plus actif, prendre plus de décisions devant son téléviseur que dans un cinéma. Avec les DVD, ou sur tablette, on est proche du livre que l’on ouvre, pose ou ferme selon nos besoins. Mais, c’est sûr, rien n’égale tout à fait la grande salle sombre où nous regardons un film entier entourés de tiers. La « voix intérieure », dans mon livre, est celle du spectateur, chez qui la figure de l’écrivain réveille un désir de création, et conforte une habitude assimilable à l’écriture, celle de se narrer sa propre vie à mesure qu’elle se déroule. La représentation de l’écrivain excite et nourrit, symbolise cette conversation intérieure avec soi, le monde et les événements. L’encensement des auteurs continue, le nombre de films le concernant ne se tarit pas et la télévision presque centenaire n’a pas encore réussi à se passer des arts du langage incarnés dans les arts du spectacle. Dans une certaine mesure, l’écrivain résume tous les autres artistes, voire tous ceux qui entreprennent un projet personnel, sublime et dangereux, car l’issue est incertaine. Dans les représentations filmiques de l’écrivain, la langue elle-même, celle de l’auteur-personnage, n’est pas souvent reproduite, mais seulement esquissée, ou référencée s’il s’agit d’un biopic. Il y a des exceptions : pour Shakespeare, Keats ou Jane Austen dans le cinéma anglophone dont les œuvres sont très connues, ou récemment, dans le cas du poète Allen Ginsberg. Souvent, la langue est suggérée, le texte n’existe que dans le monde des possibles, le personnage reste ouvert – son état d’écrivain sans texte précis, permet au spectateur de se projeter en lui. Pour The Hours (Stephen Daldry, 2002), un jeu d’identifications multiples permet en même temps au connaisseur des œuvres de Virginia Woolf, se retrouvant dans les citations – et au spectateur sans connaissances particulières – de se retrouver dans le film car il est possible de s’identifier avec une abstraction inhérente au personnage récurrent, porteur du « pouvoir écrivant » qui fait appel au désir d’expression du spectateur, une partie de ce que j’ai appelé la « voix baladeuse ». Je ne crois pas qu’en l’absence de cataclysme politique ou technologique, les formes puissent se perdre vraiment, mais elles s’adaptent et s’amplifient, s’hybridant entre elles. La séries télévisées ne remplacent pas le cinéma ; en revanche, les études universitaires sont devenues plus souples, on peut désormais décortiquer Candy ou Albator. Et pourquoi pas ? La vague de « writer-films » continue de déferler. La figure de l’écrivain continue de fasciner. C’est une figure de la construction, l’auteur se réalisant dans un projet intensément ressenti. Son ambition est pacifique – c’est donc une figure d’espoir dans un monde tenaillé par des paroxysmes de haine et de destruction.
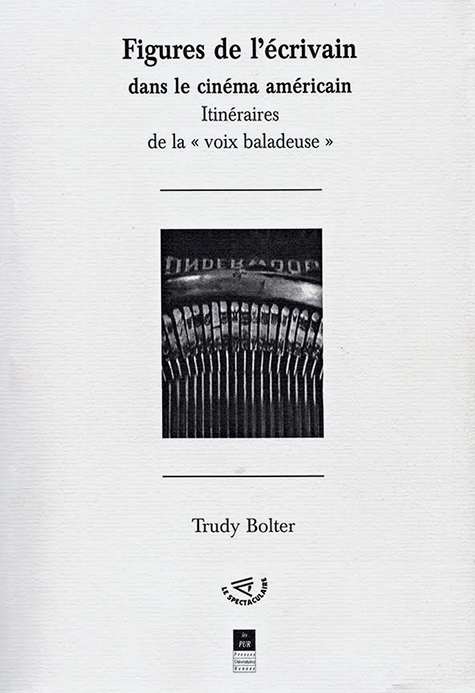
2 – Ton essai est d’autant plus important pour saisir la figure de l’écrivain que tu t’appuies sur des personnages d’auteurs qui, dans ton corpus de films, font appel à la fibre d’écrivain présente dans chaque spectateur, fibre que tu nommes précisément cette « voix baladeuse ». Peux-tu revenir rapidement sur la nature de cette voix, en quoi elle consiste, comment le cinéma t’a donné les moyens de la percevoir et si, finalement, cette voix n’est pas celle que tout lecteur entend à la lecture même des œuvres d’un écrivain… en bref, si cette voix n’est pas cette petite musique de la langue propre à toute œuvre de création à partir du moment où cette création fait preuve d’une esthétique avérée ?
C’est plutôt cela. Mais personnellement, en lisant, je n’entends pas de voix autre que la mienne, je m’approprie les paroles, sauf dans certains cas extrêmes, Lincoln ou Shakespeare, par exemple où l’aspect biographique est incontournable. En regardant des films sur Baudelaire, je ne m’identifie ni à l’acteur, ni au fantôme du poète représenté. Je suis habitée par une idée générale d’auteur qui ne m’exclut pas, par une idée générale de l’expression langagière, que je reprends à mon compte. J’avais déjà fait une thèse de littérature comparée sur la récurrence du personnage se référant à son auteur dans des pièces de Yeats et de Ionesco : suivre un plus grand nombre d’exemples dans un genre tout entier était l’étape suivante. Il arrive que l’existence de ce genre, que j’ai appelé le « writer-film » et sa très grande quantité d’exemples (autant que dans le genre du film noir – à l’époque environ 250 – bien davantage vingt ans plus tard). Constatant ce « comment », il fallait essayer de comprendre le « pourquoi ». L’idée de la « voix baladeuse » m’a paru comme une évidence, il fallait partir à la recherche de ses racines, la tester contre les écrits des théoriciens. J’avais lu avec un grand plaisir, Une histoire de la lecture (en anglais, 1996) d’Alberto Manguel, explorant nos relations affectives avec les livres. Commençant mes recherches en 1997, j’ai été influencée par un autre livre alors récent – ne traitant pas, lui non plus, de cinéma – de Maurice Couturier (La Figure de l’auteur, Le Seuil, 1995) qui m’a fait connaître des théories de la réception dont celle de Wolfgang Iser, selon lesquelles celui qui lit est en même temps un créateur, car il reconstruit à sa manière le texte. Parmi d’autres influences encore, est le Barthes tardif, qui nous dit dans Le Plaisir du texte que « …dans le texte, d’une certaine façon, je désire l’auteur : j’ai besoin de sa figure (qui est ni sa représentation ni sa projection), comme elle désire la mienne… » (Le Seuil, 1973, p. 45-46). Par le cognitivisme aussi, des théoriciens du cinéma comme Noël Carroll, Murray Smith ou Martin Lefebvre, par le concept du formaliste russe Boris Eichenbaum proposant une « voix intérieure », une sorte de proto discours, que nous construisons à chaque moment, nous racontant l’histoire de nos vies, faisant de nous des sortes d’écrivain. Ce n’est qu’un florilège incomplet des références, car, comme nous dit Ionesco dans Antidotes, « nous sommes tous les fils de nos lectures ». Peut-être bien, dans la mesure ou toute œuvre de création, un tableau, un film, incarne une voix personnelle, unique, un point de vue, et cela peut s’apercevoir même dans le cas d’ouvrages façonnés par une équipe, comme les films classiques américains qui m’ont souvent servi d’exemples. Cette voix de l’œuvre pour te paraphraser, fait appel à la voix baladeuse du spectateur, demande une confirmation, une réponse donnée à l’œuvre, une sorte d’assentiment.
3 – Dans le deuxième chapitre de ton essai, tu écris : « Le film au sujet d’un écrivain semble jaillir des sources originelles du cinéma, et remonter au premier temps de ce média ». Dès lors, serait-il possible de dire que si le cinéma (ici, américain) est à ce point lié à la figure de l’écrivain, le déclin de l’un expliquerait immanquablement le déclin de l’autre ? D’ailleurs, verrais-tu là aussi un lien – sinon une conséquence – au fait que lorsque Guy Debord a déclaré dans son film Hurlements en faveur de Sade (1952) que « Le cinéma est mort », Roland Barthes ait écrit un article aussi fracassant que « La Mort de l’auteur » (1968) lequel fut suivi d’une célèbre conférence de Michel Foucault « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (1970), qui confirmait cette disparition inéluctable de l’auteur, du moins en France… Autrement dit, alors même que l’on a prédit la mort de la littérature au moment de l’avènement du cinéma, n’est-ce pas la mort du cinéma qui entraînerait, à rebours et assez étrangement, la disparition de la littérature même au profit, justement, des séries télévisées ?
Oui, les premier exemples donnés dans mon livre sont un film de D.W. Griffith, Home Sweet Home (1914) sur le compositeur/parolier John Howard Payne, et un film de Charles Brabin, The Raven (1915), sur Edgar Allan Poe. Le « writer-film » est un sous-genre du film sur un artiste (ou musicien, ou architecte, ou n’importe quel créateur), et ce personnage incarne tout un réseau d’aspiration, d’obstacles et de réussites éclatantes, symbolisant des états et des événements communs à tous les humains. (Les robots, leur temps venu, seront-ils écrivains ?). D’ailleurs, où est le déclin du cinéma qui a trouvé de nouveaux supports – et des sous-genres, dont les séries télévisées – mais persiste comme art majeur de notre époque ? La littérature, pour moi, a un sens très large, qu’elle soit bardique, écrite à la plume d’autruche ou hurlée sous forme de slam ; c’est une œuvre d’art faite de langage et je ne vois pas comment elle pourrait disparaître. Dans Hurlements en faveur de Sade, le but de Guy Debord n’est peut-être pas de nous convaincre de la mort du cinéma, mais plutôt de nous rendre compte d’un certain formatage nous incitant de regarder n’importe quoi, et même des écrans vides, machinalement, en attendant d’y voir s’inscrire des images, n’importe lesquelles. C’est une provocation qui n’est pas inutile ! En même temps, il se met en scène, remplissant implicitement l’écran d’un gros plan fantôme le représentant. Et pourtant, malgré tout ce battage, ces cris d’affranchissement, un demi-siècle plus tard, le cinéma existe encore, l’auteur n’est pas disparu… Le Festin – magazine culturel et touristique de l’Aquitaine – a récemment publié un numéro consacré aux maisons d’auteur. David Lodge, auteur anglais, vient lui-même de publier un recueil de textes biographiques sur les écrivains, et le « writer-film » ou film sur un auteur, persiste – Bright Star (2009) de Jane Campion, le Tchekhov (2015) de René Féret, La Grande Bellezza (2013) de Paolo Sorrentino, Minuit à Paris (2011) de Woody Allen. D’ailleurs, tant que des auteurs souvent adaptés – comme Stephen King – traitent d’écrivains dans leurs livres, le cinéma va les suivre. « La mort de l’auteur » en son temps, je crois, incarnait le souhait d’être libéré d’une ancienne école de critique de textes basée sur l’étude de l’auteur historique, alors que dans la « new criticism » anglo-saxonne, l’une des approches que l’on m’a appris à utiliser – comme pour Barthes ou Foucault – le texte suffit à lui-même et seul compte la vision de l’explicateur, ce qui ne veut pas dire un subjectivisme complet, car on prend en compte les connaissances, mythes et habitudes de penser d’une époque, on voit le texte en termes de son genre, selon une théorie de langage… On remarque les répétitions, on traque les références, on cherche des cohérences structurantes, on écarte la biographie comme fil conducteur d’une analyse, mais l’explication de texte est rigoureuse. Je crois à la coexistence des genres et des formes d’art. Il n’y a pas d’époque qui en a pratiqué un seul à l’exclusion des autres : tous les arts sont nourris par tous les autres. Les séries télévisées, c’est en même temps une nouvelle phase de télévision et une nouvelle forme de cinéma : l’un n’exclut pas l’autre.
4 – Certaines séries ont mis en scène des personnages d’écrivains : Arabesque, Castle, October Road et, évidemment, Californication. Y a-t-il, pour toi, des différences perceptibles entre la figure de l’écrivain représentée dans un film de cinéma et celle dans les séries ? Peux-tu nous dire lesquelles et à quoi cela est-il dû ?
Le cinéma reste plus sélectif. La série télévisée est à la fois trop courte et trop longue – trop courte, car les épisodes ne durent qu’une heure, la moitié d’un film, et trop longue parce que vingt heures – le temps d’une saison d’épisodes – dépassent ce que l’on pourrait voir dans une même séance. D’où le besoin de répétitions et de simplifications que le cinéma n’exige pas. Quelque fois, comme dans le magistral Breaking Bad, l’analyse psychologique se creuse toujours plus dans chaque épisode, mais les séries sont parfois superficielles. D’ailleurs, certains des « écrivains » de fictions télévisées (dans Arabesque, ou Castle) ont plutôt un grain de détectives, n’écrivant que peu, ou n’écrivant plus. Hank Moody, dans Californication, est l’auteur d’un best-seller, il est riche, mais bloqué : il est donc libre pour toutes sortes de rencontres facilitées par son charisme de romancier (jadis) réussi. Son état d’écrivain semble parfois servir comme alibi pour son addiction sexuelle. Il faut l’avouer, l’auteur stéréotypé est un personnage plus disponible que d’autres pour des péripéties intéressantes, ayant du loisir, surtout quand il est incapable d’écrire. A contrario, Jane the Virgin dans la telenovela satirique américaine me plaît – son rêve est d’écrire un jour des romans sentimentaux, peu prestigieux, mais exprimant sa sensibilité. Ce rêve est partagé par beaucoup de gens : la figure de l’écrivain potentiel est plus proche du spectateur que celui de l’écrivain réussi, ou déchu.
5 – Aux États-Unis, de plus en plus d’écrivains importants travaillent pour les séries télévisées, considérées comme le nouvel eldorado de la fiction à l’instar, dans les années 30, d’un William Faulkner ou d’un Francis Scott Fitzgerald qui écrivaient pour le cinéma. Pour toi, l’avenir de la littérature et donc, de son renouvellement, passe-t-il par les séries ? L’écrivain qui travaille à une série peut-il exister et être reconnu en tant que tel ou n’est-il pas qu’un co-auteur parmi d’autres ?
Je ne sais pas si un genre peut envahir et dominer la culture toute entière, les séries sont un genre parmi d’autres, une forme de spectacle, et aussi une forme de littérature. Pourquoi s’en méfier ? J’aime bien l’idée de la coexistence de toutes les formes, les belles séries élaborées de nos jours sont une source de plaisirs : ni tsunami ni barque de secours. Jean Cocteau travaillait dans plusieurs formes. Shakespeare écrivait des sonnets et des pièces. Et puis, un genre capable de bien payer les auteurs doit être encouragé ! Et Fitzgerald et Faulkner ont eu un « après Hollywood », ont écrit de nouveaux romans – leur passage à Hollywood n’ayant pas anéanti leur maestria. Il arrive, bien sûr, que l’auteur d’une pièce ou d’un scénario ne soit en fin de compte qu’un co-auteur, inévitablement, car le cinéma est un « art total » réunissant image, musique, texte et acteurs. L’état de co-auteur est honorable. On se rappelle des grands duos de dramaturges comme, aux États-Unis, Edna Ferber et George S. Kaufman (Stage Door/Pension d’Artistes, 1936) et des scénaristes tels que Charles Brackett et Billy Wilder (LostWeekend/Le Poison, 1945 ; Boulevard du crépuscule/Sunset Boulevard, 1950 ; etc.).
Entretien © Trudy Bolter & D-Fiction – Illustrations © DR
(Bordeaux, sept. 2016)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
