ÉRIC RONDEPIERRE s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à l’occasion de la publication de son roman, PLACEMENT (Le Seuil, 2008) :
1 – Éric, tu dis dans la monographie qui t’est consacrée (Éric Rondepierre, avec une préface de Pierre Guyotat, Paris, Léo Scheer, 2003) que la plupart de tes œuvres découle de réflexes « primaires » ou « désordonnés » qui sont comme des « bouteilles à la mer, des gestes d’aveugle lancés vainement, au hasard ». Si c’est le cas pour la photographie ou la peinture, l’est-ce également lorsque tu écris ?
Hormis Placement, dont je connaissais le sujet à l’avance, j’écris en aveugle sans plan et sans idée préconçue, comme cela vient. Si je me lève avec une « bonne idée », il est rare qu’elle franchisse le cap de l’écrit. Ou alors il faut qu’elle soit floue, inconsistante, un mouvement, une image, un mot, très peu de choses. Au fur et à mesure, des lignes se dessinent, des motifs apparaissent. C’est assez long à cause des choix dont je recule toujours l’échéance. Dans la photo et dans la peinture, c’est la même chose. Sans doute est-ce la raison pour laquelle je n’ai pas fait mes photos moi-même, pendant longtemps : il fallait que ça m’arrive de l’extérieur, de quelqu’un d’autre, que je ne puisse rien prévoir. Évidemment quand j’émets un geste, il se retourne. Par exemple, si je vais aux États-Unis chercher des bandes-annonces, je trouve le Précis de décomposition qui est tout à fait autre chose, etc. Même encore maintenant, je ménage des zones d’ombre qui me permettent d’avancer, aussi bien dans l’écriture que dans la photo. Je suis de ceux qui sont allergiques à l’ennui qui peut se dégager d’une prévision ou d’une planification : j’ai peur de remplir les cases. C’est aussi que je ne crois pas qu’il soit possible pour un écrivain d’écrire (ou pour un artiste d’œuvrer) en sachant à qui il s’adresse, ce qu’il va écrire et dans quel but. Ce qui me pousse à écrire (ou à photographier), c’est justement cette disjonction entre la cause et l’effet. Bref, sans consentir aux motifs romantiques qui peuvent se déduire de cette position, j’ai du mal à me programmer. Il me plairait d’être soumis à un système de déprogrammation permanente, ce qui est un paradoxe, vous en conviendrez !

2 – Revenons à tes débuts, tes études… Tu as un parcours universitaire conséquent et qui déjà, lie arts visuels et littérature. Peux-tu nous en parler ?
Ma formation est plurielle. D’une part, les Beaux-Arts, de l’autre, l’Université. Mais c’est le théâtre qui me forme vraiment sur le tas après ces études dont l’unique intérêt est de m’avoir fait rencontrer quelques personnes dans une époque (après 68) où l’ouverture était de mise. Mon premier livre était composé d’une seule phrase dont certaines lettres s’inscrivaient sur le verso d’images gravées (eaux-fortes et aquatintes). C’était aux Beaux Arts de Paris en 1978. Un exemplaire a été déposé à la BnF sous le titre Mai d’Ose. C’était un livre isolé, lancé au hasard, sans descendance. Plus de trente ans se sont écoulés pendant lesquels j’ai fait beaucoup d’autres choses, mais la relation du texte et de l’image est une donnée qui revient nettement plus tard sous une forme ou sous une autre dans beaucoup de mes travaux, je dois le reconnaître. Quant à parler de littérature, c’est une autre question. Je m’en fais une idée bien trop haute pour la compromettre dans des travaux plasticiens qui n’ont que peu de rapport avec ce qu’elle représente pour moi depuis ma formation justement.
3 – Durant ces années de formation artistique, tu es passé par des phases très « physiques » : notamment par la danse, le théâtre et les performances. En quoi le travail sur et par le corps nourrit-il le travail intellectuel ? Qu’est-ce que ces activités de création physique ont permis de dépasser, de concrétiser dans ta création intellectuelle ? De même, peux-tu nous dire si l’écriture et la photographie nourrissent elles-mêmes les activités de création physique et de quelle manière ?
Disons d’emblée que je n’ai pas exercé ces pratiques en même temps. Photo, peinture et écriture sont venus après la fin de ma période que vous appelez « physique » (théâtre, danse, performance). Donc, votre dernière question n’appelle aucune réponse car si une pratique s’est nourrie de l’autre, cela n’a pu se faire que dans un seul sens. En revanche, il me semble que dans mon travail photographique, j’ai traversé des zones frontières qui étaient proches de celles que j’ai pu rencontrer avec mon corps dans les années théâtre. Le fait d’avoir développé une relation physique, « directe » au temps, au mouvement ralenti, aux interstices et aux ruptures, m’a sans doute servi. J’ai conservé cette sensibilité aux seuils, aux limites, à ces moments fugaces où l’identité des choses vacille. Cela posé, le travail physique théâtral et celui de photographe d’archives mobilisent des corps différents. C’est comme si tout le concentré du travail corporel de l’acteur s’était transformé, traduit dans la langue d’un spectateur dont le corps serait réduit à un œil (hyperactif, certes). Passant d’une hyperkynesie à une hyperscopie, je ne suis pas certain qu’il reste grand chose d’un processus physique. Quant à l’écriture, elle s’en nourrit dans la mesure très limitée où cette période « physique » peut apparaître comme thème narratif dans mes livres. Dans les premiers chapitres de La Nuit Cinéma, par exemple, je fais allusion au dernier rôle (Télamon, père d’Ajax) que j’ai joué. Il se trouve que le narrateur, choisi pour ses qualités physiques, est condamné à rester immobile enfoui sous des tuiles dans le noir pendant une demi-heure avant le commencement de la pièce. On peut évidemment y voir une préfiguration de ma condition de photographe à venir. Dans la suite du spectacle, il joue le rôle d’un mort évoluant avec les autres acteurs sans être vu d’eux, n’appartenant pas à la même couche de temps. On peut y voir aussi un écho de mes dernières séries (Parties communes et Seuils) ou des personnages de films anciens cohabitent avec des personnages et des décors actuels. Tout cela n’est évidemment pas concerté, c’était une idée du metteur en scène, mais le présent et le passé peuvent s’éclairer l’un l’autre.
4 – Tu es devenu un artiste pluridisciplinaire. À partir de quel moment ressent-on la pertinence et la nécessité de passer d’un médium à l’autre d’abord et ensuite de les articuler comme tu le fais dans de nombreux travaux ? Quels sont ces moments chez toi, ces émergences de nouvelles pratiques ?
En écho à la première question, je répondrais que l’émergence de nouvelles pratiques et même l’absence de pratiques (début des années 80), toutes ces évolutions, ces changements sont liés à des facteurs conjoncturels ou hasardeux dont il serait fastidieux de relater ici les tenants et les aboutissants. Dans un deuxième temps, on peut toujours trouver des pertinences et des nécessités après-coup. Il reste que cela se fait malgré nous dans l’occasion. Il y a néanmoins un choix qui s’est imposé, celui de la photographie (sans rien y connaître) parce que c’était le meilleur moyen de témoigner de ce que je voulais montrer : le photogramme. Et puis, avec le temps, c’est devenu autre chose. J’ai écrit, à l’époque, pour m’expliquer à ce sujet. Et puis l’écriture aussi s’est infléchie progressivement. J’observe, par ailleurs, que lorsque l’écrit disparaît de mes images, je commence à publier des livres. Ce n’est qu’avec Loupe/Dormeurs que cette relation devient consciente et se trouve travaillée en tant que telle. Pour en finir avec la pluridisciplinarité, qui est devenu le lot commun de la plupart des jeunes artistes, on pourra me considérer comme un comédien qui a fait du théâtre, de la danse, de la peinture, de la photo, des livres, des performances. Ces pratiques formant une suite de rôles à endosser que la vie m’a offert avec sa générosité coutumière et dont beaucoup se sont dissous dans l’atmosphère. Pour tempérer cette pluridisciplinarité éphémère, je pourrais dire dans le même temps : depuis 1992, mon médium dominant est la photographie et je n’en ai pas changé.

5 – Ta création photographique est essentiellement composée de « photogrammes », c’est-à-dire non pas par des « prises de vues » mais par des « reprises de vue ». Comment as-tu trouvé et as-tu amené à la surface visible d’un film, ces « trous noirs » ou ces matières qui sont tous invisibles à l’œil nu pour le spectateur mais qui existent pourtant bel et bien sur la pellicule comme dans tes trois séries Annonces, Précis de décomposition et Moires, à savoir : les aberrations visuelles, les incrustations illisibles, l’altération, la décomposition, la décoloration et la corrosion des images, etc. ?
Je possédais une télévision et un magnétoscope que Catherine Diverrès m’avait offert après qu’elle m’ait utilisé comme « comédien physique » dans un de ses spectacles (Lie, 1985). Je regardais des vieux films au Ciné-Club (A2) et au Cinéma de Minuit (FR3). La touche « arrêt sur image » a tout de suite capté mon attention. Il y avait un effet d’étrangeté inhérent à l’arrêt mais il fonctionnait sur toutes les images. C’est sans doute pourquoi j’ai décidé de n’en prendre aucune. Il me semblait qu’avec le noir, j’intégrais le virus contradictoire de l’arrêt tout en montrant quelque chose de singulier, d’ironique, de reposant qui échappait à cet effet, en travaillant sur la limite de ce qu’est un film. Excédents est le nom de la série parce que ces images noires sont des suppléments involontaires, au statut indécidable, qui n’apportent rien au film lui-même. Pour les reproduire, j’utilisais la touche « ralenti » en choisissant le bon photogramme et l’arrêt sur image en photographiant l’écran de ma télévision avec un appareil 24 x 36 standard chargé d’une pellicule peu sensible. Pour les Annonces, le choix était plus difficile puisque chaque image était différente (alors qu’un noir ressemble toujours à un autre noir à la TV). Dans le mouvement très rapide du texte j’isolais le photogramme qui m’intéressait où le texte restait encore informe, comme une tache sur l’image. C’est avec cette série que je commence à faire mes recherches en archives (Bois d’Arcy). Le Précis de décomposition ouvrira cette enquête vers les USA, le Canada et l’Europe. Celle-ci m’a fait découvrir le film « malade ». Le principe est le même mais le travail se fait sur la table de montage avec un équipement plus complet comprenant soufflet, objectif macro, reprodia et lampe halogène. Je n’ai pas encore conscience de la cohérence de mon propos sur le « trou noir ». Ce que je voulais faire, c’était simplement montrer les jeux de l’image et du hasard, du temps et de l’archive. Comment l’image continue à dans le noir, si j’ose dire à, à travailler pour elle-même, c’est-à-dire à actualiser sans arrêt le travail de sa propre mort. Autrement dit, comment le subjectile participe involontairement à l’économie de l’image (sur cette question, je renvoie au livre très fouillé de Thierry Lenain (Eric Rondepierre, un art de la décomposition, La lettre volée, Bruxelles, 1999). J’en ai montré quelques échantillons en 1995. La procédure est la même pour Suites, la série suivante. Ces images non plus ne sont pas vues car on ne voit jamais la projection de l’entre-deux images. Je me suis donc aperçu que toutes les pièces de ces séries depuis quinze ans étaient effectivement invisibles mais, à chaque fois, pour des raisons différentes. Je n’ai jamais eu l’idée de traquer le photogramme invisible (ils le sont par définition), ça n’a jamais été un concept ou une marque de fabrique. J’étais plus intéressé par le fait qu’ils soient involontaires. C’est pourquoi je les repère non pas dans des films expérimentaux mais dans la « grande syntagmatique des films narratifs » (Metz). J’invitais le sous-titreur et l’auteur à un colloque dont j’étais l’organisateur. Chaque image noire est une réunion de volontés qui s’ignorent. J’ai commencé Excédents par fatigue de l’image. J’avais besoin de sortir du cinéma, de partir sur des bases « négatives ». Pas d’image : quelques mots blancs. Puis, les Annonces : de l’image, mais trouée par l’absence de mots. Le Précis : des images, des mots, mais effacés, déformés, troublés. Enfin, Suites : une image divisée, inversée C’est peut-être tout le cinéma que j’aurais voulu à l’envers, reconfiguré à mon usage, dans une sorte de contre-emploi.
6 – Ces photogrammes sont directement le résultat de tes réflexions menées sur le cinéma et plus particulièrement sur les niveaux de lectures des films, sur le spectateur et le « spectacle », sur ces zones intermédiaires et non-visibles des films. Comment as-tu eu l’idée de travailler sur cette non-visibilité et pourquoi ? Théorie et pratique s’imbriquent chez toi, comment les articules-tu ?
La seule chose qui ait influencé directement mon travail sur le photogramme est l’acquisition d’une machine : le magnétoscope. Grâce aux changements de vitesse, à l’enregistrement et à l’arrêt sur image, je pouvais feuilleter le film comme un livre. Schopenhauer rapproche le feuilletage du rêve. A vingt ans, je voyais quantité de films à la cinémathèque de Chaillot ; vingt ans après, grâce au magnétoscope, je pouvais les rêver. Mon aire de jeu intellectuelle n’est pas la pensée sur le cinéma. Je connais les textes théoriques mais je ne peux rien en faire si ce n’est vérifier après-coup quelques intuitions, comme on se réveille d’un rêve. Par exemple, j’ai écrit sur Le Voyeur de Powell mais bien après avoir pris une photo dans ce film. Et lorsqu’il m’est arrivé d’écrire sur mon travail, il m’a semblé plus pertinent de passer par la fiction que par des textes théoriques. Moires, La Nuit Cinéma ont été écrits pour témoigner, prendre de la distance et essayer de comprendre. Ils n’ont fait que reculer le problème. Pourquoi commence-t-on une telle recherche ? Cela reste mystérieux même si je peux faire remonter la démarche à mes quinze ans (cf. Moires, 1998 ou Placement, 2008). Ce que j’ai pu appeler la « revanche du spectateur » est cette part d’interactivité introduite par le magnétoscope (prolongé par la table de montage) qui a permis, par exemple, au non-visible d’apparaître. Je distingue trois étapes de mon entrée dans ce continent noir qui correspondent successivement à trois films. La Dame du Lac (Robert Montgomery) : prise de conscience du noir. Le Voyeur (Michael Powell) : reprise de vue d’une photo noire. Chronique d’un Amour (Michelangelo Antonioni) : démarche artistique consciente avec développement en série de ces noirs. Ce n’est qu’avec ce dernier film que j’ai décidé de mener une enquête assidue et d’en faire part. Il faut dire que, pour Antonioni, c’était la première fois que je voyais des noirs qui n’appartenaient pas au contenu du film. Je me demandais quelle pouvait bien être leur fonction (en l’occurrence 1/3 de seconde = 8 noirs). Cette interrogation et sa non-élucidation ont été décisives. La réponse au pourquoi est aussi historique que parodique. J’y vois à présent le chant funèbre et comique d’un adieu qui serait un commencement. La parodie est une parade, célébration dérisoire d’un paradis perdu, d’un cinéma qu’on arrête (en espagnol, parar) une dernière fois avant qu’il ne disparaisse. Une histoire deuil.

7 – Le cinéma et la photographie sont deux médiums différents mais finalement ont le même support : la pellicule appelée également le film. Dans la monographie qui t’est consacrée, Daniel Arasse – qui te cite – revient précisément sur ce travail que tu effectues de « tuer le cinéma pour «décortiquer» et «disséquer le corps du film», pour faire son «anatomie» et son «autopsie par la photographie» ». Peux-tu nous en dire davantage ? Par exemple, que cherches-tu exactement dans cette autopsie ? En quoi décortiquer le corps du film répond-t-il à ton questionnement sur l’image ? Que te permettent de découvrir ces « reprises de vue » que ne te donneraient pas à voir simplement des « prises de vue » ?
J’ai utilisé la métaphore médicale à partir du Précis de décomposition à cause des films « malades » mais elle est valable pour toutes mes reprises de vue. Disséquer un corps, c’est avoir accès aux organes internes. On ne peut le faire que sur un corps mort. De même lorsqu’on regarde un film en salle, le mouvement vous transmet une synthèse de 24 images par seconde et vous ne pouvez échapper à la temporalité du film qui est sa vie. Si, par contre, vous voulez analyser ce mouvement, il vous faut arrêter le film, ouvrir son « corps », c’est-à-dire accéder à ses composantes : les photogrammes, la pellicule. Ce sont deux regards différents et incompatibles. Il faut choisir entre le photogramme et le film. Mon intervention consiste à rejouer cette opposition entre Lumière (la synthèse) et Marey (l’analyse) si vous voulez. Mais à l’intérieur du film lui-même (c’est ce que j’ai appelé « mettre Marey en Lumière »). La « revanche du spectateur » consiste à disséquer le corps du film de façon à trouver d’autres relations que celle qui nous sont dictées par la synthèse de la projection où chaque photogramme est invisible. Par exemple, dans Suites, la relation entre un photogramme et celui qui le suit n’est possible qu’à examiner le corps du film alors que la projection nie cette différence par sa synthèse illusionniste. J’ai d’ailleurs commencé cette série dans un pays où on me donnait, exceptionnellement des morceaux de films. Au lieu d’avoir une photo que j’avais prise d’un photogramme, je me trouvais en possession d’une succession de 10, 20 ou 100 photogrammes. J’ai pris conscience de l’enchaînement et une série s’est imposée. Le fait de travailler sur des unités très petites (18 m x 24 mm) a déclenché une autre série (Loupe/Dormeurs). Tout cela est évidemment impossible lors d’une projection. Pour répondre à votre deuxième question sur la reprise de vue, je suis obligé de prendre du recul, de m’expliquer en abordant un plan plus général. Dans mon travail de prélèvements (d’Excédents à Suites), les photos sont « déjà vues » puisque quelqu’un les a prises en vue avant moi. Je les reprends, en me situant derrière le regard d’un autre. Mais ces « reprises de vue » sont aussi « invisibles » (cf. question 5). C’est le paradoxe d’images invues et déjà vues. Ou pour le dire plus clairement, il s’agit d’une répétition sans original. Or, c’est exactement ce à quoi nous avons affaire au cinéma. D’une part, un matériau constitué de copies (qui varient souvent entre elles) considéré toutes comme originales non signées. Je ne connais pas d’équivalent de ce phénomène dans d’autres pratiques artistiques. D’autre part, ce paradoxe se poursuit à l’intérieur du sujet percevant ce matériau-cinéma. Soyons précis : j’explique dans Placement comment le monde extérieur m’a été offert par le cinéma. C’est une donnée biographique, anecdotique qui ne doit pas nous empêcher de constater que l’on ne peut plus voir le monde directement. L’idée même est devenue suspecte. Le film fonctionne alors comme une image du monde, qui me donne accès à ce monde. C’est une sorte de Bovarysme, si vous voulez. La réalité seconde est première : je suis informé de la vie par son enregistrement, de l’original par la copie. La forme cinématographique nous informe et nous forme. J’ai simplement pris ce Bovarysme perceptif à la lettre : la perception est un film. Prise ou reprise de vue, c’est tout un. Pendant quinze ans, je me suis attaché à ces artefacts très particuliers que Bernard Stiegler appelle des « rétentions tertiaires ». Le film en est une. Il ouvre sur le monde par ses qualités analogiques d’immersion mais c’est aussi un souvenir objectif, consultable, une sorte de prolongement de la conscience du monde, une prothèse de la mémoire. Et ce qu’on appelle la « vie » ou la « réalité » est-il autre chose que la conscience que nous avons d’elles ? La structure de la conscience est cinématographique. Nous captons, montons, derushons sans arrêt : ralenti, accéléré, arrêt sur image. Moi, je le fais littéralement. Ça me permet d’œuvrer au deuxième degré. D’être le deuxième homme, comme dans une filature. Le deuxième homme, c’est tout le monde. Tout le monde fait de la re-prise de vue.

8 – Parmi les films qui ont déterminé ta recherche, voire qui l’ont révélée, tu cites Lady in the Lake (1947) de Robert Montgomery, Peeping Tom (1960) de Michael Powell, Chronique d’un amour (1950) de Michelangelo Antonioni mais jamais Hurlements en faveur de Sade de Guy Debord. Or, ton travail consiste essentiellement à montrer le « noir » au cinéma, précisément l’« écran noir » jusqu’à titrer un de tes textes romanesques, La Nuit Cinéma (Paris, Le Seuil, 2005). Comment te « situes-tu » par rapport à Guy Debord ?
Vous parlez du tout début de mon travail (Excédents) qui portait sur des classiques de l’histoire du cinéma passant à la télévision. Mais même depuis quinze ans où je fais autre chose, je choisis dans les archives, de préférence des films narratifs, un corpus d’auteurs inconnus ou de troisième zone, car c’est avec lui que l’illusion fonctionne à plein. J’ai toujours évité la fréquentation des avant-gardes parce que l’iconoclasme est volontaire et revendiqué. De Ruttman (1936) à Oliveira (2000), en passant par Isou, Debord et de nombreux autres dont Duras, il y a une tradition du film « noir » (la liste est longue). Je n’ai pas l’intention d’en rajouter dans ce sens. Par contre détourner un film narratif (polar), classiquement ou pauvrement narratif (karaté, porno, etc.), cela me séduit beaucoup plus. Comme je fais de la reproduction de document, je ne suis pas retenu par l’intérêt artistique d’un film mais par le ruban cinématographique en tant que tel comme « nature ». Celle-ci étant plus à nu dans les films sans recherche formelle particulière, le détournement sera plus ouvert et plus fort. Je n’ai jamais vu Hurlements en faveur de Sade. Debord se situe, pour moi, dans une tradition du détournement qui remonte au moins à Lautréamont. On peut me rattacher à cette pratique en général, mais je ne vois aucune raison de m’arrêter sur un nom. En ce qui concerne les Excédents, rétrospectivement, ils me semblent plus proches de ce qui se faisait dans salons comiques du XIXe que du Situationnisme. Je vous rappelle qu’Alphonse Allais est l’auteur d’un tableau noir intitulé Combat de nègres dans une cave. C’est l’écrit (la légende) qui fait l’œuvre au moins autant que le noir. Mes noirs n’ont aucune matière. Ils sont lisses et uniformes. Il s’agit d’une absence d’image sans être un monochrome puisque le blanc de quelques mots viennent s’y inscrire. Les jeux sémantiques entre le titre de l’œuvre (qui est le titre du film-source), le sous-titre, et quelquefois l’intertitre sous-titré dans une autre langue, ancrent le noir ailleurs en instaurant avec lui d’autres liens (en général humoristiques) qui n’ont plus rien à voir avec la fiction d’origine.
9 – Tu as également produit des séries de photogrammes envisagés sur un autre mode de production : nous pensons à Stances, à Dyptika, à Suites ou encore à Moins X. Dans ces séries, parfois tu retires la couleur, parfois tu utilises le train pour les prendre à grande vitesse, parfois tu inverses la partie supérieure avec la partie inférieure et même glisses la partie supérieure de l’une avec la partie inférieure de la suivante, parfois tu cadres entre deux images d’un film, etc. Mais, ces photogrammes ont un point commun : ils sont tous divisés en deux parties. Que voulais-tu révéler en les divisant ainsi ?
Je pense que le geste de diviser se rattache et prolonge le geste princeps qui préside à tout ce que j’ai fait : couper (« Couper, c’est bon ! »). C’est une pulsion archaïque de destruction pure et simple qui se négocie différemment à chaque série. Dans celles dont vous parlez, le geste déborde au cœur de l’image elle-même qui se trouve séparée en deux. Le sens de cette séparation diffère selon les travaux. Dans Stances (1996-1998), elle prend place dans le « réel », si l’on peut dire (cf. question 7), par simple prise de vue. Si vous baissez à fond une fenêtre de train ancien jusqu’à la moitié de la vitre, elle sera divisée en deux. J’ai choisi de capter les instants où la crête de l’horizon épouse la barre de la fenêtre, ce qui partage l’image nettement entre ciel et terre. Dans Diptykas, Suites et Moins X (de 1999 à 2003), il s’agit de photogrammes. L’image de film est l’objet d’un recadrage sans manipulation (sauf le retrait de couleur de Moins X). L’élément nouveau et intéressant de mon point de vue est que si l’on cadre entre deux images de cinéma, il y a nécessairement une inversion des deux parties de l’image qui se suivent verticalement. La valeur de cette inversion change suivant les cas. Pour résumer ce que j’ai développé dans La Nuit Cinéma, je dirai que cette division crée deux images à partir d’une et que le regard est amené à balancer entre 1 et 2 sans pouvoir se fixer, en franchissant le seuil du cadre, c’est-à-dire la barre de séparation entre les photogrammes du film. Le décadrage crée une circulation du regard inédite qui creuse l’image : les parties peuvent s’autonomiser et reformer deux images, ou au contraire n’en faire qu’une, la perspective s’inverser (Le Café), les directions également (plus on monte dans l’image, plus on descend). On est assez proche d’un travail onirique, comme l’a bien noté Daniel Arasse. Dans les Hypothèses (2003-2005), cette division devient volontaire et ne doit plus rien au cinéma. Je place une partie d’image en-dessous l’autre (étymologiquement, hypothèse : placer en-dessous). Retour au réel, la conscience en plus: la boucle est bouclée. Il faut dire qu’entre temps, j’ai arrêté les prélèvements directs avec Loupe/Dormeurs (1999-2002).

10 – Loupe/Dormeurs est un travail en rupture avec les séries précédentes : tu as composé une série de photographies numériques. Chacune de ces photographies montre un premier plan où l’on voit un morceau de pellicule tenu entre des doigts et un second plan avec une femme dans différentes postures et attitudes. Mais le plus époustouflant n’est pas là : chacune de ces photographies est composée avec les 156.000 signes typo d’une fiction qui sert à l’image de pixellisation et qu’on découvre à mesure que l’on se rapproche d’elle ! Qu’a représenté pour toi ce travail ? Qu’a-t-il marqué comme tournant dans ton travail au-delà de l’abandon de l’argentique pour le numérique ?
Ce travail est né en Grèce, en même temps que je commençais les images divisées en deux (Diptykas) et que j’écrivais autour de mon travail, dans ce pays où il prenait un sens particulier. Ce fut donc un séjour profitable. La maturation fut longue puisqu’il m’a fallu trois ans avant de les montrer. Il y eut d’abord les prises de vues argentiques de « l’artiste au travail » dans les chambres d’hôtel avec ces bouts de pellicules dont j’ai parlé et leur visionnement microscopique à la loupe. Et puis, beaucoup plus tard, l’incrustation numérique du texte dans l’image. J’ai inversé mon projet de départ. Au lieu d’écrire un texte qui inclurait des images ponctuellement à l’intérieur, j’ai inclus le texte en entier dans chaque photographie. Chacune des onze photographies EST un livre (titres : Livre n° 1, n° 2, n° 3, etc.) qui comporte ce jeu sur les distances que vous avez relevé. Avec cette série, il y a plusieurs éléments nouveaux : j’interviens directement sur l’image (je la fabrique au lieu de la prélever), dans l’image (ce sont mes doigts que l’on voit), et dans l’écriture (Dormeurs, version inédite – qui deviendra La Nuit Cinéma – n’appartient plus à l’image : je l’ai incrustée moi-même dedans).
11 – Tu as réitéré, plus récemment, cette insertion du texte dans l’image avec tes Agendas (2002 à 2006). Te paraît-il important que le texte et l’image soient ainsi associés, voire confondus et fondus l’un dans l’autre ?
L’agenda continuera, j’espère, jusqu’en 2012 compris. J’en fais un chaque année. Il est tout à fait nécessaire que l’écriture d’un an et les 600 ou 700 photos prises en cours d’année soient fondus l’un dans l’autre, se brouillant mutuellement. Le projet est plus vaste : faire une seule photo de dix ans qui comprendrait tous les agendas précédents. C’est là que j’atteindrais la matière qui me convient, la non-commune mesure entre texte et image atteignant son comble et formant ce bloc de temps illisible et invisible que tout être humain dépose quelque part avant de s’en aller.

12 – Parties communes renoue avec le cinéma muet, tout en reprenant des images de la série des Agendas. Que cherches-tu à produire comme effet entre des images du passé et des images du présent, du moins, du contemporain ?
Cette série est venue à partir des images divisées et puis, avec le temps, la séparation est devenue verticale, puis finalement a cédé. Cette confrontation du présent et du passé dont vous parlez, c’est aussi la réunion de deux médiums (photo et cinéma), l’amalgame des prises de vue et des reprises de vue dans un même espace. Cela devient une seule et même chose et pourtant deux temps cohabitent dans une sorte de coexistence pacifique, si l’on peut dire. J’ai pris des films muets parce que l’écart est plus grand avec le contemporain (presque un siècle), ce sont les premiers films. Il en ressort des zones de hantise, d’hallucination, qui s’apparentent à un rêve et, pourtant, on y voit des choses de mon quotidien, les rues de Paris, des amis, mon appartement, des parcs, des gares. C’est toujours un travail sur la mémoire, qui donne une impression de « déjà vu » mais réactivé dans le présent. Seuils (montré à Lyon en mars 2010) est la suite logique de Parties communes. Dans ces données biographiques iconiques (puisque ces photos viennent des Agendas), on me voit apparaître sur trois photos. Ce ne sont plus mes doigts comme dans Loupe/Dormeurs mais ma silhouette à peine reconnaissable. Sur l’une d’elles, je suis en train de prendre la photo que l’on voit (j’ai fait un commentaire de cette photo dans Que lisent les artistes ?, (Artpress 2, n° 14, auquel je renvoie). J’ai un peu l’impression d’être ce personnage de L’Invention de Morel de Bioy Casares qui essaie de vivre dans un film dont il s’aperçoit qu’il se déroule sans public, pour l’éternité. D’abord, il y met la main, puis il apprend son texte et finalement s’intègre à un schéma narratif déjà existant sans déranger les personnages qui y figurent. Un spectateur non prévenu, dit-il, pourrait s’y laisser prendre. J’aimerais m’y laisser prendre. Derrière ce travail, il y a l’idée générale un peu inconsciente de relier des couches de temps indépendantes et de vivre à l’intérieur. L’image, c’est toujours un peu le passé, une façon de communiquer avec les morts, non ?

13 – On découvre en toi une sorte de « plongeur de fonds » dans le sens où tu fais remonter à la surface des découvertes qui viennent du fond des bobines mais également une sorte de coureur de fonds dans le sens, cette fois, où tu vas chercher ces images dans des cinémathèques lointaines et que ce travail s’étale sur plusieurs années. Tu as d’ailleurs publié dans Trafic (Printemps 1995) un texte intitulé « La Solitude du photographe de fonds » qui relate tes recherches journalières effectuées durant l’été 1993 dans les cinémathèques de New York, Washington et Rochester. Explique-nous quel est le quotidien du photographe de fonds et si d’autres que toi effectuent de semblables recherches.
C’est une recherche de base, fondamentale, que j’ai arrêté pendant dix ans. Elle est maintenant réduite au minimum. Je la trouve ingrate et pourtant nécessaire pour mon entreprise. Il faut d’abord être accepté et ce n’est pas une mince affaire. Dans les pays où les cinémathèques sont bien organisées, ma journée est la même que celle des fonctionnaires qui y travaillent. Je fais mes huit heures de visionnement, film après film. La vitesse change avec les séries. Pour le Précis, Moires, un film peut prendre quinze jours. Pour d’autres, je peux voir dix films dans la journée. Cela se passe, en général, dans une petite cabine sombre et sans air, dans une solitude quasi totale (en Italie, je pouvais même y aller la nuit, on m’avait donné les clefs). Les protocoles diffèrent selon les pays. Certains sont très pointilleux, d’autre complètement « relâchés » (je pense à la Grèce où l’on ne comprenait pas l’utilité de l’appareil photo et où l’on me conseillait les ciseaux). Les appareils, le personnel, les techniques d’archivage, les lois du copyright, les règlements de l’administration, celles de la politesse et du savoir-vivre, les équivoques linguistiques et les problèmes de communication, le mode d’accès aux films, les procédures de repérage, la disposition des corps dans l’espace, l’espace de visionnement lui-même avec les appareils, la gestion des mouvements entre ces appareils, tous ces codes, ces techniques, ces procédures infléchissent et normalisent les recherches et donc la vision elle-même. C’est pourquoi, j’en ai parlé dans mes livres. Le travail ne s’arrête pas où l’on croit. Tout un système de consommation de l’archive rigoureusement déterminé et implicite oriente l’accès aux images et donc les images elles-mêmes. A ma connaissance, il n’existe pas de photographe que ce genre de recherche intéresse. Le seul artiste dont j’ai appris l’existence récemment est un cinéaste américain (Bill Morrison) qui a travaillé dix ans après moi (en 2003) à la Library of Congress de Washington, dans les mêmes bureaux, peut-être dans les mêmes stocks. Son orientation est très nettement celle du Précis de décomposition à cela près qu’il réalise des films. Autrement, ce sont plutôt des historiens que l’on rencontre, des gens qui travaillent à des livres érudits sur le cinéma, des revues, des thèses, etc. Mais je ne connais pas tout, évidemment…

14 – Il y a un intertexte fort chez toi, qui renvoie d’ailleurs à tes photogrammes, à ces reprises. Par exemple, il y a un Stein dans La Nuit Cinéma, qui évidemment fait pensé à Duras, Le jour où Laura est morte (Arles, Actes Sud, 1995) est un clin d’œil à la Laura de Preminger (1944), etc. Parle-nous de cette dimension poundienne de ton travail, ou l’œuvre admirée est inscrite dans ton propre travail à travers la mécanique complexe des citations et détournements.
Effectivement, mon travail est de part en part intertextuel, puisqu’il se nourrit des images des autres. Il appartient à un milieu de repères et de références qu’il est difficile d’éviter. Dans l’écrit, certains sont inconscients (on me les signale), d’autres volontaires. Stein est un clin d’œil à Duras. Mais Stein signifie « pierre » en allemand, et comme ce personnage assume une partie de mon travail (Le Précis de décomposition), je lui ai aussi attribué une partie de mon nom qui se répète dans mon prénom (Éric Pierre). Le Jour où Laura est morte est un Excédent de Rondepierre pris dans Laura (dont la bande-son est : During the week-end Laura died). J’ai appris, plus tard, que Serge Daney l’avait utilisé pour un article (« Le jour où l’aura est morte »). Il m’est arrivé de reprendre des textes en changeant seulement quelques mots. Ce ne sont pas forcément des œuvres admirées. Comme je l’ai dit à la question 7, les rétentions tertiaires nous habitent et nous construisent. A ce titre, je ne fais pas de différence entre la Bible, un film ou une chanson populaire. Il m’arrive de citer (sans le dire) Claude François dans Toujours rien sur Robert ou Sheila dans Moires (en le disant). Par ailleurs, j’ai tendance à me citer moi-même ou à reprendre mes propres textes, les détournant de leur sens premier ou les améliorant. C’est ainsi que plusieurs textes d’Apartés sont repris dans La Nuit Cinéma, qu’un Excédent est présent dans une image de Seuils dont le titre renvoie à Orson Welles (Arkadin), etc. Il y a une image intertextuellement complexe, « La Muette », à l’intérieur de laquelle j’ai intégré une image noire prise dans un film de Bergman (Persona) sur un placard publicitaire du métro. C’est peut-être la seule photo (qui n’est pas une œuvre mais une illustration faites pour un livre : Moires) où l’intertexte est volontaire et significatif, nécessitant une certaine connaissance des éléments en jeu. Je ne peux ici que renvoyer à l’analyse faite par Daniel Arasse (Anachroniques, Gallimard, Paris, 2006).

15 – La Nuit Cinéma (Paris, Le Seuil, 2005) est une véritable réflexion sur la vie et la photographie en général comme sur ton parcours et ton travail en particulier… mais sur fond de guerre dans les Balkans et sous forme de fiction. Tu glisses dans ce texte quelques-uns de tes photogrammes pour l’illustrer. D’ailleurs, le titre même du livre est également celui d’une exposition faite au Grand Palais en 1992. Qu’est-ce qui a motivé la rédaction de cette fiction ?
C’est Bernard Comment qui a eu l’idée de glisser quelques images. C’est aussi lui qui m’a demandé quelque chose à l’époque de son entrée aux Éd. du Seuil. Suite à mon séjour en Grèce, je voulais un livre qui soit un document autour (cf. question 13) de mon travail mais passant par la fiction. Une sorte d’archive narrativisé. Cette répartition document/fiction m’a d’ailleurs toujours semblé problématique. Mon travail consistant à reproduire des documents prélevés dans des fictions, j’ai été amené à considérer mon entreprise comme une « expérience sans vérité ». Une chose peut être son contraire, par exemple : tout est vrai et tout est construit. L’exposition au Grand Palais dont vous parlez (ma première exposition) s’appelait La Nuit DU cinéma. L’éviction de l’article « du » pour le titre du livre, rend la nuit consubstantielle au cinéma. La Nuit peut être vue comme une grande projection où les personnages et le décor (Les Balkans) appartiennent au film. A la fin, les lumières s’allument.
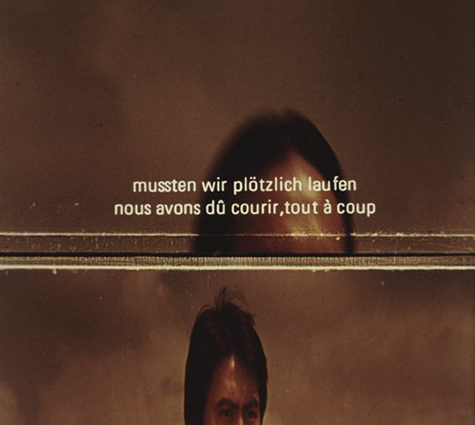
16 – Revenons à ta dernière fiction, Placement. C’est la plus « difficile » à lire, non pas dans sa langue ni dans sa réflexion, mais dans son intention : retracer la vie d’un certain Éric Rondepierre qui, à l’âge de onze ans, se trouve « placé » pour « mesures de protection et d’éducation » par la justice française et donc, retiré à sa famille pour sept longues années d’internat. Ce récit douloureux est en même temps incroyablement étonnant et formidable dans le récit que tu donnes de ton éveil intellectuel à travers les œuvres artistiques, filmiques et littéraires qui t’accompagnent tout au long de cette expérience de la vie pour le moins marquante et difficile. D’où vient ce texte et comment s’est déroulé sa rédaction ? Quelle expérience psychologique en as-tu tiré ? Cela a-t-il été réparateur pour toi ou, au contraire, infernal à « revivre » ?
La préface de cinq pages de Pierre Guyotat parue aux Éd. Léo Scheer (Éric Rondepierre, 2003) me semblait suffisante sur le sujet. Je me suis finalement rangé à l’idée de mon éditeur, qui était de développer cette matière et d’en faire un livre. Ce ne fut pas un calvaire psychologique et je n’ai rien revécu de spécial, c’est comme si je relatais la vie d’un autre. Je n’ai simplement eu aucun plaisir à l’écrire car, comme je l’ai dit au début de cet entretien, j’ai du mal à me programmer. Or, c’est exactement ce que j’ai fait. Je me suis considéré comme un cas parmi d’autres (mais que je connais mieux que les autres) sur lequel j’ai fait un travail de recherche. Puis, j’ai livré ces données construites comme un document dans un style concis et clair, sans intention littéraire et en essayant d’être le plus précis possible, en suivant la ligne chronologique depuis les origines jusqu’à la sortie à 18 ans. Imaginons une main courante, cinquante ans après. Je le dis dans le livre : je n’ai pas eu accès à mon dossier (au moins cela aurait servi à ça). Et, comme je ne voulais pas noyer le poisson de la vérité dans les eaux troubles de la fiction (story avec personnage principal portant un autre nom, travail sur le style, univers d’écrivain, psychologie…) comme l’ont fait ceux qui ont pris des chemins similaires (Auguste Le Breton, Jean Fayard, entre autres), j’ai dû faire une enquête. Cela m’a pris plusieurs années. Retrouver les gens vivants, aller les voir, les enregistrer, visiter les lieux, prendre des photos, consulter des livres en bibliothèques, contacter des juges, des avocats, des mairies, etc. Cela dépasse largement mon cas. C’est pour cette raison qu’on y trouve l’alternance d’un témoignage de première main et d’un dialogue au sujet d’un dossier Rondepierre avec des éléments plus généraux venant de cette recherche pas toujours agréable. J’étais partagé entre mon savoir récent et la naïveté de mon enfance, parce qu’à onze ans, on ne sait rien de la « société » qui vous accueille. Je voulais rendre justice aux deux, j’ai donc introduit un surplomb « savant », tout en sachant, comme je l’ai dit tout de suite à mon éditeur, que le sujet n’était pas porteur. Le placement est une procédure juridico-éducative concernant 250.000 enfants par an en France et qui n’a jamais provoqué le moindre débat, la moindre curiosité. Le problème est socio-politique : la Loi de 1958 et ses applications concrètes depuis un demi-siècle, par exemple. Qui s’en soucie ? C’était déjà le cas dans les années trente où il a fallu révolte collective et mort d’hommes provoquant des reportages de journalistes pour qu’il y ait de petits aménagements. C’est encore un tabou total avec dissimulation des dossiers, silence des institutions, des intervenants et des pensionnaires. L’accès à l’archive ne va jamais de soi, qu’elle soit militaire, médicale, juridique ou même filmique (cf. question 13). L’enfer, s’il y en a un, n’est ni le vécu, ni l’écriture, c’est simplement ce mur de silence toujours solide et devant notre porte…
Entretien © Éric Rondepierre & Isabelle Rozenbaum – Photographies © Éric Rondepierre – Vidéo © Isabelle Rozenbaum – Illustrations © DR
(Paris, mai-déc. 2010)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.