Un monde qui change mais qu’on aimerait tant voir immuable dans ses acquis – ce que certains appellent le Progrès – mais tout s’accélère et s’emballe… Le premier titre de mon roman était Finis Terræ inspiré du film de Jean Epstein, mais il était pris et Les Horizons perdus (Le Canoë, 2024) s’est alors imposé, qui évoque le film homonyme de Frank Capra d’après un roman de James Hilton : un voyage utopique qui découvre Shangri-La, une vallée idyllique et tempérée, cachée au milieu de l’Himalaya. Comme dans le film, mon roman commence par un départ précipité qui laisse derrière lui un monde en décomposition. Le voyage se déroule de manière presque chronologique, et suit le trajet qu’avait parcouru le navigateur solitaire Joshua Slocum sur son voilier le Spray d’avril 1895 à juin 1898. Mes deux protagonistes rencontrent un peu les mêmes expériences qui rappellent – si on le veut bien – celles des navigateurs de la course du Vendée Globe sur leurs voiliers hyper sophistiqués qui volent aujourd’hui sur l’eau à des vitesses jamais encore atteintes. À la seule différence que mes personnages naviguent sur un simple sloop de 9 mètres, et prennent leur temps. Ce sont les escales qui montrent l’évolution d’un monde qui voit les catastrophes se développer et se multiplier.
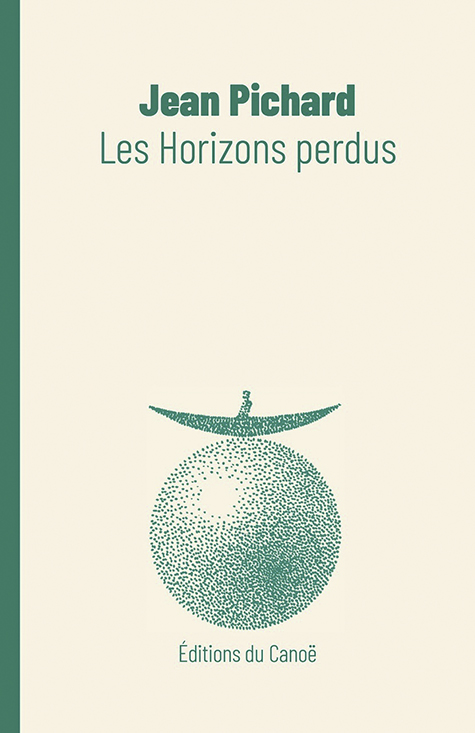
Jules Verne n’est pas loin et son art de la narration, mais aussi sa vision critique et désespérée de ses derniers textes où il remettait en question son point de vue positiviste pour le progrès. Dans sa nouvelle posthume « L’Éternel Adam » (1910), il laisse libre cours à son pessimisme sur l’avenir de l’Humanité et sa régression possible. Dans une dimension biblique, un déluge effroyable submerge la terre entière et efface la civilisation. Les quelques survivants découvrent que, autrefois, une autre civilisation davantage développée s’était également effondrée avant de disparaître. Nombreux sont les ouvrages – bandes dessinées (Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain), essais (Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, L’Utopie ou la mort de René Dumont), pamphlets (Mal de terre de Nicolaj Schultz, Comment saboter un pipeline d’Andreas Malm), romans (Le Gang de la clef à molette d’Edward Abbey, Black-Out de Marc Elsberg, Le Paradoxe de Fermi de Jean-Pierre Boudine), pour n’en citer que quelques uns – qui abordent de près ou de loin les questions qui se posent à notre époque.
Les catastrophes naturelles et technologiques se multiplient. Tout cela était annoncé depuis les années 1970. L’Homme se comporte plus ou moins comme le ferait un parasite. Cela se fait au détriment de l’environnement, de la flore et de la faune, mais aussi de l’Homme lui-même. Il faut être aveugle pour ne pas vouloir le voir. Ce que mon roman décrit est une approche convergente et multiple qui voit tout se précipiter. Le développement exponentiel de l’informatique et des banques de données – aujourd’hui aussi de l’IA – fragilise nos existences en nous rendant de plus en plus dépendants. Un climat d’inquiétude, de peur et d’angoisse se répand qui voit se développer au quotidien : manifestations, grèves, émeutes, révoltes et parfois même sabotages, guerres… Mais si Les Horizons perdus n’étaient que peur et dystopie, ils manqueraient leur propos qui est une dichotomie entre la beauté de la vie et de la nature, et cette lutte civilisationnelle et existentielle. L’auteur que je suis, vit avec ses personnages et tente de comprendre le monde dans lequel il vit. C’est une forme de lucidité. Le voyage m’aide à une mise à distance salutaire, presque méditative. Mes personnages sont des antihéros. Non sans un sentiment de culpabilité, et à la recherche d’un lieu-refuge, ils se savent en fuite pour sauver leur peau. L’espoir et le rêve les animent. Durant tout leur périple, ils font preuve de beaucoup de résilience et d’adaptation. Quelque part, je les admire. Ils me rassurent.

La lenteur du voyage est propice à la rêverie, la beauté des paysages nourrit la poésie. La langue et le rythme portent l’aventure. L’attente – ce n’est pas un hasard si le narrateur de mon livre emporte avec lui Le Désert des Tartares de Dino Buzzati – l’attente, donc, est un thème récurrent dans tous mes livres. Elle peut être comblée ou déçue, mais elle est toujours liée au moment d’avant, celui des espoirs et des angoisses. Elle est une projection dans un avenir non défini qui ne peut être qu’inventé ou imaginé. Le monde de l’écrivain. Aussi le voyage qui nous confronte à nous-mêmes et parfois nous révèle, et puis les îles – ces lieux refuges ! Je suis entouré de cartes géographiques et marines. Longtemps, j’ai été attiré par les expéditions polaires, les grands déserts, tous ces lieux où le ciel est immense.

Un autre thème qui me fascine depuis toujours est celui de la finitude et de la mort ; il est omniprésent. C’est lui qui donne un sens à la vie. Les Essais de Montaigne est mon livre de référence. J’ai été surpris par la place qu’occupe la mort dans son œuvre : les batailles, les assassinats, les exécutions, la peste et la maladie… C’est un sujet central. Une manière d’être prêt. Les Horizons perdus est le deuxième volet d’une trilogie et fait suite à Traces/Spuren (non publié) qui se passait à Berlin dans les années 80 et 90, et dont les thèmes étaient la photographie, les voyages et la mort. On y trouvait déjà le même narrateur et quelques personnages : Jacques, Pierre, Agnès et Claudia. Les Horizons perdus s’intéresse, cette fois, non plus à la photographie, mais à la navigation à voile et se passe en grande partie sur l’océan – une manière pour moi sans doute, d’exorciser le traumatisme d’une expérience en mer, où j’ai cru vivre mes derniers instants lors d’une tempête de force 10 qui venait de décimer la Fastnet Race, en août 1979.

La première version de ce deuxième volet a été écrite en 2012-2014. Les dysfonctionnements que je décris étaient déjà présents. Ils se sont amplifiés depuis, et rien n’indique qu’ils doivent diminuer un jour, encore moins disparaître. Difficile dans ces conditions de s’accrocher à une vision qui emballe les cœurs et mobilise les énergies. Il n’y a plus vraiment d’horizons aujourd’hui : la nature, dans sa vastitude et sa diversité, dans sa force et sa beauté, reste un des seuls refuges. Je parle, ici, de symbiose et de respect. Mais un retour à la vie sauvage est-il encore possible ? Seul un petit nombre peut prétendre y survivre. Ne s’invente pas Robinson qui veut. Nous avons perdu et la capacité, et la connaissance. Nous sommes « le peuple de la marchandise », pour reprendre la qualification que nous donne les Yanomami, c’est à dire : nous sommes liés à l’argent et au profit.
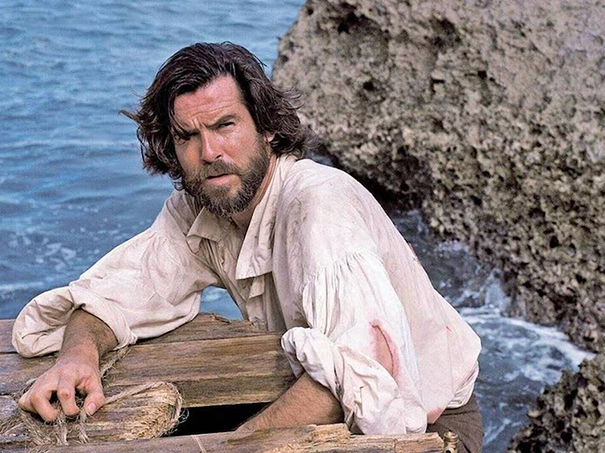
Les besoins exponentiels en énergie – l’IA les a déjà fait exploser… – vont mettre rapidement en danger notre interdépendance et le fonctionnement des réseaux informatiques dont nous sommes devenus irrémédiablement tributaires. Combien de temps encore ? C’est la question à ne pas poser ! La politique et les médias nous occupent avec d’autres sujets moins existentiels que sont les prochaines élections, les conflits, les pandémies, les scandales… Faire peur avant tout… pour ne pas penser ! Il serait temps de se déconnecter et de retrouver le sens de la vie. De prendre conscience que nous sommes vivants. Arrêter d’avoir peur. Croire à la force de la nature, la contempler et l’admirer. Il suffit de si peu pour être heureux.
Texte © Jean Pichard – Illustrations © DR.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
