ISABELLE LARTAULT s’entretient avec nous à propos des lectures performées de son « grand oeuvre », LES GRANDES OCCASIONS (Les Archives modernes, 2000) :
1 – Isabelle, tu as commencé à écrire au début des années 80, alors que tu étais étudiante aux Beaux-Arts. Comment percevais-tu cette action d’écrire dans un environnement de plasticiens alors que l’on prônait un retour à la peinture après des mouvements comme l’art conceptuel ou le body art, dans lesquels le langage était prééminent ?
Mon premier texte publié a été écrit en 1979, mais j’ai commencé à écrire des poèmes dès l’enfance. En 1980, j’étais en 3e année à l’École des Beaux-Arts de Dijon. Les mouvements comme l’Art conceptuel, l’Art minimal, le Body Art et le Land Art, mais aussi les happenings, Fluxus, etc., m’intéressaient beaucoup. L’atelier poly expérimental de Jaume Xifra dans lequel j’étudiais était ouvert à toutes sortes de pratiques. C’était parfait pour moi qui étais portée par une sensibilité à différentes formes d’art. Ici, j’allais trouver un mode d’expression original adapté à ce que je voulais dire et montrer. Si je me souviens bien, quand on a parlé de retour à la peinture, j’avais déjà terminé mes études. Mais avec À La Limite (le groupe créé, en marge de l’École, par quelques étudiants dont je faisais partie, pour présenter nos performances et celles des artistes dont nous défendions le travail), ce retour nous semblait réactionnaire : nous rejetions les objets et étions très réceptifs à tout ce qui sortait des cadres. Buren et Toroni étaient des références fortes. J’écrivais en parallèle de mes études, inspirée par la poésie sonore (Heidsieck, Giorno, etc.) et le Nouveau Roman (Duras, Butor et surtout Beckett). Aux Beaux-Arts, j’ai appris à utiliser un medium dans toute sa spécificité, à ne recourir aux autres qu’en cas d’absolue nécessité, à ne pas céder à la facilité – car souvent, les étudiants compensent les faiblesses de leurs productions visuelles en ajoutant du texte ou de la musique. Travailler pour arriver à obtenir une évidence visuelle était très fructueux sur le plan créatif et me permettait aussi d’échapper aux demandes de justifications théoriques ou pseudo théoriques des jurys d’école. Les performances Joyeux Noël etc. (1979) et N° 1244 Visages de Voyages (1981) étaient les seules, je crois, dans lesquelles il y avait du texte, mes propres textes enregistrés. Ces performances étaient à la croisée de plusieurs de mes influences d’alors.
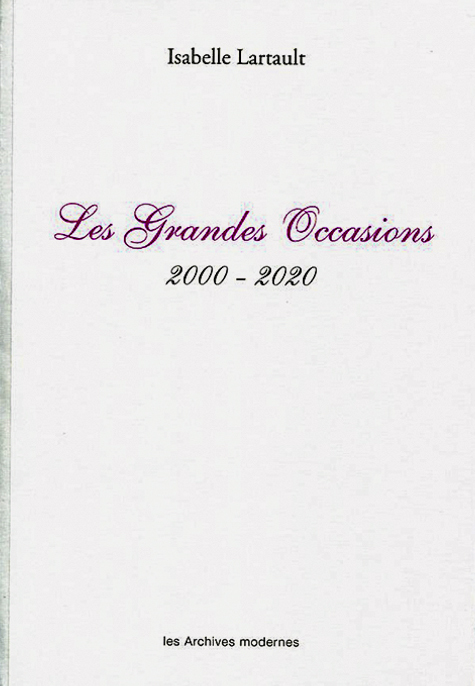
2 – Que te permet d’exprimer l’écriture que ne te permettent pas les autres médiums ? De façon générale, comment positionnes-tu l’écriture dans ses rapports avec les arts visuels.
L’écriture me permet d’exprimer davantage de finesse, de recul et de complexité à différents niveaux ; tandis que les arts visuels ont le privilège du ressenti brut, de l’immédiateté et de la simplicité. C’est difficile, mais cela peut être intéressant, d’arriver à combiner subtilement leurs différentes particularités.
3 – Peux-tu nous détailler les différentes médiations de tes textes ? Il y a le texte d’une part, sa spatialisation dans les publications, son passage à l’oral à travers des lectures avec différentes procédures dans les lieux de lectures, etc. Dans l’écriture de tes textes, est-il important d’intégrer la description des traitements futurs qu’ils peuvent subir ?
À un moment donné de ma vie, pour différentes raisons, j’ai dû abandonner les arts plastiques et l’écriture a pris de plus en plus de place. Jusqu’ici, je n’écrivais que des textes courts, et là, j’ai commencé à m’essayer au récit. C’est en écrivant L’Inattendu que j’ai compris comment ma formation aux Beaux-Arts allait servir mon désir de mettre en espace mon texte, de donner une forme à la mise en page en relation avec le contenu. Quand, en 1999, j’ai décidé de poursuivre l’écriture des Grandes Occasions (commencée en 1979), j’ai essayé d’optimiser au maximum les spécificités de l’objet livre pour qu’il rende bien compte de toutes les potentialités du texte. J’ai été attentive à différentes choses : la police de caractère, le corps du texte, le signet, le fait qu’à la fin de chaque année la numérotation s’arrête pour recommencer à la page 1, ramenant à une succession de dix-huit pages ce gros livre de plus de six cent grammes, etc. C’est à partir de cette publication que je suis revenue, en toute logique, à la performance, mais cette fois-ci sous forme de lecture. Les Grandes Occasions peuvent s’écouter dans toutes sortes de versions souvent liées au calendrier. Un texte comme des mesures & démesures est un va-et-vient entre écriture et lecture. Chaque lecture marque une étape. Un arrêt sur le texte que son expérimentation dans un lieu déterminé va remettre en mouvement, en écriture. Souvent, les mêmes textes sont repris et varient pour se relier au contexte, le temps d’une lecture ou pour se parfaire et se fixer durablement. En s’accumulant, les différentes combinaisons forment une fugue, se répondant sur des mois, des années, comme en écho. Elles gardent la trace du processus évolutif de l’œuvre. Mes textes se combinent parfois entre eux : certains textes de des mesures & démesures apparaissent dans La Veille et le Lendemain. Les découvertes, les incidents de parcours jouent aussi un rôle. Ainsi, le « stop ! » crié par l’auditeur agacé par une longue lecture des Grandes Occasions a été par la suite repris dans des mesures & démesures pour interrompre le flux interminable des données. C’est pour moi, la façon la plus naturelle de travailler. Quand j’ai écrit Les Grandes Occasions, je ne savais pas que mes lectures alterneraient entre partitions et improvisations. Tout n’est donc pas réglé par avance comme du papier à musique. Mais avec le temps et l’expérience, l’aspect combinatoire et répétitif de mes textes principaux et l’aspect relationnel qui existent entre eux se révèlent évidents et il ne me reste plus qu’à peaufiner les liens. « La description des traitements futurs que mes textes peuvent subir… » : j’imagine que vous faites allusion à La Veille et le Lendemain, textes dans lesquels je parle de mes recherches, de mes tentatives pour comprendre et décrire le processus de la création et qui font apparaître le fait que ces recherches elles-mêmes sont déjà une forme de création. Décrire, c’est aussi s’expliquer à soi-même. À propos de ce texte, je pourrais reprendre, à ma façon, ces mots de Jacques Roubaud : « Un texte écrit suivant une contrainte [qui] parle de cette contrainte ».

4 – Te considères-tu comme une plasticienne du texte, ce qui d’une certaine manière, est une définition possible de la performance ? Performer le texte est-il aussi important que l’écriture elle-même ?
Je ne vois pas en quoi être « une plasticienne du texte » serait une définition de la performance. Quant à l’appellation « plasticiens du texte », il me semble qu’elle serait mieux adaptée aux Lettristes et à leurs descendants. J’ai une formation artistique et une pratique artistique (de la performance en particulier) ; mais j’ai aussi une pratique littéraire à part entière. Ces deux expériences ajoutées à certaines influences (musicales, cinématographiques, etc.) se rencontrent à un moment donné pour aboutir à une œuvre donnée. La performance permet un contact direct avec la réalité dans un espace/temps déterminé. Elle m’oblige à transposer des textes comme des mesures & démesures ce qui leur donne de la mobilité, de la vie, de la visibilité. Elle me permet un retour immédiat et une autre forme de légitimité que celle du livre. Mais le texte prime et le plaisir que j’ai à écrire est immense. J’espère que mes textes suscitent autant d’intérêt à être lus qu’à être entendus, qu’ils résonnent même quand on se retrouve seul face à eux.
5 – Un trait commun de tes textes, c’est leur structure programmatique. Il y a un cadre préexistant qui détermine une logique d’écriture. Par exemple, dans Les Grandes Occasions ce sont les fêtes, anniversaires, etc. Dans des mesures & démesures, la quantification du réel. Même dans La Veille et le Lendemain, c’est cette notion d’intermédiaire propre au quotidien qui génère du romanesque. Peux-tu nous parler de ces « grilles » qui permettent à l’écriture de se manifester de manière moins réaliste ?
« La contrainte m’assoit à ma table, me met un crayon dans la main, me fait partir d’un point. Jusqu’où ? Libre à moi » (La Veille et le Lendemain II). Elles me permettent aussi d’enrichir les niveaux de lectures et de tenir le pathos à distance. Mais je ne tiens pas non plus à me brider outre mesure : ce qui n’aurait pour résultat, à mon avis, que d’assécher mon écriture, de la rendre illisible. Il est très important pour moi de rester lisible et compréhensible.
6 – Arrêtons-nous sur ton livre, Les Grandes Occasions. Tu proposes la description d’une fête, d’un événement ou d’un anniversaire sous une forme d’ekphrasis. Comme dans la plupart de tes textes, la description détaillée, voire la description narrative, est un procédé central. Comment t’es venue l’idée d’un tel procédé et pourquoi ?
Le premier texte des Grandes Occasions : Joyeux Noël, etc. a été écrit en 1979 pour répondre à la commande que le Théâtre de Bourgogne avait passée aux Beaux-Arts, et qui s’intitulait 10 jours avant Noël. Pendant la lecture enregistrée de ce texte, j’intervenais physiquement sur scène : je venais chercher dans un paquet, puis dans une poupée, un introuvable cadeau pendant que des diapos de photos de familles déposées sur une nappe de fête de plus en plus tâchée défilaient en fondu enchaîné tout autour du théâtre. Au moment de la publication de ce texte, j’ai eu l’idée de proposer aux lecteurs de leur écrire sur commande, à partir de la même matrice, d’autres « grandes occasions ». Au bout du compte, il y en a eu neuf et vingt ans après, à la veille de l’an 2000, l’idée de les multiplier. L’histoire de ce texte s’est donc faite en plusieurs étapes. Un procédé littéraire ne tient que parce qu’il est « parlant ». Dans certains de mes textes, la débauche de détails et l’afflux de superlatifs, ou bien la description narrative et la simplicité du langage employé peuvent, dans un premier temps, entraîner le lecteur sur de fausses pistes. Je recrée les entourloupes de la réalité : je fais croire pour mieux désillusionner. Dans Les Grandes Occasions, le piège ne se déjoue qu’avec le temps. De répétition en déclinaison, le texte conduit le lecteur ou l’auditeur de la surprise amusée à la stupéfaction jubilatoire, de la jubilation à l’inquiétude, de l’inquiétude à la dépression, de la dépression à l’écœurement jusqu’à ce que, souvent, il revienne dans le texte, réjoui, bien que conscient de ce qui l’attend. Dans des mesures & démesures, certains textes réglés comme de banals jeux d’enfants ou tournés avec trois mots comme des ritournelles sont, à mieux y regarder, lourds de sens. Dans N° 1244 Visages de Voyages, la description du coucher de soleil est si poussée qu’elle empêche la cohésion nécessaire à la vision. De cette façon, le cliché tombe en miettes.
7 – Les Grandes Occasions répète un même texte qui, très vite, varie en fonction des situations. Il y a un processus. Parle-nous de cette vision procédurale de l’écriture et de ses implications. Es-tu influencée par les enjeux de la musique du dernier quart du XXe siècle – spectrale par exemple, ou répétitive ? Et quel est ton regard sur Gertrude Stein et certains auteurs comme John Cage, John Giorno, ou même en France Jean-Luc Parant, qui ont exploré des systèmes d’écriture basés sur la valence et la répétition ?
Les Grandes Occasions se suivent et se ressemblent. Les Grandes Occasions se suivent et ne se ressemblent pas. C’est toujours la même histoire ; mais la petite fille est-elle toujours la même, même si elle change tous les ans de prénom ? Ce procédé entraîne le lecteur ou l’auditeur dans le détail de la description jusqu’à en avoir le tournis, jusqu’à ne plus en entendre que la grinçante mélodie. Ce qui m’intéresse, c’est de rappeler l’évidence et parfois la terreur de la répétition des cycles, que ces derniers soient propres au processus de la création, aux sentiments individuels ou aux événements de la vie ordinaire (sociaux, culturels ou autres). J’aime manipuler des toupies, organiser des rondes, visser des cercles vicieux et produire des effets boule de neige. L’essentiel de la vie est fait de petites variations, de petites rotations sans grandes révolutions. Ce qui tourne ne prend pas une ride. Les Grandes Occasions sont indémodables ! J’ai écouté beaucoup de musiques répétitives et j’ai découvert avec intérêt, mais tardivement, la musique spectrale. Mon rapport à la musique est très lié au corps, au chant, à la danse. Certaines pièces de Cage (avec sa façon de mettre les auditeurs à l’écoute, d’accueillir l’imprévisibilité), certains textes de Stein (pour le pouvoir d’évocation des mots puis leur dissolution dans la répétition) ont compté pour moi. La poésie-action de Giorno m’intéresse ; en revanche je me sens peu d’affinités avec le travail de Jean-Luc Parant ; je préfère les ruminations de Christophe Tarkos, les chorégraphies basées sur des géométries scéniques et sonores de Anne Teresa de Keersmaeker, Jeanne Dielman de Chantal Akerman, les autoportraits de Christian Boltanski ainsi que toute l’œuvre de Niele Toroni. Des artistes qui vont à l’essentiel avec rigueur et humour et une grande économie de moyens.
8 – Dirais-tu aussi que ces procédés et ces contraintes à dresser des listes ou des inventaires se rapprochent aussi de ce qu’a pu lui-même produire un Georges Perec? Pourquoi ?
Oui, bien sûr. La littérature matricielle a été bien explorée par Perec et par l’Oulipo en général ; et là aussi, avec rigueur et humour. Je me sens proche de Perec quand il varie à l’identique et utilise des combinatoires en s’efforçant d’épuiser le sujet.
9 – Alors même que tes textes devraient ne développer que des scénarios logiques, des déroulements cohérents, des situations rationnelles qui alimenteraient un sens inéluctable et réaliste, leur développement nous fait ressentir une espèce de dérèglement général, un excès manifeste, un débordement inévitable, parfois même une sorte d’égarement, d’irréalité de la situation décrite. Comment expliques-tu cette sensation à la lecture de tes textes ? Est-ce volontaire de ta part ? Que cherches-tu à faire ressentir à ton lecteur ?
À force de tourner, d’abord on jubile, puis on entre en transe, enfin on perd son centre de gravité et on finit par tomber. Dans certaines combinaisons de des mesures & démesures, les lecteurs donnent l’heure en même temps, mais il n’y en a pas une pareille. J’utilise des systèmes, mais les systèmes pour les systèmes peuvent aboutir à l’explosion. « Un œuf, À la coque 3 minutes, Mollet 5 minutes, Dur 10 minutes, Dur Dur 18 minutes, Dur Dur Dur 36 minutes. Au-delà de ce temps de cuisson, attendre l’explosion ». Ils peuvent aussi mener à la dictature ! Le lecteur doit être distrait pour mieux être déstabilisé et pressentir que s’il n’y prend garde, quelque chose de grave risque d’arriver.
10 – Il y a paradoxalement un fond existentiel conséquent au système adopté dans Les Grandes Occasions. Quand on lit que « tout le monde était très content, très joyeux, très gentil, très joli, très drôle, très heureux et très exceptionnel », on ressent précisément un malaise difficile à cerner mais très palpable. Pardon de cette légère digression, mais la plus grande négation de l’art que le monde n’est jamais produite, n’est-ce pas justement le fait de créer des familles ? Avec les dictatures, créer une famille, n’est-ce pas, au fond, l’art de ceux qui n’arrivent pas à créer tout court ? D’ailleurs, les artistes qui ont des enfants les font le plus souvent dans des moments de grandes dépressions quant à leur production artistique, non ? Penses-tu que nous sommes tous des traumatisés des « grandes occasions », quelles qu’elles soient ? De façon plus générale, comment traiter les facteurs autobiographiques et existentiels sans tomber dans l’expressionnisme, fut-il « expérimental » ? Est-ce un bon matériau artistique ? Et ces traitements représentent-ils un bon moyen de liquider l’amour filial et donc, un moyen pour le réel d’être influencé par l’art et non l’inverse ?
Je crois que l’écriture de ce texte évoque quelque chose de ces traumatismes, effectivement. Mais je me méfie des grandes considérations sur l’être humain, des généralisations psychologisantes ou sociologisantes. J’ai personnellement attendu d’avoir trouvé un certain équilibre avec la création pour « procréer » (Les Grandes Occasions, matrice prolifique, n’arrêtait pas de faire des petits !) et quand ma propre famille a peut-être cessé de me peser. Je n’étais donc pas dépressive du tout. La « mère » n’a pas remplacé la « créatrice », à partir de ce moment comme je le craignais. J’ai même gagné en concentration, en efficacité. Comme la quasi-obligation par la société de fonder une famille, il y a celle, « universelle », d’être heureux à des dates déterminées. Et peut-être même aussi celle de produire du pain et des jeux, et donc de l’art ! Comment traiter les facteurs autobiographiques et existentiels ? Je me pose souvent la question. Il n’y a pas, à mon avis, de mauvais sujets artistiques ; il n’y a que de mauvaises utilisations. Je m’efforce avec mes plans et mes contraintes de limiter les excès de l’expressionnisme. Dans Les Grandes Occasions, c’est la répétition qui le banalise, dans des mesures & démesures, c’est l’économie de moyens. Reste à La Veille et le Lendemain la prise en charge la plus maîtrisée possible de quelques « effets personnels ».

11 – Les textes que tu écris ont souvent fait l’objet de lectures publiques dans des galeries d’art, des librairies, au théâtre, voire à la radio comme dans l’émission ACR diffusée sur France Culture. Que cherches-tu à travers ces lectures ? En quoi consistent-elles ? Comment les organises-tu, les montes-tu au niveau de la performance elle-même pour qu’elles puissent rendre toute la dimension de ton intention artistique ?
Philippe Langlois, producteur de l’Atelier de Création radiophonique de France Culture, m’avait proposé un atelier pour la fin de l’année d’après une lecture des Grandes Occasions qui se ferait autour d’un repas. De son côté, Jean Brolly voulait une intervention dans sa galerie pendant la réunion annuelle et festive d’une « grande association » de collectionneurs d’art contemporain. Je ne me voyais pas plus animer une réunion qu’illustrer platement un texte ; aussi j’ai eu l’idée, beaucoup plus à mon goût, de relier ces deux propositions en un seul événement qui ferait encore parler mon texte. J’ai imaginé, qu’en plus de l’enregistrement de la lecture-surprise en canon à trois voix des Grandes Occasions, il y aurait celui, à l’insu des invités, des conversations pendant toute la soirée. Sur un fond de bruits de couteaux et de fourchettes commun à toutes les occasions fêtées en festoyant, on pouvait entendre le contraste entre le langage ordinaire du texte et le ton mondain des échanges entre riches voisins qui « se mettaient à table ». C’était drôle et édifiant. Les deux textes qui, le plus souvent, font l’objet de lectures, sont Les Grandes Occasions et des mesures & démesures. Pour bien fonctionner, la lecture des Grandes Occasions doit durer longtemps. On peut remonter des années en arrière et s’arrêter aujourd’hui ou lire toujours la même occasion si elle se présente au moment de la lecture. Celle-ci peut être basée sur une partition, être lue, selon les cas par un nombre limité ou illimité de lecteurs en alternance ou en canon ou en laissant une part à l’improvisation. Le public est parfois amené à participer. Pour des mesures & démesures, c’est après avoir pris connaissance du lieu, de sa fonction et parfois en tenant compte du type d’événement qui a motivé ma présence, que je choisis les textes dans une combinaison de base, en adapte certains ou même, en écrit de nouveaux. Certains textes doivent être réactualisés à chaque lecture. Souvent, elles se déroulent en respectant une chorégraphie très simple qui met en relation les lecteurs entre eux, les lecteurs et le lieu (qui peut commencer par être mesuré). J’aime donner du corps à mes textes, de la densité et entendre des voix aux timbres différents peupler mes mots, les porter au public et sentir sur-le-champ le texte agir.
12 – Parle-nous de ton rapport aux lieux, à l’in situ et à ce versant de l’histoire toujours actif.
Passer de l’acte d’écriture à l’acte de parole permet une confrontation à une situation d’énonciation concrète, réelle, vivante. Travailler in situ c’est le plaisir, à chaque fois, de la rencontre d’un nouveau lieu et l’excitation renouvelée de découvrir une nouvelle façon de s’y adapter. Les lectures me donnent l’occasion de me réapproprier quelque chose de l’histoire, de la charge émotionnelle d’un espace pour la communiquer au travers de mes textes dont la recherche d’autonomie et d’universalité doit leur permettre de s’adapter à et de s’imprégner de tous les cadres. Je n’ai pas besoin de raconter d’histoires, le lieu m’offre la sienne comme un livre ouvert. De chaque rencontre avec une situation environnementale particulière naît un objet fictionnel particulier. Avec le groupe À La Limite, nous arrivions dans les festivals de performances avec chacun notre univers et nos outils de travail particuliers. Après avoir arpenté le lieu, nous décidions d’en faire ressortir telle ou telle caractéristique, de choisir un endroit qui nous ressemble et de nous y faire une place en utilisant tel élément extrait de notre bagage personnel. De cette expérience, j’ai gardé l’idée de faire avec ce qu’on a et ce qu’on trouve sur place. C’est une attitude qui va à l’encontre de l’objet mercantile, du spectaculaire, et qui est sans doute en voie de disparition aujourd’hui.
13 – Tu dis sur ton blog que ton « travail d’écriture relève à la fois de la poésie et du roman ». Or, il nous semble qu’il relève surtout des problématiques liées aux arts visuels car il travaille le texte en vue de son traitement oral par exemple. En effet, ce que tu écris semble montrer précisément ton refus réitéré de la fiction sous sa forme la plus commerciale : le roman. Tes textes sont travaillés à partir de procédés qui sont d’abord des jeux de langages, des jeux de mots, des jeux de pensées et non pas basée sur une « histoire ». Quelle place pourrait donc avoir le roman dans de tels enjeux non romanesques ?
C’est amusant de mettre le traitement oral dans les arts visuels ! Il ne faut pas oublier que la poésie était orale au départ et que l’écriture vient après la parole. C’est vrai que j’aime aussi jouer avec les rythmes et les sons. L’écriture sous sa forme la plus commerciale ne m’intéresse pas. Mais j’ai moi-même des difficultés à classer certains de mes textes dans des catégories. Je ne sais pas vraiment à quel genre appartient La Veille et le Lendemain. Est-ce vraiment un problème ? Cette obsession de la classification n’est-elle pas celle du marché qui a besoin de bien définir ses produits pour mieux les ranger dans les rayons et cibler les consommateurs ? Pour tout dire, j’ai surtout l’impression de faire de la poésie, même si un sens désuet reste attaché à ce mot. C’est vrai que j’ai du mal à respecter les règles qui s’imposent généralement. J’ai besoin d’inventer celles qui conviennent à mes sujets pour mieux me faire comprendre et j’espère que les lecteurs ou auditeurs auront envie de jouer le jeu. D’ailleurs, le jeu (ou ce qui s’y apparente) m’intéresse beaucoup : à l’origine de mon texte des mesures & démesures, il y a les jeux et les comportements des enfants qui, bien souvent, sous une apparente légèreté, se toisent, se soupèsent, et révèlent des luttes, des emprises, des abus de pouvoir…

14 – Il y a un facteur temps dans beaucoup de tes travaux. Tes écrits s’échelonnent dans leur déroulement narratif comme dans leur rédaction sur des années. Les Grandes Occasions se déroulent, par exemple, sur vingt ans : 1980-2000. C’est énorme. Pourquoi tout ce temps ? As-tu réactualisé ces occasions depuis que tu en as publié un volume aux Archives modernes en janvier 2000 ?
Oui, le temps est depuis toujours à la base de la plupart de mes travaux. Il est inhérent à la pratique de la performance dont le caractère éphémère me séduisait. Dans ce que j’appelais « les mues », en 1980, je « pelais » les murs. En les mouillant progressivement, je retirais une à une les différentes couches de papier-peint pour retrouver le mur en dessous et projetais des films de murs debout, de murs écroulés, de lieux vides mais autrement habités. Les images étaient réalisées avec de la pellicule dont les dates limites étaient dépassées ce qui donnait au film une étrange qualité faite de disparitions et d’apparitions surexposées. Le film tournait en boucle jusqu’à ce que réapparaisse le mur éclairé dans la fenêtre projetée du projecteur super 8. Davantage, parfois, que les espaces eux-mêmes, c’est souvent les éléments qui, sur place, peuvent faire office de marqueurs de temps qui retiennent mon attention : un robinet qui goutte, la présence d’une échelle, etc. Il m’arrive aussi d’apporter des petits instruments de mesure. À la fin des lectures, il arrive que les lecteurs comptent le nombre de mots qu’ils viennent d’utiliser ou celui des minutes passées. Dans une société où il faut sans cesse produire en faisant mine de se renouveler, où l’on s’hyperactive, où l’on zappe, où l’on s’use, où tout est vite juste bon à jeter, mon geste devient aussi politique. J’ai deux ou trois chantiers dont certains sont peut-être à vie. Des petites histoires, il me semble que je pourrais en écrire à la pelle et, du coup, ça ne m’excite pas. J’ai donc trouvé ce moyen : des projets que je peux compléter ou actualiser au fur et à mesure (depuis la publication des Grandes Occasions, dix années de plus ont été rédigées et lues), retoucher ou combiner (des mesures & démesures), commencer, recommencer et (ou) analyser tout au long de ma vie (La Veille et le Lendemain) et qui peuvent se répondre et s’enrichir mutuellement. Comme toutes les personnes anxieuses, j’anticipe beaucoup sur l’avenir et j’ai trouvé là de quoi me calmer jour après nuit et nuit après jour. Travailler sur le temps, c’est tenter de le prendre et de l’apprivoiser et, contre vents et marées, c’est ma façon de durer. Comme je le dis dans La Veille et le Lendemain II : « Longtemps je me suis dit que je n’y arriverais jamais pour y arriver peut-être ».
15 – Un de tes projets important s’intitule La Veille et le Lendemain. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce texte en deux manuscrits assez épais ? Il s’agit du journal d’un personnage qui est un écrivain. Qu’est-ce qui a motivé ce sujet chez toi ? Comment le gères-tu car il demande apparemment une grande maîtrise du calendrier.
La Veille et le Lendemain est en fait constitué de trois manuscrits, trois livres (je termine en ce moment le troisième). C’est une sorte de journal, celui d’un écrivain pendant la période intermédiaire qui succède à la fin d’un livre et qui précède la naissance d’un autre. Pour explorer cette période, mon personnage écrit « sur les bords », depuis deux moments de la journée, celui du réveil et celui du coucher. Je m’intéresse depuis longtemps au processus de la création. Pour moi, finir un texte était aussi exaltant qu’épuisant et angoissant ; et je vivais difficilement cette période qui se révélait après coup remplie d’enseignements. J’errais indécise ou remplissais le temps, ne parvenant à ne laisser s’exprimer mes projets qu’allongée entre nuit et jour, protégée dans un état propice à la gestation, avec une perception particulière de la réalité. Ma crainte d’alors était de ne pas pouvoir recommencer ; finalement, j’ai compris l’avantage de ne pas finir. Chaque livre de La Veille et le Lendemain rend compte de ma perception, de ma réflexion sur l’évolution de mon travail, sur les relations entre l’art et la vie. Je parle de ce que je pourrais faire alors que je suis parfois déjà en train de le faire. Même quand il ne produit pas, un créateur est, parfois malgré lui, toujours travaillé par la création. Écrire est peut-être moins difficile que de s’y préparer, que d’élaborer le projet qui y conduit et de s’y mettre. Quant au calendrier, il est bien sûr reconstitué. Le temps y est compressé pour faciliter la lecture et rendre compte sans trop diluer de l’idée de cycle. La Veille et le Lendemain est une fiction dont les véritables mises au point me permettent d’alimenter et d’améliorer ce texte lui-même, mais aussi tous les autres.
Entretien © Isabelle Lartault & D-Fiction – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum
(Paris, mars. 2009-février 2010)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.