Et quand le hasard fait que le peuple n’a plus confiance en personne, comme cela arrive parfois, ayant été trompé dans le passé par les choses ou par les hommes, on en vient nécessairement à la ruine. (Machiavel)
L’Évasion (Gallimard, 2013), roman noir de Dominique Manotti, débute en Italie, au mitan des années 80 : Carlo Fedeli, un ancien cadre des Brigades rouges, s’échappe d’une prison de Rome en compagnie d’un petit voyou, Filippo Zuliani ; très vite, leurs chemins se séparent : Fedeli est tué quelques jours plus tard dans un hold-up raté à Milan, Zuliani arrive à Paris, où il trouve un emploi de gardien d’immeuble, par le biais des contacts que lui a donnés Fedeli dans le milieu des exilés politiques italiens des années 70 (accueillis en France grâce à la « Doctrine Mitterrand »). De façon tout à fait opportuniste, il écrit un roman intitulé L’Évasion, dans lequel il raconte son histoire et celle de Fedeli (on songe alors à Cesare Battisti qui fut concierge à Paris et auteur de plusieurs romans), laissant libre cours à son imagination, sinon à sa mythomanie (il se présente comme l’un des participants du hold-up qui a mal tourné). Très vite, le livre séduit le tout-Paris et rencontre un succès foudroyant.
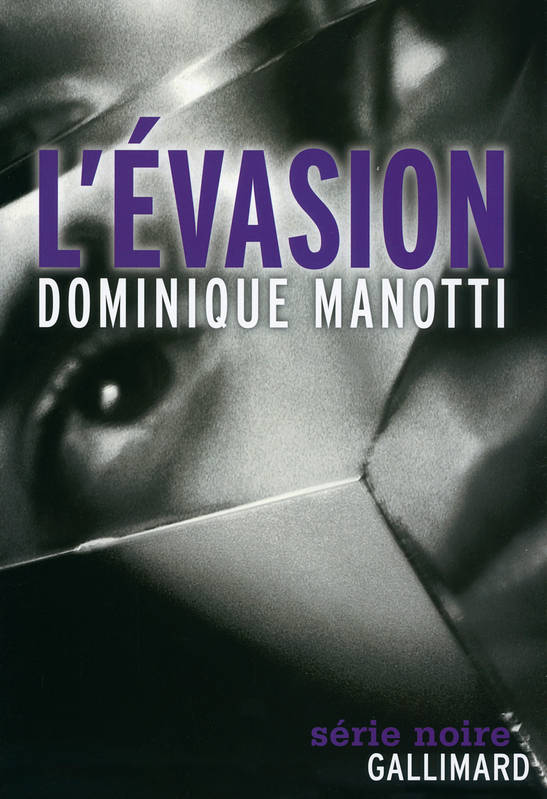
La structure narrative du roman est donc des plus simples : Dominique Manotti, on le voit, renoue avec un procédé littéraire connu, qui est celui de la mise en abyme ; le récit de Filippo Zuliani reprend dans ses grandes lignes l’intrigue du roman, qui est à son tour mis au carré par le narrateur, induisant une distance critique, une lecture « au second degré » de l’ensemble. Nulle inflexion baroque au demeurant dans ces récits gigognes qui entrelacent petites histoires et grande Histoire, nulle prétention au ludisme postmoderne : ici, le dispositif fait sens, élabore une forme qui est elle-même son propre contenu.
Les larges extraits écrits par Zuliani qui nous sont donnés à lire témoignent d’une écriture ressortissant au « roman policier » : lesté de solides poncifs (braquage, virilité, pègre, etc.), celui-ci suit le schéma classique du genre, dans un récit débarrassé de sa dimension politique au profit d’une simple histoire de gangsters (Zuiliani, de petit délinquant romain dans la vraie vie, devient un caïd dans le roman) ; à la fin, toutes les faces de l’intrigue sont révélées au lecteur, aucune zone d’ombre ne subsiste. L’Évasion, le roman écrit par Zuliani offre donc au lecteur un univers perturbé par la violence, mais fermé sur lui-même : l’équilibre est restauré dans le règlement de comptes final, le monde retrouve son ordre rassurant. Le bovarysme de Filippo fonctionne à merveille, au même titre que l’adhésion aux stéréotypes : le personnage vit par procuration et rejoint à son insu l’Histoire officielle écrite par le pouvoir, dont il est l’imbécile utile (nous y reviendrons).
Au rebours de cet univers romanesque plein, transparent, de cette écriture hyper codifiée qui remplit à la perfection son cahier des charges, le roman de Dominique Manotti, lui, se caractérise par une série de failles, de non-dits, d’interprétations hésitantes, de pistes qui sont autant de chausse-trappes pour le lecteur ; par exemple, le personnage de Carlo Fedeli reste opaque jusqu’au bout : lors d’une réunion d’un groupe d’exilés politiques italiens à Paris, une femme, issue de la formation politique Lotta continua, laisse entendre que, contrairement à ce que son ex-maîtresse affirme, Fedeli nourrissait une fascination ambivalente pour les armes et n’évitait pas les postures machistes. L’Évasion, le roman écrit par Dominique Manotti ne permet ainsi aucune identification ; de même, le flou demeure sur le dénouement : un faisceau d’éléments renforcent la thèse de la conjuration d’état (thèse énoncée dès la fin des années 70 par Gianfranco Sanguinetti, Guy Debord, et plus près de nous, Michel Bounan), mais un léger doute persiste (la piste d’un assassinat venu de l’extrême droite n’est pas écartée). Cette fin déceptive résume ainsi toutes les ambiguïtés du « Mai rampant italien » (magistralement analysé par la revue Temps critiques), elle cristallise de manière romanesque la paranoïa ambiante (la dietrologia, littéralement : la « derrièrologie ») dans laquelle l’Italie a baigné durant cette décennie.
Aussi, Dominique Manotti élabore-t-elle une forme en adéquation avec cette tension sociale et historique: on retrouve tout ce qui caractérise son art, tous les éléments qui font d’elle une voix singulière du « polar » français : écriture à la fois directe et elliptique, faite de subtils glissements énonciatifs, intrigue au cordeau, construction remarquable des personnages, incertitudes sur les motivations des protagonistes, architectonique virtuose. Manotti investit un genre littéraire populaire, mais le met à distance par une série de procédés de « recul » que l’on pourrait qualifier de brechtiens ; comme Jean-Patrick Manchette en son temps, on peut dire qu’elle passe « derrière les lignes ennemies ». Là où le roman de Zuliani fonctionne comme un simple divertissement de masse, le sien tente de dénouer « la grosse boule opaque de mensonges enchevêtrés » ; si le roman écrit par son personnage est « policier », le sien est « noir ».
Or cette distinction générique est des plus précieuses : contextualisée, c’est elle qui permet d’éclairer les enjeux historico-politiques qui font la trame du roman – et c’est ici que la forme se confond avec son propre contenu, que le roman de Dominique Manotti produit sa propre nécessité. Le récit écrit par le personnage Zuliani est inespéré pour le pouvoir politique, puisqu’il ne fait que renforcer le storytelling élaboré à l’édification des masses : en faisant de l’ex-gauchiste Fedeli un vulgaire gangster assoiffé de violence, le pouvoir joue exclusivement sur le registre de l’émotion, et partant, liquide toutes les questions politiques et sociales posées lors du « Mai rampant italien », pour clore à peu de frais la séquence des « années de plomb » (qui s’ouvre avec l’attentat de la Piazza Fontana en décembre 1969 et se ferme avec celui de l’attentat de la garde de Bologne en août 1980).
Coup double pour le pouvoir, de surcroît : la publication du roman de Filippo Zuliani précède de quelques mois l’arrestation des principaux dirigeants de Lotta continua, accusés d’avoir commandité l’assassinat du commissaire Calabresi en 1972, manière habile, là encore, de ne pas revenir sur la responsabilité des politiques dans « la stratégie de la tension ». Le roman de Zuliani est donc écrit du point de vue du pouvoir, c’est-à-dire, du Spectacle. Entre son récit et celui que nous raconte un pouvoir politique déliquescent (décomposition de la Démocratie chrétienne, implosion imminente du PCI, devenir-mafieux de l’état), ne subsiste plus aucune trace du Grand récit produit par le marxisme italien, hanté par « la main hâtive des révolutions » (Hugo) ; exit toutes les questions théoriques et pratiques initiées dans les années 60 et 70, en rupture avec la doctrine officielle du PCI et les falsifications du Togliattisme : les débats très riches autour de la revue Quaderni Rossi, la redécouverte de Gramsci, ou encore les questions essentielles posées par le Bordiguisme (qui trouveront en France un écho avec Invariance) ; les enjeux du marxisme italien furent autant théoriques – l’on songe par exemple au chantier ouvert par l’opéraïsme (dont Lotta Continua est d’ailleurs issu), dont certaines positions entraient en résonance avec la critique du Spätkapitalismus (le capitalisme tardif) d’Adorno -, que pratiques, puisque ces années furent imprégnées par une dialectique de l’émancipation. Les années 80 sont bel et bien un cauchemar, pour paraphraser François Cusset et le « cas italien » est exemplaire, comme le montre le roman de Manotti : en répétant sans cesse à l’opinion publique que le terrorisme gauchiste n’est en fait qu’une variante du gangstérisme, en lui assénant que les Rêveurs de l’Absolu ne sont finalement que des petites frappes, le pouvoir se protège, désamorce sa propre contestation tout en occultant ses turpitudes. Tel est le sens de cette criminalisation du négatif. Seule la convergence des mensonges – le mensonge d’état et le mensonge romanesque – demeure. Le roman de Zuliani fait donc autant office de divertissement que de diversion ; il participe au « façonnement industriel des esprits » (Enzensberger) et représente bien en cela une marchandise idéale.
« Si nous ne parvenons pas à faire l’analyse de notre défaite, chacun sera livré à sa solitude, à son désespoir, notre génération explosera, notre histoire disparaîtra », dit à un moment du livre Lisa Biaggi, l’ex-maîtresse de Fedeli : c’est bien la façon dont on écrit l’Histoire qui est en jeu dans ce roman. L’Histoire, on le sait, est toujours écrite par les vainqueurs et l’on pressent à la lecture du roman de Dominique Manotti que le Spectacle est en phase de triompher en ces tristes années 80 qui annoncent l’effacement de toute conscience historique, et peu ou prou, ce qu’est devenu l’Italie actuelle : un pays d’où le communisme primitif, vernaculaire a disparu, un pays où la vulgarité télévisuelle tient lieu de lien social (ce qu’avait bien prophétisé Pasolini dans ses écrits corsaires), un pays livré au présent perpétuel de la marchandise – un pays dévasté par l’imbarbarimento, pour reprendre le néologisme de Robert Maggiori. à cet égard, nul hasard si ce roman commence dans une benne à ordures : au-delà du clin d’œil au roman noir d’Edward Bunker, Animal Factory, la scène revêt très vite une portée allégorique benjaminienne : ce sont bien les poubelles de l’Histoire que fouille Dominique Manotti, poubelles où sont relégués les vaincus. « Un pays qui occulte son histoire pourrit de l’intérieur », dit encore Lisa Biaggi : c’est tout le drame de l’Italie actuelle – dont Manotti se fait l’archéologue -, où la conscience de classe s’est effondrée au profit de la classe de la conscience, celle de ces nouveaux seigneurs eux aussi soumis au temps-marchandise, qui n’est pas, la réalité du temps, mais sa publicité, c’est-à-dire, son irréalité. L’Italie est bien le laboratoire social du Pire.
Une petite lumière persiste cependant : si Filippo Zuliani découvre le pouvoir performatif de la littérature, ses potentialités émancipatrices, l’ex-maîtresse de Carlo Fedeli, reconnaissant sa défaite à la fin du livre, décide d’écrire un roman – manière de boucler la boucle ; entre la première phrase de l’incipit – « Le local à ordures pue » – et les dernières lignes du roman – « Si je veux essayer de sauver notre passé, il ne me reste plus qu’une chose à faire. écrire un roman », le lecteur aura assisté à la trajectoire d’une conscience qui tente de penser au pas de la réalité. Il se peut que pour Lisa (et les lecteurs) la littérature fonctionne alors comme un « sauvetage par transfert », un « recours contre l’accélération catastrophique de l’Histoire » (Walter Benjamin).
Avec ce roman, Dominique Manotti poursuit donc son exploration méticuleuse de « l’envers de l’Histoire contemporaine », héritière en cela du projet balzacien ; l’on comprend à la lecture de L’Évasion, que les années 80 (années qu’elle a explorées sur le versant français dans le remarquable Nos fantastiques années fric (Rivages, 2001), consacré aux funestes remugles du Mitterrandisme), représentent un pivot historique et idéologique central entre les espoirs politiques des années 60 et 70 et le désenchantement contemporain. Le terrorisme gauchiste, avec ses radicalités et ses ambivalences, cristallise mystérieusement tous les enjeux de cette Histoire ; en ce sens, il est bien, comme l’écrivait Gianfranco Sanguinetti, « la dernière énigme de la société du Spectacle ».
Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
