Clapotille (Fables fertiles, 2024) de Laurent Pépin a pour sous-titre « conte » : la 4e de couverture présente l’ouvrage comme le « dernier acte d’un conte onirique », qui fait suite à Monstrueuse féérie (2022) et L’Angélus des ogres (2023). Je n’ai pas lu les deux premiers contes ; je suis sensible à la tension née, dans chaque titre, de l’oxymore, opposant les éléments traditionnels du genre, le monstre et l’ogre, la féérie et l’ange.
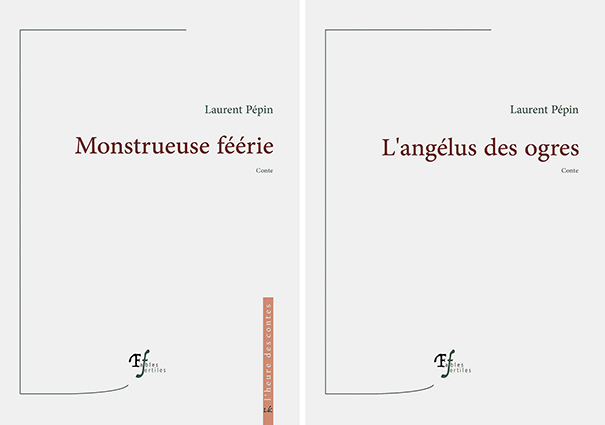
J’écoute d’abord ce titre : Clapotille, qui délaisse l’oxymore des deux premiers textes, au profit d’un nom propre qui à lui seul peut embrasser les forces antagoniques : celles de l’eau agitée en tous sens pour sonner à nos oreilles en clapot, celles qui, plus sombres et violentes, se déchaînent dans certains personnages. L’étymologie du mot (« clappetter », frapper de la main sur quelque chose, au 17e siècle) est comminatoire. Clapotille, fille des clapots. Délicate présence féminine – dont on lit dès « l’Ouverture » – qu’elle est :
… née de la rencontre fortuite d’un nuage et d’une forme familière, de la collusion hasardeuse d’un quiproquo et d’un souvenir, des jeux d’ombre et de lumière dans une forêt d’automne, d’un reflet amusant à la lisière d’un clapotis mousseux
Soit l’une des possibles clés de l’oeuvre, à la confluence du hasard des phénomènes naturels et des nécessités de la vie psychique – car c’est bien de cela qu’il est au fond question dans Clapotille.
Laurent Pépin nourrit son texte de références explicites à la poésie merveilleuse : La Barbe bleue, La Belle au bois dormant, Peau d’Âne, Le Petit Poucet, Les Fées, etc. L’on sait la fortune de ces contes, relus par le psychanalyste Bruno Bettelheim. Clapotille serait un nouveau personnage merveilleux, celle dont le pouvoir est de « fabriquer les rêves pour réparer les souvenirs des gens ». Le personnage abîmé, le malade, l’ogre, c’est le père, « boule compacte qu’ils [les parents] avaient trempée dans la fange, la haine et la honte », homme en deuil de la femme aimée Lucy, et dont le lecteur va découvrir peu à peu la dimension saturnienne, grevée d’un fatum monstrueux qui s’acharne à chaque génération.
C’est l’originalité de Laurent Pépin que de recourir aux invariants du conte pour les intégrer dans une forme plus libre, affranchie des attendus (formules rituelles, passé simple et imparfait, didactisme moralisateur plus ou moins explicite, brièveté). Et si l’on retrouve dans Clapotille le petit nombre de personnages, l’emploi de la majuscule qui essentialise les substantifs et leur assigne une fonction unique (les « Monstres », les « Voix », les « Briseurs de rêves »…), un chronotope flottant (« Cette nuit-là », « une petite plage enneigée »), la relative longueur de la novella (125 pages) permettant à l’imaginaire un déploiement plus lent, plus ample. La réalité ordinaire est transfigurée (le « Quartier des Câlinantes », le « Quartier des Enfants Oubliés ») ; le rêve déplace, euphémise les lieux inquiétants (hôpital psychiatrique, quartier des prostituées), redessine une géographie nouvelle dont on pressent l’attache réaliste déformée par « l’inquiétante étrangeté ».
À la dimension merveilleuse d’un conte onirique, où le rêve joue un grand rôle (il est ici un moyen de guérir), s’ajoute une tonalité fantastique : la figure du père habité de « Monstres », l’autre nom des pulsions qui l’agitent, évoque l’effrayant Dr Jekyll et Mister Hyde. Je découvre une allusion à l’âme soeur du Banquet de Platon, à la cafetière de Théophile Gautier, aux Corps étrangers de Jean Cayrol, peut-être. Une réminiscence, aussi, d’En attendant Godot :
La lumière ne s’incline pas, elle ruisselle, dis-je, en fronçant les sourcils. – D’accord, elle ruisselle. – Non. Elle chuchote.
La désespérante condition des hommes doués de parole, rappelée par les échanges verbaux entre Vladimir et Estragon qui cherchent le mot juste, s’incarne nouvellement dans le conte noir de Laurent Pépin. Les couples Clapotille et Antonin (petit garçon des « limbes » dont elle est amoureuse), le père et la fille Clapotille, l’époux et sa femme Lucy, dessinent la triangulation d’une famille tragique. Plus intrigant pour moi, la 4e ligne au seuil de Clapotille :
Quelquefois, le trait unaire de Lucy se mettait à scintiller dans la poche de ma veste enneigée, réchauffant mes entrailles contre mon gré.
Le trait unaire, c’est la version lacanienne du « Einziger Zug » de Freud, le « trait unique ». C’est – pour le dire très vite – ce qui relève de la parole et du symbolique. C’est ce qui permet à son porteur de se reconnaître et d’être reconnu comme personne unique. « Lucy » est la femme aimée du narrateur, père de Clapotille. Que signifie le prénom « Lucy » ? Lucia, du latin lux, la lumière. Celle qui « réchauff[e] [l]es entrailles ». Le narrateur-père s’identifie amoureusement à la chaleur organique de ce prénom ; la fille Clapotille, elle, enferme – littéralement – ce trait unaire dans une bouteille, s’identifiant à « Lucy » comme mère aimée. Lucy « scintille » – et sa fille reprend à son compte le suffixe « ille » ; mère, amante et femme archéologique, fossile australopithèque. « Lucy » comme principe féminin, qui agrafe la langue littéraire du conte et le réel des pulsions.

Avançant dans la lecture, on saisit peu à peu que l’enjeu est de circonscrire un trou noir qui avale le narrateur-père, si dangereusement que le texte aborde, de plus en plus crûment, la part la plus obscure de ce corps parlant et désirant. Si follement fait irruption ce forçage que le texte en penche dans l’emploi des italiques, et laisse entrevoir une psyché oscillant entre réalité quotidienne et monde magico-pathologique. Où l’on retrouve le fantasme du corps sans organe d’Artaud :
Des sensations douloureuses envahissaient l’intérieur de mon corps. Mes doigts et mes orteils saignaient et des organes chutaient brutalement de mon corps ou de ma figure.
Antonin, le petit garçon, acquiert dès lors une présence plus troublante. Mon goût personnel ne me porte pas à goûter l’onirisme de la fille « Clapotille » ; mais nul doute que le conte Clapotille fait béer le trou vertigineux de notre propre folie comme celle du monde extérieur. Le merveilleux, ici teinté de fantastique et de psychanalytique, permet à Laurent Pépin de faire advenir un nom propre poétique, qui tout à la fois voile et représente notre violence archaïque : « Clapotille ». L’autre nom de la clé qui ouvre les portes interdites, et la voie créatrice qui permet une échappatoire.
Texte © Bruno Lecat – Illustrations © DR.
Ce texte a fait l’objet d’une première publication le 5 avril 2025 sur le blog de son auteur, L’Œil a faim.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
