Contre-histoire des États-Unis (Wildproject, 2018, rééd. 2021) répond à une question simple : pourquoi les Indiens d’Amérique ont-ils été décimés ? N’était-il pas pensable de créer une civilisation créole prospère qui permette aux populations amérindienne, africaine, européenne, asiatique et océanienne de partager l’espace et les ressources naturelles des États-Unis ? Le génocide des Amérindiens était-il inéluctable ?
Pour beaucoup d’Américains aujourd’hui, la question ne se pose pas vraiment. Les plus conservateurs se targuent d’avoir créé une société forte et libre, admirée pour son économie et respectée pour sa puissance militaire. Les plus progressistes sont fiers de ce qu’ils pensent être une société multiculturelle et ouverte à tous, le fameux melting pot célébré par les manuels d’histoire. Beaucoup, de droite comme de gauche, républicains ou démocrates, croient en l’exception américaine, ce mélange de chance et d’audace qui transforma une modeste colonie britannique en une superpuissance mondiale.
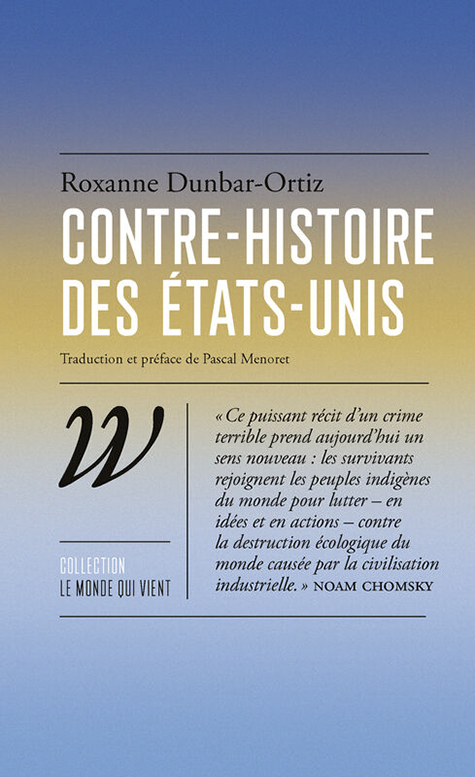
Quant aux Amérindiens, ils sont refoulés dans un passé souvent mythifié. La thèse dominante aux États-Unis est qu’ils ont souvent été tués par les virus apportés par les européens avant même d’entrer en contact avec les européens eux-mêmes : la variole voyageait plus vite que les soldats espagnols et anglais. Selon cette version de l’histoire, les peuples des Amériques seraient morts des suites de la découverte de leur continent, par simple contact avec les virus et autres produits de la civilisation européenne [1]. Les survivants auraient soit disparu au cours des guerres de la frontière, soit été intégrés, eux aussi, à la nouvelle société d’immigrés. Venus d’Asie il y a 10 000 à 20 000 ans, les Amérindiens ne sont-ils pas, au fond, les « premiers immigrants » ?
Contre cette vision irénique d’une histoire impersonnelle, où les virus et l’acier tiennent une place prépondérante et où les intentions humaines sont secondaires, Roxanne Dunbar-Ortiz montre que les États-Unis sont une scène de crime. Il y a eu génocide parce qu’il y a eu intention d’exterminer : les Amérindiens ont été méthodiquement éliminés, d’abord physiquement, puis économiquement, et enfin symboliquement. Le génocide des Amérindiens ouvrit la voie à l’esclavage des Amérindiens, puis des Africains : les colons européens, en mal de main-d’œuvre pour exploiter les gigantesques terres arables ouvertes par la guerre de conquête, inventèrent l’esclavage colonial, institution emblématique du capitalisme moderne.
Ce livre est ainsi un réquisitoire, un long J’accuse qui reconstitue patiemment les intentions et méthodes mises en œuvre par les Britanniques et perfectionnées par les États-Unis après l’indépendance. Testées par les Britanniques en Irlande du Nord à partir du 17e siècle, les techniques du génocide forment ce que Roxanne Dunbar-Ortiz nomme, avec l’historien militaire John Grenier, le « premier art de la guerre » [2], un ensemble de tactiques de guérilla conduites par des milices irrégulières et vouées non seulement à la défaite des combattants ennemis, mais aussi à l’anéantissement des populations civiles, femmes et enfants compris.

Roxanne Dunbar-Ortiz rappelle à son lecteur que la guerre d’indépendance des États-Unis fut aussi une guerre d’extermination. George Washington ne donna-t-il pas l’ordre de « dévaster tous les établissements » iroquois pour que « le pays ne soit pas simplement envahi mais détruit« ? Ne demanda-t-il pas à ses officiers de ne prêter l’oreille « à aucune ouverture de paix » des Iroquois « avant la ruine totale de leurs établissements » ? N’écrivit-il pas, en une rhétorique digne de l’actuelle guerre contre la terreur, que « notre sécurité future résidera dans leur impuissance à nous nuire » ?
L’indépendance en 1776 ne marqua pas la fin de la colonisation, mais son intensification, sa systématisation et sa brutalisation. Les États-Unis ne sont pas seulement une nation « née dans le génocide » : ils sont aussi une nation qui « a fait de cette expérience dramatique une noble croisade », selon l’expression de Martin Luther King. L’exception américaine consiste à masquer le meurtre de masse sous le mythe de la liberté pour tous.
Il aurait sans doute été possible de créer une civilisation créole sur le territoire des États-Unis actuels, si les colons britanniques, espagnols et français, de la Nouvelle-Angleterre à la Louisiane et à la Californie, ne s’étaient pas approprié les richesses du continent, n’avaient pas créé une société fondée sur le pur profit, et n’avaient pas voulu « civiliser » les « sauvages » en les convertissant au christianisme.
La propriété privée de la terre, cette invention relativement récente qui bouscula des millénaires de gestion communautaire des ressources naturelles, devint le principal outil de la domination européenne sur les cinq continents. Le libéralisme politique, idéologie occidentale dominante, idéologie de domination occidentale, voisina sans encombre, pendant plusieurs siècles, avec l’esclavage industriel, le racisme scientifique, l’orientalisme, l’antisémitisme, l’eugénisme, et la pratique assidue du génocide colonial [3]. La propriété, en un mot, ce n’est pas seulement le vol. Prendre la terre, c’est aussi administrer la mort.

Le lecteur se dira qu’il est difficile de penser une société sans violence, et que la conquête des Amériques par les Européens était peut-être un mal nécessaire, et sans doute un moindre mal. Les civilisations amérindiennes n’étaient-elles pas sanguinaires, elles aussi ? Pourquoi insister sur la mémoire du génocide, avec ses relents de haine de soi et de sanglot de l’homme blanc ?
La réponse de Roxanne Dunbar-Ortiz est glaçante : comprendre la dimension génocidaire de l’histoire des États-Unis, ce n’est pas seulement honorer le point de vue des victimes : c’est aussi une clef majeure pour comprendre l’histoire des États-Unis et, par extension, l’histoire contemporaine de l’Occident. Cela permet de saisir pourquoi l’armée de volontaires et la guerre totale sont devenues des institutions essentielles aux États dits modernes ; pourquoi l’histoire de l’Atlantique est écrite en larmes de sang ; et pourquoi la domination mondiale des États-Unis, toute chancelante et sénile qu’elle puisse aujourd’hui sembler, est la continuation de la mission meurtrière des 13 colonies anglaises.
Ce livre n’est pourtant ni désespéré, ni désespérant. Roxanne Dunbar-Ortiz montre que les Amérindiens, loin de s’être soumis à la violence européenne, ont résisté pendant des siècles à l’invasion, à l’occupation et à l’extermination. De même que de nombreux peuples indigènes confrontés à l’envahisseur européen, leur existence est, en elle-même, résistance. Les nations amérindiennes sont bien là, adossées à des territoires reconnus par traité, à des réserves, à des terres sacrées, à des monuments, à une économie symbolique et matérielle distincte. Elles se battent pour protéger leurs langues, leurs arts, leurs sciences, leurs techniques et leurs religions de l’anéantissement ou de la folklorisation qui menacent de toutes parts.
Après avoir résisté à l’extermination et à l’assimilation, les nations amérindiennes se battent aujourd’hui pour la reconnaissance internationale : un jour leurs représentants siègeront aux Nations unies et de nouveau elles échangeront ambassadeurs et ambassadrices avec les autres nations du monde. Roxanne Dunbar-Ortiz écrit pour que, plus de deux siècles après leur indépendance, les États-Unis mettent enfin en œuvre leur décolonisation.
Roxanne Dunbar-Ortiz est une militante de la cause amérindienne depuis le début des années 1970. Née au Texas en 1938, elle grandit en Oklahoma, « l’Arabie Saoudite de l’Amérique du Nord » [4], premier producteur de pétrole dans les années 1940. Selon elle, « l’Oklahoma est aussi l’endroit où le rêve américain s’est arrêté » : c’est là que les petits Blancs, fer de lance de la conquête du continent, comprirent qu’ils avaient été dupés par les corporations agricoles et l’État fédéral. Avant la Première Guerre mondiale, l’Oklahoma devint ainsi l’État le plus socialiste de l’Union [5], et Roxanne Dunbar-Ortiz grandit entre la mémoire d’un grand-père anarcho-syndicaliste et une mère passionnément baptiste et à moitié indienne.

C’est en passant par la Palestine que Roxanne Dunbar-Ortiz découvrit son ascendance indienne. Étudiante à l’université de l’Oklahoma, elle rencontra un étudiant palestinien, Saïd Abu-Lughod [6], qui lui raconta l’histoire de l’occupation et du nettoyage ethnique de la Palestine. Les Palestiniens étaient les Indiens du Moyen-Orient, déplacés, éparpillés, niés en tant que peuple et privés d’un État. Roxanne Dunbar-Ortiz qui, dans une autre vie, avait eu honte de sa « vieille sorcière indienne alcoolique » de mère [7], comprit alors que ses racines indiennes étaient non seulement une richesse, mais une méthode : lire l’histoire des États-Unis et du monde du point de vue amérindien – ou palestinien – permettait de comprendre la violence coloniale, ignorée ou relativisée par d’autres points de vue.
« Tenter de comprendre la situation politique au Moyen-Orient fut ma première expérience de déconstruction des médias dominants », écrit Roxanne Dunbar-Ortiz dans le deuxième volume de ses mémoires, Outlaw Woman (Femme hors-la-loi). « Comprendre un point de vue aux antipodes du magazine Time m’apprit à lire entre les lignes et à analyser les sources pour détecter déformations et mensonges » [8]. Dans les années 1960, Roxanne Dunbar-Ortiz fut de tous les combats : contre la guerre du Vietnam, pour la libération des femmes, contre les interventions des États-Unis au Moyen-Orient et en Amérique latine. Elle participa à la création du Mouvement de libération des femmes aux États-Unis en 1968.
Début 1970, Mad Bear Anderson frappa à la porte de Roxanne Dunbar-Ortiz, qui habitait alors à La Nouvelle-Orléans et militait dans le mouvement féministe. Compagnon de route de Fidel Castro, de Che Guevara et de Martin Luther King, Mad Bear était un activiste iroquois. « Ce que tu écris est véridique et important », dit-il à Dunbar-Ortiz. « Il est rare de trouver des idées comme les tiennes. Mais ce sont encore des idées abstraites ». Quelques mois plus tard, après s’être embarqué sur un navire bananier en route pour l’Amérique du Sud, Mad Bear lui envoya par la poste quelques lignes écrites par José Carlos Mariátegui, le fondateur du parti communiste péruvien : « La réalité indigène montrera le chemin lumineux qui mène au socialisme » [9]. Roxanne Dunbar-Ortiz consacra le reste de son existence à la lutte pour la reconnaissance des nations amérindiennes, pour les droits des femmes, contre le racisme structurel et pour la transformation radicale de l’économie politique des États-Unis.
Cette Contre-histoire des États-Unis est née d’un long débat avec Howard Zinn, dont l’Histoire populaire des États-Unis place la classe ouvrière, les femmes et les minorités au premier plan de son écriture de l’histoire. Zinn donne voix à ceux qui ont été réduits au silence par l’histoire triomphale des États-Unis, peuplée d’explorateurs, d’officiers, d’inventeurs et d’hommes d’affaires en majorité blancs et de sexe mâle.
Mais pour Roxanne Dunbar-Ortiz, l’Histoire populaire des États-Unis reste prisonnière des mythes coloniaux, en particulier du mythe du progrès indéfini des États-Unis en direction d’une « plus parfaite union », comme le proclame le préambule de la Constitution. Les Amérindiens n’y figurent qu’à quatre reprises : au moment de l’invasion européenne, pendant les « guerres indiennes » du 18e siècle, au moment de la fin de la colonisation à la fin du 19e siècle, et pendant le mouvement des droits civiques et du Red Power, dans les années 1960 et 1970.
Lorsqu’elle fit part de ses objections à Zinn, il lui répondit qu’il ne modifierait pas son Histoire populaire, mais qu’elle pouvait écrire l’histoire indigène des États-Unis. C’est ce livre que vous avez en main. En écrivant du point de vue des Amérindiens, et en plaçant le génocide au cœur de son travail, Roxanne Dunbar-Ortiz révolutionne la manière d’écrire l’histoire des États-Unis. Elle montre la voie qui mène à la décolonisation de notre univers mental et aussi, peut-être, de notre monde économique et social.
Texte (préface de l’ouvrage) © Pascal Menoret – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
[1] Cf. par exemple Jared Diamond, De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire, Paris, Gallimard, 2000, en particulier le chapitre 11.
[2] John Grenier, The First Way of War: American War Making on the Frontier, 1607-1814, New York, Cambridge University Press, 2005.
[3] Cf. Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, Paris, La Découverte, 2014.
[4] Roxanne Dunbar-Ortiz, Red Dirt: Growing Up Okie, London, Verso, 1997, p. 39.
[5] Roxanne Dunbar-Ortiz, Outlaw Woman: A Memoir of the War Years, 1960-1975, Norman, University of Oklahoma Press, 2014, p. 4.
[6] Frère du politiste Ibrahim Abu-Lughod (1929-2001), beau-frère de la sociologue Janet Abu-Lughod (1928-2013) et oncle de l’anthropologue Lila Abu-Lughod.
[7] Dunbar-Ortiz, Red Dirt, p. 176.
[8] Dunbar-Ortiz, Outlaw Women, p. 7.
[9] Ibid., pp. 291-293.
