NICOLAS ROZIER s’entretient avec nous à propos de la publication de son roman, L’ÎLE BATAILLEUSE (Incursion, 2021) :
1 – Nicolas, vous êtes auteur et artiste. Vous avez publié des recueils en poésie dont certains rendent hommage à certains de vos pairs (Antonin Artaud, Jacques Prevel, Francis Giauque), ainsi qu’un premier roman : D’Asphalte et de nuée (Incursion, 2020). En parallèle, vous avez contribué à des recensions critiques dans de nombreuses revues, tant sur les arts que sur la littérature. Vous êtes également présent sur la plateforme D-Fiction à travers un workshop intitulé « Un garçon impressionnable » qui offre cet intérêt de nous faire découvrir ou redécouvrir des créateurs dont vous expliquez l’importance du geste et de la pensée, comme de nous exposer l’éblouissement que leurs œuvres ont opéré sur vous. Pourriez-vous revenir sur votre parcours, et ce qui vous a amené à embrasser la vocation artistique ?
J’ai eu la chance d’être adolescent dans les années 80. À côté des obligations collégiennes et lycéennes, cette décade offrait une formation à part entière, une immersion chavirante. Le punk, la new-wave et le cinéma en tête, sur fond de modes frénétiques et chahuteuses, scandaient ces années enlevées et lapidaires. Les sports, l’actualité en général, et jusqu’aux faits divers, trempaient l’air du temps. Les créations rivalisaient dans un véritable tourbillon de nouveautés. Un engouement généralisé et une forme d’outrance, d’intensité haute, passaient partout. Dans ce contexte, l’art, la culture, la création débordaient dans le quotidien et la routine. Radio, TV, revues, clubs, concerts, fanzines, expositions, une modernité accélérée fusait de toutes parts sous l’influence magnétique du changement de millénaire en ligne de mire. Une large part des textes d' »Un Garçon impressionnable », revient sur des jalons forts de cette époque. Pour un adolescent, l’influence du punk traversait la Manche et montrait la voie de l’engagement spontané, avec ou sans moyens. Tout se passait au garage, dans les caves ou les sous-sols. L’énergie faisait le tri. Aujourd’hui, c’est fini, mort et enterré. Si vous n’êtes pas le fils de quelqu’un, l’ami de quelque chose, l’adhérent, l’affilié, le coreligionnaire, si vous n’avez pas souscrit, cotisé, si vous n’êtes pas un matricule sous contrôle, escorté sous bonne garde, estampillé, arborant le badge d’accréditation de telle coterie, sculpter à mains nues une montagne n’y fera rien. Vous resterez à la porte. Mais avant cela, en 87, j’ai commencé à peindre au garage, chez mes parents, au milieu des vapeurs de solvant, sur des plaques en tous genres. Se procurer les matières, le matériel, me prenait la moitié du temps, mais la peinture, pour germer, a toujours aimé les trafics, le bricolage, et les trousses incomplètes. Atomisant les problèmes de fournitures et de matière première, un fond de poésie urbaine, nerveuse et sombre, un romantisme expérimental, aimantaient les actes. La littérature et l’écriture sont venues à moi dans cette ambiance de surchauffe. J’ai aimé les films avant les livres. La mise en gloire des mots par les acteurs et actrices m’a conduit aux textes et aux écrivains. Je ne connaissais aucun auteur, juste quelques noms. L’écriture artiste que je cherchais sans le savoir, j’en trouvais des bribes, j’en humais les possibles chez Yves Simon et Le Clézio. Mes premiers fragments, sortes de déplorations descriptives et d’essais fascinés sur les paysages urbains, les tours d’habitation, datent de cette époque. Des études de lettres, reprises plus tard, par correspondance, ont mis à ma portée Baudelaire, Artaud, Gracq, et avec eux, l’ouverture d’un champ infini.

2 – Tout comme votre premier roman nous semblait marqué par un certain esprit de Sa majesté des mouches doublé d’une dimension de violence crue – un « safari de béton » – que ne renierait pas un David Peace, ce roman possédait déjà également une véritable dimension de nature writing, mais de facture française – mi-gionesque, mi-gracquienne – et que l’on retrouve accentuée dans votre deuxième roman, tant la nature, les éléments, mais aussi la géographie, en sont la dynamique même. Ainsi, à travers la figure du jeune Koenig qui déserte la légion et fuit la guerre et le Sahel pour rejoindre l’Ouest de la France, et qui, dans celle-ci, s’enfonce toujours plus vers les terres reculées des « tropiques normands » jusqu’à rejoindre une communauté de peintres réfugiés sur une île, la nature règne toute puissante, territoire fantasmé de l’origine du monde devenu ce monde de l’origine même de la création. En ce sens, lorsque Koenig devient alors cette sorte d' »espion du bocage », on se retrouve dans la peau, à la fois, du personnage de L’Invention de Morel de Bioy Casares et de celui du Désert des Tartares de Buzzati : solitude, perte de repères, épaisseur du temps, infinité de l’espace, de l’inconnu, du sauvage, troubles des sens, de la conscience, de la réalité… Parlez-nous de votre rapport à la nature, et ce qu’elle entretient pour vous avec la peinture.
Vous évoquez le personnage de Bioy Casares, dans L’Invention de Morel, celui de Buzzati dans Le Désert des tartares, auquel j’ajouterai le lieutenant Grange dans Un Balcon en forêt. C’est vrai, à l’instar de Koenig, ils multiplient les face-à-face avec des espaces reculés, livrés à des stupeurs qui les marquent et les façonnent. Il semble que, au contact de leur acuité de rêveur éveillé, la nature, les paysages se mettent, sinon à parler, du moins à faire signe avec plus d’éloquence. En ce sens, ils s’apparentent à la « plante humaine » telle que l’entendait Gracq, sensibles aux moindres frémissements de la nature et ainsi voués à une existence sensitive supérieure. Poussées à leur paroxysme, les facultés de ses personnages déclenchent « l’épanchement du songe dans le réel », et le passage du récit au fantastique. Loin d’être un naturaliste ou un pâmé végétal, je suis suburbain. J’ai eu cette chance de grandir au balcon des mutations dans l’un des quartiers géants poussés aux abords des grandes villes. Mon enfance débute entre les murs encore sans portes ni fenêtres du pavillon que nous venions visiter le week-end, à l’adresse où ma mère vit encore aujourd’hui, depuis quarante ans. Mon imaginaire s’est construit depuis ce quartier, qui donc fut aussi, depuis ma chambre à l’étage, ma fenêtre sur le monde. La variété des reliefs et paysages dans D’Asphalte et de nuée, coïncide à mon goût pour les endroits délaissés, les friches, les endroits chiffonnés où personne ne passe, sinon les rôdeurs, les fugitifs. Cet exotisme malfamé, ce voisinage louche aux replis de manigances, recèlent un véritable décor de cinéma bis. L’étrange, le sordide, l’utilitaire, l’indéfini, l’énigme des marchandises et des stocks, le silence de cache des structures en tôles ondulées, fourmillent d’histoires en puissance, plus exactement de coulisses narratives et d’événements clandestins. J’aime les no man’s land où le paysage perd son nom. Ces marges ne sont plus la campagne, ni la forêt, ni la ville, elles sont le dernier et le meilleur des terrains imaginaires parce qu’elles restent vagues. Il est vrai que les paysages parcourus dans D’Asphalte et de nuée impliquent de grandes étendues de forêt, de montagne et de splendeurs sauvages. Ce paysagisme, s’il n’oublie pas certains souvenirs d’été, en colonie, à la montagne, m’attire d’abord pour la grammaire spécifique liée à l’aventure romanesque. La part conventionnelle des éléments de description, dûment rafraîchie dans un mouvement qui en ravive les couleurs, lève des paysages de roman. La montagne et la forêt de roman possèdent un clinquant de maquettes dont j’aime à faire jouer les facettes. Le seuil des paysages, en particulier, recèle un autre pouvoir. En l’occurrence, l’image du sentier ou du panorama, récurrente au fil de l’enfoncement des personnages dans le paysage, tout en brouillant les frontières, renouvelle de façon toujours plus accrue l’impression de liberté. Les spectacles de la nature en multiplient les porches. C’est la version terrestre du grand large. Dans L’Île batailleuse, la nature dépeinte, plus prégnante encore, a pour une part inspirée le roman. L’observation directe, dans ce cas précis, a rivalisé avec le travail imaginaire. La Normandie fantasmée dans le roman prend pour modèle les paysages qui m’entourent depuis plus de trois ans, ceux du parc Normandie Maine. Ils s’étendent aux départements de l’Orne, de la Mayenne, du Calvados et de la Sarthe, et leur caractère propre, leur identité m’a longuement sidéré. Originaire de Reims, ville autour de laquelle, au nord et à l’est surtout, règnent les plaines betteravières de l' »openfield », j’ai trouvé aux portes de l’ouest français, et jusqu’aux rives du Cotentin, une diversité verdoyante dont les charmes défient le pittoresque. Une suite presque ininterrompue de décors, au sens théâtral du mot, vient à la rencontre du regard en lui souhaitant le même genre de bienvenue qu’à l’enfant face à un plateau de jeu. Les boqueteaux et la haie vive, véritables modules posés dans le paysage tels des jouets dans une vitrine, en constituent les fleurons. La campagne normande peut aisément prétendre au label « domaine d’Arnheim » tant elle paraît le fruit d’agencements méticuleux, d’effets voulus, de raffinements étudiés, de proportions harmonieuses. L’une de ses propriétés, surtout, entre dans la trame de L’Île batailleuse : celle de mener à la mer. Par feintes ou promesses, les collines normandes, les lacets des routes forestières, les villages semés sur la bonhomie des bosses vertes, chacune de ces visions annonce la mer au détour, son imminence, chaque parcelle clame son appartenance au bleu immense. Quand vous faites allusion, à raison, à la double portée de l’ouest profond, origine du monde et berceau de la création, ce pays le doit notamment à sa promesse maritime et à la vie de rivage extatique dont la création artistique serait l’exact modus vivendi. Je pense spontanément au séjour bref de Van Gogh, alors basé en Arles, aux Saintes Marie de la mer, à l’installation finale de Gauguin aux Marquises, ou encore, plus proche de nous, au flamand Karel Dierickx, dont l’imaginaire, plus que les sujets stricts, longe la mer du Nord. Volontiers déclinables dans mes récits, les petits et grands spectacles de la nature à l’écrit font des motifs indémodables absolument affranchis des peintures de genre qui les enferment dans une imagerie vieillotte ; la nature s’invite moins clairement dans ma peinture. Car, si l’on entend par nature, l’ensemble des paysages ou natures mortes plus ou moins standardisés auxquels elle peut correspondre en peinture, elle n’a que très peu de place dans mon travail où la part d’imitation passe par la géométrisation, la schématisation, la déformation et la stylisation, au point que mes tableaux semblent, de ce point de vue, parfaitement dénaturés.
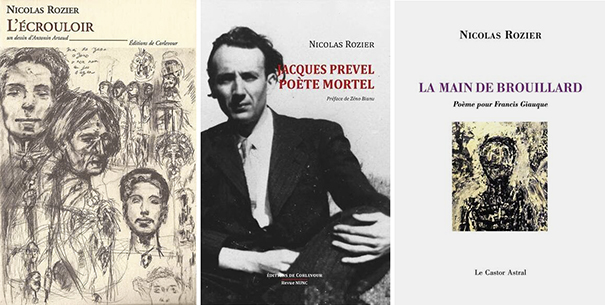
3 – Koenig, au contact de ce « pays vert » et à la découverte impromptue d’une toile, est épris du désir soudain de peindre justifiant que « ce néant d’une vie sans peinture, on ne lui ferait plus », bien qu’il n’en avait jamais eu conscience jusqu’alors. Si votre roman tente d’imposer un dépassement du dualisme entre Nature et Culture, il s’impose également comme un roman « engagé », du fait que Koenig – déclassé social qui sent « le poids de ces années d’ignorance » – n’a « personne, aucun oncle d’Amérique », dans tous les cas personne donc qui n’ait jamais partagé avec lui « une image, un livre ou même fait une allusion ». Est-ce une manière pour vous de rappeler où se situent les véritables discriminations produites par la société égalitariste, et précisément, par notre propre culture qui n’a cessé, et ne cesse toujours, d’être un des fronts de la lutte de classes ?
Vous pointez une névralgie inabordable. Tout au plus le roman peut-il, comme je l’ai fait dans L’Île batailleuse, en épeler le déchirement, lui faire une place, tout en lui donnant sa plus décente expression. Je ne m’arrêterai pas sur la farce macabre de « l’égalitarisme », le mot s’autodétruit dans sa charge de provocation. Quant à la « discrimination », beaucoup plus fourbe, le mot est lui-même d’une complexité sonore opportune aux ennemis. Le temps de prononcer ce mot lourd, on perd son objet. J’entends bien, en revanche, au milieu du vocable, le mot crime, c’est le seul qui vaille, l’unique qui convienne. J’ai longtemps cru, sans me le formuler clairement, qu’un court-circuit fondamental, un serment fait à soi-même, pourrait tout et devrait tout, à commencer par l’évitement des avanies sociales, sinon leur dispense pure et simple. Prendre de vitesse les grimaces et les pièges de l’ordure, pensais-je, rester en mouvement, dans une dynamique créatrice, pouvaient dispenser des lècheries dégoûtantes, permettre de semer les négriers, de ne jamais se laisser prendre à l’engrenage, fatal entre tous, de la boucherie salariale. J’ai même pensé, au pic des bourrasques, au plus fort du resserrement de l’étau, qu’une terrible justice, venue de nulle part, attendait son heure et viendrait à sonner, aveuglante et solennelle, le terme de l’esclavagisme institutionnel. Naïveté mortelle s’il en est. La discrimination sociale masque une autre plaie. Celle-là ne se prête même pas à l’illusion d’un possible changement, elle assure le triomphe éternel, par-delà les plus violentes barricades de l’avenir, à la pyramide immonde, avec en haut les ingénieurs braillards, et en bas, les cueilleurs de coton. Je veux parler du NON-GOÛT. Il y aurait des livres détonants à écrire sur l’énormité du NON-GOÛT en France et d’autres sur la politique de châtiment qui préside à la distribution des deniers, dans le domaine de la littérature et des arts. Mais la perversité culturelle qui est le seul, le vrai génie français, loin de s’arrêter à l’état, implique, à très peu près, la totalité des acteurs dits culturels. Ce ne serait pas trop grave, après tout, de garnir le compte en banque de quelques gringalets trentenaires à barbe soignée, ou quelques donzelles du même âge qui entrent en littérature comme on entre à la Poste, mais les bruits de chariots, à l’arrière, le cliquetis des roulettes de civière, montés des sous-sols de l’institut légal, à deux rues des rigolades imprimées, c’est plus fâcheux. La société française est une machine à fabriquer des morts. Plus il y a d’écharpes bleu blanc rouge dans les gradins, de services culturels dirigés par des duègnes sans bouche ou de vieux premiers de la classe desséchés rêvant à leur carré de pelouse en Bretagne, plus il y a de peintres et d’écrivains morts, morts inconnus et en silence, au mètre carré. Je m’entends déjà rétorquer : « Monsieur Rozier, un ton plus bas je vous prie, et d’abord, que sont ces allégations à la légère ? Donnez-nous des noms ». Si j’avais des noms, l’affaire ne serait pas moins grave, mais du moins, il y aurait du scandale. Et puis, il est vrai qu’entre deux remboursements impossibles, trois grincements de dettes, une santé en lien directe avec 51 années de traitement artistique à la française, je n’en suis pas encore à la mobilité réduite, mais j’admets ma difficulté à trouver une heure pour aller enquêter dans les funérariums et faire la sortie des fosses communes, plus encore pour aller éplucher les registres d’états civils, et trouver le dossier ne serait-ce que de l’un de ces morts anonymes. Personne ne pourra récrire Le Suicidé de la société d’Antonin Artaud, c’est entendu, mais ceux qui le rejouent sont nombreux, et, ma parole, ils le tiennent bien ; quand ils y sont, ils ne sautent pas une case ! Il est certain qu’à l’heure où les citoyens, pour une large part, ne gagnent pas de quoi s’offrir un cornet de frites le dimanche, les histoires d’artistes et de poètes, de leurs subsides passés sous le nez, des éditeurs complices, communauté d’éleveurs, non de chèvres, quoique, mais surtout de litanies bécassières, de considérations molasses nappées de conformisme et travestie en sympathie ricaneuse dont le pire des simplets ne voudrait pour briser sa solitude, ne risquent pas de faire pleurer dans les chaumières. Où vont les aides de l’État ?, pourrais-je toujours beugler le 31 au soir, à la Saint-Sylvestre, pour me défouler sans être entendu, pour ramasser les accolades de saoulards et me fabriquer du grand soir ! Me dire que ça y est, l’État va me rendre des millions si bien soustraits, au fil des ans, qu’il faut les considérer ni plus ni moins, comme un vol de naissance, une spoliation au berceau. À Paris, où il ne se passe strictement rien sinon des gueulements, j’ai regardé autour de moi. J’avais le temps et je l’ai pris, j’ai fini de recenser. Les rues ne sont plus mornes, ne clignotent plus de la flaque pour susciter un poème, elles pendent à l’horizontal, putréfiées par l’énorme passage de non-goût. Je ne suis pas Diogène qui cherche un homme, mais, même quand je ne cherche plus, je cherche encore. Avec celui qui se ferait connaître, et, qui sait, d’autres survivants, nous ferions, je crois, si quelque oracle accomplissait l’exploit de nous réunir, une bonne troupe. Mais, l’efficacité de la dispersion sociale, sa main de fer plus perfectionnée et réticulée encore en l’espèce des ARTS, ne prendra jamais ce risque. Aussi doit-elle serrer, à la base du cou, très tôt et très fort, et ne plus lâcher. La main bleu blanc rouge serre sur tous les modes. De jour comme de nuit, en Marne comme en Ardennes, des Pyrénées aux Alpes le garrot est précoce. Pour autant, la mort est lente.

4 – Quand Koenig découvre cette toile qui fait basculer son existence dans la maison de lady Brown – une mécène excentrique et richissime – il ne connaît pas encore Dikoblatch, le polonais, qui en est l’artiste. En quoi, d’après vous, l’art est plutôt une transmission qui nous échappe qu’une éducation qu’on nous inculque ? La rencontre avec une œuvre est-elle la seule clef qui ouvre le verrou de n’importe quel destin et le détermine définitivement, quoi qu’il advienne ensuite, et peu importe la pression sociale ? Lorsque Koenig commence son apprentissage de peintre, et qu’il vit parmi tous ces artistes d’envergure mondiale, quelle figure tutélaire représente Dikoblatch pour lui, comme pour vous ? Pourquoi ces artistes se sont-ils réfugiés sur cette île mystérieuse et lointaine, et comment leur propre fuite ressemble-t-elle, à s’y méprendre, à un autre genre de captivité proche, là encore, de celle décrite dans L’Invention de Morel ou du Désert des Tartares ? Au fond, est-ce l’apprentissage de cette intériorité psychique à la base de la véritable liberté, et de son sens inaliénable, universel, pour l’humain ?
La découverte d’une œuvre peut déterminer, et définitivement, oui, le parcours d’une vie. J’en fais l’expérience, depuis ma découverte de Schiele et de Lindström en 1989. J’ai su, de façon pénétrante, que je passerai mon temps à façonner ce genre d’objets appelés dessins ou tableaux. L’ampleur du désir, en l’espèce et dès son acte de naissance, ne se laisse pas confondre. Quant au caractère de transmission spontanée de l’œuvre d’art, sans médiation culturelle, rien ne peut s’y substituer. L’œuvre admirée est le puits sans fond de l’apprentissage. L’admiration est son processus d’imprégnation. L’impact, lorsqu’une œuvre touche au but, déploie des hantises étagées, des obsessions formelles, une emprise physique que le meilleur des éveilleurs, le plus chamane d’entre eux, ne pourrait offrir. Pris dans la maille d’un style, l’admirateur vrai se laisse modeler, porté par l’influence risquée et nécessaire. Risquée parce qu’elle vampirise si l’admirateur imite trop servilement, nécessaire car personne ne peut inventer sans précédents artistiques. C’est dans le jeu de ces deux pôles que se produisent les lentes métamorphoses du peintre, même si le processus diffère forcément d’un artiste à l’autre. Dikoblatch, dans L’Île batailleuse, n’a pas de modèle précis. Pour forger le personnage, j’ai d’abord imaginé, visuellement, sa peinture, à partir du tableau qui subjugue Koenig. Il y a du Bram Van Velde et du Joseph Sima dans la composition, mais l’aspect cuivré, le fard irisé de cette œuvre, j’y pensais sans modèle précis. J’ai tenté d’assortir le personnage à la peinture imaginée. Diko est le mentor provisoire de Koenig et son tuteur dans le groupe. L’artiste est le plus désabusé d’entre eux, sur un plan mondain, mais aussi le travailleur le plus assidu, le moins décourageable. Au moment de la déchéance collective, sur l’île, et de l’éclatement du groupe, son installation à l’écart lui profite, son travail connaît un rebond favorable. Il représente le peintre possédé, l’insatiable ciseleur de formes et de couleurs. Le groupe ne se réfugie pas vraiment sur l’île. Sur le continent, leur mécène leur offre des conditions de vie et de travail exceptionnelles, ils doivent à lady Brown un phalanstère clef en main, loin du tumulte. Ils finissent par s’aventurer sur cette île inconnue des cartes parce qu’ils cherchent toujours plus d’exotisme, comme cadre de vie et de stimulation artistique, plus encore parce que cette île abriterait, selon une légende, un peintre immense dont l’existence mystérieuse et l’œuvre créée au bout du monde, affole leur imagination. De plus, le groupe de peintres vieillissants voit en cette île une sorte d’ultima Thulé de l’Ouest, l’extrémité vierge d’un nouveau monde, où, présument-ils confusément, leur travail pourrait connaître un second souffle, voire une apothéose. Du reste, cette quête artistique n’est jamais entièrement dissociable d’une peinture élargie au milieu ambiant, d’un lieu de vie idéal où la peinture aurait presque lieu sans les peintres, dans l’animation propre du paysage. L’île batailleuse, je parle ici de l’île dans le roman, n’est pas un lieu fréquenté, un ailleurs d’agrément, mais une terre taboue, mal recensée, et de sinistre réputation. Les peintres s’y installent fascinés, dans un élan irrépressible, mais à reculons. Ils diffèrent d’ailleurs l’exploration entière et se contentent pendant longtemps d’une installation superficielle proche du rivage. L’île les met au pied du mur de leur création, dans un climat d’impasse où ils sont acculés à la nouveauté ou voués à une décrépitude accélérée. L’arrivée sur l’île met fin à des années de neutralité et de routine confortable. Tous, ils acceptent, fût-ce avec réticences et angoisse, l’expérience qui les attend au cœur de l’île. C’est pourquoi la liberté insulaire se confond à une épreuve de vérité, une période probatoire avant la félicité singulière offerte par l’île.
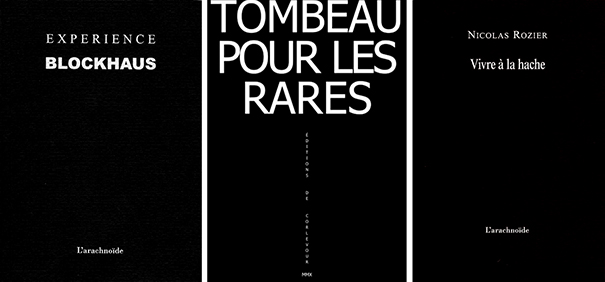
5 – « La ville ne vaut rien, il faut aller à la campagne », lit-on au beau milieu de votre roman. Pour vous, vivre en dehors de l’urbanité aliénée et aliénante est-il le seul moyen de se consacrer sérieusement à la création, mais aussi tout simplement, le moyen de vivre en osmose, non pas tant avec la nature qu’avec soi-même ? Diriez-vous que l’art est à la nature ce que l’artificialité est à l’urbanité ? Nombreux sont pourtant ceux qui vous rétorqueraient que l’art est d’abord le résultat de la bétonisation, du trafic, ainsi que du bruit de l’acier et de l’argent, et non pas de paysages champêtres et de contrées bucoliques… Votre regard sur la nature ne vous paraît-il pas caricatural et sujet à illusions : la nature n’est-elle pas aussi désuète, morne, sinon mortifère parfois ? Estimez-vous que l’art – du moins en Occident – devrait renouer avec la nature pour récupérer cette aura qui lui fait tant défaut aujourd’hui, et qui a fait la gloire et la supériorité de ses œuvres pendant des siècles ?
« La ville ne vaut rien, il faut aller à la campagne ». Sortie de son contexte romanesque précis, il va sans dire que la formule perd de son raccourci provocateur. Si jadis, elle aurait pu sembler simpliste, aujourd’hui, elle se passe d’arguments et ne résonne que mieux, je crois, sous cette forme plus lasse encore que désinvolte. J’ai vécu en milieu urbain et suburbain plus de la moitié de ma vie. La ville romantique moderne, nocturne de nuit comme de jour, telle que New York en a donné le modèle au cinéma, disons les grandes villes de l’hémisphère nord, jusque dans les années 80, présentaient encore un album ouvert, une sorte de menu où l’aventure humaine, affective et créative pouvait s’inventer. Depuis, disons, le début des années 2000, ce qui faisait l’équilibre précaire des charmes urbains a disparu. Je n’évoquerai pas l’inventaire insensé et infaisable des phénomènes géants et furtifs en cause, ils criblent l’époque d’une nullité enragée. L’ennui, l’inanité, l’absence d’allure recouvrent toute chose, les figurants compris, dans une aigreur irréversible. Mon dernier stage intensif au néant, cinq années entre Pantin et les arrondissements du nord parisien, a clôturé mon cycle d’empoisonnements, et pour le coup, récuré à l’os ce que vous nommeriez ici à bon droit, un fond « d’illusions ». Le vieux squelette des villes n’y est pour rien, me direz-vous. C’est bien vrai. Mais les spécimens types de l’époque sont parvenus à y mettre ce qui leur tient lieu de personnalité, à imprégner l’infrastructure, de la base des monuments aux piliers sous les ponts, pas un centimètre carré n’y échappe, ni bien sûr une goulée d’air. Soyez assurée que la campagne « désuète », « morne » et « mortifère » dont vous parlez, j’en connais aussi les écueils ; faute de les détester autant que les néants massifs de la grande ville, je ne les aime pas non plus, je les ai endurés étant jeune et sans possibilité d’y couper. La « campagne » explorée et célébrée dans L’Île batailleuse, scrupuleusement reconnue comme une exception, par ailleurs assez vaste, cumule la valeur d’un périmètre vivable et celle d’un décor à rêver. C’est inestimable. Par surcroît, une grande partie de ce territoire, dont l’Orne et la Sarthe, parce qu’ils sont ouvertement moqués par des politiques, me rendent ces contrées encore plus accueillantes. Les sarcasmes en question, étant donné ceux qui les profèrent, honorent ces pays plus qu’ils ne les salissent. Le mouvement, la marche ou la voiture, déclenchent le génie propre de ces étendues où le bocage, cet agencement spontanément aristocratique du paysage, pousse le raffinement à la suggestion parsemée, au-delà de ses buttes et ses haies, de résidus de ville, de vestiges abandonnés, de bornes sauvages où le territoire n’est plus définissable selon la dualité de la ville et de la campagne. J’ajouterai que mon travail peint s’attelait au départ, à la fin des années 80, au motif des immeubles, au profil énigmatique des tours ; encore aujourd’hui, une dominante géométrique et des affleurements architectes occupent mes peintures en cours. J’aime la ville saisie dans le prisme d’un art.
6 – On peut dire que votre obsession pour la couleur est égale à votre obsession de la langue, vous faisant rejouer la poésie rimbaldienne dont ce fameux « Roman » que Ferré interprète sous le titre « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans »… l’âge de Koenig précisément ! Dans votre roman, tout fait écho à ce poème comme à celui des « Voyelles ». En cela, on sent bien que vous écrivez par nécessité, et non pas pour poser comme tant d’auteurs de notre époque qui cultivent davantage leur égo à travers l’écriture que leur effacement en elle pour son accomplissement… Mais revenons à vos obsessions : la couleur comme absolu, à la manière d’un Van Gogh ou d’un Chagall, la langue comme souveraineté à la manière d’un Rimbaud donc ? Ces deux « matériaux » d’ordre supérieur, la couleur se rapportant à la lumière, la langue à la musique cosmique, les deux étant des forces suprêmes, quasi quantiques, qui nous échappent, que nous en direz-vous ?
Plus qu’à Rimbaud, la couleur se confond pour moi à Van Gogh et Artaud. Depuis les toiles de Van Gogh, plus encore depuis qu’Antonin Artaud dans son texte Le Suicidé de la société, a « recollecté » et physiquement traversé l’œuvre de l’artiste, la couleur peinte gainée dans les mots tout en restant à sa place d’empreintes convulsives sur toile, a pris une valeur de bombardement et d’expansion dans la vie sans précédent. Van Gogh et Artaud en ont dételé les paroxysmes. J’allais dire, chaque couleur a pris son poids, sa valeur de drame autonome, de bestialité sentimentale. L’intensité vibratoire des couleurs, je n’en sais absolument rien. Vous dites à raison qu’elles nous échappent. Je manipule, en chacune d’elle, un mystère complet. L’œil peut revenir sans fin sur elles, il les trouvera neuves, plus ou moins hautes ou basses, comme des notes, mais toujours retranchées sur leur identité sans prise. Conscient de cette propriété d’expatriation immédiate des couleurs, de leurs effets révulsifs ou sonores, je suis, face à elles, comme un singe face à un tableau de bord, ou tout comme. Je procède à tâtons, je télescope et j’avise. Le jeu des valeurs me guide ; en ce sens, les couleurs aident au dessin. J’ai longtemps cru que la couleur n’était pas pour moi, que le dessin l’emportait, dans mon travail, sur la couleur. Mais à force d’admirer son emploi chez les anciens, le barrage a cédé. J’avoue une fascination pour les couleurs vives, la palette du mouvement CoBrA. Même dans les œuvres aux palettes les plus sourdes, je vois des rampes complexes pour des taches, même isolées et minoritaires, de couleur intense. Je les aime très vives sans d’ailleurs pouvoir utiliser facilement les plus soutenues, comme par exemple, l’outremer ou les gammes de rouges très vifs. Dans un roman, en revanche, le champ narratif est si vaste que la couleur peut surgir à chaque détour de page sans aucune contre-indication. Le flux textuel a plutôt tendance à faciliter des accords et associations qui ne passeraient pas du tout sur une toile. La souveraineté de la langue est un état de fait, et ce, en dépit, il n’est pas mince, du traitement actuel que lui inflige les têtes de gondoles chez les libraires. Être de son temps, si cela suppose cette écriture sèche, cette matité déjetée, véhicule de mièvrerie consensuelle, je passe mon tour et d’ailleurs, on le passe pour moi. Si l’écriture était reçue, simplement reçue pour ce qu’elle est, les problèmes, les prurits et eczémas appelés « reconnaissance » ne démangeraient personne. Chaque auteur vaudrait son pesant, ni plus, ni moins, mais le déni est la règle. Un déni généralisé doublé du bon vieil adage : « les copains d’abord », après tout pourquoi pas, mais triplé d’une haine spontanée, atavique, du langage écrit et de sa souveraineté précisément. Cette grammaire arasée qu’on vend à la tonne, elle naît disparue. Elle contient son principe d’avortement.
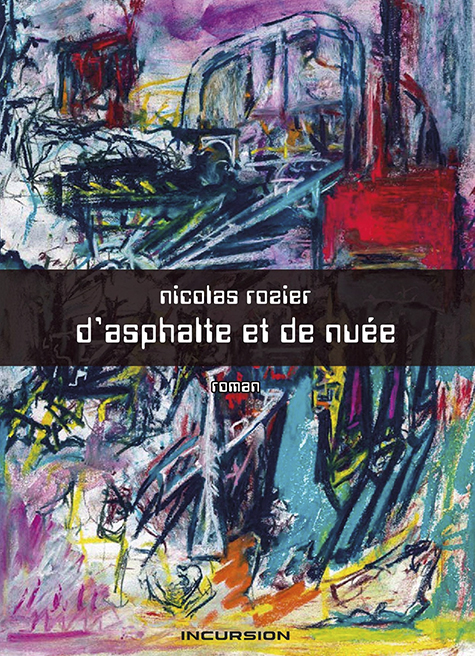
7 – La stèle d’un monument aux morts fraîchement érigé, concernant des soldats américains tombés en 1944, mentionne « un « bataillon perdu » distingué pour son mérite, le 2ème bataillon du 120ème Régiment d’Infanterie », ce qui semble retenir l’attention de Koenig sans que l’on sache ce qu’il pense précisément à ce moment-là. Voulez-vous bien revenir (pour vous) sur ce passage, ainsi que sur cette époque ? Pourquoi avoir choisie celle-ci comme cadre historique à votre roman ? Diriez-vous que si notre époque contemporaine est peu encourageante, il ne faut jamais oublier que les époques précédentes ne l’étaient guère davantage, sinon pire ? Ainsi, voyez-vous une évolution flagrante dans les difficultés rencontrées aujourd’hui par les créateurs par rapport à d’autres époques ? Finalement, diriez-vous que c’est l’époque qui fait l’art ou l’art qui fait l’époque ? Chaque époque mérite-t-elle son art? Quels sont les motifs de satisfaction que peut avoir un artiste de vivre à notre époque ? Que peut encore l’art aujourd’hui, à vos yeux, dans une société où la seule reconnaissance est celle qui se mesure à coup de followers et de clics ?
J’ai découvert la stèle noire dédiée au bataillon perdu, presque par hasard, en allant visiter le promontoire de Mortain, la butte de « Montjoie » que Julien Gracq tenait pour le plus beau des panoramas. L’éminence pierreuse où se trouve enclavée une chapelle trapue, offre un surplomb sur une étendue géante de bocage. Par beau temps, on aperçoit le Mont Saint-Michel. Discrètement érigée à l’arrière du belvédère, la stèle rend hommage aux Américains coincés sur la cote 314 de Mortain, entre le 6 et le 13 août 1944. Coupés des renforts, ils sont parvenus à repousser la deuxième division SS blindée das reich. Dans L’Île batailleuse, la même stèle annonce les personnages de Melnik et Grangier, tous deux vétérans de la bataille de Normandie. Melnik a pris part à la bataille de Mortain, et compte précisément parmi les survivants du bataillon perdu. Ce traumatisme déterminera sa vocation artistique. Face à la stèle, Koenig reçoit un signe avant-coureur que son futur immédiat ne tardera pas à élucider. Cette page de l’Histoire me touche particulièrement. Natif d’une région, la Marne, où les deux guerres mondiales restent très présentes dans les mémoires et dans le paysage, j’ai voulu ce tissage, dans mes personnages principaux, de la bravoure militaire et du talent artistique. En outre, ce passé militaire ajoutait du liant dans la création du merveilleux propre à cette Normandie semi-imaginaire. L’époque de l’Occupation a laissé des cicatrices de tous ordres que je préfère laisser en paix. La peur et la perte, le chaos et la pénurie ont fait rage. Des hommes et des femmes, à cette époque de fer, se sont distingués. J’aime les romans de guerre, plus encore lorsque la bataille n’est pas au centre du récit mais à l’arrière-plan, dans une proximité géographique ou historique comme dans Un Balcon en forêt, Le Désert des tartares, ou Kaputt. Je ne reviens pas sur les difficultés rencontrées par les créateurs aujourd’hui, évoquées plus haut. Quant aux éventuelles correspondances entre une époque et « son » art, il en existe oui, tant et si mal d’ailleurs, que le seul organe de financement, l’État, veut qu’on lui tende un miroir. Exercice de flatterie épineux, commande a priori impossible. Et pourtant, des « projets » bien montés voient le jour, menés par des individus patients et roublards qui pour rien au monde ne voudraient passer leur vie au bord de l’abîme. D’impensables pièces montées, et des moins comestibles, ruminées en résidence dans tous les coins du monde, livrées à temps au préfet local, naissent à grands renforts de centaines de milliers d’euros. L’époque mérite ce traitement puisqu’elle le plébiscite et en redemande. L’ingestion, loin de l’empoisonner ou de l’écœurer une fois pour toutes, attise son appétit, sa voracité stérile. On ne peut citer des noms, c’est l’organigramme au complet. Dans votre question sur les « motifs de satisfaction pour un artiste aujourd’hui », je salue une véritable ironie de l’abîme. Je crois qu’une équipe mandatée par une ONG devrait tenter, peut-être, de faire l’appel, en France, comme à l’aube d’un camp. Si vous n’êtes pas la nièce d’un député, envoyée en résidence pour fabriquer des Alpes en fromage blanc, il vaut mieux assurer ses arrières, comme on dit, ce qui n’est pas simple dans un pays où le seul apatride mis aux fers et au pain sec, c’est l’artiste français. Ce que peut encore l’art aujourd’hui ? Il peut durer, jusqu’à l’épuisement de l’artiste, condamné au solipsisme. S’il en a encore l’énergie, l’artiste doit trouver des lieux de stockage inédits, des fosses étanches creusées la nuit dans la forêt profonde, enterrer le tout, et laisser désenfouir par le sang frais, qui sait ?, dans quelques siècles.
Texte © Nicolas Rozier & D-Fiction – Illustrations © DR
(Neufchâtel-en-Saosnois, août-sept. 2022)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
