Je me suis appuyée à la beauté du monde
Et j’ai tenu l’odeur des saisons dans mes mains
(Anna de Noailles)
Des Étrangers (Allia, 2021), il n’y a pas d’origine. Pas de premier mot. Tout est là, déjà, dans l’épaisseur. Dans le temps. Dans les lieux. Dans l’odeur des saisons. Écrire, c’est la preuve donnée que tout est toujours en cours, avec les souvenirs, les traces qu’on laisse derrière soi, et aussi, bien sûr, au-devant : ce qu’on rêve, ce qu’on imagine. Alors, voilà. Un soir, un matin, il faut s’y résoudre, regarder ce qu’on a sous les yeux, ce qui traîne depuis des années dans quelques vieilles pages, des brouillons, un bout de cerveau. Regarder ce qui est là, et ne pas avoir d’autre choix que d’accepter de s’en débrouiller, qu’on devra bien travailler à partir de ça maintenant, et rien d’autre (rien de meilleur, malheureusement). Il faudra faire avec.
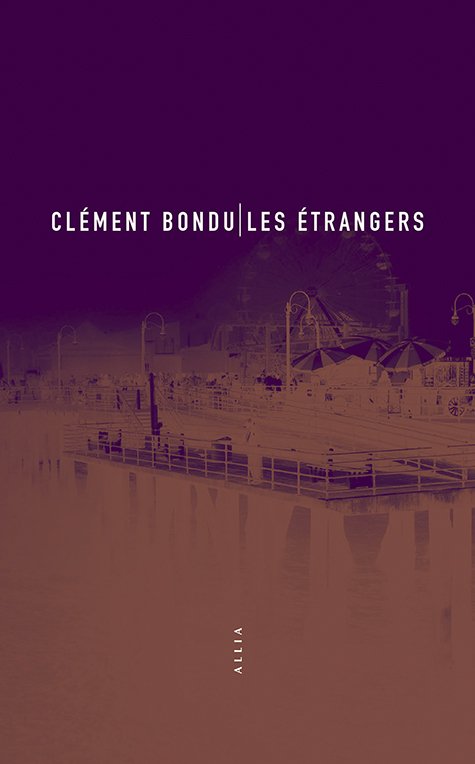
Pour moi, ce fut un vieux tas de notes dans des carnets et des feuilles volantes. Un fatras de bribes de paragraphes et de vers épars, écrits à la main, le plus souvent dans l’urgence, sur un coin de table, d’herbe, un banc, dans une ville, une chambre, un train. Rien d’autre que le geste de l’adolescent qui ne sait absolument pas ce qu’il fait, ni où tout ça le mènera, ni si cela peut valoir le coup, mais il le fait quand même et c’est tant mieux car sinon tout devrait le conduire à abandonner ad vitam ses moindres velléités à la seule pensée des siècles croulants, et des milliers de livres déjà écrits, et des tonnes de poussière et de rêves qui s’entassent à tous les coins du monde. Et sans doute, à la fin, il ne restera rien ou presque de ces morceaux-là, écrits à la va-vite, ces lignes maladroites et à peine lisibles qui n’étaient qu’un éclair. Si bien que le « genre » de ce qui s’écrit là n’a aucune importance. Poème, théâtre, récit, roman : cela ne veut rien dire à cette heure.

À cette heure, il n’y a que la nuit. Et dans la nuit, des brillances. De petits pans de réalité arrachés à la grande masse noire, immémoriale. La sensation précise d’un instant, une rencontre, une apparition. Un moment de terreur, de vertige, de joie. De petits fragments de nuit dont on ne sait plus bien au juste s’ils ont existé réellement, ou si quelqu’un les aura vus pour nous en rêve, depuis un autre corps, un autre temps. Ici, ce furent, en vrac, quelques visages du monde. Certaines rues de Tanger. Le café Hafa et le cinéma Alcazar dans la rue d’Italie (que j’aimais monter et descendre aussi souvent que possible). Plus loin, l’internat de la rue Descartes et le porche de la rue Daval à Paris, qui m’apparurent un soir de déprime, avec leur rythme propre. Et puis, de simples noms. Des noms comme il s’en trouve de ce côté du monde. Paul. Marianne. Ismaël. Le temps transfiguré dans une rue de Madrid. Calle del Amparo. Le refuge que l’on souhaite aux êtres chers. Et la lumière d’avril qui jouait sur les branches au fond d’une cour miteuse où j’avais vécu, et aimé. Mais quel sens tout cela pouvait-il bien avoir ? Je voulais peut-être simplement ne pas oublier la lumière du soleil telle qu’elle s’était levée un jour à Sète, ni le froid de l’hiver dans les avenues désertes de Berlin, ni la chambre 52 du Napoli Centrale qui n’existe pourtant que dans un livre (que je pensais alors ne jamais réussir à écrire). Où était donc le temps perdu ? Quelle sorte de vérité pouvait-il bien tenir entre ses mains fermées ? Où bat le cœur des choses, des êtres que nous avons connus ? Il y a là de la croyance, et de l’invisible.

À la manière de ces nuits des chants, ces nuits de poésie et de guérison que pratiquent certains peuples d’Amérique du Nord pour soigner un des membres de leur communauté. C’était sans doute ça aussi, pour moi, écrire. Faire ma nuit des chants. Une nuit qui, au bout du compte, durerait sept ans. Ainsi, la porte que Paul ouvre devant lui sur le bateau qui le mène de Sète à Tanger n’a aucune réalité matérielle. C’est une expérience temporelle, extatique, où vacillent le proche et le lointain, l’inconnu et le familier. À l’orée d’un autre continent, submergé par une sensation de vertige qui semble l’attirer irrémédiablement vers le vide, Paul se tient sur le pont du « grand navire véloce » comme au seuil d’une résurgence. Le paysage qu’il regarde devant lui apparaît alors de l’autre côté de lui-même, avec la force d’un déferlement. Soudain, tout se déplace. Les frontières du visible s’étirent à l’infini. On pourrait presque croire aux souvenirs d’un rêve.

La jeunesse, l’amitié, l’Europe, le désir. Y avait-il un chemin ou plusieurs ? Valait-il mieux garder les yeux ouverts ? Ou bien, tout regarder comme si de rien n’était, l’air distant, les paupières mi-closes ? Au fond, ne faisait-on jamais que s’éloigner ? Un pas. Un pas encore. Une porte, puis une autre, puis une autre encore. Dans la nuit, les contours deviennent flous, les limites se distendent. Alors on continue (sans trop savoir pourquoi). C’est quelque chose comme tirer les cartes, ou tourner les tables. Jouer avec le manque et les adieux. Jouer avec le sens qu’on donne parfois aux choses, puis qu’on perd aussitôt. Répondre en secret à des phrases entendues, restées là en suspens (tant d’années sans savoir quoi dire). Enfin, avoir l’impression de pouvoir tenir sa petite conversation avec les morts. Faire parler les fantômes. Certains, même, aussi vieux, aussi seuls que nous. Qu’ils aient pour nom Léon Tolstoï ou Orhan Pamuk, Alejandra Pizarnik ou Arthur Rimbaud, Cesare Pavese ou Marguerite Duras, W. G. Sebald ou Claude Simon, Marcel Proust ou Natalia Ginzburg, Elsa Morante ou Roberto Bolaño. Et le jeu parfois tournait mal. Car chaque mot devait être dans son rythme, et à sa place. Et souvent, tout semblait dérisoire et faux. Et j’avais l’impression de me brûler les mains. Alors, écrire, c’était ça aussi : faire un feu et jeter un miroir dans les flammes.

Au fond, il était peut-être simplement question de quelque chose que quelqu’un avait perdu, et qu’il s’agissait de retrouver. Ne serait-ce qu’un reflet. Un peu de soi resté dans l’épaisseur des cendres. Des indices, des signes, dispersés çà et là. Dans la langue. Et dans la nuit. C’est-à-dire partout, et en toute chose. Là où il y a de l’autre. De l’autre, par-dessus tout. Car l’identité est une tombe. Elle n’a aucune valeur et ne signifie rien. Pour autant que nous ne cessons jamais de rêver notre vie tout en la vivant. Nous ne cessons jamais de rêver notre vie et celle des autres. Il ne peut donc y avoir aucune ligne de rupture nette entre le document et la fiction, le réel et l’imagination. « La vérité est double, pour le moins ». Nous sommes faits de corps passagers et de projections multiples. Étrangers, allant d’une rive à l’autre, traversant les mers, les lacs, les villes qui, à leur tour, se déplacent en nous. Rien à faire. C’est l’autre qu’on désire, ou qu’on fuit, qu’on admire, et qui nous inquiète. C’est l’autre qui nous échappe. Et c’est l’autre qui nous vient. Comment ne pas vouloir (ne serait-ce que le temps d’un livre) essayer de se mettre à sa place ? Essayer de se mettre à la place de l’autre n’est pas lui prendre pour autant. C’est un geste qui sauve, parfois. Quand bien même nous savons que c’est perdu d’avance, que nous ne pourrons jamais l’atteindre absolument. Quand bien même nous savons que c’est une chose impossible, et irréalisable. C’est sans doute précisément pour cela que nous devons continuer à le faire. C’est précisément pour cela que les livres existent, et qu’ils demandent un peu d’attention et de courage, un peu de douceur et de temps. Perché la gioia è una cosa seria. La joie est une chose sérieuse. C’est pour elle qu’on doit travailler, retourner à l’ouvrage (quand bien même, parfois, on s’en passerait). C’est pour elle qu’on pleure, qu’on crie même s’il le faut, quand les forces manquent. Mais c’est pour elle aussi qu’on frappe dans ses mains, et qu’on danse, quand tout semble flotter, que les images surgissent et qu’on se croit soudain porté par les ombres. Oui. La joie est une chose sérieuse. C’est pour elle qu’on fabrique des livres, et qu’on les donne à lire. Pour elle que sept ans sont parfois une nuit. Pour croire encore qu’un livre peut être une puissance, et inciter à vivre, à aimer, à désirer.

À s’appuyer encore à la beauté du monde. À tenir l’odeur des saisons dans ses mains. Certains jours, j’aime à croire que nous y arriverons. Que nous serons modernes, à notre façon. Que nous préférerons pour l’avenir ce qui est complexe et inattendu, difficile et contradictoire. Que nous préférerons aux écrans et aux algorithmes, aux codes et aux contrôles, le temps et l’espace libres, les corps et les êtres imprévus. Que nous préférerons à la lumière blanche des morts, qui efface et écrase tout, chaque petit fragment de nuit qu’il reste de par le monde. En nous et au-dehors. Chaque petit fragment de nuit et de forêt immémoriales. C’est là, peut-être, que j’aimerais faire tenir quelques pages d’un livre. Là, dans les yeux d’un chien. Dans l’âme d’une pierre. Au pied d’un arbre lourd. C’est là que j’aimerais célébrer. Convier les amies, et les inconnues. Convier les inconnus. Pour jouer encore.
Un roman est la vie secrète d’un écrivain,
l’obscur frère jumeau d’un homme.
(William Faulkner)
Texte © Clément Bondu – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
