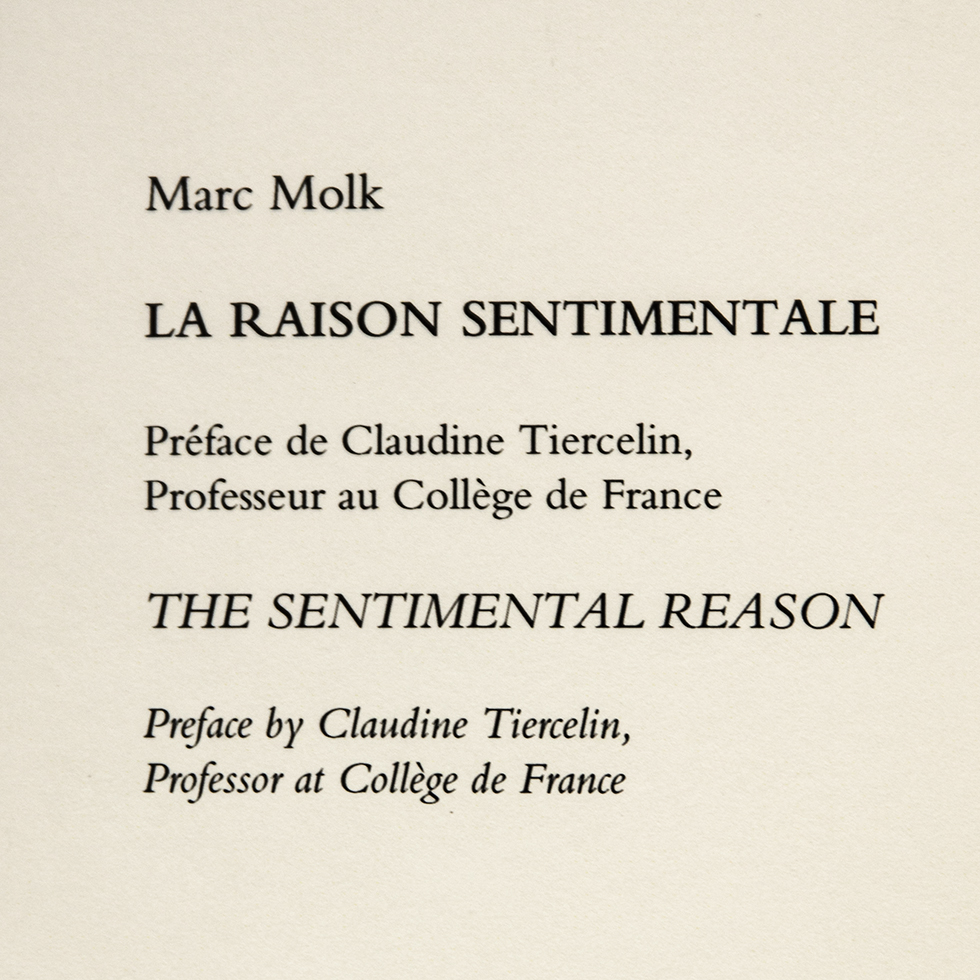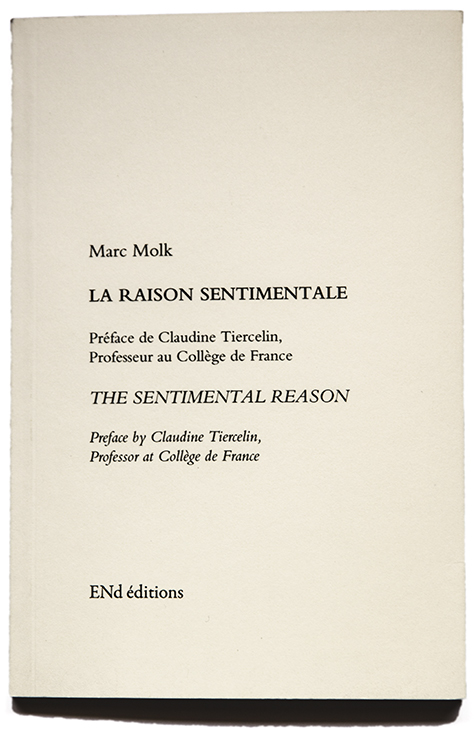
CLAUDINE TIERCELIN nous offre très aimablement de publier sa préface à l’allocution de MARC MOLK au Collège de France à l’occasion de sa parution en volume : LA RAISON SENTIMENTALE (ENd Éditions, 2017) :
Marc Molk n’est pas vraiment un romantique. C’est plutôt un classique contrarié. Fusions, hésitations, trébuchements, ratages, isolement radical, retrait en soi douloureux par le « tunnel de la méditation active », mythes et allégories, personnages ophéliens, gisants, noyés, « suprématie des effets liquides et importance d’une certaine confusion » : tout cela on le trouvera, à profusion même, chez ce peintre de l’intime. Pas tout à fait pourtant : l’ambition avouée « d’adjoindre une grande mélancolie à sa peinture », se double toujours chez Marc Molk d’auto-dérision, d’un refus quasi-stoïcien de la complaisance à soi-même, car le romantisme « gras et collant », celui qui emprisonne dans « la subjectivité de l’amoureux transi », dans les regrets, la tristesse et le désenchantement, « voilà bien ce dont il faudrait expurger le monde » (La Disparition du monde réel, Buchet Chastel, 2013). Marc Molk est peut-être veuf et inconsolé, mais il n’a rien d’un ténébreux.
Ortega y Gasset ne s’y trompait pas : « Toute notre vie mentale est cristallisation », laquelle « déborde le problème de l’amour » (El Sol, juillet 1926, in Études sur l’amour, trad. Ch. Pierre, Payot&Rivages, 2004, p. 64). Car « aimer est quelque chose de plus grave et de plus significatif que se passionner pour les lignes d’un visage et la couleur d’une joue : c’est se décider pour un certain type d’humanité qui s’annonce symboliquement dans les détails du visage, de la voix et du geste ». Il faut donc suivre l’évidence stendhalienne, mais en oublier les « gesticulations romantiques » sur la perfection totale et le surinvestissement conscient, accepter plutôt de se placer dans « un état d’esprit inférieur, une espèce d’imbécillité transitoire ». Car « sans l’ankylose de l’esprit, sans la réduction de notre monde habituel, nous ne pourrions pas tomber amoureux » (p. 77). Or, il le faut. Nous le devons aux autres tout autant qu’à nous mêmes. « L’état amoureux » étant « d’abord un phénomène de l’attention » (p 71), il faudra « tenter de décrire directement l’acte amoureux en prenant son signalement comme fait l’entomologiste avec un insecte capturé dans la nature », afin que « les lecteurs qui aiment ou ont aimé quelque chose ou quelqu’un, puissent maintenant saisir leur sentiment par ses ailes translucides et le maintenir fixe sous le regard intérieur » (p. 77).
À bien des égards, Marc Molk procède de même. Faire la liste de ceux qu’il a perdus (Pertes humaines, Arléa, 2006), inventer de subtils entomogrammes où fusionnent écriture, insectes et dessin, peindre enfin, sont tout un. Le peintre, aime lui aussi cristallisations et « paillettes iridescentes », faire « couver » des jus qui viendront colorer les grisailles, les éclabousser et les perturber par des graines, des lentilles, du riz ou des haricots, la toile bien arrimée au sol avec force couvercles de pots de confiture. En réaliste généreux, il « fait peindre » les éléments eux-mêmes, l’eau, l’air et la terre, parler la dynamique des fluides, la logique de l’eau, par la « répartition hydraulique des pigments bruts ». Il laisse l’empreinte du monde suivre sa logique propre, avec son mouvement et ses accidents de parcours, car il veut « inviter la réalité par la qualité stupéfiante de la trace qu’elle laisse bien davantage que par une reproduction illusionniste » déterminée d’avance. Foin de la représentation. Soyons juste attentifs.
Car s’il est « vrai que plus on juge, moins on aime », et que « peu d’hommes vous mettent dans le cas de faire exception à cette règle, il n’est pas vrai (ce qu’a dit Rousseau après Plutarque) que plus on pense, moins on sente » (Chamfort, Maximes et pensées, CXL). Peinture, amour et raison vont de pair, mais n’ont rien d’immédiat. Ils exigent au contraire beaucoup de savoir faire, une réelle « connaissance » pratique.
D’abord par la « raison » ou structure intentionnelle, nécessairement « allocutoire » du tableau, qui est toujours pour Marc Molk une « oeuvre dédiée » : tous ces visages, tous ces êtres nommés, chacun avec sa couleur propre, qui lui ont « appris à peindre », tout simplement parce qu’il lui ont « appris à vivre ». Par la raison encore, et la part qu’y prend, tout naturellement, en ce « monologue intérieur inquiet en amont de chaque jeu de mains », en cette « décortication de la pensée », la « réflexion délibérative », dans le choix du moment opportun, du « ponçage » ou de « la reprise à l’huile grasse », toute cette « nuée d’arbitrages tactiques », « ce casse-tête permanent », « ce jeu de stratégie long, très prémédité », plus important que leur exécution proprement dite.
Attention, patience, humilité, fuite de la vanité, autant de vertus proprement intellectuelles et épistémiques de cet agent de connaissance qu’est le peintre, sur lesquelles insistent tant aujourd’hui, plus que sur le contenu, les philosophes de la connaissance proches du courant de « l’épistémologie des vertus », désireux de montrer, comme jadis Aristote, à quel point la connaissance pratique repose sur un art de la sagacité et du discernement (phronesis), obligeant à relativiser cette « légende intellectualiste » (Gilbert Ryle) d’une supposée « supériorité » de la connaissance « théorique » et à en revoir l’image : loin d’être une suite de propositions, de vérités ou de faits que l’on contemplerait, elle engage, en fait, une forme d’intelligence proche du savoir pratique, et, au même titre que lui, des aptitudes (à l’imagination, à la représentation iconique, etc.), des capacités incorporées, situées, des dispositions et des talents divers où se jouent nos perceptions, nos émotions et tout notre corps, nous ouvrant ainsi à un domaine d’expérience rempli de signification.
Marc Molk est sûrement plus proche d’une telle attitude anti-intellectualiste de la connaissance. Ce n’est pas seulement un moraliste du Grand Siècle, pénétré des valeurs de l’aveu, de la faute pardonnée, du mépris envers soi et du repentir, voire de la rédemption, conscient tout à la fois du ridicule des « »leçons » de morale et du respect absolu que l’on doit à la normativité de la raison, dès lors que l’on épouse une certaine « éthique de l’erreur ». Car trahison des sentiments et trahison des clercs : c’est tout un. Aussi peu intellectualiste qu’il soit, et qu’il le veuille ou non, Marc Molk n’en est pas moins, en matière de connaissance, en général, un « épistémologue responsabiliste » des plus extrêmes.
Mais la « raison » bien sûr, n’a rien ici d’une froide Minerve hegelienne : la « sauce cerveleuse » ne sort pas du Goulag : elle est de part en part « sentimentale ». Marc Molk sait que « celui qui veut trop faire dépendre son bonheur de sa raison, qui le soumet à l’examen, qui chicane, pour ainsi dire, ses jouissances, et n’admet que des plaisirs délicats, finit par n’en plus avoir. C’est un homme qui, à force de faire carder son matelas, le voit diminuer, et finit par coucher sur la dure » (Chamfort, Maxime CLXX).
Aussi découvre-t-il plus qu’il ne dicte « l’ordre d’exécution » que lui « souffle » le tableau : la visée idéale, c’est la désinvolture, la nonchalance, « la sprezzatura que l’on peut donner à sa conversation ou à ses tableaux », cette « apparence d’aisance et de naturel, qui cache les difficultés de l’artifice, et laisse accroire que tout est fait sans peine et quasi sans y penser ». La démonstration technique peut « jouer les fières » : quelle que soit l’excellence de la prise de main, la dextérité, la virtuosité atteinte, l’illusion majeure serait de croire à une « neutralité sentimentale de la technique ». Car « chaque procédé, chaque geste, chaque outil ne se contente pas d’organiser différemment la matière. Il existe une vocation propre de chaque technique à exprimer une gamme de sentiments plutôt qu’une autre ». Ce n’est donc plus seulement du rendez-vous voluptueux du tableau, de la matière sensuelle érotique que l’on touche, des flottements de l’âme aussi, rendue plus « malléable » par la musique, qu’il s’agit ici : c’est de cette « chaîne vertueuse » qui se crée et qui rend alors possible « l’expression claire », parce que celle-ci est « subordonnée à un projet humain, à une autre émotion que la sienne propre, à celle du peintre », à une nouvelle façon de regarder, poussée d’autant plus loin que « l’on entre dans une discussion à plusieurs devant la toile ».
Car la raison sentimentale ne joue pas sur le registre de l’émotion immédiate, de n’importe quel état affectif, passion, humeur, pure réaction physiologique ou impression fugace : s’il est question de « véritable » émotion esthétique induite au terme d’une « recherche tenace », qu’il s’agisse « d’émotion inverse » ou de « curiosité rétrogénétique », nous sommes plus près ici de ce que Descartes appelait, dans les Passions de l’âme, des « émotions intellectuelles », ces « émotions intérieures de l’âme » (§ 147), si nécessaires pour le rééquilibrage des eupatheia, en ce qu’elles viennent au secours de l’entendement et font intervenir, crucialement, dans toute connaissance, le mouvement calme propre à notre vouloir lui-même (§ 75). La raison sentimentale, c’est plutôt donc la fusion austenienne des deux sœurs jumelles « Sense and Sensibility », le pendant de ce que William James appelait « the Sentiment of Rationality », cette forme de « sensibilité à la rationalité », indispensable à la vie même de la raison, à nos modèles et idéaux de pensée, d’action et d’évaluation, lesquels exigent des dispositions émotionnelles adéquates. Se respecter soi-même, n’est-ce pas avoir l’amour de la vérité et l’horreur du mensonge, le souci de l’exactitude, une répugnance à l’égard de l’erreur logique ou factuelle, de l’admiration pour les réalisations théoriques, du respect pour les arguments des autres ? Comme en attestent les recherches récentes (R. de Sousa, M. Nussbaum, A. Damasio, J. Deonna & F. Teroni), loin d’être privées ou subjectives, ou de pures sensations comme des chatouillis, nombre d’émotions supposent l’appartenance à une communauté linguistique et sociale. Elles ont toujours une dimension physiologique et affective, conative (ou motrice), mais aussi épistémique, évaluative et sociale. On sait mieux aujourd’hui ce qui les distingue d’autres états affectifs mais aussi d’autres états mentaux comme les croyances, les désirs, les sensations, les perceptions ; ce qu’est leur grammaire ; à quoi tient leur passivité ; s’il faut y voir des états occurrents ou plutôt dispositionnels, quelles contraintes normatives pèsent sur elles, et comment nous les évaluons. Loin en effet que nos émotions se réduisent toutes, comme le pensaient les Stoïciens, en conséquence de leur monisme rationnel, à des jugements erronés, s’il en est bien de négatives (peur, angoisse, indifférence, haine, tristesse, jalousie, colère, frustration, honte, dégoût, ambition), il en est bien aussi, que leur nature soit ou non cognitive, d’éminemment positives, sinon pour établir la validité, la justification de nos croyances, les raisons que nous avons d’entretenir tel jugement, au moins par le rôle qu’elles jouent dans la découverte, la genèse et l’acquisition de connaissances : sans la surprise, la curiosité, l’admiration, le désir, la joie, l’amour (Descartes,Traité, §69) sans le malaise suscité par le doute, nous ne saurions faire le départ entre doutes feints et doutes réels, déterminer ce qui est pertinent et saillant, dans une situation donnée. Toute enquête authentique serait à l’arrêt.
Marc Molk ne veut pas choisir entre sentir et penser, entre peindre et écrire, entre peindre et vivre, car « la vie s’étudie dans les tableaux et la peinture se perfectionne dans la vie ». Le peintre et l’écrivain, bien vivants dans le Siècle, n’ont pas tort. Parier sur la raison sentimentale « qui ordonne ce brassage » suppose de ne pas se perdre en de vaines arguties sur ce qui serait plus ou moins rationnel, ou épouserait le mieux le sensible, sur la base d’oppositions factices (le plus souvent scientistes) entre ce qui relèverait de la scientificité et ce qui serait marqué au sceau de la non scientificité. C’est parier ensuite, contre Chamfort, sur la possibilité, si nécessaire aujourd’hui, comme je l’ai moi-même montré ailleurs (« Raison et sensibilité », in La Reconstruction de la raison, Collège de France, col. « Philosophie de la connaissance », 2014), de dessiner les règles d’un art de juger, qui permette d’aimer et de ne pas haïr. Cet art du discernement implique certes un travail critique, de mieux saisir ce qui se joue au sein de « l’espace des raisons », de penser le rapport entre la raison et les raisons, la manière dont celles-ci s’articulent aux causes, et s’articulent plus ou moins bien entre elles, les liens qui se tissent entre nos raisons de croire et nos raisons d’agir, ou encore pourquoi, ou si, nos raisons épistémiques doivent toujours, ou jamais, ou parfois seulement, l’emporter sur nos raisons pratiques ou vitales. C’est mesurer aussi à quel point l’irrationnel vient se loger dans le rationnel, mieux comprendre les mécanismes qui tiennent à l’aveuglement, à la duperie sur soi, à la faiblesse de la volonté et nous empêchent de réagir efficacement aux forces des croyances irrationnelles qui sont à l’origine du fanatisme et de l’intolérance. La raison seule n’y suffit pas, car « à une croyance vivante, il faut plus que la présence intellectuelle de l’idée » (Jules Vuillemin), et c’est donc « ce surplus qu’il convient d’examiner », en nous dotant de règles pour la direction certes de l’esprit, mais aussi de l’âme.
S’il faut se méfier des affects, il peut être tout aussi irrationnel de nier toutes nos émotions ; ce serait ne pas voir que la sensibilité, foncièrement, s’éduque, que l’école de la sensibilité artistique, en particulier, nous aide moins à exprimer des affects subjectifs « intérieurs » qu’à procéder à l’éducation de nos dispositions tout uniment affectives et intellectuelles. Et plus que tout, peut-être, à éduquer notre sensibilité au vrai. Car il ne suffit pas de connaître pour être vertueux. Comme le disent Platon dans la République, puis Aristote dans l’Éthique à Nicomaque, « s’agissant de la vertu, il ne s’agit pas non plus de savoir ce qu’elle est ; il faut au contraire tâcher d’avoir la vertu et de l’exercer, à moins qu’il existe pour nous une autre façon de devenir bons » (1179b3-4). Émotions et désirs peuvent dominer la connaissance, en empêchant l’acratique d’effectuer des actes qu’il sait être vertueux. Il ne suffit donc pas de savoir quelles sont les bonnes dispositions à l’action ni quelles actions conviennent. Il faut aussi avoir les bonnes dispositions à l’émotion et à la motivation. Or nous n’y parvenons qu’en éduquant, par habituation, répétition, imitation d’exemples, nos affects, nos passions. Il faut entraîner émotions et motivations, en sorte qu’elles « s’accordent » avec la raison (1102b28). Et il le faut, car connaissance et raison n’y suffiront pas : « Un sujet ne peut entendre l’argument qui l’en détourne, ni d’ailleurs le comprendre, s’il vit au gré de ses affections » (1179b28-29). Aussi la raison sentimentale de l’artiste est-elle si importante, car, mode de compréhension, l’émotion est aussi un mode de perception. Bien qu’indémontrables, les opinions des gens d’expériences comptent, car « ils ont acquis par l’expérience un œil qui leur permet de voir correctement les choses » (1143b12), d’apercevoir dans une situation ce qu’il convient de faire. Éprouver les émotions « quand on doit, pour les motifs, envers les personnes, dans le but et de la façon qu’on doit, constitue un milieu et une perfection, ce qui précisément relève de la vertu » (1106b21-23). Comprendre et percevoir, c’est ici ressentir, percevoir, littéralement, des valeurs.
Pudeur, honnêteté, zéro complaisance. Tel est le peintre. Tel est l’écrivain. Ils s’appuient l’un sur l’autre. Comme un empereur prénommé de même, Marc Molk a lui aussi revêtu très tôt le manteau philosophique. Je ne sais s’il apprit « dès l’âge de douze ans à coucher sur la dure et à pratiquer toutes les austérités de l’ascétisme stoïcien », s’il « fallut les instances de sa mère pour le décider à étendre quelques peaux sur sa couche », si sa « santé fut plus d’une fois compromise par cet excès de rigueur », bien que cela ne l’empêchât pas « de présider aux fêtes, de remplir ses devoirs de prince de la jeunesse avec cet air affable qui était chez lui le résultat du plus haut détachement ». C’est en tout cas ainsi que parle affectueusement Ernest Renan de Marc Aurèle : « ses heures étaient coupées comme celles d’un religieux. Malgré sa frêle santé, il put, grâce à la sobriété de son régime et à la règle de ses moeurs, mener une vie de travail et de fatigue ». Mais, ce Marc là « n’avait pas ce qu’on appelle de l’esprit, et il eut très peu de passions. L’esprit va bien rarement sans quelque malignité ; il habitue à prendre les choses par des tours qui ne sont ceux ni de la parfaite bonté ni du génie. Marc ne comprit parfaitement que le devoir » (Marc Aurèle et la fin du Monde antique, Calmann-Lévy. 1891).
À en juger par le merveilleux esprit qui anime ses textes et ses tableaux, et qui déplaira peut-être à ceux dont la raideur mentale veut toujours contraindre à choisir entre écriture et peinture, entre raison et sentiment, il y a tout lieu de croire qu’au si talentueux Marc Molk, ne manqua pas « à sa naissance, le baiser d’une fée », « une chose très philosophique à sa manière », à savoir « l’art de céder à la nature, la gaieté, qui apprend que l’abstine et sustine n’est pas tout et que la vie doit aussi pouvoir se résumer en sourire et jouir ».
Texte © Claudine Tiercelin – Illustration © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.