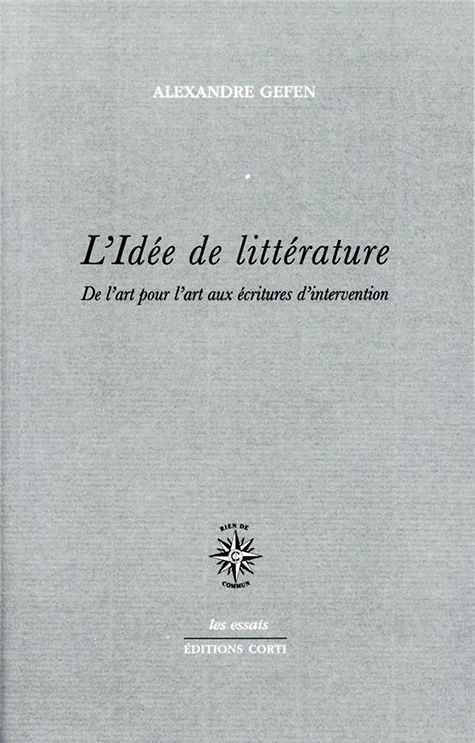
Sous couvert d’une histoire de « l’idée de littérature », d’un processus qui selon l’auteur invaliderait ce que cette idée charriait ou charrierait encore en terme « d’idéologie esthétique » (celle de « l’art pour l’art », de la « religion du texte », d’un « supposé universalisme ») pour finalement, depuis une « pratique communicationnelle et relationnelle », « éthique » et « démocratique », privilégier « une conception de la littérature comme un concept ouvert, extensif et inclusif », Alexandre Gefen dans son essai L’Idée de littérature (Corti, 2021) illustre et défend de facto une conception postmoderne de la littérature, bien que cette occurrence, presque absente des pages de son livre, ne soit nullement revendiquée. Pourtant, Gefen l’avoue implicitement lorsqu’il remarque que, « après l’échappée esthétique tentée par la modernité, l’heure est à une littérature d’intervention ». Le mot « intervention » (présent dans le sous-titre de l’ouvrage : « De l’art pour l’art aux écritures d’intervention ») se rapportant à la littérature considérée « comme un moyen et non comme une fin ».
On peut déjà se faire une première idée de ce que l’auteur entend distinguer négativement et positivement en citant plusieurs noms d’écrivains qui illustreraient deux idées opposées de la littérature. En ce qui concerne les premiers, on ne s’étonne pas de trouver Maurice Blanchot, coupable d’avoir érigé « cette idéologie de négativité critique […] en doxa de la modernité ». Gefen passe par perte et profit toute l’oeuvre critique de Blanchot en indiquant que ce qui la constitue fondamentalement « a pu constituer le masque d’un engagement à l’extrême droite de son auteur entre les deux guerres, une tare qu’il fallait absolument dissimuler en enfouissant par la théorie de l’autonomie tout souvenir des compromissions passées ». Ce pont-aux-ânes, que Gefen reprend après d’autres, entend frapper de vacuité l’engagement plus conséquent et plus déterminant de Maurice Blanchot à l’extrême gauche : de la revue 14 juillet à mai 68, en passant par le Manifeste des 121 (dont Blanchot a été le principal rédacteur).

À Richard Millet, Gefen reproche son tropisme anti anglo-saxon dans le domaine littéraire. Millet étant le seul, parmi le millier d’auteurs cités dans L’Idée de littérature, à être qualifié de « réactionnaire » ! Il figure également dans une liste d’écrivains pour qui, depuis Stendhal, « la démocratie amène nécessairement dans la littérature le règne des gens médiocres, raisonnables, bornés et plats, littérairement parlant ». On est étonné d’y trouver Julien Gracq, dont Gefen tance curieusement « la déploration peu républicaine […] contre une figure de l’écrivain » qui ressortirait « déformée et grossie » des « bains de foule » dans un climat de « vulgarisation presque électorale » ». Ces citations sont extraites de La Littérature à l’estomac, un texte critique majeur de Julien Gracq. Texte au sujet duquel Xavier Boissel a pu très justement relever – dans un hommage rendu à Manchette – qu’il « attaque férocement les moeurs littéraires françaises de l’après guerre, le milieu littéraire parisien, le carriérisme des auteurs, la putasserie de la critique, le bavardage culturel, la littérature de divertissement et la littérature édifiante ».
Cette posture de « Grantécrivain », que Gracq brocarde pourtant dans La Littérature à l’estomac, se trouve improprement accolée à l’intéressé par Gefen. Ceci pour avancer que Pierre Michon a été « rapidement consacré par l’histoire littéraire comme le dernier « Grantécrivain » français après la mort de Julien Gracq, précisément pour son exigence stylistique et l’image élevée qu’il se fait de la littérature ». Michon représente l’exemple patent de ce contre quoi Gefen entend s’opposer, j’y reviendrai. Dans ce registre, mais « dans une veine encore plus conservatrice, le romancier et essayiste Philippe Vilain s’inquiète lui-aussi de la « déligitimation de la notion d’idéal esthétique » à travers la disparition du souci de style ». Le tapis ainsi déroulé, Gefen nous assure que « c’est par cette nostalgie de la grande langue française que l’on peut expliquer une partie du succès chez les lettrés de ceux qui, comme Pierre Michon ou Pascal Quignard placent encore au premier plan le souci de la langue » (c’est moi qui souligne). Les malheureux ! Ne leur a-t- on pourtant pas dit et redit que ce « souci de la langue » n’était plus qu’une revendication de has been ! Gefen évoque même une imposture propre à Michon que l’écrivain mettrait en scène. L’explication qui suit paraît obscure, pour ne pas dire incompréhensive. Le lecteur ne retient in fine que « l’incroyable illusion romantique » revendiquée par l’écrivain l’a « conduit à intégrer rapidement programmes scolaires et manuels ». Ici, Michon se trouve donc récupéré par l’institution scolaire ou universitaire, alors que la même intégration, chez des auteurs prisés par Gefen, ne peut que prouver l’excellence de ce qu’ils écrivent.
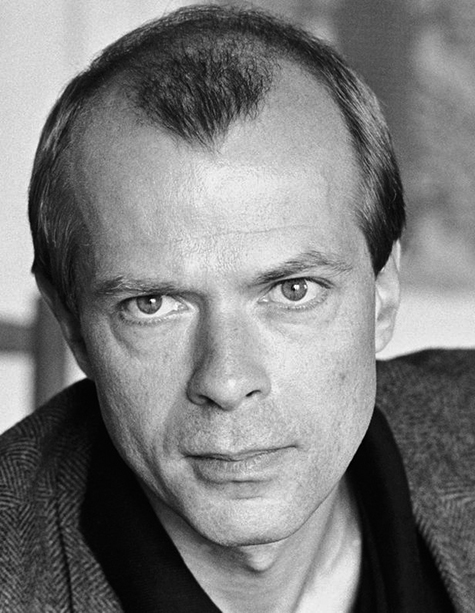
Plus en amont, Alexandre Gefen ne s’attarde pas sur ce qu’il appelle un « catéchisme esthétique », c’est-à-dire « un appel problématique à l’action de l’art pour l’art dont le surréalisme et le tournant de la « nouvelle critique » sont deux moments bien connus ». Mais « biens connus » pour qui ? Du seul Gefen, semble-t-il, qui en associant, même de façon problématique, le surréalisme à l’art pour l’art confirme qu’il n’y entend pas grand chose. On aurait aimé que Gefen développe ce propos. Certes, il cite Julien Benda qui a qualifié dans les années 1940 de « littératurisme » ce que plus de 70 ans plus tard Gefen s’efforce de critiquer depuis une certaine idée de la littérature. Le Nouveau Roman est également soumis au même rejet. Gefen s’appuie sur l’un des petits marquis des Lettres, Aurélien Bellanger, qui en 2012 affirmait qu’il « ne reste rien de Sarraute » (!). Gefen ajoutant que « le travail sur le langage ne peut désormais plus prendre le pas sur la question de la signification, ni remettre en question les impératifs de clarté et de lisibilité ». Ceci dit en passant par un auteur qui s’exprime parfois dans un jargon très peu compatible avec de tels impératifs…
En revanche, pour en venir aux écrivains cités de manière positive ou exemplaire, Alexandre Gefen distingue ceux qui « tendent vers une langue si ce n’est simplifiée, du moins apaisée avec elle-même, et cherchant en principe l’adéquation et non la singularité » (« d’Emmanuel Carrère à Michel Houellebecq, d’Annie Ernaux à Christine Angot, de François Bon à Aurélien Bellanger »). Gefen loue « le réalisme sociologique » d’Annie Ernaux, « chroniqueuse de sa génération à laquelle l’histoire littéraire doit d’avoir politisé le genre volontiers égotisme et autarcique de l’autobiographie ». Par ailleurs, dans une rubrique relatant « l’expérience traumatique de leurs auteurs », Gefen met en avant « le récit naturaliste d’Édouard Louis, les fictions à clef de Christine Angot, le road movie punk de Virginie Despentes ».

Un nom apparaît dans les deux listes, celui de Christine Angot. Je le reprends volontiers parce que « l’oeuvre » de cette écrivaine défie l’analyse, l’esprit critique et même le sens commun. Comment un fort contingent de journalistes et de responsables des pages littéraires de journaux et magazines, tous montés au créneau lors de la parution en 2015 de Un amour impossible, peuvent-ils encenser un écrivain de cet acabit ! Et dans cette liste figurent des critiques littéraires que l’on croyait pourtant protégés contre pareil phénomène d’angotamie. Il faut remonter à L’Inceste (1999) qui plus que les précédents attirait l’attention sur Christine Angot, pour avoir un début d’explication. Cette partie de la critique qui a tressé des lauriers à Un amour impossible ne protège-t-elle pas Christine Angot (la personne autant que l’écrivaine) ? Ce qui s’expliquerait de la façon suivante. Cette pauvre Christine qui a été « incestée » par son père (in L’Inceste donc) ne peut se reconstruire qu’en écrivant, et nous devons l’aider en ce sens. Il s’agit d’un processus de reconstruction long, difficile (les détracteurs de l’écrivaine augmentant la difficulté), que l’on accompagnera en encourageant Christine. Puisque Un amour impossible revient une fois de plus sur cet inceste (preuve étant ici faite que le traumatisme reste présent), il nous faut, nous critiques littéraires responsables, déclarer très bon, voire excellent ce dernier roman. C’est ainsi que l’on aidera Christine à surmonter cette épreuve traumatique. La critique joue donc ici, pour résumer, un rôle thérapeutique. Elle a abandonné tout esprit critique pour se transformer en critique compassionnelle. La littérature n’a pourtant pas grand chose à voir avec cela…
Promu déjà comme l’un des événements de la rentrée littéraire 2021, le dernier roman de Christine Angot, Le Voyage dans l’Est, revient une fois de plus sur le motif « inceste ». Tiphaine Samoyault – dans (hélas !) En attendant Nadeau – le défend sur un mode très en phase avec l’idée de littérature selon Gefen. Il s’agit bien de le défendre parce que son article laudateur s’adresse également aux contempteurs de la romancière. Samoyault cite un extrait du Voyage dans l’Est qu’elle qualifie de « scène extraordinaire » (en relation avec ce que j’écrivais plus haut, on vérifie là à quel point ce « compassionnel » peut aveugler nos critiques littéraires). Elle ajoute que « ceux qui disent ou prétendent que Christine Angot écrit mal le disent parce qu’ils sont incapables de supporter ce que cette langue dévoile d’eux-mêmes. Ils préfèrent la rhétorique, les fleurs du « beau style », tout ce qui masque souvent au lieu de dévoiler ». On croit d’abord comprendre que tout détracteur de Christine Angot se situe objectivement dans le camp du père incestueux. Et puis l’on se demande bien, Le Voyage dans l’Est à l’appui, de quel dévoilement l’on nous entretient ici, quand le roi (ou la reine) est nu et plus que nu !

Gefen, qui reste mesuré dans l’éloge, s’extasie cependant dans sa conclusion sur « les dernières lignes » du roman Vernon Subutex de Virginie Despentes, dans lesquelles le personnage principal « s’identifie tour à tour à une série de figures » (le paragraphe en question étant entièrement cité) : « Je suis la pute arrogante et écorchée vive, je suis l’adolescent solidaire de son fauteuil roulant, Je suis la jeune femme qui dîne avec son père qu’elle adore et qui est fier d’elle… », etc., etc. En rappelant que ce roman était paru le 7 janvier 2015, Virginie Despentes, dix jours après la tuerie de Charlie Hebdo, dans un entretien aux Incorruptibles reprenait en quelque sorte ce procédé en précisant qu’elle avait été à la fois les tueurs, les frères Kouachi, et leurs victimes. Quoiqu’en disent et prétendent les admirateurs de Despentes, celle-ci renvoie dos à dos les assassins et leurs victimes. Ce qui suffit à la disqualifier sur les plans politique et moral.
Pour revenir à la littérature, nous retenons difficilement notre sérieux quand Gefen se lance dans un panégyrique de Vernon Subutex qui, comme les romans précédents, se distingue surtout par l’indigence du style de l’auteure. Certes, d’aucuns comparent très favorablement Vernon Subutex aux « meilleures séries télévisées » ; et plus généralement mettent en avant l’oralité de sa production romanesque (n’est pas Céline qui veut !), son contenu social et sexuel, voire subversif. Sauf que sans une expression adéquate, nous en restons à un niveau de misérabilisme littéraire à tous les étages. Cela ne valant évidemment pas pour la seule Virginie Despentes. D’ailleurs, du point de vue de la littérature défendue en règle générale dans L’Idée de littérature, le cas Despentes paraît périphérique. Plus fondamentalement Alexandre Gefen s’inscrit en faux contre « la notion d‘oeuvre ». Ceci pour « envisager la littérature non comme un thesaurus de « textes » mais comme un ensemble « d’activités » ». Ici l’auteur entend évoquer « des formes de politiques locales inclusives qui embrassent un vaste spectre d’activités pédagogiques et créatives, valorisant les savoirs propres des individus et des communautés dans leur capacité à produire des mondes habitables ». Bon, à lire pareil laïus, la « notion d’oeuvre » a encore de beaux jours devant elle !

Avant de poursuivre cette lecture critique de L’Idée de littérature, arrêtons nous sur le mot « activités » pour apporter les précisions suivantes. Celles-ci ne sont pas directement liées à la littérature, et s’écartent de la grille de lecture proposée par Gefen. Pourtant, il importe de faire ressortir une notion (celle de « culturel »), absente des pages de L’Idée de littérature, mais qui n’est pas sans entrer en résonance avec la manière dont Gefen se positionne contre la notion d’oeuvre. Le culturel, si je tente de le définir, précise les attentes en matière de culture. Soit une culture dite « vivante » dont nous serions le cas échéant les usagers. C’est-à-dire une culture dispensée en direction de populations ciblées (mais pas nécessairement) avec la possibilité, pour les intéressés, de se livrer à une activité culturelle. L’usager n’étant pas seulement un consommateur de « produits culturels » dans la mesure où il participe à ces activités.. Et puis, a priori, le culturel n’établit pas de distinction : le rap vaut la musique classique, qui vaut la danse moderne, qui vaut l’atelier théâtre, etc. Contre ceux qui défendraient une conception élitiste de la culture – l’art, pour simplifier – le culturel a toujours raison démocratiquement parlant (selon l’idée dominante de la démocratie). La discussion porte alors sur la question des moyens, celle des investissements financiers, des subventions, des budgets : afin de permettre au plus grand nombre, davantage encore, d’accéder à la culture.
Il s’agit, bien entendu, d’intentions parce que dans la réalité cela peut se traduire différemment. Quoi qu’il en soit, les questions liées à la culture ne sont pas épuisées par le culturel. Et plus particulièrement celles qui relèvent de l’art. Car celui-ci ne saurait être rabattu sur le culturel. Ce dernier, fondamentalement (ou tendancieusement si l’on préfère), représente une forme d’émancipation « petit bras » qui ne peut être comparée à l’émancipation versus art. Cependant, pour éviter ici tout malentendu sur l’art, encore faut-il ne pas confondre « hiérarchiser » et « distinguer ». Ce n’est pas tant l’aspect élitaire que l’on prête à l’art qu’il faudrait alors discuter que l’absence de relations dialectiques entre l’art, la culture et la société que la terminologie « hiérarchiser » induit.
Une dernière précision. Cette digression sur le culturel et l’art reprend deux paragraphes d’un texte écrit plus de vingt ans plus tôt dans un tout autre contexte. François Rastier, depuis un article publié en 2021 dans la revue Cités, indique que « la cancel culture s’apprête à réaliser le voeu suprême de l’industrie culturelle : remplacer la culture par le culturel, calibré par les communautés qui sont autant de segments de clientèle ». Voilà qui prolonge, et réactualise notre propos sur le culturel. Et représente une bonne transition avec ce qui suit.

En revenant à L’Idée de littérature, Alexandre Gefen, en bon auteur postmoderne, évoque un effondrement du « »moment littéraire de la littérature » qui nous a servi de normes et continue d’informer encore nos fantasmes », dés lors que selon lui se trouvent remises en cause « les frontières entre non-fiction littéraire et journalisme, poésie et performance, enquête en sciences sociales et en littérature, séries et roman ». L’auteur signifie ainsi son accord avec le monde tel qu’il va, tel qu’il évolue, tel qu’il impose de nouvelles normes, sur le plan littéraire principalement, mais également dans le domaine de la communication et du politique. Si l’on entre dans le détail de cette « transformation », d’abord en matière littéraire, Gefen relève que « le régime d’écriture dans lequel s’inscrit la plus grande majorité des romans paraissant en langue française est celui d’un réalisme modeste, où le roman cherche sa forme avec confiance » à l’aide d’une « langue apaisée ». Ceci, nous l’avions compris, contre les prétentions langagières de l’avant-garde, ou de toute écriture singulière, et bien entendu « sans faire de l’innovation stylistique une nécessité ». Gefen écrit dans ce registre que « de Camus à Houellebecq, la modestie, l’économie esthétique et l’indifférence générique se sont imposées dans le contemporain ». Enfin, comme dirait Zazie : « Réalisme modeste, mon cul ! ». En d’autres temps, moins conformistes, on imagine la volée de bois vert qu’auraient administrés les surréalistes, et d’autres, à un auteur prônant le « réalisme modeste » en littérature. On dira que Gefen est aussi le produit de cette époque, la nôtre, et qu’en 1969 encore, date de l’autodissolution du groupe surréaliste, toute proposition tenue en terme de « réalisme modeste » aurait passé pour une aimable plaisanterie. À l’aune d’une pareille idée de la littérature, dans un ouvrage privilégiant, certes, la situation littéraire en France, mais qui cite des centaines d’écrivains et critiques anglo-saxons inconnus de nos services, l’absence d’un Thomas Bernhard ou d’une Elfriede Jelinek vaut comme indication (comme celle, plus généralement, d’auteurs extérieurs au monde anglo-saxon). Dans un livre qui croule sous les références (un millier de noms d’auteurs figurent à l’index), relevons les absences de Kafka, Thomas Mann, Artaud, Bernanos, Gombrowicz, Pessoa, Giono, Michaux, Nabokov, Pavese, Bakhtine, Genet, Celan, Vian, Ponge, Kundera, Butor, Kerouac, Garcia Marquèz, Marthe Robert, Perros, Handke, Bergounioux, pour se limiter au 20e siècle…

Gefen évite d‘utiliser la terminologie « cancel culture » quand il mentionne, aux États-Unis, la présence dans les maisons d’édition de lecteurs dont la fonction est « de prévenir toute offense, même involontaire, envers les communautés minoritaires, les sensitivity readers, en traquant les poncifs culturels rémanents avant publication, et les politiques universitaires visant à prévenir les étudiants par des trigger warnings de contenus potentiellement choquants dans des oeuvres anciennes ». C’est vouloir à mots couverts justifier une forme inédite de censure, plus insidieuse que celle à laquelle nous étions confrontés jusqu’à présent. Genfen prend ici, comme exemple, celui de la querelle autour du poème d’André Chénier « L’Oaristys » pour indiquer que cette tendance « touchait désormais la France ». Ce qu’en dit Gefen dans un premier temps, qui pourrait paraître comme le situant au-dessus de la mêlée, l’est moins quand il ajoute : « La question est ici moins de savoir si ces procès prospectifs et rétrospectifs relèvent d’une vigilance nécessaire ou de nouvelles formes de censure, que de constater qu’il est difficile d’attribuer au pharmakon littéraire une valeur thérapeutique sans en faire aussi un poison potentiel ». On ne sait pas bien ce que vient faire là cette « valeur thérapeutique » sinon pour occulter, ou du moins minorer, qu’il s’agit bien là – si les mots ont un sens – de censure. Car l’affaire dite de « L’Oaristys » est significative de ce point de vue-là. À savoir la volonté, depuis un positionnement néo-féministe, de censurer un poème de Chénier qui, selon ses censeurs (des agrégatifs qui, d’ailleurs, l’élargissent à des « textes mettant en scène des violences sexuelles ») témoignerait d’une « culture du viol », et même l’accréditerait. Il y a déjà quelque anachronisme à vouloir plaquer une prétendue « culture du viol » sur un poème de la fin du 18e siècle ! Sans parler du caractère problématique, voire contestable de cette notion.

Il n’est pas anodin de signaler que le critique avec lequel Alexandre Gefen manifeste le plus son désaccord est Vincent Kaufmann qui, dans Dernières nouvelles du spectacle, ce que les médias font à la littérature, dénonce « les effets collatéraux de la médiatisation sur le plan littéraire ». Celui-ci témoignerait, selon Gefen, « à la fois d’un mépris des médias, des oeuvres populaires et d’un refus de laisser partir la figure du « Grantécrivain » solitaire et reclus ». Ce « mépris des médias » n’est nullement à blâmer (bien au contraire). Mais il s’agit de « culture de masse » (et non « populaire », si celle-ci existe encore). Pour le reste, je ne pense pas que nous avons lu le même livre… En tout cas, c’est vouloir expédier cavalièrement un ouvrage qui – Gefen se garde bien de de le mentionner – analyse de manière évolutive les interactions entre les champs littéraires et médiatiques depuis les années 1970. D’où le caractère dominant de la télévision dans un premier temps qui renforce la dichotomie oeuvre/auteur. Comme l’écrit Kaufmann : « Cela veut souvent dire aujourd’hui que l’auteur doit être authentique, et qu’il est plus important d’être authentique que de savoir écrire ». Kaufmann donne un exemple pertinent ce ce que la littérature fait et défait à travers « le dernier Hervé Guibert ». Un écrivain dont l’oeuvre se situe « à ce moment charnière où l’auteur bascule vers le spectaculaire, mais [qui] enregistre en outre ce basculement à la façon d’un sismographe, en exposant ou même surexposant les rapports entre les écrits et les médias (audio)visuels ».
En réalité, répond Gefen, « la tension entre l’écrivain à succès médiatisé et l’écrivain de la littérature restreinte est déjouée depuis longtemps par la visibilité médiatique de nombre d’auteurs « exigeants » », depuis Duras déjà. Je ne sais pas de quelle exigence Gefen nous entretient ici. À l’en croire, celle-ci aurait changé de camp et ne concernerait plus que des écrivains « à succès médiatisé ». En dehors de la « visibilité médiatique », point de salut ! Ce constat fait, Gefen va jusqu‘à y reconnaître une « démocratisation de la littérature » qu’il attribue plus particulièrement aux usages de l’Internet. Nous sommes en terrain connu. Gefen se livre alors à une apologie du monde numérique et du rôle des réseaux sociaux dans l’émergence de nouvelles fictions. Indiquons que cet éloge comporte un couplet progressif, puisque « ayant émergé des communautés, ces fictions participent d’un travail intense et totalement invisible de réappropriation inventive et de jeu à vertu émancipatrice ». Alors que Staline demandait (« Le Vatican, combien de divisions ? »), Gefen remet le couvert : « Qui est écrivain, demande-t-il, le romancier Gallimard publié à 400 exemplaires ou l’écrivain sur Wattpad et ses millions de vue ? ». Et d’embrayer sur des comparaisons du même ordre…

Alexandre Gefen entend prouver que « l’idée de littérature » défendue tout au long de son livre a fini par s’imposer contre celle qui, à l’entendre, tenait le haut du pavé au siècle précédent. Ce qui se joue ici recoupe l’opposition entre modernité et postmodernité, cependant de manière moins flagrante en littérature que dans d’autres modes d’expression. Je rappelle que Gefen ne revendique nulle appartenance à cette postmodernité pourtant illustrée dans de nombreuses pages de son livre. Quant à la modernité, évoquée parcimonieusement par notre « critique » (mais bien repérable à travers toute mention réitérée d’une « idéologie esthétique ayant dominé la littérature moderne et ses institutions »), elle souffre d’un déficit de définition. J’ajouterai que la modernité issue de Baudelaire, celle qui me requiers ici, ne se confond pas avec celle du même vocable reprise dans le champ des sciences politiques (même si les prémices sont philosophiques), laquelle modernité remonterait aux Lumières. Cette seconde grille de lecture ne prend pas véritablement en compte, contrairement à la précédente, ce qu’il importe d’analyser dans le domaine des Arts et des Lettres. Le linguiste Henri Meschonnic l’a précisément exposé en évoquant « les confusions intéressées et entretenues sur la modernité » entre, d’un côté, « la modernité au sens de Baudelaire », et de l’autre, « une modernité philosophique » qui irait « des Lumières à Habermas ».
À travers sa grille de lecture littéraire, Gefen laisse entendre avec d’autres mots que ce monde est devenu postmoderne, et qu’il s’agit d’une évolution dont il conviendrait de se réjouir. Ce qu’il en dit n’est pas sans renvoyer (même s’il faut un peu le nuancer) à ce qu’écrit François Rastier dans l’article mentionné plus haut : « Le postmodernisme a tout à fait concrétisé et accrédité l’idée que le début de ce millénaire avait marqué une coupure définitive. Les millenials seraient naturellement porteurs d’une nouveauté sans précédent qui périme toute tradition culturelle, renvoyée à une antiquité oiseuse et compromise ». En ce sens, le « progressisme » que d’aucuns pourraient évoquer dans plusieurs pages de L’Idée de littérature – l’intérêt pour une « littérature-monde en français » depuis le manifeste du même nom, celui également pour « les études post-coloniales », pour « l’agenda sociétal #MeToo », voire d’une « sortie du spécisme en littérature » (sic) – entre en résonance avec le « meilleur des mondes » dont l’ouvrage d’Alexandre Gefen dessine les contours. Celui d’une société qui va chercher ses modèles aux USA. Même si les « progressismes » évoqués ci-dessus écornent quelque peu « l’ordre néo libéral », ils sont parfaitement solubles dans un capitalisme new look. Le mot « capitalisme » apparaît rarement dans L’Idée de littérature étant donné que, pour l’auteur, la nature de la société qui en découle relève d’une évidence qui ne saurait être discutée.
En revanche, le mot « démocratie » et l’adjectif « démocratique » reviennent à la manière d’un leitmotive d’un bout à l’autre de L’Idée de littérature. Comme je l’ai déjà suggéré, cela permet à Gefen de souligner a contrario le caractère antidémocratique, selon lui, de la plupart des écrivains relevant d’une modernité (ce que l’auteur persiste à réduire à travers la terminologie « idéologie esthétique ») dite « dépassée ». Mais c’est aussi pour avancer que la réhabilitation de la culture de masse, initiée depuis l’exemple américain, renverrait à un processus de démocratisation. On pourrait appeler celle à laquelle Gefen se réfère de « démocratie réduite aux acquêts » tant cette conception s’éloigne de ce qu’est en réalité un fonctionnement démocratique (la possibilité pour chacun de décider collectivement de tous les aspects de la vie en société) pour lui substituer ce patchwork (des ateliers d’écriture aux réseaux sociaux, en passant par les écritures numériques et les forums de lecteurs).

À dire vrai, tout ce qu’Alexandre Gefen mobilise dans L’Idée de littérature pour dénoncer le caractère élitaire, antidémocratique, nostalgique, conservateur (prétendus tels, dirais-je) d’une esthétique littéraire qui aurait fait son temps, ne serait plus en phase avec l’époque, ne renverrait qu’à de « vieilles lunes », tout ceci donc s’évertue à banaliser ce qui reste malgré tout au coeur d’une question que Gefen aborde par un biais lorsqu’il se gausse de ces écrivains qui, comme Michon et Quignard, « placent encore au premier plan le souci de la langue ». J’ai déjà évoqué plus haut ce qui suit pour qualifier la prose d’une « écrivaine » (et cela s’étend à un certain nombre d’auteurs cités favorablement dans L’idée de littérature), mais il m’importe de le redire maintenant pour conclure. À savoir que sans une expression adéquate – celle, en premier lieu, de ce « souci de la langue » – la littérature versus Gefen n’a qu’un intérêt sociologique (qui logé à l’enseigne d’un « réalisme modeste » débusque son misérabilisme littéraire). Pour le dire autrement, et pour en finir enfin, on ajoutera que l’auteur de L’Idée de littérature nous convie à prendre des vessies pour des lanternes. Il était question, un peu plus haut, de « vieilles lunes ». Mais je crains fort que le lecteur qui adhérerait au propos de Gefen en soit réduit à ne regarder que le doigt censé lui montrer l’une d’entre elles.
Texte © Max Vincent – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
