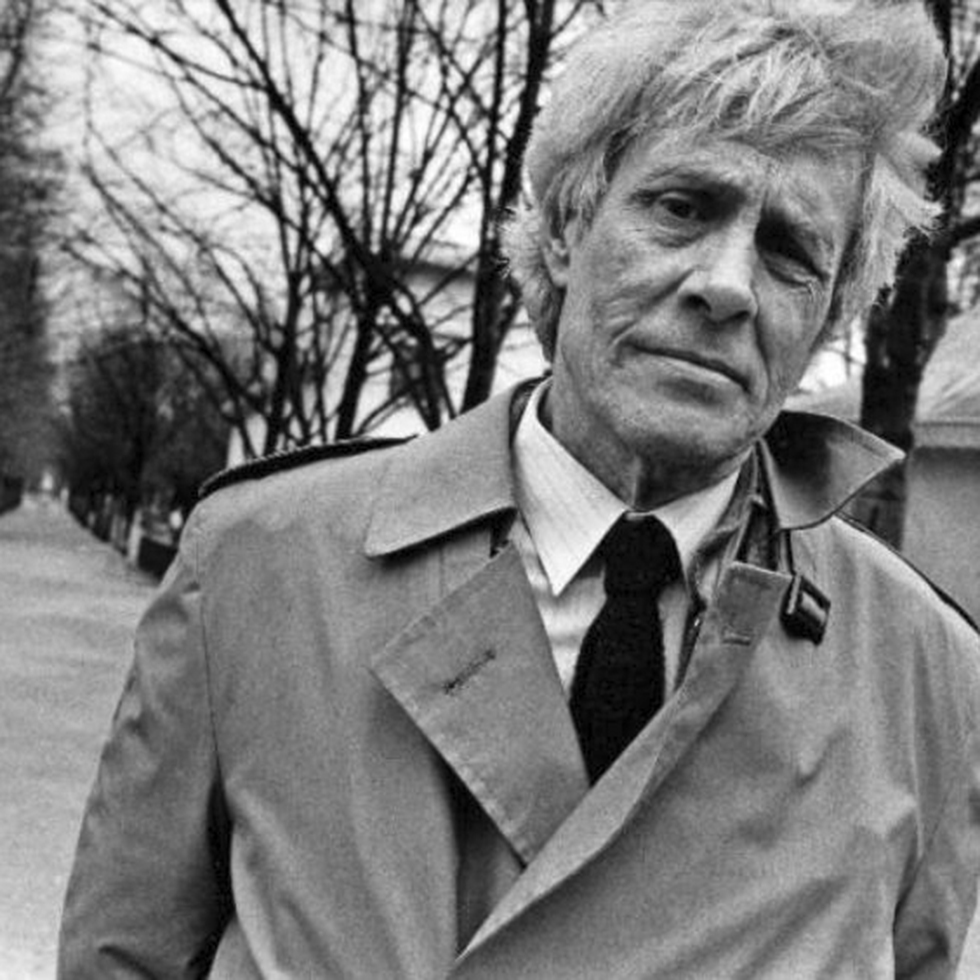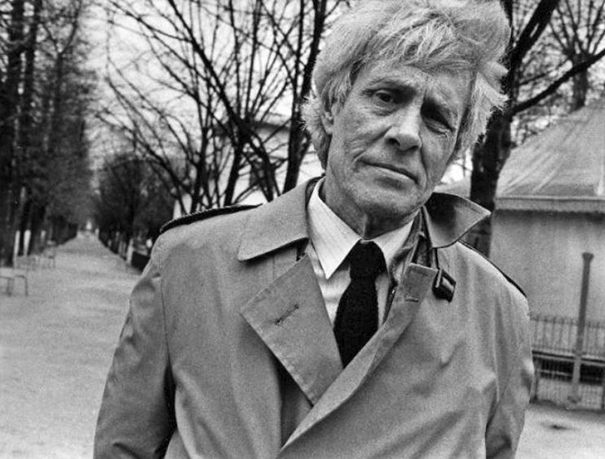
Trouvé en livre de poche au fond des Ardennes, à Redu, village du livre désert où les caisses de livres ressortent chaque week-end, depuis des lustres, avec leur cargaison inchangée, presque fossile, Requiem des innocents de Louis Calaferte (Julliard, 1952), dans cette édition jaunissante et patinée, excède, et de très loin, les promesses extravagantes de son titre. De cette misère criarde annoncée sur la couverture représentant un groupe de garçons roulés dans la poussière, je m’attendais à une histoire de pauvreté et d’enfance, sans plus, pour tout dire à ce lot de déchirements limités mais forcément lancinants de la rue, à l’une de ces fictions de sueur et de sang dans la veine de Los Olvidados de Buñuel. Mais la rue, pour Requiem des innocents, c’est beaucoup dire. Ici, on ne devrait pas parler de lieu du drame mais du drame du lieu, qui plus est bien réel et non inventé, dans lequel Calaferte nous entraîne sur la piste de son enfance. Piste est encore trop beau, cela sent l’aventure, presque la brousse. La place dans laquelle Calaferte nous enferme est d’un type à nul autre pareil. Elle ne souffre aucune comparaison avec un périmètre ou territoire recensé. Faute de mieux, un camp, autour d’une galerie de mine ou mieux, un village de l’an Mil, pourrait donner le change. Le lecteur s’imagine mal que l’endroit appelé « la zone » par ses occupants ait pu exister en boue et planches bien réelles dans l’immédiate périphérie lyonnaise, dans les années 50. Car nous voilà au fond du haut Moyen-Âge, finalement bien avant l’an Mil. Les hordes barbares ont violé les gauloises, décapité les maris, empalé leurs têtes, et une faune de survivants batifole dans une aube lourde, soufrée, urineuse, où tout, êtres et grincements de la matière, hurle à la lune et aboie à la mort. Volontairement, je n’ai pas relu le texte pour n’en garder que les traces du séisme, les sédiments et les images déformées. Calaferte travaillait dans une remise ou un garage, à la fièvre, ce premier roman d’expression sèche et somptueuse, où le souvenir de son enfance terrible devait prendre forme. Tout entier taillé dans le face-à-face, la frontalité du cruel, du vicieux et du méchant, aussi dans ces moiteurs de trous perdus où les silences annoncent les sacrifices, Requiem des innocents ouvre la fosse à reptiles du genre humain. On s’y soulage et s’y déchire sans distinction d’âge, de poids ou de sexe. Les géniteurs de Luigi sont si abjects, selon les mots de l’auteur, que leurs traits s’effacent ; « La Sofe », sadique surnommée « la garce » par son fils, et Lucien, le père, un alcoolique et un lâche, ne sont que l’hydre à deux têtes des souffrances infligées à leur fils, battu chaque matin en guise de bonjour. Nous suivons, pour l’essentiel, la « bande à Luigi », le jeune Calaferte. Elle ne rôde que d’un coup fourré à un autre. Schborn, le chef, est le seul ami de Luigi. Les deux se battent et ne s’estiment qu’à la violence. Les deux ou trois autres se partagent le rôle de souffre-douleur. Schborn terrorise et domine tout ce qu’il croise. Les enfants mutilent, charcutent et ne brûlent que d’assassiner, ce qu’ils réaliseront presque. L’humanité décrite par Calaferte dépasse sans effort tous les types des bas-fonds. Laisser-aller criminel, paresse violente, bas instincts, atavisme, bestialité, folie arrosée à la vinasse, la liste des tares et des monstruosités semble sans fin. Au spectacle des « hommes » et des « femmes » évoqués, on pense à une espèce sans nom, genre d’échassiers ou de phoques où dominent, selon les carcasses, l’os ou le bourrelet. On pourrait penser que l’enfance n’est pas possible dans ce contexte ; elle l’est. C’est même elle le sujet massif de ce livre qui prend de vitesse son propre lyrisme. Requiem des innocents, pour le ton et le style, n’est pas lyrique mais d’un mauvais accueil sur la terre. D’une mauvaise nouvelle à hauteur des yeux, dans la couleur et la texture de l’air, d’une tournure fatale où le programme des tortures ne varie que très peu. Le simulacre de rites et de quotidien ne repose que sur la gamme réduite des façons de nuire. Les enfants sont des caricatures de caricatures (leurs parents), c’est-à-dire qu’ils se répartissent entre les rachitiques à dents pointues et les vaincus, les faibles, les proies. Car si une chape mortelle écrase cette suite de bouges, la vie n’en fourmille pas moins ; c’est-à-dire la recherche goulue, avide, de l’assouvissement entre deux réveils de beuverie. Dans ce milieu de condamnés à ciel ouvert, le sexe burlesque, entre culbute et vautrements, parait le parent pauvre, le spasme bâclé d’un désir mort, une frustration bonne à aiguillonner la rage. Restent la violence psychologique, les mots et les coups. En la matière, Calaferte devient aux yeux du lecteur non plus un primo romancier ravageur mais l’explorateur d’un monde inconnu, d’une civilisation tuméfiée où les sévices sinistres et traîtres sont la règle, où chacun arbore son œil poché et son ecchymose de la veille ; c’est le maquillage de coutume. Dans mon souvenir, les adultes s’avinent, tombent de l’échelle ; ne font rien sinon dépasser de l’espèce de nid ou de trou où éructe par moments leur trogne engoncée dans des chiffes. Seule la bande reste en mouvement, s’écarte sur des terrains vagues pour commettre ses méfaits. Et, en guise de terrains vagues, c’est ici vraiment le prototype du genre. Bidons, lambeaux de grillages, immondices, boue et gravats ; là où ils enterreront l’un des « leurs », l’abandonnant à son sort, juste la tête au dehors. Il sera retrouvé le lendemain, toujours vivant. Dans Requiem des innocents, c’est un assassinat à blanc ; le sentiment de l’assassin, la nuit durant, est entré en Luigi, en Schborn. Cette violence de cauchemar à ciel ouvert, constante, trame l’histoire, lui donne son fond et son premier plan ; rien ne se passe hors de cette violence, rien ne l’abrège durablement. Toutefois, et ce, dès les premières lignes, Calaferte, dans la qualité du regard qu’il pose sur les monstres de son passé, atroces ou juste burlesques, parvient à tenir une note sourde, sans doute la clé du génie de ce texte, que je ne flétrirai pas en la qualifiant de « tendre », car sa portée, sa charge de cœur lourd ne mériterait qu’un nom martial, une distinction vraiment à part, tellement le cœur s’y étrangle à mots couverts.

Une mention spéciale doit être accordée à la relation entre Luigi et Lobe, le directeur d’école. Au passage, toute l’institution scolaire prend une raclée en deux temps trois mouvements dont je n’ai pas d’exemple. Ce n’est qu’une prison, une arène, une pâture à gâcher les êtres. Loucheur, le professeur, dont le nom seul rebique comme une affreuse anomalie, condense l’esbroufe et le patraque de cette vaste mise à la discipline, ici complètement impossible, des Luigi et des Schborn. En revanche, Lobe, le nouveau directeur d’école, qui prend la mesure de la calamité à l’arrière-plan, saisit la trempe des deux jeunes, surtout de Luigi, et leur apporte ceci de parfaitement neuf : la considération. Il devient l’exception et la référence. Étrange spadassin de la République, dandy à monocle du front social, Lobe est plus irréel qu’un spectre fraternel. A la fois père, grand frère et directeur d’école, gouverneur des chahuts, directeur bagarreur, il est, enfin, au poste le plus inattendu, le premier pourvoyeur de poésie, le premier à tendre à Luigi une invitation à vivre, à camper un aperçu en chair et en os de tout ce que pressentait le jeune Luigi sans jamais en avoir eu l’exemple vivant. Que l’on songe aux merveilleuses pages de leur marche dans la nuit et cette découverte de la voûte étoilée. La nuit étoilée reviendra en nuit lunaire, un soir terrifiant, avec Schborn, dans le froid d’une chambre d’hôtel miteuse, où se jouera une acmé amicale, un déchirement à deux, au spectacle d’une certaine lune verte finale, proprement indicible dans Partage des vivants. Requiem des innocents, c’est donc surtout l’amitié entre Luigi et Schborn. Schborn, nous l’avons tous rencontré, ne serait-ce qu’au détour de quelques livres d’aventures pour adolescents. C’est le dur au grand cœur ; c’est le « grand » de la bande. En vérité, à l’époque de la zone, a-t-il douze ou treize ans ? Pourtant, il y a du demi-dieu, du prince ténébreux chez cet éphèbe aux ongles longs. Dur, sournois même, pétri de violence, grésillant d’une énergie de bête fauve. Mais hanté par un rêve de grandeur, de noblesse. Moins apte que Luigi à la formulation, à l’expression par les mots, Schborn est enfermé en lui-même, il porte en lui l’explosion du peuple des Schborn de tous les temps ; laminé par une mélancolie de dinosaure, un désespoir de saurien qui le détraque et prépare son destin de jeune premier fauché net. Si tous les fantômes du passé sont évoqués, Schborn, lui, est invoqué. Sans emphase, mais l’on sent la rupture de ton, à voix haute ou à voix basse, c’est une invocation à l’alter ego des heures sans nom, au garant, au héros de l’indescriptible. Schborn devient le nom totémique du passé, de la souffrance de plein fouet, de chaque minute cernée d’impossible. Schborn ne meurt pas, d’ailleurs, il disparaît dans une nuit glacée, pulvérisé à l’usure précoce, anéanti par la mauvaiseté générale. Calaferte le racontera dans la suite au Requiem. Et l’on sent qu’avec ce nom bref, Calaferte dit quelque chose d’inhumain qui le brûle. Cette plongée dans l’intensité, dans l’épaisseur hurlante des morts qui s’appellent, on la lira peut-être, au plus profond, dans l’épisode le plus effarant du texte, je veux parler de la mort de Scopiatto. Il existe, en littérature, ce qu’il est convenu d’appeler « de grandes pages », et il y a leurs sœurs écroulées au nombre desquelles il faut bien compter « la mort de Scopiatto ». Ces mots, cette ambiance de mots sûrs que l’on voudrait non seulement dire mais déposer, implanter dans ceux que l’on aime, « la mort de Scopiatto » en possède la teneur. La mort du chien à trois pattes, venu un jour de nulle part et dont rien, jamais, après les grêles en tout genre, n’a effacé l’espoir d’affection, rassemble sur lui toute la peur, toute la peine, tout le mal. Scopiatto sous les yeux, c’est la parade criante de tous les crimes, l’état mort-vivant d’un coeur général, et le spectacle intenable de sa mutilation. Aussi, quand Luigi entraîne le chien à l’écart pour le tuer, sans que les détails les plus crus nous soient épargnés, la portée de l’événement dépasse la barbarie du geste. Une implication nous échappe et se grave profondément : un éblouissement infigurable, l’arrêt des tortures, l’éclatement de l’étreinte impossible, la mise à mort de cette preuve ambulante, avec Scopiatto, de « tous les gestes qui ont manqué » (Antonin Artaud).
Texte © Nicolas Rozier – Illustrations © DR
Un garçon impressionnable est une série de critiques artistiques et littéraires.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.