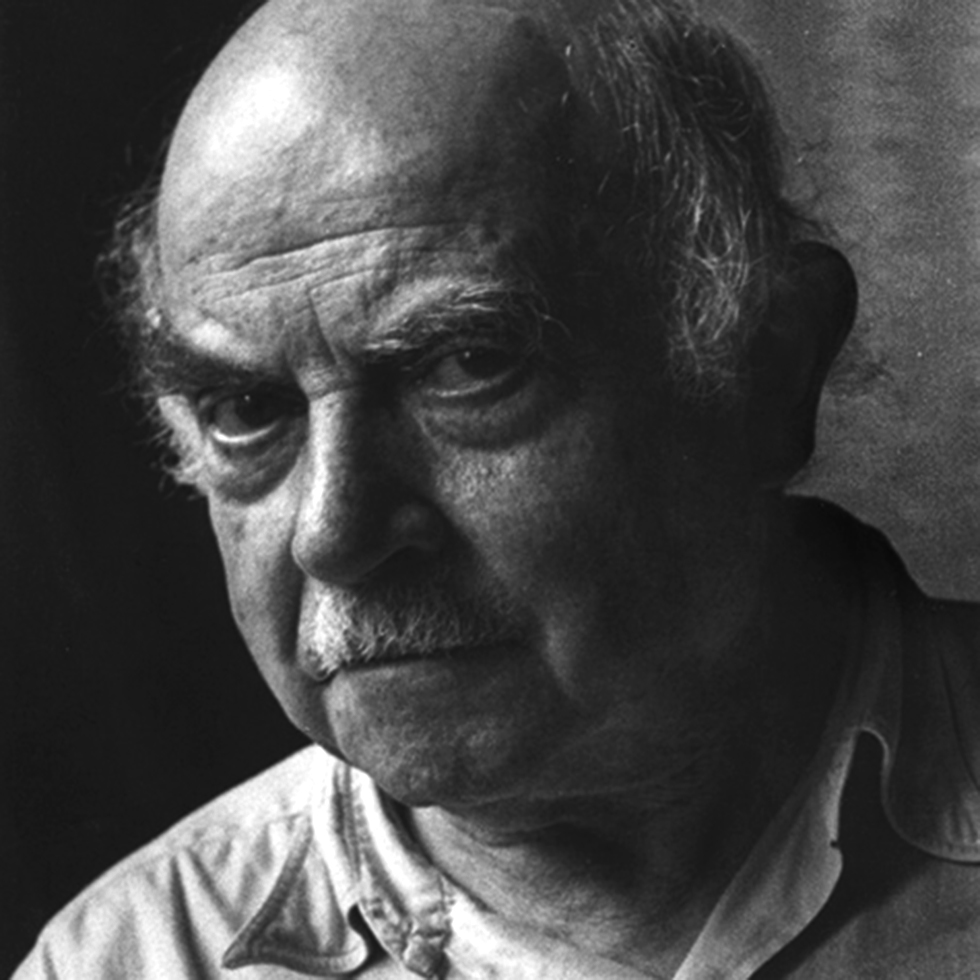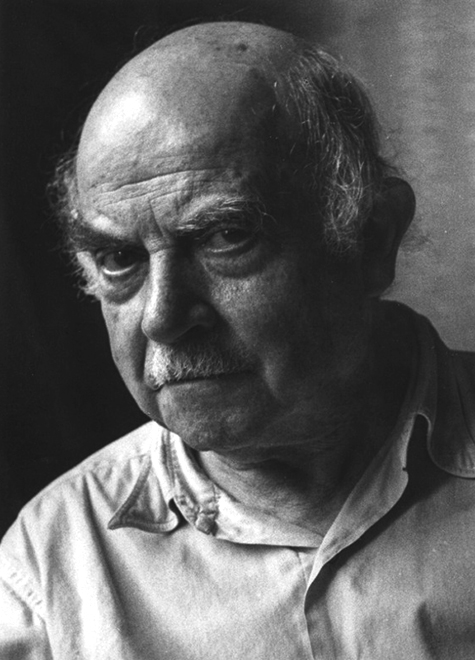
Durant l’hiver 1992-1993, à Paris, le Musée d’Art Moderne dédia une grande exposition aux expressionnistes allemands. Aux murs hauts et vastes qu’un souvenir incertain lisse de béton clair, rayonnaient les visions bien connues de Kirchner, notamment ses figures anguleuses sur fond de rues, femmes en toilettes dessinées en hachures, en coups de pinceaux obliques et ostentatoires inspirés de van Gogh ; ou encore les paysages de Schmidt-Rottluf, en deux ou trois pans de terre rouge, presque émaillés. Aussi les bois gravés de Heckel, les portraits en lames de couteaux. Entre schématisation et influence primitive, les peintres de l’époque tentaient d’avancer sur la voie frayée par van Gogh, Munch et Ensor. Ma mémoire opère mal ou sélectionne de façon trop sévère, car je ne garde des tableaux vus sur place, de ces œuvres que par goût et tempérament j’étais censé aimer inconditionnellement, qu’un impact mesuré, une impression médiane, presque en suspens, en attente de décantation. Les couleurs et les lignes agressives, étrangement ou pas, se ruaient en effet, libéraient une fraîcheur de tableau peint de la veille, une virulence pigmentaire indéniable, d’allusives trouées paradisiaques, et pourtant, peut-être en raison du format des tableaux, vraiment de petite taille, plus sûrement à cause du dessin maltraité, trop fruste aux entournures, je ne quittais l’exposition qu’avec un sentiment mitigé. Je n’admirai pas à la hausse, je repartis à demi-satisfait, engourdi dans une impression plutôt favorable mais sans plus. A mieux y repenser, à feuilleter mon vieil exemplaire Taschen de L’Expressionnisme, tournant les pages cartonnées et les grandes illustrations en couleur de cette édition de 1988, je constate à quel point ce livre a prévalu, qualitativement. Bien sûr, les reproductions n’étaient pas meilleures que les originaux, mais l’objet de contrebande culturelle, l’édition à bas prix signée Dietmar Elger m’a marqué plus durablement, et à portée de mains, que l’exposition parisienne. Celle-ci aurait dû consacrer l’expérience des reproductions sur papier, ce fut l’inverse. L’exposition consacra le livre d’art, le Musée portatif aux pages qui se détachent. En dessin, je n’ai rien contre la déformation, bien au contraire, et d’ailleurs la déformation n’existe pas dans le dessin. Tout ce qui vibre efficacement, dans les lignes et les traits, vient des vrilles, des torsades, des arabesques, des accrocs, tremblements et variations angulaires de cette sismographie qui court du cerveau à la main. Seulement, les manières d’Océaniens allemands adoptés par Schmidt Rotluff ou Kirchner me semblaient parfois un recul d’ambiance, un raidissement par rapport aux avancées solitaires de van Gogh. Quand je pense aux artistes de Die Brücke, je pense avant tout, sur le plan graphique, aux bois gravés, et au genre de dessin gourd, délibéré, sur lequel reposent les charmes de cette technique venue de Dürer. Un graphisme cruel, acéré, invente l’empreinte véritable de ces artistes. Les almanach et les affiches, avec l’insertion des lettres qu’ils supposent, constituent un apport universel à la grammaire des peintres. Les grandes lettres intégrées aux dessins augmentent le climat d’agressivité et de harangue lié à l’empressement de peindre neuf. Kokoschka utilisera merveilleusement cette technique, et, plus tard, j’en vois encore l’influence sur le manifeste « Pandémonium » de Baselitz et Eugen Schönebeck, mais aussi dans les dessins lunaires de Günter Brus, sans parler des « dessins écrits » d’Antonin Artaud. Nolde, avec ses vagues de terre, ses rivages terrestres, est un cas à part. Frère précoce des falaises maritimes d’August Strindberg. Nolde détient le secret des larges et épaisses bandes de peinture qui, roidement agencées, donnent en quatre ou cinq touches majeures le paysage compact d’une saignée violette où les rouges ocreux et les jaunes chauds transparaissent comme des sangs seconds. Plus tard, et jusqu’à aujourd’hui, « Die Brücke » a tenu bon à la place ingrate qu’il s’était faite dans ma mémoire. À l’ombre de laquelle ils sont restés, les rouges écarlates s’y sont carminés. Les toiles sont devenues des plaques austères aux éclats de vitrail. Tel « Village saxon » de Heckel débordé de la fin du XIXe siècle, telle « rupture de digue » de Schmidt-Rottluff, me paraissent contenir l’explosif artisanal des tableaux qui tiennent dans le temps. Les donzelles, les baronnes, les putains de Kirchner et les pantins costumés qui les accompagnent préfigurent le traitement plus obscène et fouillé qu’en feront plus tard Dix et Beckmann. Le systématisme des zigzags et chevrons de Kirchner esquive l’affrontement de problèmes dessinés que Dix et Beckmann prendront en charge plus frontalement. Pour autant, j’ai aimé après coup les accents circonflexes de Kirchner pour ce qu’ils sont : la multiplication de la touche en accent circonflexe de Van Gogh, cette touche qui finit en volée de corbeaux au-dessus d’un champ de blé. Partout chez Kirchner, la maille en v de ce corbeau est devenue l’unité graphique des peintures. Kirchner a pris le corbeau de Van Gogh et l’a effilé en série pour en coudre chacun de ses motifs. J’ai dit plus haut : « Océaniens allemands », l’expression honorifique se double après coup, pour désigner ceux qui furent de Dresde, de la totale destruction à venir de la ville par les bombes anglaises de 1945. Les tapis de bombe générant une température de mille degrés sur trente mètres de haut, cela a bien dû, trente ans avant, appeler des rites ou des œuvres prémonitoires. Une sorcellerie urbaine du cataclysme qui dès cette époque grondait dans les fondations et les visages de fêtes tristes.

Et justement, un artiste les a peintes ces explosions, en avance sur 45, et même en avance sur 14-18. Il s’appelait Ludwig Meidner. En 1911, à l’époque où Kandinsky et Marc, en Bavière, fondent, avec Klee et Maecke « Der Blaue Reiter », la faction « Die Brücke » migre à Berlin et se lie à de nouveaux peintres dont Ludwig Meidner. Fasciné par la grande ville, épris de sa complexe et foisonnante machinerie de formes, Meidner exhorte ses amis et s’exhorte lui-même à embraser la ville de feux qu’il voit en elle, un ou deux ans avant la guerre. Ce rêve de ville éclose, poussée à son avènement brutal par la voie des arts, Meidner en a perçu le mode dans une exposition futuriste, à la galerie Sturm de Berlin en avril 1912. Les obliques cabrées, les droites braquées de la fierté bizarre soulevée par le dynamisme motorisé et la vitesse, ont joué assurément dans la scénographie peinte inventée par Meidner. L’artiste entendait célébrer la ville, mais celle-ci est réduite, dans ses tableaux, à une bousculade ombreuse d’étages, aux rangs de fenêtres couchés, en cours d’effondrement. L’immeuble passe immédiatement, chez Meidner, au tombeau collectif, à l’hécatombe des familles surprises à l’heure du soir, fauchées par des puissances géantes et sans formes dont l’artiste ne montre que les gerbes explosives, les cônes éblouissants, les formes en étoiles, les branches explosives. Du ciel ou de la terre, les faisceaux rappellent aussi bien des tirs et bombardements prémonitoires que les éclairs voraces d’un orage meurtrier. Le feu d’artifice n’est pas loin, sinon que les bâtiments flambent et s’écroulent. Moins que jamais, la description des toiles ne saurait rendre l’effet physique des toiles sur pièce. Car les toiles de Meidner furent le centre irradiant de l’exposition de 1992 ; les plus impatientes, les plus intenables. Pour mieux en rendre compte, il faut sans doute évoquer le mélange d’impressions lié à ces rectangles de nuit. Car l’ancienneté des toiles réalisées au début du siècle, non seulement ne vous lâche pas face aux toiles de Meidner, mais les scènes elles-mêmes portent leur âge. Ce sont bien de vieux tableaux, cependant, et contrairement à leurs voisins d’exposition, les tableaux de Meidner gardaient une énergie encore très neuve, indemne. Celle-ci provient des contrastes de la nuit peinte. La gamme des bleus sombres, des bleus de Prusse profonds, et les contrastes jaunes qui en découlent, donnent aux villes de Meidner une facture de gadget, d’image récente, voire refluant d’un avenir indéterminé. Meidner écrivait également des poèmes, réunis sous le titre « Dans mon dos, l’océan des étoiles ». Et c’est ainsi que se donnent à voir les villes explosives de Meidner. L’influence de Van Gogh s’y fait sentir sous la forme de « nuits étoilées » dont les astres, déjà giratoires et béants chez Van Gogh, auraient muté et dégénéré en fleurs monstrueuses, en tentacules lumineuses ou lasers menaçants. Variantes électrocutées de la nuit étoilée de Van Gogh, les toiles de Meidner en relancent les enjeux de contrastes hurleurs. Traversés de halos verdâtres et bleuâtres nés du bleu sombre plus foncé que tous les noirs, percés au jaune, au rouge et à l’orange, les tableaux deviennent des plaques brillantes, violemment insolées plus que peintes. Meidner a senti la violence miroitante des catastrophes dans le frais et leur propension à créer des flashs hallucinatoires, à tremper la foule dans une immersion délirante devancière de la mort. À l’approche des toiles, nous voyons un phosphore expérimental allumé avec les moyens de la peinture. Les villes en feu de Meidner, avec leurs figurines dans les marges, posées là comme des témoins démonstratifs, agitent presque les bras. La présence des citadins en déroute rappelle le mouvement créé par Meidner avec Jakob Steinhardt et Richard Janthier : « Les Adeptes du pathétiques ». Les figurines représentées en marge des scènes créent un effet de dramatisation inverse. Les scènes d’apocalypse y gagnent, non un regain de pathétique, mais une naïveté où le tableau tire soudain du côté de la peinture d’anticipation, presque de la SF, il n’y manquerait que les avions ou les soucoupes d’une invasion. Bras en l’air ou se tenant la tête à deux mains, les personnages stylisés, aux membres raides et visages burlesques font corps avec les bâtiments croulants ; Meidner les intègre dans la même masse en train de ployer. Et l’on croirait, plus que les victimes d’un bombardement, les spectateurs et acteurs montés sur l’estrade en feu d’un décor de théâtre. Il y a du jouet dans cet emboîtement de bleu, de jaune, de rouge et de vert. Le clignotement sourd des couleurs à l’huile, leur brillance vénérable se combine à une manière discrètement joviale, où l’énergie retenue de la caricature donne aux formes une légèreté de décor en carton-pâte. Les immeubles eux-mêmes subissent un traitement burlesque qui rappelle, en beaucoup plus raide, les maisons de Soutine.
Texte © Nicolas Rozier – Photographies © DR
Un garçon impressionnable est un workshop de critique transdiciplinaire in progress de Nicolas Rozier.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.