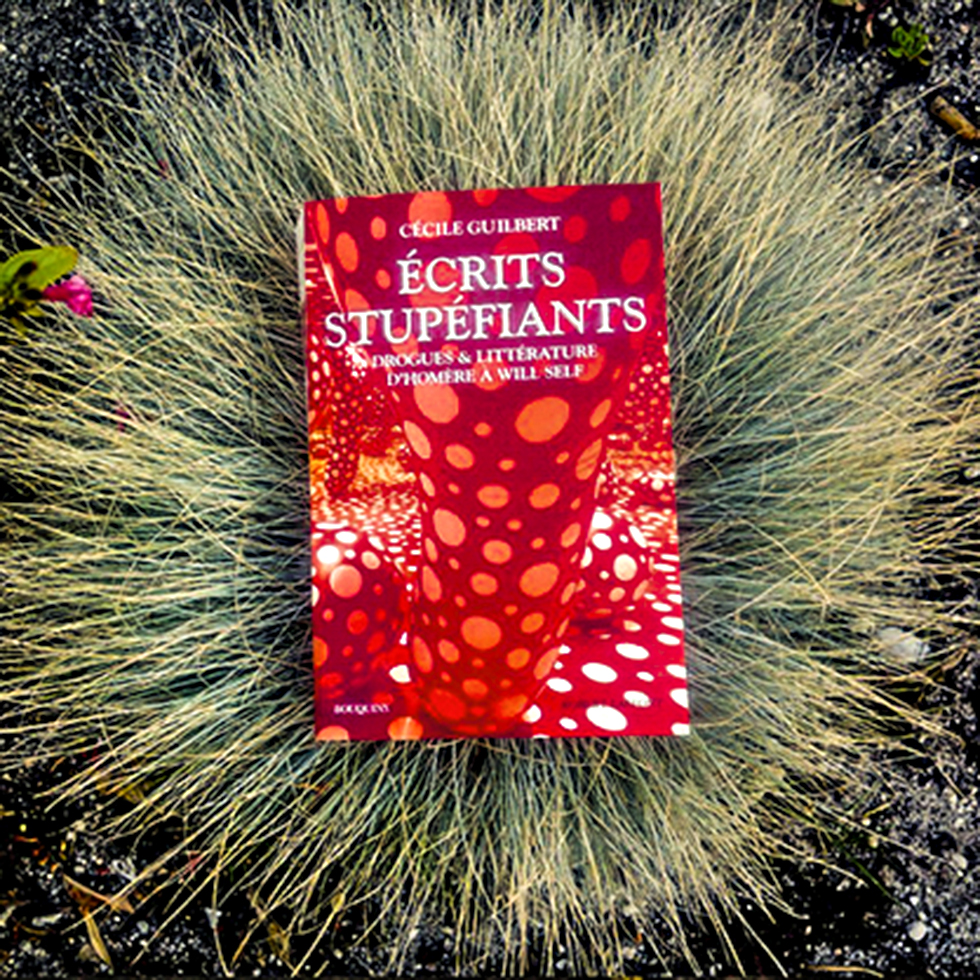CÉCILE GUILBERT s’entetient avec nous à l’occasion de la publication de son essai ÉCRITS STUPÉFIANTS : DROGUES & LITTÉRATURE D’HOMÈRE À WILL SELF (Laffont-Bouquin, 2019) :
1 – Cécile, tu es une familière de D-Fiction pour en être une « invitée », mais aussi pour représenter l’un de ces rares auteurs français avec lequel nous partageons une « amitié » que d’aucuns ont pu définir, en d’autres temps, comme étant à l’origine de cette fameuse « communauté inavouable » qui, pour nous, est celle de la seule littérature, cette « insurrection verbale » même à laquelle tu voues entièrement ton existence, comme tu l’expliques en introduction de ton nouveau livre, Écrits stupéfiants – drogues & littérature d’Homère à Will Self : « Je vivais alors dans un état de prodigieuse exaltation, nerfs à vif, noircissant carnets et cahiers, m’imaginant incomprise, maudite, sublime, perdue pour toutes les causes sauf celle de l’insurrection verbale ». Peux-tu revenir pour nous sur cette insurrection qui t’anime depuis tant d’années, et qui, sans aucun doute, a été à l’œuvre durant presque une décennie dans la conception même de cet ouvrage. De quoi est-elle le nom ? Comment s’est-elle constituée ? Quel en est son centre vital pour toi ? Quels en sont, aujourd’hui, ses enjeux et son sens dans le monde qui vient à tes yeux ?
La phrase que vous citez se réfère à mon adolescence, une époque où je découvre vers 13-14 ans la littérature – en l’occurrence la poésie puisque mes « dieux » sont alors Pascal, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud – et qui correspond à une phase d’enthousiasme, d’exaltation romantico-lyrique assez mimétique où « l’insurrection verbale » fait corps avec l’esprit de révolte. Il est cependant vrai que j’ai éprouvé tôt les pouvoirs de séparation et de salvation qu’impliquaient l’art en général et la littérature en particulier, pouvoirs auxquels secrètement je devais aspirer et que j’ai rencontré en lisant certains livres comme en contemplant certaines œuvres. De quoi s’agit-il ? de la séparation d’avec la famille, le social, la « moraline », tout ce qui « ensemblise » dans le groupe et le collectif. Quant à la salvation, il faut l’entendre au sens strict du salut invoqué par Joyce quand il s’exclame : « Word, save us ! » Se sauver de qui et de quoi? Eh bien précisément de ce qui précède, à savoir des mensonges éhontés que l’espèce humaine ou la « communauté » ne cesse de se raconter, vaste sujet que j’ai « traité » dans mes livres sur Saint-Simon, Debord, Laurence Sterne, Warhol, ainsi que dans presque tous mes textes critiques, notamment ceux consacrés à Nabokov et Sade. J’ajoute aussi que très tôt la littérature entendue comme sphère de lecture, de méditation et d’écriture (mais sans la dimension d’une « tour d’ivoire » coupée du monde contemporain, que je récuse) m’a séduit à cause du mode de vie qu’elle supposait : temps et solitude vécus comme des ivresses, des luxes, des voluptés suprêmes ou des extases dans lesquelles je me roule, me vautre, me love… et dont la dimension d’étude n’a, bien sûr, jamais été absente. Je tiens énormément au loisir studieux, à l’otium des Anciens dans sa dimension de gratuité désintéressée. Outre que rien n’est plus subversif aujourd’hui, la lecture et l’écriture ne s’en dissocient pas car c’est la connaissance qui nous « sauve » et nous libère. C’est mon côté « gnostique-vedantique » (je rappelle que gnôsis en grec et veda en sanscrit renvoient à la « connaissance » et à la « science sacrée »). À partir de là, il faut bien entendu considérer Écrits stupéfiants, dans son archivage le plus complet possible d’expériences singulières liées à la consommation de substances psychotropes différenciées, comme une entreprise de subversion de tous les bobards racontés sur « la drogue » du point de vue social et politique.
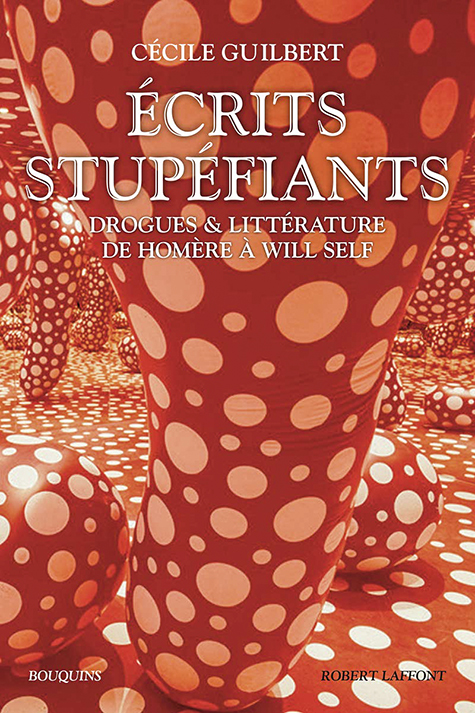
2 – Auteur d’ouvrages de non-fiction – sur Debord, Saint-Simon, Sterne, ou encore Warhol – ainsi que de nombreuses analyses critiques sur des auteurs ou des thèmes tant classiques que contemporains, tu as également publié de la fiction sous la forme de romans. Peut-on dire des Écrits stupéfiants, ce nouveau livre qui nous apparaît à la fois comme une étude savante et un témoignage personnel, qu’il est la symbiose par excellence de ton écriture d’essayiste et de romancière, puisqu’il parvient, à travers ton introduction époustouflante, et les analyses passionnantes que tu consacres aux substances illicites, comme aux œuvres littéraires qui s’y rattachent, à créer un véritable récit, où le lecteur progresse substance après substance, extraits après extraits ? La forme de l’essai que tu as renouvelée au point que l’on peu inverser la formule roman-essai à ton propos, et dire qu’il s’agit d’essais-romans, te paraît-elle toujours aussi riche en possibilité formelle qu’il y a dix ans lorsque tu composais Warhol spirit ?
Comme vous le savez, même si j’ai eu peu ou prou l’ambition de renouveler le genre de l’essai littéraire qui ne saurait être confondu avec l’essai journalistique et pas davantage avec l’étude universitaire, la question du « genre » auquel peut appartenir un livre m’importe guère et m’a d’ailleurs joué souvent des tours avec les « commerciaux » des maisons d’éditions et les libraires puisqu’il est difficile de savoir dans quelle catégorie classer certains ouvrages comme L’Écrivain le plus libre ou Warhol Spirit. Biographie ? récit ? essai ? histoire de l’art ? critique ? Du coup, qu’ils soient inclassables ne peut que me réjouir et pourrait constituer un assez bon programme pour tout écrivain. Ceci étant, il est évident que les Écrits stupéfiants ne seraient pas ce qu’ils sont et auraient été lus et reçus autrement si mon introduction avait été didactique et non autobiographique. Au-delà de l’érudition considérable mobilisée dans cet ouvrage, je trouve important de prouver que mon corps, mes sensations et ma mémoire sont engagés dans cette affaire en raison de mon intérêt qui fut précoce et simultané tant pour la littérature que pour les drogues. Ce n’est pas tant une question de légitimité sur le sujet qu’une insistance sur la subjectivité irréductible que cette expérience emblématise. Sinon, je l’ai déjà répété plusieurs fois mais plus que jamais m’apparaît nécessaire de distinguer les « livres » des « non-livres » tant l’inflation de la camelote augmente. « Poubellication » disait Lacan ; « poublier » a inventé Sollers pour dire l’incessante transmutation du parallélépipède imprimé en déchet qui augmente dans des proportions jamais vues. Si le livre digne de ce nom est, comme le disait Mallarmé un « instrument spirituel », alors à chacun d’imaginer par quels biais, voies, détours, mélanges des genres ou ruses il s’écrit. Car il s’agit toujours de trouver un « dispositif » – mot que je n’aime guère mais qui fait comprendre que l’on excède la question de la construction et du genre littéraire dans lequel s’inscrit un texte. Or, il existe autant de dispositifs que de « vrais livres » possibles, me semble-t-il.
3 – Ton ouvrage est découpé en quatre parties qui reprennent la nomenclature du pharmacologue allemand Louis Lewin : « Euphorica » (opium, morphine, héroïne), « Phantastica » (cannabis, substances psychédéliques), « Inebrianta » (anesthésiants et solvants), « Excitantia » (cocaïne et crack, amphétamines et ecstasy). Un prologue sur « deux substances mythiques » (soma et népenthès) s’y ajoute, ainsi qu’un épilogue sur « deux paradigmes de la drogue » (produit et dose). Ton ouvrage est une « bible » hors du commun sur les stupéfiants, la première du genre au monde. Parle-nous de la conception de ce projet, la manière dont il a évolué et ce qui l’a motivé : la consommation de stupéfiants et la lecture d’ouvrages sur le sujet ont-ils été pour toi, au départ, tes seules motivations ?
« En tant qu’essayiste, j’ai toujours aimé écrire les livres que j’avais envie de lire » ai-je écrit en incipit de l’avant-propos des Écrits Stupéfiants. Cette phrase doit être prise au pied de la lettre : j’ai eu l’idée de ce livre car j’avais envie de l’avoir dans ma bibliothèque. Autant dire que cet ouvrage qui aurait dû exister depuis longtemps, tant son sujet est évident et convaincant, manquait au rayon du savoir universel. Mais si j’avais envie de l’avoir et de le lire, c’est évidemment parce que mon intérêt pour la littérature fut concomitant, simultané même, à ma curiosité des substances psychotropes expérimentées au même âge, vers 13-14 ans. Au fil des décennies, mon intérêt pour la première a augmenté tandis qu’il déclinait pour les secondes et c’est à ce point de disjonction achevée que le projet est né, comme si, inconsciemment, je tournais une page personnelle avec cette immense étude supposant un autre type d’addiction, une autre forme de compulsivité, purement textuelle et littéraire, ouvrant à une dimension anthropologique et historique captivante. Réfléchissant à ce que j’étais en train de faire et découvrant au fil des ans tellement d’écrivains ayant frayé avec « l’imaginaire des drogues » – pour reprendre le titre du livre important de Max Milner sur le sujet – je me suis dit que le résultat constituerait sans doute une « histoire parallèle » de la littérature ou du moins une autre histoire des deux derniers siècles. Comme par hasard – et c’est passionnant – cette histoire des rapports entretenus par les écrivains avec la drogue correspond à l’acmé de la littérature en tant que configuration moderne par excellence puisqu’à travers elle se joue toute la problématique de l‘invention et de l’émancipation aux XIXe et XXe siècles. Bref, alors qu’au début je croyais seulement recueillir le maximum de preuves vécues ou imaginées des drogues, une archive de sensations intimes à travers toutes sortes de livres, je m’aperçois que ces derniers m’obligent à réfléchir aux usages rituels, thérapeutiques, récréatifs des psychotropes ; de m’intéresser à leur histoire botanique, chimique et économique ; de me pencher sur les phases historiques de répression et de permissivité sociales comme de m’interroger sur leurs causes et leur effets. Car Michel Perrin a raison, « la drogue » (terme pourtant à bannir tant les substances sont diverses) constitue bien un « fait social total » associé « tout à la fois au bon et au mauvais, à l’interdit et au prescrit, à la liberté et à la dépendance, au religieux et au profane, à la vie et à la mort, à l’acte gratuit et à l’exploitation économique ». Du coup, aussi libres, avant-gardistes, transgressifs et subversifs qu’ils puissent être, les écrivains n’échappent pas aux contraintes de la géographie, aux contextes socio-politiques ou aux modes – CQFD.
4 – Nous le constatons en te lisant, et en lisant les auteurs de ton anthologie qui l’évoquent : la prise de stupéfiants est souvent ramenée à une pratique quasi aristocratique, à une démarche spirituelle dont la consommation, la culture et les rituels rassembleraient les « adeptes » dans une sorte de communauté, elle aussi, « inavouable ». Burroughs le souligne assez en déclarant que « la came n’est pas, comme l’alcool ou l’herbe, un moyen de jouir davantage de la vie. C’est un mode de vie ». Parle-nous de cet esprit de la prise de drogue qui semble d’ailleurs renvoyer à une période très précise, débutant avec le romantisme et finissant avec les punks, où l’élévation se mêle à la chute, l’éloge des sensations à l’autodestruction considérée comme un des Beaux-Arts en face d’un monde vulgaire, hygiénique, puritain et athée ?
Bien que les « camés » semblent constituer une confrérie spéciale parmi les humains, il importe vraiment, en matière de prise de stupéfiants, de discerner les démarches, les usages, les motivations et les cultures propres à chaque produit en fonction des époques afin de ne pas tomber dans les généralisations. Précisons que dans l’esprit de Burroughs, « la came » c’est l’héroïne : un « mode de vie » en effet, puisque cette dernière y est entièrement assujettie en raison de la dépendance induite par la morphine avec son cortège d’idées fixes bien connues et documentées dans tous les livres qui en traitent : besoin du produit, recherche du produit, problèmes d’argent, intoxication croissante, assuétude, esclavage, cercle vicieux de la désintox-réintox, etc. Mais il est vrai que paradoxalement, une dimension aristocratique s’est incarnée avec l’opium, non pas à travers le laudanum assez trivial mais avec la fumerie telle que l’ont décrite un certain nombre d’esthètes de la « bonne drogue » parmi lesquels il faut citer Louis Laloy, Claude Farrère, Albert Puyou de Pouvourville, Jean Cocteau et quelques autres. Quoique la fumerie asiatique, nord-américaine ou londonienne puisse être sordide dès lors que l’accent est mis sur la dépendance au produit et l’abrutissement de créatures trop pauvres pour consommer autre chose que du dross (comme chez Dickens ou Wilde), elle est aussi luxueuse dès lors que son décor est soigné, son matériel raffiné, son atmosphère esthétisée. Ceci étant, à rebours de tous les clichés attachés à la déchéance inéluctable que provoquerait l’héroïne, certains écrivains toxicomanes ont mis un point d’honneur à revendiquer une forme un peu crâne de souveraineté : je pense à Roger Vaillant, Alexander Trocchi, mais aussi Yves Salgues et Bernard Delcour. Par ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue que les motivations conduisant certains individus à consommer des drogues sont extrêmement diverses. Il y a les « malades » comme par exemple Laurent Tailhade, Alphonse Daudet, Boulgakov ou Artaud qui en consomment (en l’occurrence de la morphine) pour ne plus souffrir d’un certain nombre de pathologies physique ou nerveuses qui leur sont propres. De même le spleen, la dépression, l’angoisse, toutes sortes d’états d’âme conduisent également à la prise de stupéfiants, en général des euphorica mais pas que. Il y a aussi les consommations motivées par la simple curiosité (le haschisch réputé moins dangereux est alors un produit idéal) ou le désir délibéré d’expérimentations systématiques à des fins d’études de l’esprit en soi ou de soi – cas de Benjamin, Jünger, Witkiewicz, Huxley, Michaux. Sans oublier – et là je schématise à mort – les psychostimulants pour s’amuser et faire la fête (cocaïne, Ecstasy) ou travailler plus et plus longtemps (amphétamines). Et puis, il y a cette fameuse « recherche spirituelle », d’ampleur et d’étendue fort variée, qui passe généralement par la prise de phantastica, cannabis et drogues « psychédéliques » naturelles ou de synthèse – plantes divinatoires, molécules « enthéogènes » – qui obéit elle aussi à d’innombrables variantes selon les personnalités et les psychismes.
5 – Ces Écrits stupéfiants sont une anthologie incroyable et fabuleuse de la littérature, identique à bien des égards à ces catalogues de « fous littéraires » si chers à André Blavier. Ainsi, dans un doux voisinage, on y croise des noms largement connus et reconnus (Homère, Baudelaire, Balzac, Verne, Malraux, Sagan, Kerouac, Poe, Loti, Castaneda, Dickens, Wilde, Burroughs, Ginsberg, Jünger, Huxley, Michaux, Rabelais, Maupassant, Londres, K. Dick, Gibson, Boulgakov, Kipling, Cocteau, Artaud, Pessoa, Doyle, Easton Ellis, Sollers…), mais également toute une pléiade d’auteurs plus confidentiels et oubliés (Rabbe, de l’Isle-Adam, Farrère, de Pouvourville, Segalen, Rollinat, Schwob, Jarry, Lorrain, Jaloux, Magre, Régnier, Salmon, Toulet, Péladan, Tailhade, Algren, Bulteau, Salgues, Adelswärd-Fersen, Retté, Welsh, Monfreid…), voire complètement oubliés (Collins, Bonnetain, Boissière, Custot, Moreau, Daguerches, Gilbert de Voisins, Symons, Barnitz, Delphi, Cottinet, Dubut de Laforest, Csáth…). On remarque la présence de femmes (Charlotte Brontë, Elizabeth Siddal, Colette, Tita Legrand, Yvette Guilbert – on hallucine quand même 😮 -, Mireille Havet, Christiane F., Isabelle Eberhard, Clara Malraux, Alice B. Toklas, Muriel Cerf, Édith Boissonnas, Carolyn Cassady, Amélie Nothomb, Anaïs Nin, Laura Huxley, Tala Dorian et Marina de Van). Comment se sont organisés la collecte de ces noms d’auteurs et le recensement de leurs œuvres évoquant explicitement les stupéfiants ? As-tu été surprise par tes découvertes ? Nous savons qu’au cours de ta recherche – plutôt vers la fin – tu es tombée sur une collection extraordinaire de documents qu’un collectionneur t’a dévoilée et que tu as évoquée dans ta chronique hebdomadaire à La Croix en ces termes : « Mais vertige aussi de m’apercevoir qu’il existe encore tant de références inconnues, jamais citées, des océans de savoir à investiguer, avec la charge de travail ultime que ça représente ». Faut-il donc constater que ta « Bible » devrait faire plusieurs volumes pour tendre à une exhaustivité satisfaisante sur le sujet ?
J’ai commencé par inventorier tout ce que je possédais dans ma bibliothèque et bien sûr les classiques étaient là, presque en masse avec les opiophages anglais, les Romantiques orientalistes français, Baudelaire, Edgar A. Poe, la Beat Generation, Michaux, Christiane F., Nick Tosches, etc. Ensuite, j’ai relu ou acquis des ouvrages spécialisés sur les drogues, des monographies sur certains stupéfiants, ainsi que leurs bibliographies qui comportent toujours des ouvrages de littérature. J’ai aussi profité d’anthologies spécialisées existantes, notamment sur le cannabis et la cocaïne. Mais plusieurs ouvrages spécifiquement consacrés à la problématique des drogues dans la littérature se sont avérés capitaux comme La Belle Époque de l’opium, anthologie séminale d’Arnoud de Liedekerke ; L’Imaginaire des drogues, de Thomas De Quincey à Henri Michaux, de Max Milner ; Les Poisons de l’esprit, drogues et drogués au XIXe siècle de Jean-Jacques Yvorel, ainsi que deux ouvrages américains très féconds : celui de Marcus Boon, The Road of Excess, A history of Writers on Drugs, et Writing on Drugs de Sallie Plant. Ces lectures m’ont conduit à acheter des dizaines et des dizaines de livres d’autant que j’ai aussi gardé trace au fil des années des recensions de romans ou de récits ad hoc et recueilli tous les conseils de lectures que l’on pouvait me donner quand je parlais de mon projet autour de moi. Je dois aussi préciser que le cœur de ma quête concernant le récit (réel ou imaginaire) d’une expérience de chacune des substances avec toute leur gamme de sensations associées, j’ai laissé de côté tous les romans (notamment de science-fiction) où les drogues ne figurent souvent qu’au titre d’ingrédients dans le décor. Vers la fin, alors que je me demandais s’il valait le coup que j’aille consulter certains titres épuisés à la BnF, j’ai fait la connaissance du collectionneur auquel vous faites allusion, Aymon de Lestrange, qui a mis avec une immense gentillesse et une non moins grande générosité sa bibliothèque spécialisée à ma disposition. Il m’a non seulement permis de photographier des dizaines de textes que je n’avais pas, mais m’a fait découvrir de nombreux auteurs oubliés comme Théo Varlet et Joseph-Charles Mardrus, et même des textes d’auteurs célèbres dont j’ignorais qu’ils avaient écrit sur ce sujet comme Henri de Régnier, Fernando Pessoa, Alphonse Daudet ou encore Isabelle Eberhardt. Cette rencontre a permis d’enrichir considérablement le volume qui, de toute façon, était limité en termes d’ampleur physique et financièrement, à cause des coûts d’achat de droits assez élevés puisque les œuvres d’un grand nombre d’auteurs du XXe siècle ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Par ailleurs, si je me suis limitée à un maximum de trois « entrées » de drogues par auteur (c’est le cas de Michaux et de Ginsberg), il va sans dire que ces derniers ainsi que les poly-expérimentateurs et/ou poly-toxicomanes que furent William S. Burroughs, Ernst Jünger, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Walter Benjamin, Aleister Crowley ou Klaus Mann auraient pu figurer à presque chacune des entrées. De plus, je constate que des ouvrages sont parus sur le sujet depuis que j’ai mis le point final à mon travail et que je n’ai pas eu le temps de lire ni d’inclure. Je pense à Techno Freaks (Le Serpent à plumes, 2018) de Morgane Caussarieu ; à Babylon Express (Le Dilettante, 2018) de Marie-Mathilde de Malfilâtre; à Nino dans la nuit (Allia, 2019) de Capucine et Simon Johannin ; à Psychedelia (Galilée, 2018) d’Ali Mitchell ; à Trip, psychédéliques, aliénation et changement (Au Diable Vauvert, 2019) de Tao Lin ; à DMT (Au Diable Vauvert, 2019) d’Irvine Welsh, mais aussi à deux livres qui me semblent passionnants : Foucault in California (Heyday, 2019) de Simeon Wade et Mescaline : A Global History of the First Psychedelic (Yale University Press, 2019) de Mike Jay. J’ajoute aussi que l’on a porté à ma connaissance que très récemment l’existence d’un livre qui m’avait échappé : Les Chérubins électriques (2016) de Guillaume Serp – de son vrai nom Guillaume Israël (1960-1987), chanteur du groupe new-wave “Modern Guy”. Comme vous le voyez, le sujet demeure en expansion puisque paraîtra aussi chez Grasset l’année prochaine Voir la lumière de Tom C. Boyle, sorte d’ « exofiction » autour de l’invention du LSD et de la révolution pyschédélique de Timothy Leary. À ce sujet et comme le montre Écrits stupéfiants, l’exploration littéraire propre à chaque écrivain étant fort tarie en matière de drogues, je pense qu’il n’est nul besoin d’être grand clerc pour prévoir l’essor de ce genre de « romans » autour des figures du glorieux passé psychotropique de l’humanité car le business éditorial y pousse, le tarissement de l’imagination littéraire y pourvoit et le réservoir culturel où puiser des histoires est immense.
6 – En te lisant, on constate donc combien l’histoire de la littérature, à partir du XIXe siècle, se confond avec celle de la consommation de drogues. On constate aussi combien cette relation se complexifie permettant une multitude d’interprétations, car cette expérience est pratiquée dans un cadre moderne, post sacré en quelque sorte, où les liens avec la société entière et un système transcendant de valeurs – comme dans l’Inde et le Mexique antiques – sont absents. Avec le temps, les contradictions s’amplifient. On perçoit combien d’une part, pour les plus cultivés, on se drogue pour réaffirmer cette liaison avec l’invisible, mais d’autre part, qu’on échoue à le faire réellement car le socle religieux et social d’une telle expérience étant perdu, on tombe vite dans la caricature spirituelle. Aucune société contemporaine ne possède plus les structures initiatiques et religieuses d’une consommation rituelle et sacrée de la drogue. Au fur et à mesure des décennies, la dimension récréative l’emporte sur la quête nostalgique de l’inconnu. On voit d’ailleurs une critique des stupéfiants surgir chez certains auteurs, non plus au nom de la bonne santé, mais de la dénonciation de produits libéraux-libertaires dont l’usage conduit à des expériences conventionnelles régulées par le marché de la Pop-Culture. On pense ici à Patrick Modiano et Virginie Despentes, que tu cites à propos du LSD et de la coke. Tu ne sembles pas loin de partager leurs avis à la fin de ton enquête…
Ces remarques renvoient à la question fondamentale, qui est à la source de toutes les expériences de substances psychotropes répertoriées depuis que l’humanité peuple la Terre : Pourquoi se drogue-t-on ? Si j’ai écrit que c’était peu ou prou toujours pour s’augmenter – en sensations, en connaissance, en puissance – je pourrais également paraphraser le neurologue Benjamin Gall en disant qu’on « entre » dans une drogue par la porte de la douleur, de la volupté ou du sacré. En d’autres termes, si la plupart des drogues « modernes » et chimiques (comme la morphine, l’héroïne, la cocaïne et les amphétamines) font, en vertu de leur qualités thérapeutiques réelles ou supposées, l’objet de pratiques médicales avant d’être récréatives ou hédonistes, toutes les autres qui sont des « phantastica » (cannabis, peyotl, champignons, iboga et autres plantes divinatoires) ont d’abord une histoire sacrée, rituelle et cultuelle. Il est évidemment compliqué pour un Occidental de rentrer dans la pratique culturelle originaire de ces produits, mais certains l’ont fait de bonne fois, dans le cadre d’initiations en bonne et due forme (je pense ici à la célèbre « curandera » Maria Sabina qui a été visitée au Mexique par les grands mycologues Robert G.Wasson et Roger Heim, le poète René de Solier et par certains Beatles !). Par ailleurs, bien qu’opérant dans des sociétés laïcisées, des expérimentateurs utopistes de mescaline et de LSD – comme respectivement Aldous Huxley et Timothy Leary – ont réellement cru au potentiel heuristique et socialement pacificateur de ces substances qu’ils souhaitaient voir consommer par les individus au nom de l’élargissement de la conscience. De leur côté, Kerouac, Ginsberg et Michaux, extraordinairement sensibles à la dimension spirituelle de l’existence, ont peu ou prou articulé ce type de drogues à leur quête, quitte à les abandonner pour se vouer plus essentiellement à la poésie ou à la méditation. Et aujourd’hui, quoiqu’on pense des problématiques du « développement personnel » ou du New Age comme religions de remplacement, sagesses de substitution ou avatars narcissiques de monades mondialisées en quête de repères transcendantaux, il est patent qu’ils contribuent au revival des drogues psychédéliques. Pour revenir à vitre observation finale, autant je pense que la critique modianesque du LSD dans les années 60 a tout à voir avec celle du grégarisme des jeunes de l’époque, autant Virginie Despentes a bien compris que la coke, et plus généralement les psychostimulants, sont les lubrifiants du capitalisme planétaire qui a besoin que les gens « tiennent » à n’importe quel coût dans leurs emplois qui ne sont pas des métiers dignes d’amour et de fierté. À ce sujet, le jour où j’ai lu que les marins pêcheurs français prenaient désormais de la cocaïne pour supporter leurs conditions de travail, je me suis dit que quelque chose avait vraiment changé non seulement dans la sociologie des drogues mais dans leur instrumentalisation politique. Et il n’est bien sûr pas anodin que l’écrasante majorité des drogues de synthèse inventées chaque jour soient principalement des psychostimulants car imaginons un peu ce que donnerait une société où les gens, en quête de souvenirs ou luxueusement enroulés dans les méandres de leur vie intérieure, s’allongeraient tous les après-midis pour fumer de l’opium pendant des heures !
7 – Il t’était difficile d’être totalement exhaustive et cela pour des raisons éditoriales liées à la masse du volume, aussi aimerions-nous que tu nous parles ici, sur DF, à la manière de tes Écrits stupéfiants, d’auteurs et de drogues que tu n’as pas pu inclure. Tu nous ferais ainsi l’honneur d’inédits et de chutes de ton livre. Nous pensons à Antony Burgess et à son lait aux amphétamines dans L’Orange mécanique (1962), mais surtout à Frank Herbert qui s’est largement inspiré de ses propres expériences avec les champignons hallucinogènes pour écrire ce chef-d’œuvre universel qu’est Dune (1965) et dont l’intrigue repose autour des drogues, et plus précisément du « mélange », appelé également l’ « épice de prescience », qui rend possible la perception du temps et spécialement de l’avenir, modifiant complètement les relations politiques, commerciales et sociétales dans l’univers. Il y aussi Robert Silverberg, à qui le National Institute on Drug Abuse (NIDA) commanda en 1974 un rapport sur toutes les drogues, réelles ou imaginaires, stimulantes ou paralysantes, euphorisantes ou déprimantes, libératrices ou asservissantes, qui se répandaient au fil des pages de cette littérature dite de science-fiction dont il était l’un de ses éminents représentants, notamment grâce à ce roman inégalé sur la question : Le Temps des changements (1971) où le personnage, par la prise de « Sumara » explore les profondeurs de son inconscient et découvre son véritable désir. Parmi les drogues bien réelles, si tu veux présenter le Ya Bah ou la DMT, tu es la bienvenue. Enfin, tu es libre de parler de ce que tu souhaites et qui n’a pas pu figurer dans ton texte.
Concernant le LSD, j’aurais bien aimé pouvoir faire figurer des poèmes de Claude Pélieu et un extrait du D-Man (1966) de Gabriel Pomerand, comme faire traduire certains textes issus de livres tels que The Amphetamine Manifesto (1972) du mystérieux Harvey Cohen, Journeys into the Bright World (1978) de Marcia Moore qui m’aurait permis d’avoir un extrait sur l’expérience de la kétamine, et How to Stop Time : Heroin from A to Z (1999) d’Ann Marlowe. Toujours à propos de l’héroïne, je regrette d’avoir dû sacrifier des extraits pourtant traduits en français de Julia et son bazooka (1969), de la romancière britannique Anna Kavan. Il est très dommage aussi que je n’aie pas d’extraits des grands livres d’Alexander Shulgin et de Terence McKenna. J’aurais aimé voir figurer d’Avita Ronell un extrait de son étonnant Addict, fixions et narcotextes (Bayard, 2009) et d’une manière générale beaucoup de textes qui figurent dans l’anthologie américaine intitulée Sisters of Extreme, qui rassemble bon nombre de femmes anglo-saxonnes ayant écrit sur les drogues. Car parmi ces dernières, il y a quand même la poétesse Mina Loy qui a écrit des poèmes sur la cocaïne, la salonnière Mabel Luhan Dodge qui raconte ses “peyotl-parties” à Greenwich Village, l’étonnante Emily Hahn qui a bourlingué en Chine dans les années 1930 et signé deux papiers majeurs sur l’opium dans The New Yorker, la pionnière Marlene Dobkin de Rios, première femme à avoir rendu compte d’une expérience d’ayahuasca dans Visionary Vine (1971), etc.
Entretien © Cécile Guilbert & Caroline Hoctan – Illustrations © DR
(Paris, nov. 2019)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.