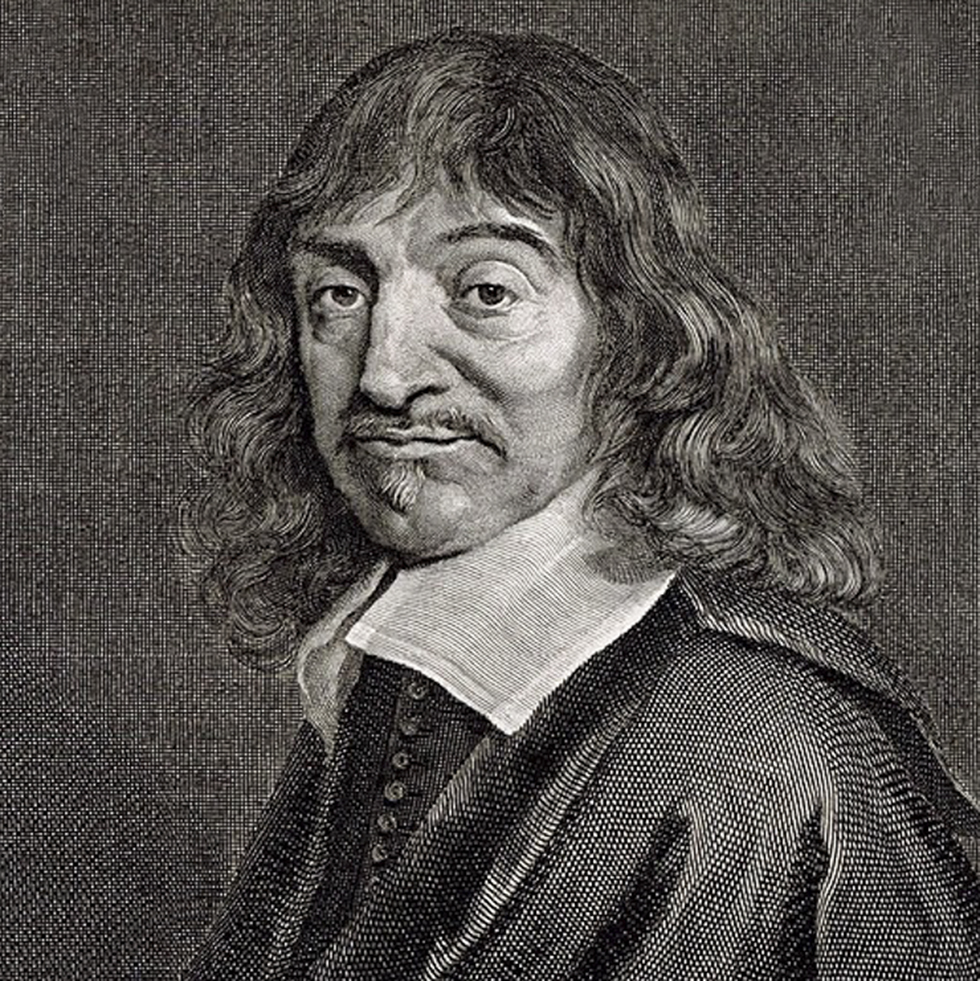« À défaut de voir ce que sera demain, je me contenterai bien de voir hier et de vivre dans la société de M. Descartes ». Passer un moment en compagnie de Descartes, Flaubert en rêve comme d’un bon moyen pour traiter sa mélancolie, peut-être, à mon insu, ce passage d’une de ses lettres m’a-t-il conforté dans mon désir de relire Descartes, tout Descartes pour entendre la voix forte, amicale et courageuse de celui dont Hegel fait le « héros » de la philosophie, un héros qui affirmait aimer la vie et ne faisait de la philosophie que parce que, parmi toutes les activités qu’il avait envisagées, c’était la plus innocente et celle qui lui procurait le plus de joie. Voilà la raison pour laquelle j’ai écrit ce Descartes, sur la foi d’un rêve (L’Harmattan, 2024).

En 1637, il y a maintenant près de quatre siècles paraissait, anonymement – non en France, mais à Leyde, la ville des tulipes et de Rembrandt – un petit livre qui allait durablement bouleverser la philosophie, mais encore, l’image qu’hommes et femmes se faisaient de leurs capacités. « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », ce « bon sens » ou cette « raison » que Descartes définit, dès l’incipit de son livre, comme « la capacité de distinguer le vrai du faux », peut-être l’utilisons-nous mal et faisons-nous tant d’erreurs que l’on a pu se gausser – Montaigne en tête – de tous ceux qui réclamaient plus d’argent ou plus de beauté, mais jamais au grand jamais, plus d’intelligence, tant ils étaient sûrs d’en posséder suffisamment, et de n’être pas des bêtes. Mais pour Descartes, on est homme ou on ne l’est pas, et dans ce domaine, il n’y a pas de plus ou de moins. Tout être humain, quel que soit son âge, son sexe, sa langue, son lieu d’origine et même sa folie, a en lui cette capacité de jugement, et ce, qu’il l’exerce à bon escient ou pas, qu’il ait appris la « rhétorique » ou pas, qu’il parlât latin ou « bas-breton ».

« Il y a plus de différence de tel homme à tel homme qu’il y a de tel homme à telle bête » [1] affirmait Montaigne. Descartes est maintenant à l’opposé de Montaigne. La capacité à distinguer le vrai du faux et la volonté de décider librement de l’exercer au moins une fois dans sa vie pour tenter de devenir maître de nos pensées – à défaut de l’être de nos actions – pour Descartes, aucun animal ne les possède, et sur ce point il ne variera jamais. Mais qu’il se soit éloigné d’Aristote et de Montaigne, qu’il renonce à s’adresser en latin à ses pairs pour choisir, ce qu’aucun philosophe n’avait fait avant lui, d’écrire en langue vulgaire, sans aucune référence érudite, pour être compris de tous et toutes, ne le rapproche pas pour autant de tous ceux qui disent posséder des secrets et utilisent des poudres de perlimpinpin pour fasciner les gens. Non ! Descartes n’est pas démagogue. Il ne conforte pas chacun dans ses certitudes en remettant en question ceux que son temps appelle les « doctes », et ceux dont on dirait aujourd’hui qu’ils appartiennent à « l’élite », aux « sachants », aux « experts ». Il questionne tout, et nous rappelle que « nous avons tous été enfants avant que d’être hommes », enfants dépendants de nos appétits, de nos nourrices et de nos précepteurs. Aucune de nos opinions, quelle qu’en soit l’origine, ne doit échapper à notre questionnement, faire comme si – n’oublions jamais le comme si – tout était douteux et comme si tout ce en quoi nous pouvions imaginer le moindre doute était faux, et voir si, au terme de cette ascèse, il subsistait quelque chose ou si nous devions, avec les sceptiques, penser que tout, mais vraiment tout était douteux.
Ose te servir de ton propre entendement ! Ose juger de ce qui est vrai ou faux, bien ou mal ! Un siècle avant Kant, Descartes affirme : il faut oser et il ose. Il ose tout, et loin de chercher à raccommoder un édifice du savoir déjà bien ébranlé par les attaques des sceptiques, il le met à terre et pratique une table rase totale sur laquelle, seul, il se propose de tout reconstruire : « Je me résolus à ne tenir pour vrai que ce que je saurais évidemment être tel ».

« L’idée de secouer une pensée à laquelle on se fiait est une idée brave » [2]. Péguy et Alain, quand ils parlent de Descartes, utilisent un vocabulaire militaire et Valéry qui aimait tant Descartes le définit comme « un grand capitaine de l’esprit » menant à bien, dans le Discours de la méthode, la plus grande aventure de l’histoire de la philosophie… et en payant le prix, même auprès de certains de ses héritiers, réputés pour leur bonhomie, mais continuant à être choqués par l’irrespect cartésien envers les professionnels de la pensée :
Parfois notre auteur a plutôt recherché les applaudissements que la certitude.[3]
Belles paroles pour le grand public. [4]
Par de telles déformations des choses on prépare les esprits à l’entêtement et aux paralogismes. [5]
Il me semble qu’il serait équitable d’attribuer aux anciens ce qui leur est dû et de ne pas cacher leurs mérites par un silence malveillant et préjudiciable à nous-mêmes. [6]

C’est en ces termes qu’après la mort de Descartes, Leibniz commente, article après article, ses Principes. Tocqueville disait que, en 1789, c’était Descartes qui était descendu dans la rue ; garder en mémoire le premier article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les hommes sont nés libres et égaux en droit » et lire au début du Discours que « la puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes », c’est être tenté de lui donner raison et trouver Descartes bien naïf d’avoir cru – mais l’a-t-il vraiment cru ? – que ne se mêlant ni de politique, ni de théologie (c’est à dire des données de la Révélation), ni de morale, il pourrait, malgré sa notoriété toute nouvelle, continuer à vivre et à travailler paisiblement pendant que de simples gens sans prévention, ayant lu le Discours, et convaincus par la clarté de ses arguments, feraient pression sur tous les détenteurs de pouvoirs universitaires, religieux et politiques pour qu’ils reviennent sur des opinions erronées et rendent possible, enfin, la publication du Monde qui, depuis quatre ans – depuis la condamnation de Galilée – moisit dans un tiroir.

Descartes serait-il insolent comme on l’en accusait parfois ? À coup sûr, car même si, toujours en ce début du Discours, il affirme ou concède qu’il peut se tromper et ne prendre « qu’un peu de cuivre et de verre… pour de l’or et des diamants », ou qu’il a, comme tous les autres hommes, une fâcheuse tendance à « se méprendre en ce qui le touche », il affirme aussi très clairement que « regardant d’un œil de philosophe », « sans présomption », les actions et entreprises de tous les hommes, il les trouve vaines et inutiles :
Je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pour l’avenir que, si entre les occupations des hommes purement hommes, il y en a quelqu’une qui soit solidement bonne et importante, j’ose croire que c’est celle que j’ai choisie. [7]
Et cette utilisation du « Je » ! Ce « Moi » omniprésent et de si mauvais goût qui, d’abord, dit ne pas vouloir faire la leçon ni enseigner à quiconque ce qu’il doit faire et simplement présenter, en toute « franchise », sa « vie comme un tableau, afin que chacun puisse en juger » et en tirer ce qui lui semble bon et qui, ensuite, comme au théâtre, se masque et propose de ne voir dans son récit qu’une « histoire, ou si vous l’aimez mieux… une fable » !
« Je vous raconte, dit-il, l’histoire de mon esprit, vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a de la hauteur dans cette position, et du cavalier, et du style Louis XIII, non gouvernable »[8] commente Alain dans ses Propos. Non gouvernable, peut-être, non imitable sûrement, car contrairement à Rousseau affichant dès le début des Confessions sa certitude, qui peut faire sourire aujourd’hui, de former « une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et dont l’exécution n’aura point d’imitateur » [9] ce petit texte, où Descartes expose le chemin qui a été le sien, constitue, aujourd’hui encore, un objet totalement singulier, la première et la dernière autobiographie spirituelle d’un philosophe choisissant de parler de métaphysique à ses contemporains comme on mène une conversation en tisonnant son feu et en parlant de soi.

« Un roman » dira Voltaire du Discours pour le dénigrer. « Le roman de notre époque », écrira Valéry à Gide après une énième relecture de ce texte dont il ne peut se lasser et pourtant, sûrement, le plus grand classique de l’histoire de la philosophie, celui dont Bertrand Russell dira même que, avec lui, commence la philosophie moderne. Comment ne pas hésiter avant de se lancer dans la lecture d’un petit livre, bruissant de tant de lectures prestigieuses, pour y chercher simplement, et aujourd’hui encore, ce qu’il dit offrir à tout un chacun : une méthode pour bien conduire sa raison en un siècle qui, comme le nôtre, comme le sien, tout en gardant les traces institutionnelles et redoutables de certitudes passées n’est, en fait, plus certain de rien, ni de l’existence d’une vérité, ni même de la capacité de chacun à l’atteindre dans quelque domaine que ce soit. Peut-être existe-t-il vraiment « une méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences » qui puisse être comprise et suivie par n’importe qui, même par « un Turc », même par « une femme » – le titre de ce Discours n’est pas mensonger – mais quel précepteur m’a appris jusque-là à me passer de lui ? Quel précepteur a eu, jusque-là, assez de générosité pour me dire : estime-toi à ta juste valeur, il y a en toi comme en moi, non seulement une « lumière naturelle », mais aussi des « semences » de vérité, j’ai appris à les développer et te présente ce à quoi je suis parvenu dans des domaines scientifiques qui, pour l’instant, te paraissent peut-être inaccessibles, mais ne le sont pas :
Et si j’écris en français, qui est la langue de mon pays, plutôt qu’en latin, qui est celle de mes précepteurs, c’est à cause que j’espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu’aux livres anciens ; et pour ceux qui joignent le bon sens avec l’étude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point, je m’assure, si partiaux pour le latin, qu’ils refusent d’entendre mes raisons pour ce que je les explique en langue vulgaire. [10]

Toute sa vie, Descartes conservera cette défiance vis-à-vis de l’érudition et cette confiance en la capacité de chacun à se débarrasser de ce qui entrave sa pensée. Après le retour à Freud, le retour à Marx, après toutes les analyses de ce qui, de l’extérieur ou de l’intérieur, détermine notre pensée et notre conduite, peut-être le temps est-il venu d’oser Descartes, d’oser enfin dire « Je » et d’en tirer toutes les implications. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ? Qu’est-ce que l’homme ? Ces questions, qui sont à la base de la pensée critique kantienne, d’où viennent-elles si ce n’est du grand chambardement introduit par Descartes, ce philosophe français, dans lequel Heidegger voit le destructeur de la métaphysique, métaphysique qui, pour lui, après avoir été grecque ne peut être qu’allemande or s’il y a bien quelqu’un à qui ce nationalisme est étranger, c’est Descartes et s’il y a quelqu’un pour qui la métaphysique est essentielle, c’est bien toujours Descartes.
« Ne faites pas couler le sang français », dit Descartes au médecin suédois qui le saigne en un dernier mot d’esprit révélateur d’un philosophe qui toute sa vie s’est interdit d’être un esprit chagrin, mais qui n’a jamais donné ni au sang ni au sol français une vertu particulière. Pour Descartes, la métaphysique ne vient pas après, mais avant la physique, elle est, dit-il, à la racine de la philosophie. S’il m’est possible de sortir de la solitude du cogito c’est parce que ce moi qui doute, ce moi qui pense et qu’on a pu présenter comme une sorte de fantôme hantant la machine qu’est devenu le corps, ce moi, du fait qu’il doute, prend conscience de lui-même comme d’un être imparfait qui ne peut se juger ainsi que parce qu’il a en lui une idée du parfait, une idée de Dieu et d’un Dieu qui ne pourrait être parfait s’il n’existait pas.

Descartes met la métaphysique cul par-dessus tête, ce n’est pas l’harmonie et la beauté du monde qui « prouvent » l’existence de Dieu, c’est l’existence de Dieu qui me permet de sortir de la solitude de mon moi, et de retrouver le monde et un monde connaissable par moi. Si Dieu n’existait pas, les sceptiques auraient raison, et pour le dire rapidement, rien ne me permettrait d’affirmer que ce qui est vrai aujourd’hui, le serait encore demain. Descartes est catholique. Il a, dit-il avec ironie, la religion de son roi et de sa nourrice, mais son Dieu n’est pas très catholique, il n’a pas créé le monde pour les hommes et n’intervient en rien dans leurs affaires, ni pour les récompenser, ni pour les punir. Sa liberté est une liberté d’indifférence, et si sa puissance est telle qu’il aurait pu faire que 2 et 2 fassent 5, on peut dire en reprenant l’expression sartrienne, qu’il a jeté l’homme dans le monde en le laissant totalement libre de ses choix et libre finalement aussi de se connaître, de connaître ce monde et de le transformer pour le rendre plus habitable.
« Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » : cette affirmation qu’on a tant reprochée à Descartes rendu responsable de toutes les dérives des sociétés industrielles occidentales, on ne la trouve qu’une fois dans la dernière partie du Discours de la méthode. De même, on ne trouve qu’une fois au même endroit ce qui, aux yeux de Descartes, justifie toute sa démarche, justifie le fait d’avoir désenchanté la nature : construire une physique entièrement mathématisée qui permette enfin, une transformation concrète de la vie des gens. « Pour vivre heureux, vivons cachés », affirme Descartes, et tout un temps, il hésite à publier le résultat de ses recherches. Ce qu’il aime, c’est la recherche et sa tranquillité, et s’il y renonce c’est, dit-il encore, pour avoir cru « que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu’il est en nous le bien général de tous les hommes ». [11]

Cet optimisme de Descartes, on n’en trouve plus trace dans les Méditations qu’il écrit en latin et publie en y intégrant les critiques de philosophes et de théologiens (alors même qu’il tient depuis bien longtemps pour totalement stériles ces débats), mais on ne peut pas dire pour autant que les Méditations fassent quelque concession que ce soit aux doctes auxquels il s’adresse. Par amitié pour Mersenne, il lui laisse choisir le titre de son livre qui paraît en 1641, mais si la première édition affirmait que dans ces Méditations étaient « démontrées l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme », dans la seconde, beaucoup plus modestement, Descartes ne promet plus une démonstration de l’immortalité de l’âme, mais seulement de « la distinction de l’âme et du corps ».
Si, dans un premier temps, Descartes refusait de donner une âme aux animaux – ce qui aurait permis même aux fourmis d’accéder à l’immortalité – là, force nous est de reconnaître que contrairement à Kant, Descartes ne promet pas, même à l’homme vertueux, une récompense dans l’au-delà, car à l’au-delà et à une vie après la mort, il croit et il aspire bien peu, lui suffisent la joie que lui procurent sa recherche de la vérité, une bonne santé et la compagnie de quelques amis. Il le clame dans les seuls écrits qu’il veut dorénavant produire : des lettres à ses amis. Et tous les cartésiens d’abandonner ce Descartes qui, loin de prendre de face les problèmes, affirme dans ses lettres les affronter du « biais » qui pouvait les lui rendre agréables. Martial Guéroult reconnaît le caractère disons, hors-système, de la médecine et de la morale cartésiennes que « le Traité des Passions ou la Correspondance envisagent partiellement ou à bâtons rompus » [12] et met cela sur le compte de la mort prématurée de Descartes qui, sûrement, sans elle serait « parvenu à organiser systématiquement les ultimes conséquences de sa doctrine ».
Pourtant, Descartes dit à plusieurs reprises, et cela dès le Discours de la méthode que, pour la vie, il est nécessaire d’utiliser des biais qui ne sont pas acceptables pour la recherche de la vérité. Que Martial Guéroult se méfie de l’aspect conversation « à bâtons rompus » de la Correspondance avec Chanut et Élisabeth, qu’il ne supporte pas que ce soit dans ses échanges amicaux et, qui plus est, ses échanges amicaux avec une femme où il se révèle merveilleux « médecin de l’âme », qu’il offre ses doutes, ses confidences et dernier fruit de sa philosophie, sa morale, peut se comprendre, mais pas sa méfiance vis-à-vis des Passions de l’âme, ouvrage publié par Descartes de son vivant qui n’est en rien un exposé « partiel » de sa pensée. Mais comment Martial Guéroult pourrait-il accepter que « son » Descartes écrive dans le dernier paragraphe de son dernier texte publié, en guise en quelque sorte de testament, que l’âme peut, bien sûr, avoir « ses plaisirs à part », mais que « tout le bien et le mal de cette vie » vient des passions et uniquement des passions, que ce sont les hommes passionnés qui « sont capables de goûter le plus de douceur dans cette vie » et que la sagesse a « principalement » pour utilité d’enseigner « à s’en rendre tellement maître et à les ménager avec tant d’adresse, que les maux qu’elles causent sont fort supportables, et même qu’on tire de la joie de tous ». [13] ?
Ce Descartes qui, non seulement philosophe sur tout ce qui se présente, comme il le disait à Huygens, mais qui affirme n’être devenu autonome que par l’habitude de « toujours regarder les choses qui se présentaient du biais qui me les pouvait rendre le plus agréables » est tellement différent du philosophe méthodique que nous avons vu à l’œuvre dans l’exercice du doute et la recherche de la vérité, que nous avons bien du mal à penser qu’il s’agit du même homme. C’est ce terme de biais, sur lequel je tombe pour la troisième fois dans un passage de Descartes, et que François Jullien choisit toujours pour caractériser, justement, ce qui dans la pensée chinoise est à l’opposé de la pensée méthodique occidentale, et en particulier cartésienne, qui me dérange.

Oui, Descartes, c’est l’homme audacieux qui attaquait « de front » tout l’édifice de la scolastique pour le mettre à terre, mais c’est aussi l’homme qui sait et a toujours su que, pour vivre, il fallait suivre une démarche bien différente et se rendre disponible à l’accueil de tout ce qui se produit et ne dépend pas de nous pour, en le tournant dans tous les sens, « trouver » pour reprendre, non la pensée chinoise, mais la métaphore d’Épictète, l’anse par laquelle il pouvait être porté [14]. Je ne connais pas du tout la pensée chinoise, mais je ne connais pas plus LA pensée occidentale, j’essaie de lire et moi-même d’accueillir dans sa complexité un philosophe, un écrivain au style inimitable que, pour pasticher Valéry, nous voulons tellement rendre cohérent que nous finissons par le transformer en monstre ou en hippogriffe.
Dans l’Histoire de la Folie à l’âge classique, Michel Foucault reprend – consciemment ou non, je ne sais – le mot de Valéry et parle du « coup de force » de Descartes, mais pour lui, ce coup de force du cogito, marque l’exclusion de la folie et le début du grand enfermement des fous. J’aime que le deuxième chapitre de son livre intitulé « Le grand renfermement » commence par un commentaire très précis d’un passage de la « Première Méditation » de Descartes. J’aime que Jacques Derrida, dans L’Écriture et la différence reprenne, très longuement et très précisément, le texte de la « Première Méditation », puis le commentaire qu’en fait Michel Foucault avant d’en proposer lui-même un commentaire, qui tout en disant sa reconnaissance à Foucault pour ce qu’il lui a apporté, met littéralement à terre l’interprétation que celui-ci donne du passage de la « Première Méditation » et conclut :
Que je sois fou ou non, je suis et cela tant que je pense. La philosophie, c’est peut-être cette assurance prise au plus proche de la folie contre l’angoisse d’être fou. [15].

Grâce à Foucault, mais contre lui, Derrida déclare : « Foucault m’a fait prendre conscience du fait que l’acte philosophique ne pouvait plus ne plus être cartésien en son essence et en son projet ». Puis-je ajouter que, grâce à Descartes, de cet acte et de ce courage philosophique, nous savons que chacun d’entre nous est capable, quand il ose, de penser ? Car, grâce à Descartes, nous savons aussi qu’il y a une « fatigue de l’esprit » que nous ne pouvons traiter qu’en ne pensant « à rien », « ce qui n’est pas perdre son temps mais le bien employer » pour recouvrer sa santé en ne s’occupant qu’à regarder « la verdeur d’un bois, les couleurs d’une fleur, le vol d’un oiseau et telles choses qui ne requièrent aucune attention » [16]. Oui, Flaubert avait raison, quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, vivre dans la compagnie de Descartes permet de lutter efficacement contre sa mélancolie.
Texte © Marie-Paule Farina – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
[1] Montaigne, Essais I, 42 : « De l’inégalité qui est entre nous », Bibliothèque de la Pléiade.
[2] Alain, Propos, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1 282.
[3] Leibniz, Opuscules philosophiques choisis, Vrin, 1978, p. 17.
[4] Ibid., p. 27.
[5] Ibid. p. 30.
[6] Ibid. p. 36.
[7] Descartes, Discours de la méthode, Bibliothèque de la Pléiade, p. 127.
[8] Alain, Propos, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1 122.
[9] Rousseau, Les Confessions & Autres textes autobiographiques, Livre 1, Bibliothèque de la Pléiade, p. 5.
[10] Descartes, Discours de la méthode, 6e partie, Bibliothèque de la Pléiade.
[11] Ibid., p. 168.
[12] Martial Guéroult, Descartes selon l’ordre des raisons, t. 2 : L’âme et le corps, Aubier, 1992, p. 270.
[13] Descartes, Les Passions de l’âme, Bibliothèque de la Pléiade, p. 795.
[14] Épictète, Manuel in volume Les Stoïciens, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1 128 : « Toute chose a deux anses, l’une qui permet de la porter, l’autre qui l’interdit. Si ton frère est injuste, ne prends pas la chose sous l’angle de l’injustice (car c’est l’anse qui ne permet pas de la porter), mais plutôt sous l’angle de la fraternité, de l’éducation commune, et tu la prendras par où on peut la porter ».
[15] Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Le Seuil, 1967, p. 92.
[16] Descartes, « Lettre à Élisabeth, (mai-juin 1645) » in Correspondance avec Élisabeth et autres lettres, Garnier-Flammarion.