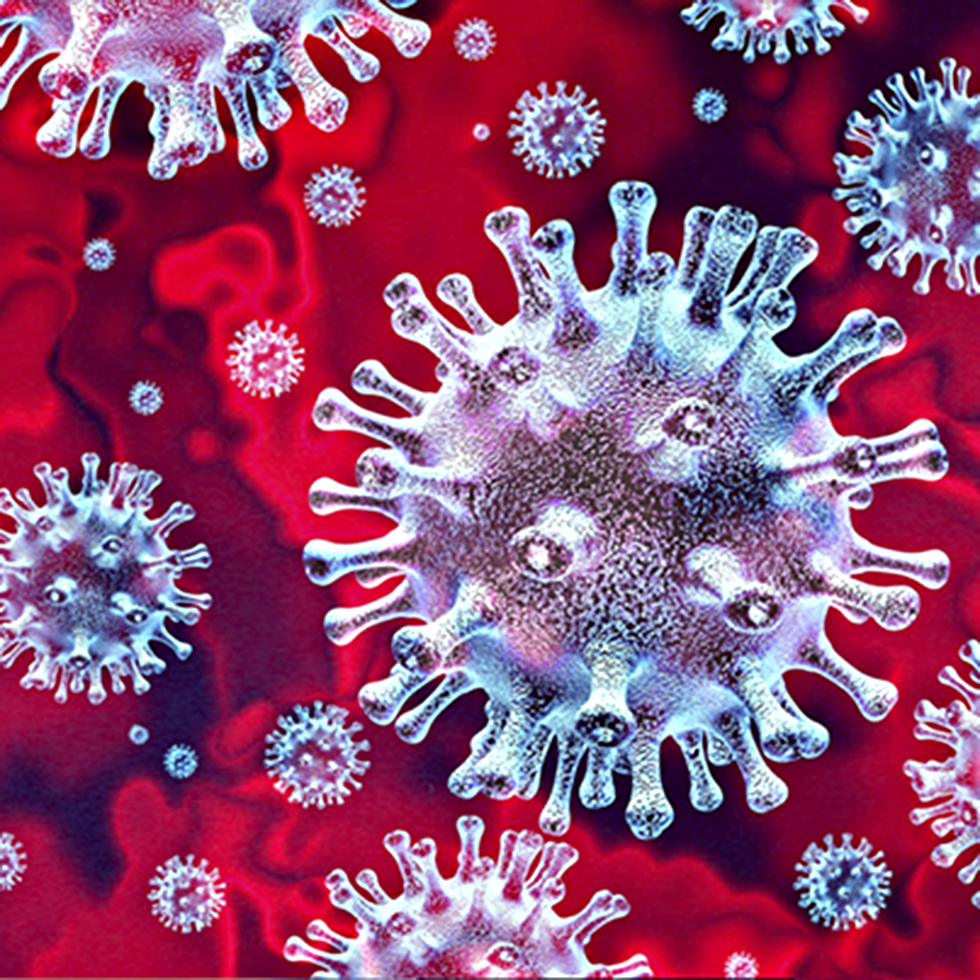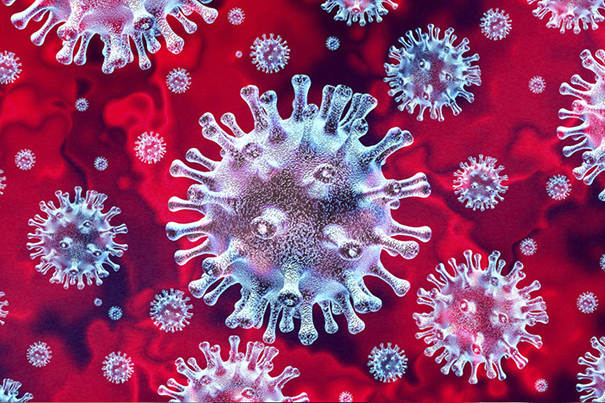
J’ai quitté Paris pour la « province » en 2010, changeant radicalement de vie. Cette décision découle de la prise de conscience, aussi soudaine que profonde, que le « système » ne pourrait continuer longtemps à ce rythme, ni dans cette voie de plus en plus étroite et qui ne mène plus nulle part pour la grande majorité d’entre nous. Après la crise financière de 2008 que, pour des raisons personnelles, j’ai vécu dans l’épicentre même de son surgissement, à New York, j’ai effectivement eu la conviction que le « système » durerait peut-être encore quelques années, mais pas davantage, avant son effondrement définitif et sa complète et radicale transformation. J’ai longuement développé cette réflexion au sein de mon deuxième roman, Dans l’existence de cette vie-là (Fayard, 2016).
Je tiens cependant à souligner que je n’appartiens à aucune mouvance décroissante ou collapsologique. Je n’adhère à rien ni ne crois d’ailleurs en rien, et surtout pas à ce que je vois et entends, qui relève encore et toujours de la rhétorique et du conditionnement de ce « système », que l’on soit pour ou contre lui. Depuis 2008, et donc plus encore depuis 2010 où j’ai tout quitté, cette conviction que les choses ne pourraient pas continuer ainsi très longtemps, qu’il fallait vivre autrement, construire une autre existence dans une autre vie, c’est-à-dire penser différemment que le modèle proposé – caduc sinon déjà obsolète – est devenu pour moi une véritable obsession : celle de mon écriture même, à travers laquelle je tente de suivre ce précepte d’Einstein : « Le monde que nous avons créé est le résultat de nos pensées. Il ne peut pas être changé sans que l’on change notre manière de penser ».
Pourtant, à quelques exceptions près, force est de constater qu’une telle conviction fait sourire, quand elle ne suscite pas carrément suspicion, indifférence, voire simplement mépris, surtout lorsqu’elle est formulée par un auteur n’appartenant pas au « sérail », et qui plus est, a l’outrecuidance de penser depuis des contrées lointaines, mais surtout de sa « province ».
Mais à quoi assiste-t-on alors qu’en cette période cataclysmique où l’engagement à leur risque et péril de toute une frange de personnes anonymes, et véritablement héroïques, devrait nous amener à plus de retenue et de mise en retrait de nos égos ? Aux mièvreries im-pensées d’auteurs, dont les œuvres autoréférentielles sont déjà en temps normal extrêmement pénibles, sinon fort préjudiciables pour la littérature française en pleine décomposition. Ainsi, s’étalent dans les pages de journaux et de magazines, leurs états d’âme de « confinés » depuis leur maison de campagne et autres résidences de villégiature. Nous, auteurs vivant en « province », considérés comme de véritables « péquenauds » par ce milieu littéraire parisianiste, et soumis depuis de longues années à un confinement économique de stade 3, restons confondus devant tant de sottise et d’indécence, mais surtout d’inconscience, comprenant pourquoi tant de gens préfèrent finalement se détourner de la littérature au profit des séries télé ou des sextoys.
Aussi, disons-le une bonne fois pour toutes : s’il existe ne serait-ce qu’un seul milieu où la pensée est le plus formatée, c’est-à-dire le plus exterminée dans son essence même, c’est bien dans le milieu littéraire où ce n’est pas l’exigence de la réflexion qui prime, ni même l’ambition et l’originalité d’une écriture qui prévalent, mais uniquement le fric, le divertissement et les larmes chaudes de la compassion victimaire. Pour ceux qui se demandent aujourd’hui quel est donc le niveau de pensée de ce milieu et de la plupart de ses auteurs (je n’ose employer le terme d’écrivains car nous ne parlons plus ici d’écriture) qui y sont promus à grandes pompes, il suffit d’ouvrir les « journaux » de ceux qui bêlent et geignent sur leur confinement, mais également les « œuvres » de ces chantres d’une autofiction testimoniale dont le seul horizon de pensée s’arrête à leur nombril et à leur destin germanopratin. L’excellent et trop méconnu Patrice Jean le résume dans son dernier roman mieux que je ne saurai le faire :
Thomas vivait déjà dans le monde d’après la pensée, d’après la littérature, je veux dire que pour lui, la cause était entendue, le règne du rien, de la camelote et du profit s’étendait à toutes les zones de l’Europe, la vie littéraire, ses succès, ses prix, ses grands auteurs, tout n’était que simulacre et marketing. Les lecteurs, incultes, consacraient « la daube qu’on leur fourguait », les journaux célébraient des « produits consensuels », même l’enseignement « se couchait devant les chiffres et les ventes ». (Tour D’ivoire, 2019).
Aussi, lorsqu’on est un auteur qui a la volonté de sortir des sentiers battus, qui prend des risques personnels pour y parvenir – parfois même des risques qui mettent sa propre vie en jeu – qui a la prétention de proposer une nouvelle manière de penser le monde, qui a l’ambition d’élaborer une œuvre exigeante et pensante, que peut-il espérer de ce monde, ou de ce milieu ? Rien. Même pas la reconnaissance de son métier, puisque, c’est bien connu, l’écriture n’est pas un « travail » mais une activité de loisirs, une simple distraction, tout comme son contenu n’est plus qu’une de ces formes débilitantes et mercantiles de divertissement, et non plus un outil de réflexion ou d’émancipation. Ainsi, un auteur doit avant tout amuser la galerie (entendez être « médiatique »), distraire les foules (entendez jouer à l’idiot utile du « système »), et être rentable (entendez rapporter de l’argent avec ce qu’il publie sans en gagner trop lui-même, voire même de préférence ne rien en obtenir, étant de bon ton de penser qu’il vit « d’amour et d’eau fraîche »).
Aujourd’hui, rédigeant ces lignes, je sais donc que ce n’est pas tant le coronavirus que je dois craindre et dont je risque de crever que de ce « système » lui-même qui, précisément, a la haine de la littérature chevillé au corps, comme il a la haine de la liberté, de la diversité et de la vie. Depuis dix ans maintenant, il n’y a pas un seul jour où, devant la page blanche de mon écran, je ne ressente une inextinguible oppression, qui peut m’étreindre quelques minutes, comme durer des journées entières. Elle ne vient nullement de l’angoisse de ne pas savoir quoi ou comment écrire ce que je dois écrire, mais de ce sentiment diffus et permanent renvoyé sans cesse par ce « système » qui me fait cyniquement comprendre que je ne suis rien, ni auteur bankable, ni pisse copie rentable, et que je m’affaire à réaliser quelque chose qui, en fait, ne parle plus à personne, pas même ceux qui se targuent encore de « lire ».
À ce titre, il n’est donc pas surprenant – au-delà de toute littérature qui s’effondre – que depuis des mois, sinon des années, les appels, cris et suppliques de scientifiques comme de jeunes et de populations confrontées de plein fouet dans le monde entier au caractère disruptif de ce « système », restent lettres mortes, et ne suscitent eux-mêmes pas davantage de changement et de remise en question de celui-ci. Songeant à Walter Benjamin qui, s’appuyant sur Pierre Naville, conseillait d’ « organiser le pessimisme », il me semble qu’est venu le temps d’organiser plutôt l’optimisme. M’appuyant à mon tour sur Marguerite Duras dans Hiroshima mon amour, j’aimerais ainsi crier à sa manière :
Ô Coronavirus, mon amour, rends-nous plus forts, plus clairvoyants, et si tu ne nous tues pas complètement, sauve nous un peu, puisque, aujourd’hui, tu es notre seule chance d’envisager un autre monde.
Texte © Caroline Hoctan – Illustration © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.