Quoi qu’ait pu en dire Roland Barthes, revenir aux textes – et seulement aux textes – est une entreprise impossible quand il s’agit des textes de Sade car, et ce depuis bien longtemps, Sade est « l’infâme Sade », et ceux qui le lisent comme ceux qui ne le lisent pas, le font malgré ou à cause de sa réputation. Et Sade le sait très bien qui, dans les notes de Juliette joue de cette réputation pour faire croire que toutes les orgies qu’il décrit, aussi rocambolesques soient-elles, sont peintes d’après nature et l’on y croit. Magnifique réussite du romancier, terrible prise de risque pour l’homme Sade et pour ses commentateurs et commentatrices à qui l’on dit sans cesse, j’en témoigne : « Jamais je ne lirai un homme pareil », ou plus directement : « Comment pouvez-vous lire, comment pouvez-vous défendre quelqu’un d’aussi dégoûtant ?”. Et l’on se retrouve toujours à expliquer ce qu’a été la vie de l’homme Sade, et l’on se retrouve toujours à justifier Sade et à se justifier en présentant l’homme comme une victime et l’oeuvre comme une oeuvre d’imagination, et seulement d’imagination, mais la question demeure : si l’on désire vraiment être libre pourquoi choisir, alors qu’on est enfermé à la Bastille et accusé de « libertinage outré », d’écrire un livre aussi sulfureux que Les 120 journées de Sodome, « le livre le plus immoral qui ait jamais été écrit » ?
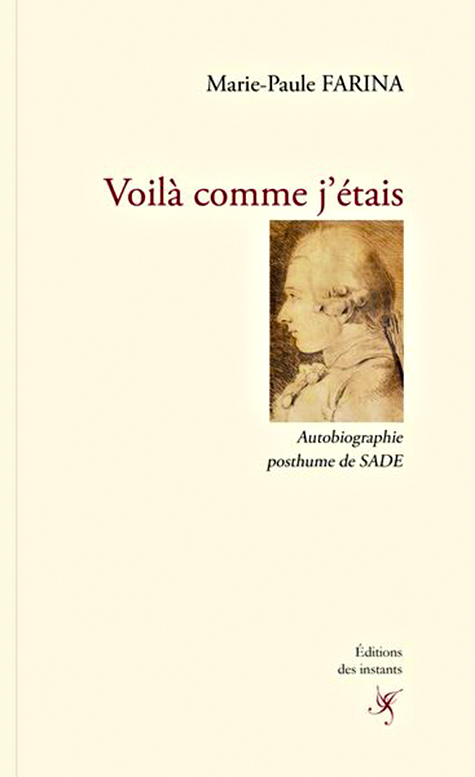
Pourquoi dans ce contexte Sade n’a-t-il pas écrit des Mémoires ou une autobiographie? Je me permets dans l’autobiographie que j’écris à sa place – Voilà Comme J’étais : Autobiographie posthume de Sade (Des Instants, 2022) – de suggérer une réponse empruntée à la correspondance du romancier le plus proche de lui au 19e siècle, Flaubert : « Rédiger des confessions, des mémoires, il faut réserver cela à la vieillesse quand l’imagination est tarie », et jusqu’à la fin, l’imagination de Sade – tout comme celle de Flaubert – a été débordante. Pourtant, écrire ses Mémoires, Sade y a pensé.
« Phrase à inclure dans mes Mémoires : Les entractes de ma vie ont été trop longs”. Cette note de Sade n’est pas la seule qui montre un Sade vieillard à Charenton, envisageant la possibilité d’écrire ses Mémoires, mais ce travail, s’il le prépare à Charenton, il n’envisage de s’y adonner vraiment qu’une fois libre et achevant sa vie, chez lui, au château de Saumane, le château de son enfance, le dernier bien qui lui reste. Jamais, contrairement à ce qui a pu être dit par de nombreux commentateurs, Sade ne s’est « installé » à Vincennes, la Bastille ou Charenton. Jusqu’au dernier jour de sa vie, il a lutté contre la surveillance et la censure, et n’a désiré qu’une chose : vivre en Provence, chez lui, libre, pour « être enfin son propre maître », et dénoncer tous ceux qui pendant des décennies l’avaient privé du seul bien dont même les animaux jouissent, et dont lui Sade avait été despotiquement, illégalement privé : l’air ! C’était cela qu’il donnait comme finalité à ses Mémoires.
Pourquoi alors cette quasi-unanimité contre laquelle, en vain, je me suis élevée dans mes essais comme si, sous le sérieux discours universitaire sur Sade, survivait quelque chose de l’ordre de la peur ou du dégoût amenant, par exemple, les deux derniers biographes de Sade, par féminisme sûrement, ou désir de conserver intacte leur réputation, à réhabiliter non Sade, mais sa belle-mère pour l’un, sa femme pour l’autre, et à trouver que, finalement, en prison Sade était dans son lieu. Quand Sade dit que ce qui lui arrive n’arrive qu’à lui, il a raison !
« Même l’homme contrefait trouve des miroirs qui le rendent beau », affirmait le moine Clément dans La Nouvelle Justine, mais quand le premier biographe, et quasi hagiographe de Sade prenait à la lettre les perversions décrites dans Les 120 journées de Sodome, qu’il lisait comme une « confession » avec seulement un peu trop de coprophagie ou de scatophagie pour être tout à fait crédible, parvenait-il vraiment, malgré son amour de Sade, à le rendre beau, et à convaincre de l’injustice qu’avaient constitué les 28 ans d’enfermement d’un pareil obsédé sexuel ?
À lire la dernière biographie de Sade, saluée par un grand prix du Sénat 2019, on se dit que de Gilbert Lely à Stéphanie Genand, on a vraiment fait le tour de tout ce qui peut-être imaginé sur la sexualité de Sade, et sur son enfermement. « Sade auteur naît entre des murailles et cette genèse carcérale détermine, pour une grande part, sa préférence pour les jouissances modérées », écrit Stéphanie Gernand, poursuivant « qu’il s’agisse de se conformer à un modèle littéraire, soumis à des règles, ou de contenir l’élan sexuel, Sade privilégie la rétention ». La prison a rempli son rôle, y est entré un obsédé sexuel en est sorti un homme de lettres abstinent et fréquentable. Vive la prison, et vive Mme de Sade qui réussit, sinon à convertir Sade, du moins à « l’humaniser » ! Je ne pense pas que Sade aurait apprécié cette lecture si édifiante de sa vie ni de son oeuvre, et qu’il aurait, me semble-t-il, été très surpris – lui qui trouvait si longs les entractes de cette vie – de voir cette biographe ranger, non ses années de prison, mais sa petite décennie de liberté pendant la Révolution sous le titre « Entracte ». Comment peut-on manquer à ce point de sympathie pour la personne dont on écrit la biographie ? Comment peut-on la trahir à ce point ?
« Toujours parler raison serait bien sec », affirme à plusieurs reprises Sade qui, après plus de dix ans passés à Vincennes et à la Bastille, plaisante plus que jamais, et réclame encore et toujours à sa femme d’égayer son style et de lui raconter quelques fariboles qui le distrairaient de son état. Ceux qui l’enferment, au contraire, disent l’enfermer pour qu’il fasse « des réflexions », pour faire « mûrir » sa tête ; de leur côté est la raison, de son côté l’aveuglement, la folie et comment, ne le voit-on pas, par-delà le désespoir, est aussi de son côté la gaieté, toujours !
Peut-être en écrivant cette autobiographie, ai-je éprouvé le désir de quitter, au moins un moment, le très sérieux et souvent mensonger habit du philosophe et du critique pour enfiler celui, multicolore et beaucoup plus sadien, du comédien ou du romancier qui, par profession, se doit d’être tolérant et d’entrer en sympathie avec tous les personnages dont il joue ou invente le parcours ? Peut-être ai-je éprouvé ce désir en voyant combien sous les discours en apparence « objectifs », « rationnels », ou simplement « raisonnables », tenus par beaucoup de commentateurs de l’oeuvre sadienne se cachaient d’a priori irrationnels les rendant, à tout jamais, aveugles à l’ironie pourtant évidente de certains textes, et sourds à toute lecture différente de la leur, sourds surtout encore et toujours, à la souffrance de Sade. Enfin, pour aller à l’essentiel, j’ai lu tellement d’énormités écrites par les plus connus et reconnus commentateurs de Sade que, renonçant au sérieux de l’essai ou de la biographie, je me suis dit qu’il était peut-être temps de faire une place au jeu de la contrefaction dans lequel Sade était passé maître, et de lui donner, un peu tardivement, la parole pour qu’il puisse lui-même, et librement, se justifier et raconter sa vie.
Cette autobiographie s’il ne l’a pas écrite, peut-être m’était-il possible de l’écrire à sa place ou de l’écrire avec lui et de faire entendre ainsi dans ce que – pour pasticher Kundera – nous appellerons « le fracas imbécile des certitudes » sur Sade, une voix qui, en se présentant d’emblée comme contrefaite, introduirait des questions, un dérangement, un sourire, permettant enfin, peut-être, de comprendre plus que de juger un homme qui, avant tout, aima la vie et la plaisanterie, et aurait surement apprécié une si innocente supercherie. Dès l’épigraphe de mon livre, je me situe donc De l’autre côté du miroir, et nouvelle Alice, me permet d’afficher l’usurpation d’une identité qui n’est pas la mienne :
Alice, avec grand intérêt regarda le roi tirer de sa poche un énorme calepin sur lequel il entreprit d’écrire. Une idée lui vint à l’esprit : elle saisit l’extrémité du crayon qui dépassait un peu l’épaule du roi et elle se mit à écrire à sa place.
Inventer des histoires, des personnages, dès l’enfance, cela m’est apparu comme un pouvoir extraordinaire, si extraordinaire que jamais je n’aurais osé supposer que je pouvais en posséder ne serait-ce qu’une petite parcelle. J’étais lectrice et cela suffisait à mon bonheur. J’ai lu, plus tard, grâce au combat de Gilbert Lely et Jean-Jacques Pauvert, Justine et Juliette enfin sorties de l’Enfer des bibliothèques, comme je lisais les romans de mon enfance, seule, pour le plaisir et en dehors de tout cadre scolaire, universitaire ou éditorial. Très vite, j’en ai parlé, très vite j’en ai ri avec mes enfants, mes élèves, mes collègues, et très vite, j’ai éprouvé aussi le désir de défendre Sade et d’écrire pour le faire, comme si m’incombait une sorte de mission chevaleresque. Mais là, j’ai découvert qu’être lectrice de Sade était une chose, faire connaître et reconnaître une lecture aussi inconvenante que la mienne en était une autre… J’ai essayé de ressusciter et de faire découvrir le Sade que j’aimais, j’ai essayé de faire entendre son rire, montré combien ce rire qui avait permis à Flaubert de lutter contre ce qu’il appelait sa « maladie noire » pouvait être essentiel. Je l’ai fait en respectant plus ou moins les codes actuels de l’essai et de la critique. Pourquoi m’en suis-je si complétement et ostensiblement affranchie pour écrire ce dernier livre ? Je n’en sais rien, mais j’y ai éprouvé un tel plaisir que je ne le regrette pas.
Je me suis permis d’inventer un rêve de Sade. Je me suis permis de lui souffler dans l’oreille son propre texte, mais aussi parfois, un peu de Ionesco, un peu de Beckett, un peu de Obaldia et un peu de Flaubert pour lui remonter le moral et le distraire de sa solitude. Je l’ai fait dialoguer avec d’éventuels critiques de son utilisation du théâtre comme thérapie, et avec d’éventuels lecteurs, des aveux qu’il était prêt ou non à faire, mais surtout, je lui ai fait jouer un autre rôle que celui du méchant. Pour cela, je n’ai pas vraiment eu besoin d’inventer. Je me suis contentée de l’écouter se raconter dans ses lettres, bien sûr, et dans son Journal, mais aussi dans ses nombreuses notes et dans son oeuvre. Ai-je pour autant gommé ce qui m’irritait ? « Je m’en sers », dit-il des jeunes servantes qu’il affirme avoir très légalement recrutées auprès d’une maquerelle et rendues à leurs familles quand elles les réclamaient… Il pourrait sûrement dire la même chose de la petite Madeleine non de douze ans, comme le dit Michel Onfray, mais de seize, et dont il va pendant les deux dernières années de sa vie monnayer auprès de sa mère les « services ». Ai-je, pour le moins, eu besoin de rajouter une petite sauce romanesque ou historique pour rendre acceptables de si tristes rapports entre une adolescente et un vieillard ? Non, tout était déjà là pour les rendre sinon acceptables, du moins humains, tristement, mais aussi tendrement humains.
Texte © Marie-Paule Farina – Illustrations © DR
Pour lire le making-of de l’auteure concernant son précédent essai sur Sade, c’est ici.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
