
La thématique de cet ouvrage de Gisèle Sapiro – sur la dissociation (ou pas) entre l’oeuvre et l’auteur – ne peut qu’intéresser tout lecteur soucieux de la mettre à l’épreuve des nombreux exemples cités dans Peut-on dissocier l’oeuvre de l’auteur ? (Le Seuil, 2020). Je constate cependant, le livre refermé, comme un infléchissement de l’auteure (« spécialiste de l’engagement des intellectuels et des rapports entre littérature et politique ») vers un positionnement marqué en faveur de certaines thèses féministes, voire ce que l’on appelle la « cancel culture ». La « conversion » de cette sociologue à l’écriture inclusive, même si son utilisation n’est pas systématique, en est l’une des illustrations. C’est sur cet infléchissement qu’il m’importe principalement de répondre de manière critique, en faisant part de mes réserves, et plus encore de mes désaccords avec les analyses de Gisèle Sapiro sur quelques-uns des auteurs et artistes que son livre convoque : de Michel Houllebecq à Bertrand Cantat, en passant par Martin Heidegger, Renaud Camus, Richard Millet, Roman Polanski, Gabriel Matzneff, Richard Wagner, Louis-Ferdinand Céline, Paul Gauguin.
Je ne me prononcerai pas sur des auteurs comme Maurras, Grass, De Man, Jauss, que je connais mal. En ce qui concerne Peter Handke, j’ai suivi de loin les polémiques sur ses prises de positions contestables lors des conflits de la fin du siècle dernier dans les pays de l’ex-Yougoslavie, ravivées plus récemment par l’attribution du prix Nobel de littérature qui lui a été décerné. Si j’apprécie l’œuvre littéraire de cet écrivain, il n’a pas à proprement parler « une tête politique ». Il s’est même fourvoyé en défendant des personnages indéfendables. Cependant, la manière dont certains rejettent l’écrivain, eu égard ces prises de positions malencontreuses, me semble excessive. Il y a irresponsabilité et irresponsabilité : celle de Handke en l’occurrence n’est pas la pire. Nous sommes bien d’accord.
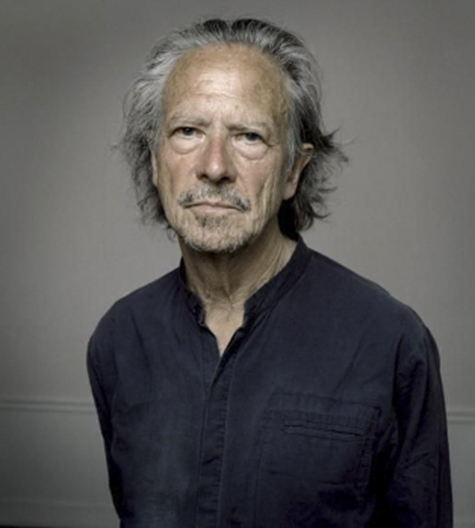
Michel Houellebecq a toujours cultivé une certaine ambiguïté. C’était flagrant lors de la parution en 2001 de Plateforme où ce sont ses propres déclarations publiques accompagnant la sortie de ce roman qui lui vaudront d’être poursuivi par des associations musulmanes. Houellebecq affirme publiquement ne pas être raciste et ne pas vouloir faire « d’amalgame entre arabes et musulmans ». Ceci pour répondre à des détracteurs qui, selon lui, confondent les propos tenus par les personnages de ses romans avec ceux qu’il tient en tant qu’écrivain par voie de presse. On peut en douter parce que certains de ces propos romanesques traduisent très exactement la pensée de l’auteur. Par exemple le fameux : « J’éprouvais un tressaillement d’enthousiasme chaque fois que j’apprenais le meurtre par balles d’un enfant ou d’une femme enceinte palestiniens ». Houellebecq joue de cette ambiguïté : c’est là son talent, diraient certains, ou bien sa perversité, penseraient d’autres. Dans un temps (celui de la rentrée littéraire 2001, au lendemain des attentats du 11-Septembre) où l’accusation de racisme restait dans le domaine strictement racial, Houellebecq remplaçait habilement le terme « arabe » par celui de « musulman » pour éviter de porter le flanc à l’accusation de racisme. Il convient de rappeler ici « la constance à toute épreuve » de l’écrivain, de Plateforme à Soumission. Ma réticence – pour user d’un euphémisme – se rapporte à l’association qu’in fine Gisèle Sapiro fait entre Houellebecq et Polanski, arguant d’une stratégie comparable dans les deux cas. Le lecteur a comme l’impression que les cinq pages pertinentes qu’elle vient de consacrer à Houellebecq avaient principalement pour objet de délivrer cet improbable constat.

En ce qui concerne Martin Heidegger, mes réserves portent d’abord sur les analyses – reprises par l’auteure – de Peter Trawny au sujet des Cahiers noirs. Parce que cette lecture ne révèle nullement une quelconque « prise de distance et une critique du national-socialisme » de Heidegger lors de sa démission du poste de recteur de l’Université de Fribourg. Trawny tente (certes, il n’est pas le seul) de sauver malgré tout Heidegger. Par exemple, chez ce dernier, la mention d’un « antisémitisme inscrit dans l’histoire de l’être » s’opposerait au « racisme biologique » des nazis. Cette façon de dédouaner le philosophe n’est rien moins que retorse. Comme le révèlent les séminaires alors inédits des années trente et quarante analysés par Emmanuel Faye, Heidegger « apporte au racisme la caution la plus radicale que l’on puisse trouver […], ce n’est plus le droit ni la médecine, mais bien la philosophie elle-même qui se trouve récupérée, dévoyée et détruit par cette utilisation monstrueuse du terme « métaphysique » ».

Plus loin, Gisèle Sapiro rectifie le tir en discutant ce que Trawny appelle chez Heidegger « erreur », « égarement » ou « errance ». Pourtant, si l’on partage ici son analyse, son raisonnement s’en vient ensuite buter au moment de conclure contre ce qui apparait alors comme l’impensé de ce chapitre sur Heidegger. Puisqu’on nous incite à « plutôt s’interroger sur ce que les Cahiers noirs révèlent de l’inconscient épistémique d’une discipline profondément marquée par l’oeuvre gigantesque du philosophe ». Tout ça pour ça ! L’adjectif, là souligné, apporte la preuve que malgré tout ce qu’on peut reprocher à l’homme Heidegger, son oeuvre n’en reste pas moins « gigantesque ». Une pensée qui s’est identifiée en grande partie avec ce qu’il y a de pire au XXe siècle ne saurait avoir la « grandeur » que des heideggeriens déclarés ou contrits persistent à vouloir lui prêter. Emmanuel Faye, dans plusieurs livres (dont son essentiel Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie), et Thomas Bernhard sur un plan satirique (dans Maîtres anciens) ont dit ce qu’il fallait en penser.
Avec des écrivains comme Renaud Camus et Richard Millet, le désaccord porte – pour le premier comme pour le second – sur l’interprétation de leurs « affaires » respectives (en 2000 pour Camus, et 2012 pour Millet). Associant ces deux écrivains, Gisèle Sapiro écrit que leur évolution, « liée à une trajectoire littéraire déclinante », s’inscrit dans le registre de « la provocation » (« stratégie visant à maintenir leurs positions dans un champ en transformation »). Si l’hypothèse reste recevable avec Millet, elle s’avère infondée en ce qui concerne Camus (qui écrivait en 1999 dans Etc : « De tous les reproches qui lui sont faits, celui qui l’agace le plus, et qui lui paraît le plus injuste, et le plus abusif de ceux qui le formulent, c‘est celui de provocation »). De toute façon, c’est mal connaître cet écrivain que de lui prêter pareille stratégie. Gisèle Sapiro connaît bien les dossiers des deux affaires en question, mais semble ignorer l’oeuvre de Millet comme celle de Camus. En cela, elle ne se distingue nullement de la grande majorité de ceux qui se sont positionnés contre Camus en 2000, et Millet en 2012. Dans le cas de Renaud Camus d’ailleurs, sa trajectoire n’était pas à proprement parler « déclinante » en 2000. Rappelons ainsi que Camus a très sensiblement évolué depuis 2002 vers un positionnement qui le classe aujourd’hui indiscutablement à l’extrême droite, voire à l’ultradroite (même si sur certains aspects, il s’en distingue). J’ajoute que dans le milieu de la « fachosphère », Renaud Camus n’a pas que des amis : son passé « sulfureux » ne passant toujours pas.

J’en viens à « l’affaire Renaud Camus » elle-même. Le commentaire de Gisèle Sapiro reprend les grandes lignes de ce qu’on a pu lire à l’époque dans la plupart des médias. Je regrette que cet emballement médiatique n’ait ensuite pas fait l’objet d’analyses rétrospectives convaincantes. J’imagine que l’évolution de l’auteur vers l’extrême droite et l’écho rencontré par ses théorisations sur « le grand remplacement » et « la remigration » en portent principalement la responsabilité. C’est dommage parce que, depuis, une analyse objective et dépassionnée de cette « affaire » aurait pu apporter de nombreux enseignements. Le paradoxe étant que la contribution la plus pertinente sur « l’affaire Renaud Camus » provenait de l’auteur lui-même dans maintes pages de l’ouvrage Du sens (publié en 2002). Un livre malheureusement peu commenté lors de sa sortie, sinon de manière biaisée. Selon toute vraisemblance, Gisèle Sapiro ignore son existence alors que le propos de Du sens n’est pas sans recouper quelques-unes des thématiques traitées dans ses ouvrages depuis de nombreuses années comme, par exemple, la responsabilité de l’auteur dans les pages d’un « journal d’écrivain ». C’est même le seul point sur lequel Camus et quelques-uns de ses accusateurs puissent s’accorder : notre écrivain précisant que « la responsabilité de l’auteur d’un journal répond à celle du lecteur, qui implique qu’il tienne compte de la nature de ce qu’il lit, et fasse soigneusement la distinction entre le statut de sens d’une phrase ici et là ».
Avant la dite « affaire Renaud Camus », cet écrivain confidentiel (du point de vue de son lectorat) ne laissait pas pour autant indifférents les « pros » de la profession : certains ne prisant guère (dans ce Journal publié chaque année) les passages où l’écrivain décrivait le détail de ses relations homosexuelles. Pourtant, cet aspect paraissait secondaire en comparaison de la manière dont Camus, depuis une analyse de « l’état du français contemporain tel qu’on le parle et l’écrit aujourd’hui », prenait principalement comme cible les journalistes et les intellectuels médiatiques (son Journal mentionnant mains aspects d’une certaine « débilité journalistique »). Donc, sans aborder les divers aspects de l’oeuvre protéiforme de l’écrivain dans le dernier quart du XXe siècle où le « stimulant » (en plus de ce qui vient d’être évoqué, citons un tropisme topographique, des analyses sur l’évolution du goût petit bourgeois, d’autres sur la question de l’emploi, l’art contemporain, la culture, etc.) le disputait au « discutable » (une réflexion autour du concept de civilisation, de l’affirmation d’une position cratyliste, un penchant pour la francité, voire une défense de l’inégalité), Renaud Camus, depuis ce qui a été plus haut souligné, indisposait un certain nombre de journalistes et de médiatiques, et plus particulièrement de critiques littéraires.
Car, comment expliquer le retentissement de cette « affaire » alors que cet écrivain plutôt confidentiel était totalement ignoré du grand public ? Gisèle Sapiro le met sur le compte de l’antisémitisme de l’auteur. Pourtant, je pourrais citer plusieurs écrivains et artistes davantage connus que Camus, au sujet desquels des révélations ou des accusations d’antisémitisme durant la seconde moitié du XXe siècle n’avaient nullement provoqué pareil emballement médiatique, même de très loin. Pour revenir au printemps 2000, le quotidien Le Monde – deux mois après le début de « l’affaire Renaud Camus » – reconnaissait ainsi, par la voix de son médiateur, avoir publié une quarantaine de contributions (articles, tribunes, pétitions, lettres de lecteurs) sur la dite « affaire » : une recension très majoritairement défavorable à Camus, il va sans dire. Il y avait pourtant de quoi s’étonner devant une telle couverture journalistique : surtout de la part d’un périodique dit « de référence » qui avait d’autres chats à fouetter ou de sujets à traiter. À croire que le tout puissant directeur de la rédaction de l’époque en faisait une question personnelle…
Cette campagne était née, on le sait, dans les lendemains de la publication par Renaud Camus de son Journal de l’année 1994. Provoquée à l’origine par une « petite phrase » de l’écrivain concernant les collaborateurs de l’émission Le Panorama de France Culture, ce propos, certes malencontreux, se révélait être – replacé dans son contexte – la réponse maladroite et vindicative de Camus à une sévère critique dont il venait de faire l’objet dans cette même émission. Par ailleurs, le propos de Renaud Camus traduisait une réalité : le fait, incontestable (tout auditeur de bonne foi du Panorama en 1994 pourrait en témoigner), que la place réservée aux questions traitant de la judéité, du judaïsme, et plus encore de la Shoah, s’avérait plus importantes que d’autres durant les années 1990, dans cette émission précisément. Il est vrai que Camus le rapportait sur un mode déplaisant, dont l’interprétation pouvait donner libre court à l’accusation d’antisémitisme. Ce qu’on n’a pas manqué de faire en isolant la « petite phrase ». Pourtant, pour ceux qui connaissaient en 2000 les écrits de Renaud Camus, son Journal, mais également ses romans et nombreux essais, l’accusation d’antisémitisme paraissait infondée au regard de plusieurs témoignages de ce même journal, lesquels ne pouvaient que s’inscrire en faux contre une telle accusation. Ce serait fastidieux de vouloir tous les citer, mais l’un d’entre eux, quatre ans plus tôt, relatif à ce que l’écrivain rapportait lors de sa participation à la manifestation de protestation au lendemain de l’ignoble profanation du cimetière juif de Carpentras, l’illustre très exactement. En une dizaine de lignes, Camus dit l’essentiel de ce qu’il faut en penser, sur le ton qui convient, sans pathos inutile.
Et puis, au moment où éclatait « l’affaire Renaud Camus », l’écrivain publiait Nigthsound, suivi de Six Players, un livre passé totalement inaperçu : une belle méditation sur l’art et la Shoah. D’aucuns, parce qu’on leur avait mis sous le nez des extraits du Journal allant dans ce sens, prétendront que les propos philosémites de Camus constituaient la preuve par excellence de son antisémitisme ! Le principal reproche que l’on pouvait alors adresser à l’écrivain étant de penser que l’on devrait s’autoriser d’une liberté de parole envers tous les sujets traités. Il eut tort de croire que l’on pouvait, par exemple, le faire dans les termes de ceux de Nietzsche (pour citer un philosophe exempt de toute accusation d’antisémitisme) dont l’oeuvre comporte des fragments qui, lus sans donner le nom de l’auteur, pourraient être considérés « antisémites ». Depuis la Seconde Guerre mondiale, en se référant à l’extermination des juifs (« Le plus grand crime de l’histoire de l’humanité », écrit Renaud Camus), la liberté de parole que l’on s’autorisait jadis, à la manière d’un Nietzsche, risque d’être entendue sur un mode équivoque, y compris par des personnes de bonne foi.
Gisèle Sapiro cite la tribune « Déclaration des hôtes-trop-nombreux-de-la-France-de souche » publiée par Le Monde (certainement rédigée par Lanzmann et Roudinesco), contresignée par quelques-uns de nos intellectuels les plus en vue. Je ne voudrais pas trop m’attarder sur cette « affaire Renaud Camus », mais je pourrais mettre le texte de cette tribune pétitionnaire à l’épreuve de la grille de lecture proposée par Michel Foucault dans son article « Les monstruosités de la critique » (1971). Nous nous trouvons confrontés avec cette tribune aux « quatre méthodes traditionnelles de transformation (la falsification du texte, le découpage ou la citation hors contexte, l’interpolation et l’omission) » obéissant « aux mêmes lois (l’ignorance du livre, l’ignorance de ce dont ils parlent, l’ignorance des faits et des textes qu’ils réfutent) ».

Comment, d’emblée, Gisèle Sapiro peut-elle écrire que Richard Millet est « l’auteur de romans assez confidentiels » puisque certains d’entre-eux (en se limitant à La Gloire des Pythre, Ma vie parmi les ombres, L’Amour des trois soeurs Piale, voire le problématique La Confession négative) ont contribué à placer Richard Millet parmi les meilleurs écrivains de sa génération, surtout dans le domaine romanesque ? À croire qu’elle ne s’est intéressée à leur auteur qu’à l’occasion de « l’affaire Richard Millet ». Le « confidentiel » se rapporte davantage aux essais (ou aux pamphlets) – la source romanesque étant semble-t-il tarie – que Millet a publié à partir de 2006. Un « confidentiel » à la mesure d’un lectorat sensiblement plus modeste, que l’on pourrait cependant récuser si l’on se place du point de vue de la réception critique de ces essais, toute négative soit-elle en règle générale. Richard Millet, pour le mieux, y traite de questions littéraires récurrentes chez lui (à l’instar de Place des pensées, consacré à Blanchot, ou de L’Enfer du roman), et pour le pire, y ressasse ou recycle quelques-unes de ses obsessions (autour de la francité, du multiculturalisme, de la déculturation, etc.): Millet renchérissant davantage d’une publication à l’autre dans le registre xénophobe.
Les pages que notre sociologue consacre à cet écrivain portent principalement sur ce qu’on a appelé « l’affaire Richard Millet », suite à la publication en 2012 par cet auteur de Langue fantôme suivi de Éloge littéraire d’Anders Breivik : ce dernier texte, qui ne comporte qu’une quinzaine de pages, étant à l’origine du scandale. Ici, contrairement à Renaud Camus, la provocation est avérée. On relèvera que Millet devenait au fil des ans, un auteur de moins en moins « fréquentable » pour la critique littéraire. Ce qui d’une certaine façon alimentait le masochisme de l’écrivain, bien pourvu de ce côté-là. Pourtant, lors de la rentrée littéraire 2012, un seuil avait été franchi. Je ne m’attarderai pas sur cet Éloge qui n’en vaut pas la peine. La provocation paraît trop manifeste pour qu’on puisse s’en offusquer, du moins de la manière indignée dont de nombreux commentateurs ont reçu cette quinzaine de pages. M’intéresse davantage ce que Sapiro analyse depuis les protestations de Le Clézio (qui reprends maints griefs exprimés à l’égard de Millet) et d’Annie Ernaux. Au sujet de cette dernière, nos analyses divergent sensiblement. Je rappelle qu’Annie Ernaux publiait dans Le Monde du 10 septembre 2012 une tribune intitulée « Le pamphlet fasciste de Richard Millet déshonore la littérature » : un article contresigné par 118 écrivains (excusez du peu !).
Il s’agit incontestablement du point d’orgue de cette « affaire Richard Millet ». Annie Ernaux est une écrivaine estimable, mais son article ne rend pas justice aux qualités que l’on peut reconnaître à son oeuvre littéraire. Elle a tout à fait le droit de s’indigner du contenu du pamphlet de Millet, indignation que l’on peut comprendre, voire partager. Tout comme il va également de soi qu’Annie Ernaux ne saurait souscrire au constat sans appel de Richard Millet sur la littérature contemporaine, déclaré par lui « nullisime ». En revanche, paradoxalement sur le terrain où Millet s’avère le plus critiquable (alors que ses critiques envers la littérature contemporaine sont en partie justifiées), Annie Ernaux se trompe de cible ou de cause. Écrire que le pamphlet de Richard Millet est « un texte porteur de menaces pour la cohésion sociale », ou « un acte politique à visée destructrice des valeurs qui fondent la démocratie », ou encore qu’il « déshonore la littérature » paraît tellement disproportionné (ou hors sujet) au regard de ce dont il vient d’être question, que le mot « ridicule » vient naturellement sous la plume. En tout état de cause, pour l’élargir aux critiques généralement adressées à l’auteur de Ma vie parmi les ombres, c’est vouloir se fabriquer un ennemi à très bon compte. On savait que Richard Millet n’avait pas plus que Peter Handke une « tête politique », mais il en irait de même avec Annie Ernaux (pourtant fervente lectrice de Bourdieu comme chacun le sait) sur un mode différent. Comment la prendre au sérieux quand elle va presque jusqu’à qualifier Millet d’ennemi politique n°1! L’indignation de Richard Millet (qui s’indigne en permanence contre tout ce qui l’insupporte dans ce monde) l’entraine à dresser un tableau du monde contemporain un rien paranoïaque. Alors que l’indignation d’Annie Ernaux (contre la nature de celles de Millet) la conduit à écrire des niaiseries.
Dans les premières lignes de sa tribune, Annie Ernaux indique que Richard Millet est éditeur chez Gallimard. Pourquoi le mentionne-t-elle ? Quel rapport avec l’indignation qui suit ? Plus loin, elle y répond en s’interrogeant sur « la responsabilité de son auteur au sein d’une maison d’édition ». Une phrase lourde de conséquences. Ici, nous sortons du terrain très légitime de la critique des idées et de la pensée d’un auteur pour nous aventurer sur celui, plus problématique, qui consiste à s’adresser indirectement à un employeur, éditeur en l’occurrence, pour l’inciter à se débarrasser d’un collaborateur « mal pensant ». C’est un aspect pour le moins inattendu de cette « responsabilité », au sujet de laquelle j’aurais aimé entendre Gisèle Sapiro (auteure de plusieurs livres sur la responsabilité des écrivains et des intellectuels). Justifie-t-elle ici l’attitude dénonciatrice d’Annie Ernaux ? Car, en appelant un chat un chat, en demandant ainsi (et les 118 signataires avec elle) la tête d’un directeur de collection des Éditions Gallimard, c’est répondre à l’abjection, celle des mots, de la pensée, voire du sens, par une abjection d’un tout autre type, par ce qui relève non pas de la critique, mais de la dénonciation : cette dernière, forte de son bon droit, de sa légitimité, de la loi du nombre, voire de l’esprit de meute (« Messieurs dans le lit de la marquise / C’était moi les cent dix huit chasseurs / La la la, la la la »).
J’ignore comment Le Monde a contacté si rapidement la centaine d’écrivains ayant contresigné le texte d’Annie Ernaux. En tout état de cause, l’opération a bien fonctionné eu égard la notoriété de plusieurs signataires. On peut aussi supposer qu’un nombre non négligeable d’écrivains sollicités ont décliné l’invitation. Et que d’autres, à l’instar de Pierre Jourde (auteur d’un article nuancé : « Pourquoi je n’aurais pas signé le texte d’Annie Ernaux ») n’ont pas été contactés. À consulter cette liste de 118 signataires, je regrette d’y trouver certains noms (celui de Franck Venaille en premier lieu, mais également ceux de Bruce Bégout, François Bon, Arlette Farge, Dan Franck, JMG Le Clézio, Gérard Mordillat, Bernard Noël, Gérard Macé, Éric Marty, Christian Prigent, François Rastier, Bernard Desportes, Denis Roche, Lydie Salvayre). Quant au reste la moitié des noms me sont inconnus. Pierre Assouline a reconnu, parmi les signataires, « l’habituelle cohorte de médiocres du petit monde littéraire » ainsi que « les ennemis chroniques de Gallimard ». Je veux bien le croire. Il n’en est pas moins fâcheux de trouver les noms d’écrivains « estimables ». Dans quelle mesure ceux-ci ne se sont-ils pas leurrés sur ce qu’on leur présentait ? Ont-ils véritablement lu l’article d’Annie Ernaux ? Quand elle affirme que ne pas intervenir sur Richard Millet, « c’est prendre le risque de se mépriser soi-même plus tard. Parce qu’on l’a lu », on a d’abord envie de lui répondre que, après tout, c’est son problème. Prendre au pied de la lettre pareille affirmation, et quelques autres du même registre dans l’article, signifie – pour parler clairement – que Richard Millet serait le premier fasciste de France. Ce qui est grotesque. Et pourtant ça marche : 118 collègues l’ont ratifié.
Quels enseignements tirer de cette « affaire » ? On peut bien sûr ne pas trouver à son goût, sinon plus, cet indéfendable Éloge d’Anders Breivik qui, je ne vais pas y revenir, ne méritait pas pareils excès d’indignation. Et surtout, paraissaient disproportionnées les réactions suscitées par cette publication et leurs conséquences. Ce sont les idées xénophobes de Richard Millet et consort qu’il faut combattre et contre lesquelles il importe de réagir. Mais, à vrai dire, il faudrait avec lui plutôt parler d’obsessions que d’idées… Ce qui n’est pas tout à fait la même chose. D’autant plus que Millet ne représente que lui, échappe à tout classement de type politique qui le rangerait parmi les écrivains d’extrême droite. Son cas s’avère plus complexe que le croient tous ceux, ses contempteurs, qui très souvent ne l’ont pas lu. Et puis, pour parachever le tableau, il convient d’évoquer quelque « haine de soi » chez Millet qui n’est, après tout, que l’envers de cette haine dont l’auteur abreuve ses contemporains. La première n’excuse pas la seconde, mais devrait contribuer à replacer cette haine-là dans de plus justes proportions.
On en vient à se demander, en regard du tableau très critique que Millet brosse de la littérature contemporaine, si la qualification d’écrivain « xénophobe » ou « fasciste » ne serait pas, d’une certaine manière, l’arbre qui cache la forêt. C’est là une façon commode de s’en prendre à un écrivain sans évoquer ce qui se rapporte plus décisivement à la littérature. Et là, il faut bien avouer que le propos de Richard Millet n’est pas sans contredire les qualificatifs mentionnés plus haut. Quand par exemple Millet remet en cause la supériorité du roman anglo-saxon dans la littérature mondiale. Mais surtout, lorsque l’écrivain dénonce la scénarisation d’une partie de la production romanesque, et son processus de marchandisation (« il s’agit moins de promouvoir des oeuvres que de manipuler des codes extra-littéraires pour conquérir un marché »). Richard Millet force un peu le trait quand il s’agit d’écrivains français contemporains. Mais comment, plus en amont, ne pas relever l’adéquation entre l’exigence littéraire revendiquée (au prix de quelques excès) et la manière de l’illustrer en convoquant les noms d’un « panthéon littéraire » qui sont indiscutablement ceux que la littérature mondiale a produit pour le mieux depuis deux siècles ? J’y ajouterai juste Elfriede Jelinek, pas trop appréciée par Millet pour des raisons peu compréhensibles, sinon « la haine anticatholique » de Jelinek.
Finalement, le plus troublant de « l’affaire Richard Millet » ne réside-t-il pas dans l’accord implicite, autre paradoxe, entre Millet et ses contempteurs ? Le premier en rêvait, les seconds se sont efforcés de le confirmer à grand renfort de publicité : Richard Millet se trouvant promu en 2012 au rang de « plus détesté des écrivains ». Le masochisme de Millet, brûlant tous ses vaisseaux avec une délectation plus allègre que morose, faisait appel d’offre : d’aucuns, parmi ses ennemis déclarés, y répondront sur le mode sadique. Pourtant, l’aspect un rien provocateur des propos incriminés aurait dû inciter les « pros » de la profession a faire preuve de plus de circonspection. Le milieu littéraire a-t-il donc besoin d’ennemis de la facture de Richard Millet pour se rassurer ainsi à bon compte ? Ses représentants disent l’exprimer au nom de ce qu’ils nomment « la littérature » : le ridicule et grandiloquent « Richard Millet déshonore la littérature » d’Annie Ernaux. La littérature en a vu d’autres ! Et puis, disons le sans fard, quitte à reprendre ce verbe galvaudé, elle « s’honore » plus de compter Millet parmi ses hérauts que la grande majorité des écrivains ayant contresigné le texte d’Annie Ernaux.
Des plumitifs, certes, ont déclaré derechef que ce Richard Millet était en définitive un écrivain bien médiocre (ce qu’on peut à la rigueur accepter de ceux qui ignoreraient l’oeuvre romanesque de l’écrivain, mais pas de ceux qui la connaissent). En revanche, on reconnaîtra que, après 2012 – le blog alors ouvert par l’écrivain en témoigne -, Millet enfonçait de billet en billet un clou réactionnaire qui, non pas indisposait (nous étions en terrain connu, malheureusement trop connu, avec en plus une haine et un ressentiment qui n’appartiennent qu’à l’auteur), mais dont le côté répétitif, voire obsessionnel, finissait par susciter l’ennui.

Avant d’en venir à l’essentiel avec Roman Polanski (la dissociation ou pas, entre l’homme et son oeuvre), j’aimerais revenir sur l’interprétation par Gisèle Sapiro d’un extrait du dossier de presse de J’accuse. Qu’imagine-t-elle que Polanski puisse répondre à la question posé par Pascal Bruckner en ces termes : « En tant que juif pourchassé pendant la guerre, que cinéaste persécuté par les staliniens en Pologne, survivez-vous au maccarthysme néoféministe aujourd’hui ? ». Autant la question s’avère outrancière, polémique, orientée, autant la réponse (« Il y a des moments de l’histoire que j’ai vécus moi-même, j’ai subi la même détermination à dénigrer mes actions et à me condamner pour des choses que je n’ai pas faites ») paraît relativement mesurée. Quand Gisèle Sapiro évoque « le caractère scandaleux de ce rapprochement entre la fausse accusation de trahison dont le capitaine Dreyfus fut victime et les actes de violences avérés contre une mineure pour lesquels le réalisateur a été condamné », cela ne rend pas justice au propos de Polanski qui n’a jamais nié ces « actes de violences » remontant à 1977. Puisqu’elle ne cite pas d’autres extraits de cet entretien, c’est lui faire un faux procès. Ce que Gisèle Sapiro reproche à Polanski a moins été exprimé par le cinéaste que par Bruckner. D’ailleurs, elle mentionne l’extrait d’un article de l’essayiste dans le magazine Le Point où Bruckner renchérit sur son propos du dossier de presse, entre autre, à travers l’aversion que lui inspire le féminisme. Polanski n’est principalement pour lui qu’un prétexte. Et puis, le « rapprochement » en question renvoie par la bande à une version inédite de la concurrence entre les victimes. Je m’empresse d’ajouter qu’avoir été une victime ne vaut pas comme justificatif de ce qui s’ensuit.
Polanski a pu, le cas échéant, se référer à ses démêlés judiciaires outre-Atlantique, mais ce qu’il a exprimé sur J’accuse, de manière constante, tient dans la déclaration suivante (que Gisèle Sapiro ne cite pas) : « Je ne parlerai pas d’une identification, ou alors dans un sens assez général. L’essentiel de cette affaire c’est quoi ? Le refus d’une institution, l’armée en l’occurrence, de reconnaître son erreur, et son obstination à s’enfoncer dans le déni en produisant des fausses preuves. Moi je connais ça, même si ce n’est pas l’armée ». Un propos évidemment inacceptable pour qui ne doute pas un seul instant de la véracité des accusations de viols portées contre le cinéaste depuis 2017. En revanche, si le doute est permis, on peut juste reprocher au cinéaste, non pas de s’identifier à Dreyfus comme ses accusateurs le martèlent, mais de s’être laissé aller (même dans un autre registre) à une analogie n’ayant rien de scandaleux ni de répréhensible, mais qui dans le contexte particulier de la sortie de J’accuse pouvait paraître déplacée.
Gisèle Sapiro use sans modération de la litote pour présenter le fait suivant. Je la cite : « Si l’établissement public territorial Est-Ensemble de la Seine-Saint-Denis a envisagé un temps de déprogrammer le film de Polanski J’accuse, cette opinion a été écartée au profit d’un débat ». Comme ces choses-là sont dites ! Alors que, d’ordinaire, les demandes d’interdiction de films en France émanaient jusqu’à présent de municipalités de droite ou d’associations catholiques, pour la première fois, des élus de gauche (la maire PS de Bondy, et l’une des ses adjointes PCF) demandaient au président de cet établissement public de déprogrammer une oeuvre cinématographique. Ce dernier donnait un accord de principe, puis revenait sur sa décision devant les réactions négatives des programmateurs de salles de cinéma, dont celle de Stéphane Goudet (le directeur du Méliès à Montreuil) déclarant excellemment : « Nous demandons dès à présent à nos élus la liste des cinéastes dont nous n’aurons plus le droit de programmer les films et la définition de leurs critères. Un comité de vérification de la moralité des artistes est-il prévu puisque la liberté individuelle des spectateurs n’est pas suffisante ? ». Quand Sylvie Badoux, la maire adjointe de Bondy, l’élue la plus en pointe pour déprogrammer J’accuse, répond que « ce n’est pas du contenu d’un film contre lequel nous nous insurgeons, mais de la personnalité d’un homme abject », elle ne sait pas à quel point elle aiguise les ciseaux de Dame Anastasie, puisque le critère ici retenu pourrait s’appliquer à quelques autres cinéastes renommés dont Clouzot, Woody Allen, Chaplin (il faut lire ou relire Hands off Love, une protestation en 1927 du groupe surréaliste envers la violente campagne de presse menée par des ligues de vertu américaines contre Chaplin). Et comme l’abjection des uns n’est pas nécessairement celle des autres, cette liste devrait sensiblement s’élargir selon d’autres critères : Dame Anastasie ne risque pas de se retrouver au chômage !
Sans pour autant reprendre de manière catégorique le point de vue des associations féministes (pour qui « Nous ne pouvons séparer l’homme de l’artiste »), Gisèle Sapiro laisse entendre que, même si le film J’accuse « ne présente aucune apologie de la pédocriminalité ou du viol » (merci de le préciser !), en revanche les récompenses attribuées à Polanski lors de la cérémonie des Césars pourraient, selon elle, « signifier la perpétuation de la méconnaissance collective d’abus de jeunes femmes dans le milieu du cinéma et donc l’octroi d’une forme d’impunité ». Cette argumentation serait recevable s’il y avait une relation de cause à effet entre le contenu de J’accuse et la nature des accusations portées contre Polanski. Pourtant, Gisèle Sapiro reconnaît qu’il n’en est rien. Elle prolonge son propos sur l’impunité dont bénéficieraient les cinéastes prédateurs par l’affirmation que « la reconnaissance artistique », la consécration d’un artiste, « risquent d’occulter […], voire de légitimer les violences faites aux femmes ». Tout d’abord cette « reconnaissance artistique » concernant Polanski ne date pas d’aujourd’hui, ni même d’hier, alors que les accusations portées contre lui sont plutôt récentes. Il se trouve que J’accuse (que je qualifierai de « film académique ») correspond à la catégorie de films répondant à des critères de césarisation. Ce que les « pros » de la profession avaliseront lors du vote. Et puis, cette année 2020 n’étant pas celle d’un « grand cru » dans le paysage du cinéma hexagonal, il n’y avait pas de quoi s’étonner de la sélection, puis du vote. Ensuite, est-ce vraiment la bonne cible ? Polanski n’est pas Weinstein à ma connaissance. En quoi son nom doit-il être associé à des « abus de jeunes femmes dans le milieu du cinéma » ? On a l’impression que Gisèle Sapiro a en tête « l’affaire Adèle Haenel ». Une fausse piste puisque personne, en dehors des milieux cinématographiques, ne connaissait l’existence de son cinéaste-prédateur. Il faudrait citer des noms avec Polanski. Le seul qui puisse être évoqué, celui de Samantha Geimer, renvoie à l’année 1977 : « violences » ou « abus » que Polanski avait alors reconnus, et pour lesquels il avait été condamné aux États-Unis.
Voulant dépasser « l’opposition entre liberté de l’art et censure morale », Gisèle Sapiro suggère que l’on devrait codifier « les métiers de la création » d’un point de vue déontologique à l’instar des médecins, avocats et enseignants. Mais quel serait en l’occurrence l’équivalent d’un serment d’Hippocrate pour les représentants de ces différents métiers ? Voilà du grain à moudre pour nos humoristes : les deux sexes y seraient-ils pareillement assujettis ? Gisèle Sapiro évoque ensuite les positions d’autorité d’un Polanski et d’un Ruggia qui leur auraient permis de commettre des actes répréhensibles. Mais ce sont tous les membres de la société en « positions d’autorité », de l’entreprise à la cellule familiale, qu’il faudrait alors doter de ce code déontologique que Gisèle Sapiro appelle de ses voeux.

Il importe, pour lui répondre sur le point essentiel, de distinguer l’homme du cinéaste : ce dernier ne peut se trouver réduit à ce dont on accuse l’homme. On a le droit de ne pas aimer son cinéma, de le critiquer sans ménagement, mais il est parfaitement saugrenu de demander, par exemple, l’annulation d’une rétrospective à la Cinémathèque d’un cinéaste au prétexte que l’homme fait l’objet d’accusations qui relèvent du judiciaire. Il s’agit, ni plus ni moins dans l’intention, d’un acte de censure. Cela n’a pas été concluant avec la rétrospective de Polanski malgré la pression des organisations féministes, mais en revanche celles-ci ont obtenu ce qu’elles demandaient avec le report, pour ne pas dire la suppression, de celle de Jean-Claude Brisseau : le « capital symbolique » du premier, pour parler comme Gisèle Sapiro, s’avérant supérieur à celui du second.
J’aimerais savoir ce que Gisèle Sapiro pense de l’intrusion d’un commando néoféministe dans une salle de cours à Paris 8 en février dernier. Ces militantes affirmaient qu’elles étaient là « pour empêcher la discussion » prévue ce jour-là sur J’accuse (dans le cadre d’un enseignement portant sur « les usages publics de l’histoire ») et qu‘elles ne quitteraient la salle que sous « cette condition ». L’enseignante, après une discussion avortée, dut se résoudre à abandonner la place. Dans un tract rédigé ensuite par ces militantes, on y lit que « étudier l’oeuvre » de Polanski, « c’est cautionner le réalisateur et cautionner l’impunité judiciaire et médiatique des hommes puissants dans une société patriarcale ». C’est affirmer de manière frontale et sur un ton catégorique ce que Gisèle Sapiro relève de façon plus mesurée et moins vindicative.
Je conclurai sur ce point que nous retrouvons là le sempiternel refus de séparer l’oeuvre de la personne de son auteur. De l’oeuvre en réalité, il n’est question puisque pour les contempteurs de Polanski, seules entrent en ligne de compte les considérations morales (pour ne pas dire moralisatrices) sur l’homme. Ensuite, il convient de rappeler – une fois de plus – que tout ce qui peut être reproché à l’homme Polanski relève du judiciaire. Quant au cinéaste, à condition de quitter l’anathème moralisateur pour privilégier l’analyse critique de son cinéma, il reste à prouver que son oeuvre serait explicitement, ou même implicitement, une apologie du viol et de la prédation masculine. Tout comme la soeur Anne du conte, pour l’instant je ne vois rien venir. En revanche, signalons que lors de la sortie en 1979 de Tess, Jean-Patrick Manchette, dans l’une de ses chroniques cinématographiques, qualifiait Polanski de « féministe » : en ce sens que les héroïnes de ses films « deviennent actives et dynamiques, bien plus que les mecs ».

Pour en venir à Gabriel Matzneff, Gisèle Sapiro se place d’emblée sur le terrain judiciaire : « Ses actes comme ses écrits constituent des infractions à la loi ». D’une part, la discussion paraît mal engagée puisqu’elle ne fait pas la distinction qui s’impose pourtant entre les uns et les autres. D’autre part, en évoquant précédemment l’oeuvre de cet écrivain comme « le récit autosatisfait de ses exploits sexuels avec des enfants », une différence mériterait ici d’être faite entre les textes qui se rapportent au tourisme sexuel (là il s’agit incontestablement d’enfants), et ceux où Matzneff évoque ses relations, entre autres sexuelles, avec des adolescentes. Il semble préférable pour bien savoir de quoi l’on parle, d’opérer cette distinction.
Certes, Gisèle Sapiro n’est pas critique littéraire, mais affirmer que les récits de Matzneff « n’ont de littéraire que la prétention » paraît peu pertinent. Je ne me souviens pas que, dans ses livres précédents (qui convoquaient de très nombreux écrivains, dont certains peu recommandables), Gisèle Sapiro se soit exprimée en ces termes. Sans être à proprement parler un lecteur de Matzneff (dont je n’ai lu que deux ouvrages vers la fin des années 1970), je lui avais trouvé, me semble-t-il, quelques qualités de styliste. Ce qui n’avait rien de bien original : la majorité des commentateurs ne pensaient pas différemment de l’écrivain. Ce que Gisèle Sapiro appelle « prétention » doit certainement se rapporter à l’indiscutable narcissisme de Gabriel Matzneff. Mais elle n’est pas sans savoir que de très nombreux écrivains en sont pourvus, ce qui ne préjuge pas que leur oeuvre en soit affectée.
Venons-en à cette impunité dont Matzneff aurait bénéficié depuis plusieurs décennies (dans « un monde médiatico-littéraire très masculin »). Les faits qui l’accréditent sont aujourd’hui bien documentés : y compris à travers cette « chute de la maison Matzneff » amorcée vers la fin du siècle dernier, et durant laquelle cet écrivain, quasiment privé de lectorat, ne survivait sur le plan littéraire qu’à la faveur de ses amitiés germanopratines. Gisèle Sapiro donne le détail de ces complicités. Comme je l’ai lu ailleurs, ce sont d’autres pages sur Matzneff qui attirent l’attention. En particulier lorsque Gisèle Sapiro indique que des personnalités du « monde médiatico-littéraire » entendraient malgré tout défendre cet écrivain. Elle cite Pierre Jourde qui ne peut se résoudre à confondre chez Matzneff les actes et l’oeuvre (sans pour autant se prononcer en faveur de cette dernière), seule attitude susceptible d’éviter le recours à la censure, notamment celle, dans le cas présent, de Gallimard décidant de ne plus publier le Journal de Matzneff. La littérature, précise Jourde, élargit la connaissance que nous avons du monde, y compris à travers ce que celui-ci aurait de peu aimable : « Interdire, censurer au nom du Bien et de la Morale, c’est en effet ce vers quoi tendent certains groupes de pression liberticides ». Gisèle Sapiro ne répond pas directement au propos de Jourde : elle se contente de commenter la décision de Gallimard, justifiée selon elle pour des raisons éthiques (lesquelles ont beau dos si l’on se souvient du climat de cette « affaire Matzneff-Springora » et des pressions qui s’exerçaient alors sur l’éditeur). En notifiant que « la souffrance exprimée par Mme Vanessa Springora dans Le Consentement fait entendre une parole dont la force justifie cette mesure exceptionnelle », Gallimard adopte un profil bas qui s’explique, nous sommes au moins d’accord là-dessus, par le fait « qu’il s’expose à une interdiction si ces livres sont reconnus comme une apologie de la pédocriminalité ». Mais ne parlons pas de censure, affirme Gisèle Sapiro, comme si « censure » devenait un gros mot envers tout écrivain qualifié de pédocriminel !
Il y aurait beaucoup à dire sur le contenu de ce Consentement et la nature d’un pareil succès de librairie. Mais comme Gisèle Sapiro n’en parle pas suffisamment, il est difficile d’en débattre davantage. Elle se réfère surtout à l’historienne Laure Murat qui, dans Le Monde propose de faire « le procès de la complicité de l’intelligentsia », et à travers lui, « le procès du ministère de la Culture » assorti d’un « examen de conscience de la société toute entière ». Remarquons que Laure Murat – comme d’autres – ne se livre à ce genre de surenchère que dans le cas particulier de Gabriel Matzneff, ou celui plus général des affaires de pédophilie, voire depuis « la violence d’un système » de prédation masculine. Parce qu’en dehors de qui l’indigne dans le cas présent, ce « procès de la complicité de l’intelligentsia » reste aux abonnés absents. Pour Laure Murat, il existerait une « bonne » intelligentsia (féministe, antiraciste, LGBT…), plutôt américaine, et une autre : celle dont elle fait le procès. Dans un entretien à Télérama, Laure Murat s’étonne qu’une femme puisse ne pas se sentir traumatisée si on lui a pincé les fesses dans un bus à quinze ans. Par contre le hashtag « balance ton porc » (la réaction « à une rage longtemps contenue »), n’est pas sans provoquer une « certaine jubilation », dit-elle. Quant au « puritanisme américain », il n’existerait que dans l’imagination des européens. Pour Laure Murat, les accusations portées contre les féministes de vouloir moraliser l’art, et plus encore de vouloir le censurer, sont nulles et non avenues. Pourtant, comme elle revient trop souvent d’un entretien à l’autre, sur ce déni-là, c’est le doute plus que la persuasion qui finit par prendre le dessus dans l’esprit du lecteur. Je ne me suis attardé sur Laure Murat que parce que Gisèle Sapiro la remercie à la fin de son ouvrage « pour sa relecture intégrale de cet essai et ses riches commentaires ». D’où le soupçon que plusieurs passages discutables de Peut-on dissocier l’oeuvre de l’auteur ? aient été inspirés par une telle lectrice…

Gisèle Sapiro consacre moins de place à d’autres auteurs dans son ouvrage, sinon encore à Richard Wagner en reprenant la thèse de Jean-Jacques Nattiez dans Wagner antisémite. Signalons que Nattiez fut, dans le dernier quart du XXe siècle, un fervent wagnérien. Ce genre de retournement aurait mérité d’être mieux analysé car c’est là l’un des points aveugles de son livre. Comment ne pas reconnaître que cet adepte d’une cause longtemps défendue, s’est retourné contre elle en 2015 avec la foi d’un nouveau converti ? Nattiez à plusieurs reprises sollicite le texte wagnérien pour lui faire dire ce que ses nouvelles convictions croient y trouver. Comment également ne pas relever que la manière obsessionnelle chez Nattiez, et quelques autres (dans le monde anglo-saxon), de vouloir d’un opéra à l’autre, apporter la preuve de l’antisémitisme de Wagner, ressemble à l’attitude de ces négationnistes qui cherchent de manière non moins obsessionnelle à prouver l’excellence de leur thèse, à savoir la négation de l’extermination des juifs d’Europe ? Il n’est nullement question de nier l’antisémitisme de Wagner, mais de le replacer dans de plus justes proportions. Par exemple, la lecture de la monumentale correspondance entre Wagner et Liszt (et des documents s’y rapportant) confirme, si besoin en était, que l’antisémitisme n’occupe qu’une place marginale dans les préoccupations de Richard Wagner.

Le cas Louis-Ferdinand Céline mériterait un long développement. Je m’en tiendrai à ce que Gisèle Sapiro en écrit. Ses pamphlets sont indiscutablement antisémites, et il n’y a pas lieu de les « métaphoriser » comme le proposait Gide pour Bagatelles pour un massacre. Cependant, pour replacer cette « étrange Association israélite pour la réconciliation des français » dans le contexte du « procès Céline » de l’après-guerre (cette association étant intervenu en faveur de l’écrivain), Gisèle Sapiro semble ignorer – tout comme la quasi totalité des commentateurs – que Céline, lors de son exil danois, s’est évertué à défendre des positions philosémites sur le même ton de conviction qui était le sien durant ses années d’antisémitisme forcené. Là, ce sont les aryens qui en prenaient pour leur grade. Ce que l’on pourrait trop rapidement penser être dicté par la nécessité de la défense judiciaire de Céline ne l’était pas à l’origine. C’est seulement dans un second temps que cette défense prendra ce nouvel élément en considération (l’anti-antisémitisme de l’écrivain étant auparavant revendiqué dans des lettres à divers correspondants). Avec Céline ce qui est odieux reste odieux. Mais la « question Céline » ne saurait se trouver réduite à ce Gisèle Sapiro en dit. Du moins pour qui entendrait prendre acte de la vertigineuse réversibilité qui vient d’être évoquée.

Dans les pages consacrées à Bertrand Cantat, Gisèle Sapiro se contente de reprendre l’argumentation des organisations néoféministes. À travers l’exemple « des politiciens condamnés pour crimes et délits » voyant « leur peine assortie d’une période d’inéligibilité » les privant de toute parole publique, l’association Osez le féminisme ! oublie de préciser que les dits « politiciens » sont en réalité des élus. C’est à ce titre que leur condamnation peut inclure une peine d’inéligibilité. Donc, la comparaison avec Cantat, envers qui la peine devrait également être assortie d’une mesure « d’interdiction de se produire en public » lors de sa sortie de prison, s’avère sans objet. Que Bertrand Cantat puisse continuer à exercer son métier une fois sa peine purgée n’encourage en rien le féminicide, ni ne transforme les spectateurs venus entendre le chanteur en complices d’un meurtrier. Il est regrettable que Gisèle Sapiro accrédite ce positionnement d’Osez le féminisme ! qui paraît plus dicté par le ressentiment que par une quelconque exigence morale. Il aurait été plus opportun, pour faire bonne mesure, de citer les propos que Virginie Despentes avait tenus au lendemain des attentats de janvier 2015, dans lesquels elle renvoyait dos à dos les victimes de Charlie-Hebdo et leurs assassins. Ce qui aurait permis de remettre en perspective cette tribune publiée par Despentes dans les lendemains de la cérémonie des Césars.
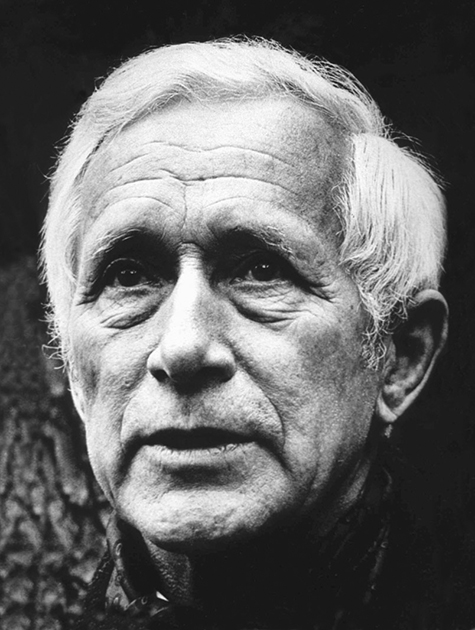
Quand Gisèle Sapiro écrit que « depuis le Nouveau Roman le rejet de la littérature engagée a conduit à dissocier les prises de positions politiques de l’oeuvre », fait-elle remonter ce rejet au seul avènement du Nouveau Roman ? On pourrait le croire si elle reprend à son compte un propos d’Anne Simonin. Elle sait pourtant parfaitement que la « littérature engagée » avait fait l’objet de critiques, parfois virulentes, aux lendemains de la Libération par Char, Bousquet, Bataille et Breton. Un peu plus loin, je remarque que Ernst Jünger figure dans une liste d’écrivains « nationalistes, fascistes, xénophobes, racistes, sexistes ». Cela vaut certes pour les autres, mais je m’étonne de trouver Jünger souvent réduit à son compagnonnage d’avant 1933 avec l’extrême droite. De nombreux intellectuels classés à gauche passent par perte et profit tout ce qui ne viendrait pas corroborer l’image d’un Jünger fascisant, voire fasciste. Comme si l’oeuvre de l’écrivain allemand ne comportait que Orages d’acier et Le Travailleur ! Il paraît préférable de s’adresser à Julien Gracq et à Maurice Nadeau pour savoir de quoi il en retourne avec Jünger.

Gisèle Sapiro est un peu rapide avec Paul Gauguin. On aimerait ainsi savoir si elle se situe dans le camp des accusateurs du peintre. Elle mentionne « le débat actuel autour de Gauguin » alors qu’il s’agit en réalité d’un procès. Cette manière euphémisée de l’évoquer laisse peu de place au doute. Le peu que Gisèle Sapiro en dit, en terme de « diffusion des représentations coloniales », laisse entendre qu’elle reprend à son compte l’un des deux chefs d’accusation. On aurait aimé qu’elle entre plus dans le détail de ce « débat ». Car le lecteur ignore à la lire que des groupes de pression, principalement dans le monde anglo-saxon, veulent interdire ou « encadrer » tout projet d’exposition consacré à Gauguin. Pourtant, si l’on prend en considération les nombreuses biographies sur le peintre breton, la thèse (soutenue par les décoloniaux) selon laquelle Gauguin serait un personnage raciste et colonialiste vole en éclat. Même l’accusation de pédophilie (par les néoféministes) relève de la fiction si l’on se rapporte au contexte polynésien de l’époque, ou même accessoirement au droit français quand le Code Pénal ne punissait que les « attentats à la pudeur sans violence en dessous de 13 ans » (les compagnes de Gauguin ayant 13 ou 14 ans). Comment parler de pédophilie alors que les adolescentes polynésiennes étaient « en ménage » dès leur puberté (plus précoce que celle des jeunes filles européennes) ?
Au sujet de ces polémiques autour de Paul Gauguin, Philippe Lançon indique que « la morale de l’oeuvre n’est pas dans sa vie, certes pas celle rêvée d’un ange, mais dans les formes qu’il crée. La censure – et l’imbécillité qu’inévitablement elle exige et produit – commence lorsqu’on se met à confondre les deux, au point de regarder celle-ci à la lumière de celle-là ».
Ainsi, dans l’avant dernière page de son essai, Gisèle Sapiro émet l’avis que « s’il ne faut pas censurer les oeuvres de l’esprit, j’émettrais une réserve, en raison de leur caractère performatif, pour celles qui incitent à la haine raciale et au sexisme, qui stigmatisent les populations vulnérables et qui font l’apologie du viol et de la pédocriminalité, à condition de distinguer apologie et représentation ». Je lui répondrai qu’il ne faut en aucun cas censurer les oeuvres de l’esprit, y compris celles qui seraient les plus répréhensibles, inadmissibles ou condamnables selon ses critères. À condition – en reprenant le sempiternel cas de la publication des pamphlets antisémites de Céline – de doter, par exemple, cette éventuelle édition de l’introduction et de l’appareil critique ad hoc. Nous induisons, lisant l’auteure, qu’il conviendrait de censurer toute oeuvre faisant « l’apologie du viol et de la pédocriminalité ». Alors, faudrait-il censurer la quasi totalité de l’oeuvre de Sade ? C’est regrettable que Gisèle Sapiro ne se soit pas exprimée sur ce cas d’école. En prenant ici, comme seul exemple, celui de Matzneff, elle ne prenait aucun risque. L’absence criante de Sade, dans un ouvrage traitant des relations entre la vie et l’oeuvre d’un auteur, s’avère significative.
Également, pour revenir sur cette « réserve », je m’étonne de la présence dans la liste ci-dessus, aux côtés de « la haine raciale » et de « l’apologie du viol et de la pédocriminalité », de la notion de « sexisme ». Que vient-elle faire dans cette galère ? Gisèle Sapiro n’est pourtant pas sans savoir que le délit de sexisme (l’outrage sexiste étant aujourd’hui sanctionné par une contravention) ne saurait être confondu avec le harcèlement sexuel, puis l’agression sexuelle, et enfin le viol. Je n’entends pas défendre le sexisme, bien au contraire, si je lui fait remarquer que cette censure qu’elle réclame également pour des oeuvres de l’esprit dites « sexistes » nous priverait – pour se limiter à ce seul exemple – de l’écoute de plusieurs chansons de Jacques Brel et de Georges Brassens. Ce qui serait regrettable. Ne lui serait-il pas possible, comme le réclamait très justement Stéphane Goudet aux censeurs de J’accuse, de faire tout simplement appel à l’intelligence de l’auditeur (ou du lecteur, du spectateur, du regardeur…) ?
Juste auparavant, Gisèle Sapiro répondait à la question – peut-on dissocier l’oeuvre de l’auteur ? – par la négative. Nous pourrions y répondre de même, d’un point de vue disons libertaire : mettre en accord, dans la mesure du possible, sa vie avec ses idées, et par extension, avec son oeuvre. Mais ce n’est pas ce à quoi entend souscrire Gisèle Sapiro qui, une dernière fois, convoque « les associations féministes et celles contre le racisme et la racialisation » comme garantes d’une règle non écrite dont les linéaments ont été exposés plus haut à travers la « réserve » émise par l’auteure (la nécessité de censurer malgré tout les oeuvres de l’esprit qui se trouveraient dans le collimateur de ces associations). Ce que Gisèle Sapiro traduit de façon euphémique par « sensibiliser à des problématiques encore trop occultées ». D’où il ressort, ceci et cela posé, qu’un « certain arbitraire s’immisce ». Jean-Louis Jeannelle (« L’Autonomie de l’art en question » in Le Monde des Livres du 20 novembre 2020) ajoute : « Les agissements privés sont ainsi dénoncés de manière plus tranchée que les positions idéologiques, signe que l’intérêt contemporain pour les questions de genre et de sexualité a rendu plus fragile l’autonomie longtemps revendiquée pour le champ artistique ». Pour un ouvrage qui a l’ambition de « mettre en perspective historique, philosophique et sociologique cette question » – celle posée dés le titre du livre – et d’offrir « à chacun les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d’embûches », il semble donc, malheureusement, que cela soit plutôt manqué.
Texte © Max Vincent – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
