Depuis son renouvellement à la fin du 19e siècle avec Paul Vidal de La Blache, grande figure de la géographie morphologique ou « naturaliste », jusqu’à sa transformation radicale en science sociale dans les années soixante, la géographie, et ce quelles que soient ses tendances, a toujours suscité un vif intérêt en France. Urbanistes, ethnographes, sociologues, économistes, « écrivains-géographes » (tels Julien Gracq ou Jean-Christophe Bailly), ils sont légion à s’en être emparés. Objet transdisciplinaire par excellence, il était inévitable, après les profonds bouleversements qui ont affecté le tissu urbain dans l’après-guerre et jusqu’à nos jours, qu’elle connaisse un tournant positiviste. À l’issue de Mai 68, le contexte académique, marqué par la critique de la géographie classique vidalienne qui avait vu l’émergence d’une « nouvelle géographie », plus quantitative, y était favorable. Les fractures territoriales et la redécouverte d’Élisée Reclus – géographe et anarchiste – ne furent certainement pas étrangères à cette attention portée aux dimensions sociales du spatial. Dans ces conditions, nul hasard que ce soit sur la ville elle-même que s’est polarisée la discipline, en témoigne de manière presque symptomatique la parution du livre de Colette Pétonnet (encouragée par son maître, André Leroi-Gourhan) consacré aux habitants d’une cité de transit, Ces gens-là, en janvier 1968 (C. Pétonnet, Ces gens-là, Paris, Maspero, 1968). C’est que la géographie ne saurait être un objet neutre. Et la ville, encore moins, dans la mesure où elle est le terrain où se matérialisent de manière éclatante les luttes sociales. Au-delà du regard anthropologique, il était logique que les marxistes s’en saisissent. C’est à ce pan entier de la critique que s’attaque Métromarxisme : Un Conte marxiste de la ville (Entremonde, 2018), le livre d’Andy Merrifield, aussi érudit que salutaire, et que plus d’un se réjouiront de voir enfin proposé au lectorat francophone.
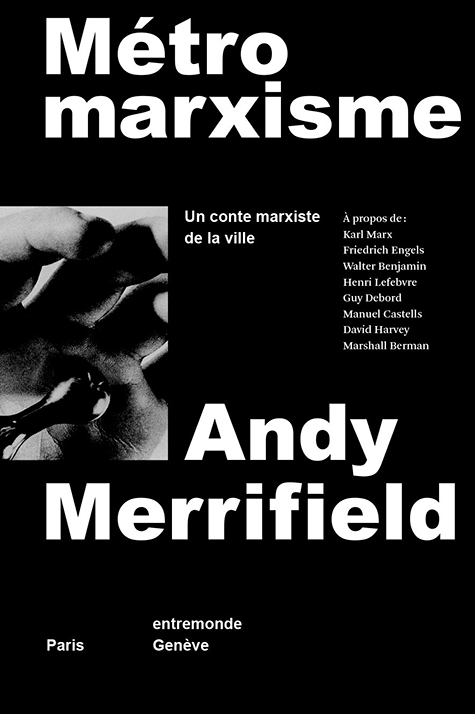
Figure hétérodoxe de la géographie anglo-saxonne, franc-tireur de l’université qu’il a quittée momentanément pour parcourir l’Auvergne sur un âne nommé Gribouille ((Expérience relatée dans son seul livre jusqu’ici traduit en français : L’Âne de Schubert, Arles, Actes Sud, 2008. )), tel un Robert Louis Stevenson des temps modernes, Andy Merrifield, élève de David Harvey (avec lequel il a fait sa thèse) et fils spirituel de Henri Lefebvre (auquel il a consacré une monographie ((A. Merrifield, Henri Lefebvre : A Critical Introduction, Londres, Routledge, 2006, à paraître aux Éditions Entremonde.)), est l’un des géographes marxistes contemporains les plus en vue. Débordant largement le cadre d’une sociologie urbaine « positive », son approche se veut avant tout critique, démontrant, livre après livre, que la spatialité urbaine concentre certains motifs « marxiens » – accumulation du capital, aliénation et exploitation –, dessinant ainsi les contours d’une œuvre engagée. Métromarxisme, paru au Royaume-Uni en 2002, se présente comme une synthèse du marxisme urbain à travers huit figures majeures de la critique marxiste de la ville : Karl Marx, Friedrich Engels, Walter Benjamin, Henri Lefebvre, Guy Debord, Manuel Castells, David Harvey et Marshall Berman. Ce savant essai, écrit dans une langue claire et accessible, est une belle introduction pour qui a la curiosité d’appréhender le phénomène urbain sous l’angle d’une critique radicale.
Huit auteurs donc, comme autant de pièces d’un puzzle éparpillées, stimulant une lecture active, une attention critique de tous les instants, appelant sans cesse à une retotalisation dialectique de son objet. Chaque chapitre à lui seul est une allégorie de l’ensemble : en bon matérialiste, Merrifield procède suivant une méthode inductive, en livrant d’abord des éléments biographiques épars sur chaque penseur étudié. Nulle coquetterie d’auteur ici, il s’agit bien plutôt de montrer en quoi ces huit penseurs ont tenté de vivre comme ils ont pensé et de penser comme ils ont vécu. Cet entrelacs innerve tout l’essai : tous ces hommes ont en effet d’abord en commun, non seulement le fait d’être marxistes, mais, comme le précise Merrifield dans son introduction, ils ne se cachent pas d’être « aussi clairement pro-urbains, ce qui les rend sympathiques ». Merrifield rappelle que les métropoles ont souvent été suspectes aux yeux d’une certaine tradition révolutionnaire, lui préférant de loin l’édification d’une « base paysanne » (comme ce fut le cas en Chine, à Cuba ou plus tard au Cambodge et au Nicaragua). La ville représente de facto, pour une certaine tendance du marxisme, le lieu central de la corruption et de l’oppression bourgeoises. L’approche privilégiée par les penseurs présentés par Merrifield va à rebours de cette tradition, dans la mesure où « ils dénoncent l’injuste abondance de la ville capitaliste, tout en défendant les vertus et les potentialités latentes de la vie citadine ». On le voit : le point de départ du livre de Merrifield est la contradiction et c’est à démontrer sa fécondité que s’attache son travail, à mettre en exergue un monstrueux urbain contenant à la fois le pire et le meilleur.
De quoi s’agit-il ? L’auteur part d’un constat présent dans les écrits de Marx : si celui-ci a pulvérisé « les divisions traditionnelles entre les disciplines, il n’a jamais ressenti le besoin de penser la ville elle-même, n’a jamais vraiment associé le développement de l’industrialisation (et de la production) à celui de l’urbanisation (et de production de la ville) ». Certes, reconnaît Merrifield, il l’a fait pendant un temps, à la fin des années 1840, « mais cela ne fut jamais incorporé à ses classiques méditations des années 1860 ». Le fait que « l’urbanisation n’était pas à la pointe de la critique de Marx » a ainsi de quoi surprendre. De même, après lui, Engels ne s’est guère intéressé à l’ambiguïté quotidienne de la métropole moderne, même s’il s’en faisait une idée partielle. Il ne comprit pas que « la texture de la ville était plus épaisse et sa densité, plus riche ». Ni lui ni Marx ne furent marqués par la politique et la culture propres à la ville. Toutefois, quand on lit Marx entre les lignes comme le fait l’auteur, l’on entrevoit le rôle fonctionnel qu’elle serait susceptible de jouer. Rappelant judicieusement un passage célèbre du Manifeste communiste – « Tous les rapports sociaux immobilisés dans la rouille, avec leur cortège d’idées et d’opinions admises et vénérées, se dissolvent ; ceux qui les remplacent vieillissent avant même de se scléroser. Tout ce qui était solide, bien établi, se volatilise, tout ce qui était sacré se trouve profané » –, Merrifield en induit que la ville est justement le lieu même de l’accélération de l’Histoire, celui où les choses ont le plus de chances de se volatiliser. De même, si chez Engels, « les problèmes de la ville sont remplacés par les problèmes de la révolution », un livre comme La Situation de la classe laborieuse en Angleterre, tout en montrant l’effroyable et grouillante misère qui sévissait à Manchester (explorée par le jeune Engels au moment même où Walt Whitman arpentait les trottoirs de la métropole nord-américaine avec un regard plus poétique et moins unilatéral), jette implicitement les bases d’un marxisme urbain. Si donc la grande ville concentre tous les maux du capitalisme, envisagée comme une totalité concrète, elle est paradoxalement aussi le lieu de toutes les déliaisons et de tous les possibles.
Au moment où Friedrich Engels disparaît (en août 1895) et où ses cendres sont dispersées en mer, un petit garçon de trois ans fait une expérience qui deviendra « Chronique berlinoise » : Walter Benjamin va profondément renouveler le champ de la critique urbaine, depuis un substrat ouvertement marxiste, marquée cependant par l’enseignement de l’un de ses maîtres, le sociologue Georg Simmel. Comme un autre outsider de la théorie critique, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin retiendra surtout sa perspective « micrologique » : dans la vie moderne, rien n’est anodin, le détail trivial révèle, par synecdoque, l’essentiel, met à nu la machinerie sociale. Benjamin restera aussi imprégné par l’essai de Simmel, Les Grandes Villes et la Vie de l’esprit, où la dualité de la ville moderne est explorée dans tous ses aspects, y compris dans ses angles morts : certes, la grande métropole atomise ses citoyens, perdus dans les foules solitaires « parmi lesquelles ils sont nus et vulnérables, et où chacun évalue et calcule, y compris les autres » ; mais, de manière concomitante, « elle étend les potentialités humaines, élargit les cadres de pensée de chacun, permet aux gens de respirer et d’abandonner leurs identités figées, les libérant des préjugés et des contraintes de la petite ville ». Ceci donne l’occasion à Andy Merrifield de formuler une critique pénétrante de l’École de Chicago, qui n’aura retenu de Simmel que son aversion de « l’hypertrophie de la culture objective » urbaine (ou si l’on préfère, sa sensibilité, la Kulturkritik), gommant ainsi les jeux d’opposition et, partant, décapitant ainsi sa sociologie. Tout autre est le regard de Benjamin, chez lequel le mouvement reste éminemment dialectique. Selon Merrifield, Benjamin n’envisage pas le capitalisme comme un tout continu : Il y a « toujours des trous, toujours des failles imperceptibles » ; si le règne de la marchandise est difficilement contestable, « il y a, en fait, dans la culture, dans l’urbanisme et l’architecture, dans la vie quotidienne, une porosité qui rend l’économie perméable, sujette à la subversion ». Merrifield rappelle que c’est à Naples, une ville entièrement sous la coupe de l’Église catholique, de la mafia (la Camorra) et de la police fasciste où Benjamin déambule en compagnie de sa compagne Anna Lācis, que furent susceptibles de surgir aux yeux du philosophe les « constellations imprévues ». Il montre enfin que c’est la lecture de Baudelaire, poète et flâneur hanté par « la double postulation », et celle des Surréalistes, qui a permis à Benjamin d’appréhender la métropole comme lieu tout à la fois de la mystification et de l’émancipation, pour en conclure qu’il fut « le premier marxiste à saisir la ville capitaliste comme une illumination profane ».
C’est à Paris, capitale du 20e siècle, et quasiment dans les mêmes années que le philosophe français Henri Lefebvre, marqué comme Walter Benjamin par le surréalisme, attaché lui aussi aux menus détails du quotidien et à la critique de la marchandise, pensera à son tour le phénomène urbain. Si, dès les années 1930, il publie un essai (La Conscience mystifiée) dans lequel il s’emploie à dévoiler les soubassements de la domination (aliénation, fétichisme et mystification), c’est dans l’après-guerre de la reconstruction qu’il concentrera toute sa pensée critique sur les profonds bouleversements urbains qui affecteront le « territoire » français. La planification technocratique fait jaillir de la terre des « villes nouvelles » et des « grands ensembles » où l’atonie existentielle le dispute à l’ennui consumériste, garantissant le contrôle social. Les centres-villes perdent leur vitalité spontanée, saccagés et désintégrés dans un premier temps, ils sont ensuite rénovés et rehaussés pour être annexés par la bourgeoisie. Exilée en banlieue, la classe ouvrière perd ses prétentions à l’urbanité, or pour Lefebvre, « sans un centre, il ne saurait y avoir d’urbanité ». Comme le travail chez Marx, l’espace devient abstrait, espace de la croissance et de l’accumulation du capital, il nie le véritable espace concret qualitatif, un espace différentiel, « différent parce qu’il célèbre la particularité, du corps et de l’expérience » et qu’il affirme « le droit à la ville ». Il s’agit donc pour Lefebvre de se réapproprier la vie quotidienne dans la ville par ce qu’il nomme un « moment vécu ».
Ce « droit à la ville » comme espace de rencontre et de fête va entrer en résonance directe avec les aspirations de l’Internationale situationniste et de son principal acteur, Guy Debord. On oublie souvent en effet que l’IS fut d’abord l’émanation d’une critique frontale de l’urbanisme. Dès les années cinquante Debord et les siens avaient mené une guerre contre les planificateurs urbains, leurs armes – héritées de la poésie moderne – étaient la libre association, le détournement, la dérive. L’urbanisme unitaire de l’IS révélait les mensonges de l’urbanisme bureaucratique et transformait la ville en terrain de jeu, propice à la « construction des situations ». Comme Lefebvre, Debord savait que l’urbanisation guidée par le marché détruisait les villes. Tous deux, étant marxistes, « savaient pareillement que le sujet révolutionnaire, organisé collectivement et mobilisé tactiquement, pouvait mettre en péril ce monde crépusculaire », « soumettre l’espace au temps vécu » (Thèse 178 de La Société du Spectacle). Or, comme le rappelle Merrifield, si l’acmé de ce programme révolutionnaire fut Mai 68, Lefebvre ne suivit pas la jeune génération dans la rue. Le rendez-vous fut manqué.
Comme nous l’avons dit en préambule, la période post-soixante-huitarde voit l’émergence d’une prise en compte plus « positive » du phénomène urbain. À cet égard, trois universitaires occupent une place importante dans le propos de Merrifield : le Catalan Manuel Castells — élève rebelle d’Henri Lefebvre -, l’Anglais David Harvey et le New-Yorkais Marshall Berman. Le premier, dans une perspective althussérienne, tente de « formaliser une science sociale de la ville » et s’emploie à « attaquer les questions d’urbanisme et la sociologie urbaine pour leur contenu idéologique ». Avec La Question urbaine (1972) ((M. Castells, La Question urbaine, Paris, Maspero, 1972.)), Castells cherche à élaborer une « science de l’urbain » pour en découdre avec son ancien maître (Lefebvre) et l’École de Chicago, qui réduit la ville à la concurrence sociale et à ses conséquences funestes (anonymat, repli, superficialité, anomie) ; il s’agit cependant de mettre au jour « la réalité réelle » du monde urbain derrière sa « représentation imaginaire » car pour le capitalisme, la ville fonctionnelle est devenue « la spécificité spatiale des processus de reproduction de la force de travail et des processus de reproduction des moyens de production ». Si les travaux de Castells ont pu s’avérer féconds dans les années soixante-dix – en témoigne la publication d’une monographie sur la ville de Dunkerque en 1974, où la mise à nu du capitalisme monopolistique d’État est disséquée depuis une rigoureuse enquête de terrain –, Merrifield pointe cependant avec sévérité ses reniements à partir du début des années quatre-vingt et l’enlisement de ses travaux dans une sociologie des flux et des réseaux qui tourne le dos au monde concret. Impitoyable, Merrifield note qu’avec Castells, « la Silicon Valley a trouvé […] son commissaire politique le plus doué et le plus éloquent ».
Tout autre est selon lui la perspective de David Harvey. Exilé dans les années soixante-dix dans la ville de Baltimore aux États-Unis, ville d’une grande pauvreté et où les inégalités et « la question noire » se posent avec une acuité terrible (c’est d’ailleurs dans cette ville que se déroule la série The Wire), ce géographe, auquel va toute la sympathie d’Andy Merrifield, n’aura de cesse dans ses travaux et via la revue Antipode, de fonder un « matérialisme historico-géographique » radical. Avec Social Justice and the City (1973), d’abord, ouvrage qui s’articule autour d’une théorie critique de l’espace, de la justice et de l’urbanisme, ferraillant avec les sociologues de l’École de Chicago ou des penseurs réformistes tel que John Rawls. Avec ensuite un article consacré au marché immobilier de Baltimore paru dans Antipode dans lequel il parvient à des conclusions proches de celles de Lefebvre, « l’espace et l’urbanisme ne contribuent pas seulement à la reproduction de la force de travail, comme le pensait Castells », les « dynamiques spatiales des marchés fonciers et immobiliers urbains, stimulent en fait l’accumulation du capital ». Se dessinent ainsi les contours d’une géographie de la domination, qu’achèveront de tracer The Limits to Capital (1982) et Paris, capitale de la modernité (2003) ((D. Harvey, Paris, capitale de la modernité, Paris, Prairies ordinaires, 2011.)) où l’analyse de la circulation du capital financier et de la spéculation urbaine dans le Paris du Second Empire est explorée et dévoilée avec une rigueur sans pareille. Enfin, c’est à une postmodernité toujours plus invasive que s’attaque David Harvey, à sa « logique culturelle » qui joue pernicieusement des catégories de l’esthétique et de la différence et contre laquelle il en appelle à une remise à plat du programme des Lumières, prônant un réexamen critique des catégories de l’éthique et de l’unité.
Avec Tout ce qui est solide se volatilise ((M. Berman, Tout ce qui est solide se volatilise, Genève/Paris, Entremonde, 2018.)), le New-Yorkais Marshall Berman élabore une dialectique métropolitaine entre modernisation et modernité, explorant les contradictions internes de cette dernière, mettant en exergue sa « destruction créative » via sa ville natale. C’est à New York que se forge une nouvelle grammaire urbaine, un « vocabulaire moderniste de la contestation », puisant dans la rue une énergie et une spontanéité inexploitées. Certes, ce processus « volatile » est « source de désintégration et d’incertitude, il est étourdissant et effrayant, mais aussi, pour Berman, libérateur et excitant ». C’est dans ce sens qu’il répondra aux reproches de nihilisme et de narcissisme que lui aura adressés le marxiste anglais Perry Anderson, l’enjoignant à rompre avec l’académisme, lui préférant un marxisme plus « vagabond », qui n’hésite pas comme Baudelaire en son temps (et Benjamin) à plonger dans « la merde du quotidien », à « lire les signes dans la rue », bref, à entrer de plain-pied dans « l’héroïsme de la vie moderne ». C’est tout ce qui différencie l’approche du phénomène métropolitain de Marshall Berman de celle d’un Mike Davis, qui « manque d’espace public » et « renonce à toute idée d’expérience commune » ; Davis élabore aux yeux de Berman un urbanisme complaisant, fasciné par cela même qu’il dénonce, dépouillant les hommes de leur puissance d’agir, un urbanisme hypercritique en attente du « cataclysme final » et du day after. Comme David Harvey, Marshall Berman règle son sort à la « compression postmoderne », « la ville, pour Berman comme pour Harvey, fut toujours la ville moderne ; la postmodernité, pour eux, est un rideau de fumée ».

On le voit, dans ce livre les pièces du puzzle s’assemblent et s’emboîtent avec une remarquable cohérence : tel un peintre cubiste, Merrifield pense simultanément avec et contre tous ces auteurs ; comme il l’écrit lui-même dans sa postface, « certaines des pièces en éclairent d’autres, ou parfois les éclipsent« , mais on ne peut qu’apprécier cette narration dialectique, qui démontre qu’il est possible d’aimer la ville capitaliste tout en restant marxiste. À l’heure où la plupart des universitaires appréhendent l’espace urbain d’une manière abstraite toujours plus schématique et modélisée (par exemple dans la géographie chorématique), où les penseurs de la ville en particulier et de l’urbanisme en général occultent l’organisation de la vie quotidienne en zonages dévoués à l’aliénation (habitation, travail, consommation, divertissement), la lecture de cette synthèse proposée par Merrifield ne peut être que stimulante. L’urbanisme en tant que totalité organisée est bien la clef de voûte de l’édifice social et rien n’empêche de reprendre les analyses de Merrifield pour les appliquer à ce que l’on appelle le « périurbain », cette suburbia (qu’une poignée d’écrivains français tels que Bruce Bégout, Marc Berdet ou Philippe Vasset s’attachent à penser) qui s’invite aujourd’hui dans la crise sociale que connaît la France avec le mouvement des Gilets jaunes. Cloisonnés qui dans des grands ensembles, qui dans des lotissements, qui dans des centres urbains transformés soit en désert social, soit en décor pour touristes, nous vivons entourés de bretelles d’autoroutes qui mènent – via des des ronds-points –, à des parcs d’attraction ou à des galeries marchandes. C’est cet espace que nous devons penser, avec les armes de la critique exposées par Merrifield dans ce livre, sans jamais séparer l’urbanisme de sa fonction sociale réelle, l’organisation du terrain de la domination par l’économie marchande. Walter Benjamin écrivait en 1940 qu’il nous fallait « prendre l’histoire à rebrousse-poil ». Avec Andy Merrifield, nous comprenons que c’est la géographie qu’il nous faut prendre à rebrousse-poil. Ce n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage, qui, remettant à l’honneur une pensée marxiste authentiquement critique, mise à mal par le anything goes postmoderne, ouvre des perspectives pour notre émancipation future.
Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
