Ce roman, Ghost Writer (L’Insaisissable, 2024), s’appelait au tout début de cette aventure, Tu ne convoiteras pas. Le titre d’un polar lambda… Au fur et à mesure du développement de l’intrigue (après la première moitié), il m’est apparu que je devais mettre l’accent sur le personnage secondaire, cet écrivain fantôme, qui oriente le récit vers une sorte de mise en abyme.
Cet écrivain fantôme est la face obscure du personnage principal dont les réflexions personnelles s’insèrent dans la narration. Ce ghost writer est ainsi ce qu’il est convenu d’appeler un penseur réactionnaire : je me suis d’ailleurs inspiré indirectement pour ce personnage d’un très bon écrivain et éditeur, – et de sa face sombre, misanthrope et masochiste, qui a défrayé la chronique germanopratine, il y a une dizaine d’années.
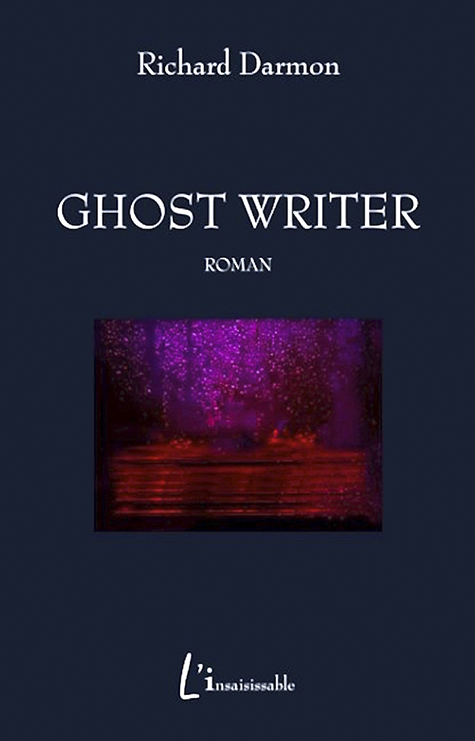
J’ai mis l’accent sur ce personnage en premier lieu pour décentrer le propos. Je n’avais pas du tout envie que mon roman soit réduit et récupéré par la pensée réactionnaire mollassonne qui a pignon-sur-télévision depuis 25 ans. Je voulais que cette pensée ait sa place, – elle me semble inévitable dans les questions et les enjeux que j’aborde et qui font partie de notre postmodernité, mais je voulais que ce personnage secondaire soit un peu comme la mauvaise conscience du personnage principal qui, lui, est plutôt une sorte d’anti-héros bien modeste, mais qui n’a pas les capacités de penser cette postmodernité. À défaut de pouvoir en donner une réflexion pertinente, il ne sombre pas dans un systématisme idéologique, il se contente d’un certain relativisme. Pas du tout bien sûr, un relativisme idéologique, loin de là, mais bien plutôt la conscience aigüe que cette accélération sans précédent de la postmodernité, si elle suscite des frayeurs et des fantasmes légitimes, que cette accélération du monde est inévitable. En germe depuis les débuts de l’Homme, (le mythe de la Genèse dans la Bible est à cet égard le noyau nucléaire qui réfléchit à cette disposition géniale de l’intellect humain, mais aussi aux conséquences terribles qui peuvent advenir de cet Hubris), il ne reste qu’à vivre ou à survivre avec son époque ; du moins, comme le fait le personnage principal, à être en décalage avec celle-ci.
Au-delà de cet aspect idéologique – la présence de cet écrivain fantôme – le ghost writer s’inscrit ainsi dans une mise en abyme du récit en train de se lire, un décentrement littéraire cher à Jorge Luis Borges ou à Julio Cortázar, mais aussi à certaines nouvelles fantastiques du 19e siècle qu’on peut retrouver également dans certains polars de seconde zone. (Je tiens beaucoup à « l’aspect ringard » de ce que j’appelle le Polar de seconde zone). C’est un procédé littéraire qui m’a toujours procuré beaucoup de plaisir, et c’est le procédé littéraire idéal pour éviter l’ennui d’un récit trop linéaire. De plus, cette mise en abyme est une capacité inhérente à l’esprit, au cerveau humain, et non un simple procédé artificiel. Cette disposition d’esprit, pour peu que nous ayons le réflexe de la faire fonctionner, nous aide donc à nous décentrer, à appréhender l’altérité d’où qu’elle vienne.
La lecture de L’Homme sans gravité du psychanalyste Charles Melman m’avait fortement intéressé ainsi que L’Utérus artificiel d’Henri Atlan. Le nom du personnage principal est d’ailleurs un clin d’œil à ce grand esprit. Ces ouvrages, qui ne sont pas vraiment des dystopies – Melman évoquait ce qu’il pouvait constater durant sa clinique et Atlan affirmait que la gestation par ectogènese en laboratoire ex-utero sera possible dans moins de 50 ans – avaient donc suscité mon trouble et ma réflexion.
Par ailleurs, il faut souligner que mon roman n’a rien à voir avec mon travail photographique. Si ce n’est, je dois l’avouer, une certaine vision du monde assez pessimiste que l’on peut discerner dans mes « Natures mortes » où les produits de la nature n’indiquent pas la profusion, mais bien plutôt comme le signe d’un sacrifice. Ainsi, dans mes recherches sur l’abstraction en photographie, il est possible de discerner ce goût pour des espaces minimalistes propices à la méditation que l’on peut retrouver également dans certaines parties du roman. Mais, bien évidemment, c’est au lecteur de dire s’il y a lieu d’une congruence entre ces deux modes d’expression que j’utilise.

Le film dystopique de Richard Fleischer, Soleil vert, m’avait fortement impressionné quand j’étais jeune. De même que 2001, l’Odyssée de l’espace. Dans Soleil vert, nous pouvons justement appréhender quelque chose de tout à fait probable pour l’humanité à venir, l’anticipation d’une hypothèse à court terme. L’intrigue dans Soleil vert se présente, elle-aussi, sous la forme d’une intrigue policière, une intrigue que je qualifiais plus haut, à tort ou à raison, comme un polar de seconde zone, ringard (à l’inverse de la réflexion plus sophistiquée de 2001). C’est cette ambiance, l’éthos de cet inspecteur qui m’avait tant plu et qui avait suscité mes interrogations et ma projection identificatoire. Par mon roman qui interroge le monde, celui en train de se faire, c’est un peu comme si j’en revenais aux premières dilections de ma sensibilité. C’était en tout cas une intention : faire un roman avec ce genre d’éthos pour les personnages, créer une ambiance assez similaire, une anticipation tout à fait probable à court terme.
Concernant la fameuse question du déterminisme, nous pouvons évoquer Spinoza. Henri Atlan, qui est un spinoziste conséquent, affirme : il y a du déterminisme, il est même absolu. Et, il ne nous reste de liberté qu’à comprendre ce qui nous agit, dit-il. Maïmonide affirme, lui, le contraire ; et, avec beaucoup de difficultés, énonce : il y a du libre arbitre.
Dans mon roman, me semble-t-il, en dépit des prouesses technologiques prodigieuses, de la liberté de plus en plus ample que permet la postmodernité, les personnages errent entre divers déterminismes, le déterminisme social, mais aussi biologique, et celui, psychique, découvert par Freud. Je crois que cette question travaille le texte de façon souterraine, puisque cette question travaille la société, et plus généralement, la notion même de civilisation : qu’en est-il de la liberté humaine ? Il me semble en effet que cette question a innervé ma réflexion pendant l’écriture de ce roman, sans bien sûr que je me la pose.
En ce qui concerne la part d’imaginaire et la part de « vécu » de ce roman, j’ai laissé le plus possible mon imaginaire être le second scénariste de cette histoire ; mais je tenais à ce que cette histoire porte en germe quelque chose de très personnel. Il y a, en effet, à divers endroits du texte, des interrogations, des hantises, des fragments autobiographiques qui rehaussent cette fiction par ces petites pépites d’humanité qui lui donnent des accents de vérité. Par cet aspect-là – je dis bien par cet aspect essentiellement – je trouve que ce texte est réussi. Il m’en donne en tout cas satisfaction. Voilà ma récompense : ces petits effets de réel justifient en quelque sorte ce texte, ou tout au moins, m’en donnent justification. À des moments, ça parle « juste », et ça s’insère bien, me semble-t-il, dans la narration.

Ce que peut ainsi la littérature, je dirais même ce qu’elle peut plus que jamais, c’est de préserver ce retour vers soi, les autres et le monde, c’est de retrouver un certain sens de la lenteur. Cette disposition à toutes sortes de transports que le déferlement d’images, qui s’accélère avec la vague des séries TV, vient saturer dans le sens où les dispositions de l’esprit et de l’imaginaire ne sont plus suscitées, puisque le travail de l’imagination suppose des trouées et des manques, toute chose que cette « Société du Spectacle », et son déferlement d’images, obstrue.
Texte & Photographies © Richard Darmon – Illustration © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
