CÉCILE GUILBERT s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son essai WARHOL SPIRIT (Grasset, prix Médicis essai 2008) :
1 – Cécile, commençons par l’une des approches fondamentales de ton travail qui est de te confronter à la pensée créatrice dans la littérature, mais également dans l’art. Tu as ainsi étudié quelques figures tutélaires comme Saint-Simon (Saint-Simon ou l’encre de la subversion, 1994), Debord (Pour Guy Debord, 1996), Sterne (L’Écrivain le plus libre, 2004), et donc Warhol. Que cherches-tu à montrer précisément de la création à travers ces personnages singuliers et représentatifs de paroles et de gestes littéraires et artistiques forts ?
Précisément en quoi consiste la singularité. Et que la pensée est toujours belle, bouleversante, même ! Dès lors qu’il y a une pensée, une parole et un style pour les dire, distinguer la littérature de l’art n’a pas grand sens. Les « figures tutélaires » comme vous dites, qu’elles se soient voulues « historien » (Saint-Simon), « écrivain, aventurier et penseur stratégique français » (Debord), « auteur de roman » (Sterne) ou « business artist » (Warhol), sont avant tout des artistes de grand style aristocratique.
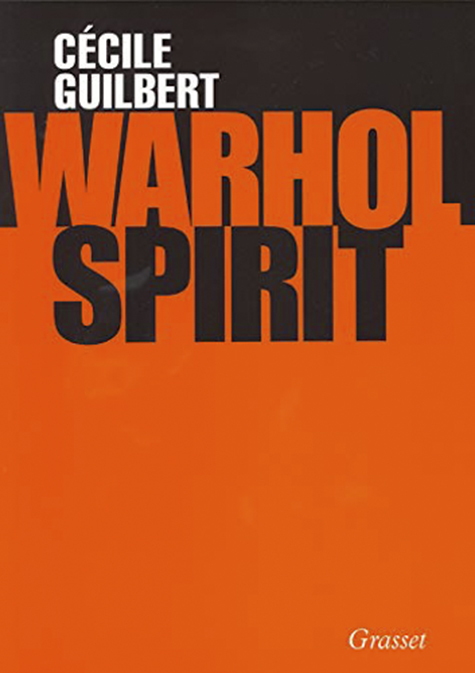
2 – Tu as publié un roman (Le Musée national, 2000), mais l’essai biographique fictionnel est une caractéristique de ton travail d’écriture. Il occupe chez toi une fonction très précise, celle de faire de l’artiste ou de l’écrivain étudié un personnage fictionnel ou, pour le dire autrement, celle de révéler la part fictionnelle de son existence pour approcher la dimension « mythique » de sa vie. Pourquoi ce désir d’écrire à partir de la vie d’artistes et d’écrivains ? Est-ce pour toi une possibilité d’approcher les véritables ressorts d’un « génie » propre à la création ?
Quoiqu’il y ait « fiction » dès qu’il y a de l’écriture, je dirai que le genre de l’essai fictionnel s’applique surtout à L’Écrivain le plus libre livre consacré à Laurence Sterne où j’avais besoin de créer, pour des raisons essentiellement rhétoriques, un dialogue (forcément fictionnel, donc) avec le spectre de Sterne. J’avais aussi besoin, tant elle est inconnue du public français et stratégique quant à l’entreprise romanesque et mystificatrice de Sterne, d’inclure sa biographie, ce qui donne un essai mêlant plusieurs genres. En ce qui concerne les autres, je ne pense pas écrire à partir de la vie mais surtout des écrits de mes héros. Aussi la part fictionnelle m’y semble plus faible, de même que la biographique. Cette dernière ne sert qu’à faire valoir, quand c’est nécessaire, la part non mythique mais emblématique d’une pensée et d’une geste artistiques.
3 – Tu viens de rassembler des essais publiés initialement dans des revues littéraires, mais aussi dans des magazines au sein d’un recueil titré Sans entraves et sans temps morts (2009). Les sujets pourraient paraître très variés puisque tu traites autant de la forme des villes contemporaines et de la précieuse cruauté de Jonathan Swift, que de l’histoire du rock, la perfection des jardins de Le Nôtre à Vaux-le-Vicomte, le mysticisme de Kerouac, mais aussi de la guerre dans la Société du spectacle, ou encore des porte-jarretelles. Cependant ce recueil suit un fil rouge qui forme toute son unicité entre sensualité, liberté, pertinence et nous ajouterions volontiers quel que soit le sujet dont il s’agit : Littérature ! Car au-dessus de tout, reste toujours la littérature pour toi… Peux-tu revenir sur la conception de cet ouvrage qui s’inscrit hors du consensus mou et des goûts vulgaires si partagés dans notre monde actuel ? Pourquoi un tel ouvrage aujourd’hui dans tes publications ? Que signifie-t-il pour toi ?
Il m’a semblé intéressant de rassembler ces textes parus de manière erratique dans des journaux, des magazines et des revues (par essence « volatils »), non parce qu’ils méritent de passer à la postérité (!) mais parce qu’ils prouvent, me semble-t-il, qu’en dépit des raisons et des supports pour lesquels ils ont été écrits, il s’agit toujours, précisément, d’écrire, et en toute liberté. De ce point de vue, je ne fais aucune différence entre ces textes qui prolongent mon activité d’essayiste et ceux de mes livres car j’ai toujours choisi mes sujets et proposé à la presse écrite (qui les a acceptés) ceux sur lesquels je souhaitais m’exprimer. S’ils se lisent déconnectés et décontextualisés des médias, sans que l’on sache où ils ont paru, tant mieux : cela prouve qu’ils tiennent la route en soi ! J’imagine aussi que de cette cinquantaine de textes parus de 1998 à 2008 émerge un système nerveux, un ton, un goût qui font écho au reste, et parfois l’excèdent (de nombreux critiques ont été surpris que j’écrive sur le rock ou le porte-jarretelles !). Traces et signes des événements (voyages, livres, phénomènes culturels) qui, ces années-là, m’ont vraiment excitée ou intéressée, ils prendront sans doute une autre signification en fonction des prochains, ceux que j’écris depuis 2008 et en ce moment à à rassembler dans un autre volume dans dix ans !
4 – Une certaine tendance éditoriale semble dénigrer aujourd’hui la création d’œuvres personnelles marquées par une écriture ou un geste artistique novateur pour leur préférer des productions normées, prétextant que les premières n’intéressent plus personnes et, surtout, ne sont plus « rentables » sur le marché actuel de l’édition. Que penses-tu de cette réalité éditoriale ? Comment la résistance, la persévérance des écrivains est-elle encore concevable ou possible dans ce contexte?
Effectivement, la tendance au calibrage est devenue très forte sur le marché éditorial mais ça ne date pas d’hier puisque Lautréamont parlait déjà de ces livres qui « s’accroupissent aux étalages » et Mallarmé du « produit agréé courant » en fustigeant « l’universel reportage »… Concernant la question du genre, le roman est devenu une sorte de totem sur lequel repose la part la plus importante des enjeux éditoriaux, alors même que cette étiquette facile et passe-partout sert à diffuser à peu près tout et n’importe quoi à confessions pauvrettes, pseudo-récits autobiographiques, bref déluge de subjectivités, souvent misérable. L’art du roman étant comme tout art, minoritaire, nul ne s’étonnera des résistances rencontrées dès lors qu’audace, innovations stylistiques et formelles, etc. D’un autre côté, l’« illisibilité » formellement et historiquement propre à l’avant-garde n’est plus recevable pour des raisons historiales à question complexe impossible à développer ici… N’empêche que le roman à succès contemporain et mainstream est aux ordres de l’industrie culturelle qui n’a rien à voir avec l’art. D’où l’importance avant tout de l’histoire, de l’intrigue, de la story racontée (cf. ce qu’on appelle en politique, mais aussi dans la communication et la publicité, lesquelles ont depuis longtemps fusionné, le storytelling), éminemment profitable en termes d’adaptation audiovisuelle dans la cash machine qu’est le Spectacle. Proust avait déjà eu en son temps des mots très durs sur cette conception du roman comme « sorte de film cinématographique des choses »… Quant à l’essai majoritairement écrasé dans la sous-langue journalistique, qu’il puisse être hissé – comme j’ai voulu le faire – non seulement à certaine hauteur stylistique, mais aussi dans certaines formes inédites induites par l’essai-biographico-fictionnel (avec variations typographiques, inclusion de documents divers à peinture, photos, etc.) pour Sterne, ou l’essai-graphique (avec placards de couleur, jeux de mots en anglais, listes, photos et reproductions de documents divers, le tout maquetté et soigneusement typographié, de la couverture à la dernière page des mentions légales…) pour Warhol, ne rend pas la partie facile avec les éditeurs : demeure la stratégie et l’obstination pour parvenir à ses fins, je ne vois rien d’autre…

5 – Tu as rencontré de grosses difficultés pour faire publier tel que tu l’entendais ton Sterne comme ton Warhol alors même que tu devrais – en tant qu’auteur reconnu et de qualité – voir tes projets aboutir sans problème. Ton Warhol a été finalement récompensé par le Médicis essai et l’on peut voir certains livres – publiés bien souvent des années plus tard après des refus réitérés d’éditeurs – remporter des succès critiques et/ou commerciaux. Quelles sont, selon toi, les raisons qui expliquent ce phénomène ? Les éditeurs sont-ils à même, finalement de savoir ce qu’est un « bon » livre ?
Si les éditeurs sont généralement satisfaits du résultat final, a fortiori quand la critique, les ventes et les prix suivent (outre l’obtention du Médicis, Warhol Spirit a déjà dépassé les 10.000 exemplaires), il est vrai qu’ils ont énormément de mal à imaginer un livre différent de ce qu’ils ont déjà pu voir tant qu’il est en cours et répugnent à la prise de risque. À moins que vous soyez déjà bestseller, il leur est devenu impossible de signer un contrat au vu de seulement quelques pages de synopsis ou de maquette, aussi convaincants et brillants soient-ils. Par ailleurs, ce qu’on appelle « littérature » est non seulement minoritaire dans le business général du livre mais réduite à peau de chagrin dans l’idiosyncrasie de beaucoup d’éditeurs. Lesquels d’entre eux savent vraiment lire ? Lesquels d’entre eux se passionnent réellement pour la pensée, la parole, le Verbe ? La concentration éditoriale en grands groupes et les résultats financiers attendus par les actionnaires expliquent sans doute en partie que l’ancien jeu (financer ce qui ne se vend pas ou peu par les gros succès) devienne de plus en plus caduc. Tout d’une certaine façon doit « marcher ». Néanmoins, de petits éditeurs prennent encore des risques et se hasardent dans des sentiers extrêmement audacieux qui, d’ailleurs, paient parfois, ce qui est plus que réconfortant. Les éditeurs font parfois penser à leurs homologues de l’industrie cinématographique qui se grattent la tête pour imaginer la martingale du succès : présence de stars, gros battage, buzz, anticipation d’un nouveau succès à partir d’un précédent, etc. Mais ils prennent parfois de gros bouillons comme récemment avec Christine Angot, Catherine Millet, BHL et Houellebecq, à preuve que le public n’est pas aussi « pavlovien » qu’ils l’imaginent et qu’on ne la lui fait pas en le matraquant ! J’ajoute que cette pratique éditoriale est aussi funeste dans la mesure où elle « assèche » les finances des maisons d’édition en aggravant le système à deux vitesses : les supposées stars vendeuses raflant des avances de plus en plus exorbitantes tandis que les autres doivent se contenter d’à-valoir de plus en plus réduits.
6 – Principal travers de ce qu’une certaine tendance éditoriale domestiquée au « marché » engendre dans la littérature actuelle : la combinaison tout à la fois de pensées consensuelles et de provocations exacerbées. Comment deux injonctions aussi antinomiques peuvent-elles coexister ? Quelle en est la conséquence sur l’écriture ?
Parce que les lecteurs veulent à la fois se trouver en terrain connu et se divertir, être rassurés et avoir de quoi blablater. Que cela puisse marcher a beau être hallucinant, ces vieilles recettes éculées continuent à faire leurs preuves car ce que vous appelez « littérature actuelle » n’est qu’un succédané sociologique. Comme dirait Sollers, le public est majoritairement « sociomane ». Ce qu’un de mes amis appelle le « marketing punk » (de scandale, de provoc) a toujours existé mais à vrai dire, plus rien ne scandalise vraiment car il est prévu que le marché absorbe tout. Pour reprendre l’inénarrable expression d’un ancien Président de la République, ces choses-là font rapidement pschitt ! Que certains auteurs tablent sur ces bêtises et les anticipent dans leurs projets de livres est avéré, mais quand bien même ils connaissent un certain retentissement, ce dernier ne dure que le temps des foires, non ?
7 – Il semble que la conséquence d’un tel retournement touche directement la notion même de littérature qui fonde l’idée de poésie : à savoir que la littérature permettant l’expression d’une certaine poésie serait aujourd’hui le principal obstacle à sa compréhension. Ainsi, faire acte d’écriture, produire de la littérature, exprimer une « langue » (et non seulement la langue), c’est-à-dire pour suivre Heidegger, habiter en poète la littérature, serait un obstacle à son accessibilité (en terme de reconnaissance médiatique) par les masses. Pour toi, la littérature, donc l’écriture, peuvent-elles être encore perçues aujourd’hui comme une même notion ou doivent-elles être considérées comme deux notions séparées ? Comment percevoir la dimension poétique, c’est-à-dire cette manière même d’habiter la littérature, sans que celle-ci soit ressentie comme une posture d’écrivain prétentieux et inaccessible ? Warhol avait prédit en 1966 que « bientôt toutes les choses à la mode seront identiques »… L’identique comme « fadeur », est-ce ce qui arrive également à la littérature, écrire étant l’activité à la mode la mieux partagée au monde ? Partout les mêmes livres, les mêmes « pensées »?
Écriture et littérature ? Deux notions qui doivent être distinguées puisqu’on assiste précisément de nos jours à un déluge d’ « écriture » (du côté de l’identité, de la fadeur, de la non-pensée) alors que la « littérature » devient rarissime à aussi raréfiée que l’expérience poétique du monde qui en constitue l’ouverture. La parole poétique ayant à voir avec la vérité de la sensation et de la méditation pensive d’une certaine expérience du monde, elle est à la fois la chose la plus simple et la plus difficile et il n’est nul besoin d’une langue prétentieuse pour la dire. Sur ce point, relire Acheminement vers la parole de Heidegger.
8 – Dans ta préface au volume des œuvres de Jack-Alain Léger (2006), tu rapportes ce propos du romancier : « L’histoire racontée n’a aucune importance. La seule vérité est dans la manière d’écrire ». Cette vision de l’écriture n’est-elle pas devenue pour le moins obsolète ?
Encore une fois, je ne la crois pas obsolète, mais minoritaire. Minoritaire bien sûr du côté de ce qui s’écrit, se produit, se publie. Et minoritaire du côté de l’ « attente » de la majorité des acheteurs de livres (que je distingue des authentiques lecteurs qui possèdent la Bibliothèque et l’Histoire, seul gage d’esprit authentiquement critique). Dieu merci, il est encore des auteurs pour qui la vérité est dans la manière d’écrire. Chacun fait ce qu’il peut, dans la mesure de son talent, de ses moyens, lesquels doivent de nos jours (comme hier, pensons à Joyce, Proust, Céline, etc.) n’être pas seulement artistiques mais stratégiques. La société qui n’en veut pas doit toujours être d’une certaine façon violée à frontalement ou en douceur, de force ou de ruse. Personnellement, je conseillerai plutôt la douceur, et la ruse façon « chinoise » (feindre de ne pas vouloir, détachement, etc.).

9 – La reconversion de l’écrivain en scénariste semble être une des alternatives proposées à l’écriture au 21e siècle. En effet, n’est-il pas attendu des écrivains qu’ils racontent d’abord des histoires (au premier degré du terme : intrigue, romance, rebondissement, dialogue sans fin, personnages campés, clichés collant à la « réalité », etc.) quitte à ce qu’une intrigue ou une romance remplace une autre et ceci au rythme des saisons ?
Absolument ! C’est ce que j’ai évoqué plus haut avec le storytelling. Il s’agit toujours d’être aux ordres : scénariste, adaptateur, dialoguiste dans une industrie où celui qui écrit n’aura pas le dernier mot, le final cut comme on dit. J’ajoute qu’une autre alternative de laquais, non concurrente mais complémentaire, est proposée à l’écrivain (cela se constate tous les jours et partout) : être « chroniqueur », c’est-à-dire commentateur de l’actualité littéraire culturelle dans les magazines télés, radios, etc. Un mot qui en dit long sur la disparition de la critique littéraire et des hiérarchisations qu’elle implique, même si la critique subsiste dans quelques niches sans réel pouvoir d’influence et qu’on peut toujours essayer de tirer son discours vers le haut à partir d’un strapontin de « chroniqueur »…
10 – Penses-tu que nous sommes passés dans une ère post-fictionnelle, c’est-à-dire dans une liquidation définitive de la littérature comme acte d’écriture ?
Je pense au contraire que nous vivons dans une ère absolument fictionnelle et à tous les étages (politique, société, finances, culture, mode, etc.) au sens où l’on ne cesse de nous raconter des histoires (et prenez cette expression dans les deux sens du terme !). N’identifiant pas la littérature à l’écriture (même si elle passe par du langage) mais à de la pensée en tant qu’expérience vécue par un sujet singulier doué pour l’infuser dans sa parole, il est clair que l’expérience en question est massivement découragée mais toujours possible. De ce point de vue, chacun doit répondre de son désir, de la façon dont il vit, des personnes ou des lieux qu’il fréquente, de sa liberté, de sa solitude, de ce qu’il lit, regarde, aime et comment, etc. Tout cela se vérifie dans les livres de chacun, c’est-à-dire dans ses phrases, son rythme, sa tonalité, etc.
11 – Dans ton Saint-Simon, tu rappelles qu’être écrivain, c’est échapper « par définition à toutes les définitions ». Or justement, aujourd’hui, un auteur est défini par le marché d’autant mieux qu’il publie des livres calibrés dont le contenu est immédiatement identifiable. Un écrivain dont le travail ne serait pas automatiquement identifiable peut-il encore espérer rencontrer un public, c’est-à-dire des lecteurs ?
Oui, la définition sociale de l’écrivain est aujourd’hui celle du romancier avec tous les malentendus dont nous avons parlés. Pensez à l’auteur de théâtre, de poésie, ou même à l’essayiste qui n’est pas sous nos latitudes qualifié de « non fiction writer » comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons mais assimilé à un vague journaliste, a fortiori quand il n’a pas quelques romans publiés à son arc… D’un autre côté, à partir du moment où vous publiez, vous touchez forcément des lecteurs. J’ai un peu honte de ce truisme mais c’est la qualité qui compte, pas la quantité. De ce point de vue, j’ai souvent été enchantée des contacts inattendus, riches et plaisants que j’ai pu avoir avec certains lecteurs. Et qu’ils puissent être des milliers, c’est déjà énorme, non ? De grâce, n’épousons pas le point de vue de l’éditeur !
12 – La plupart des romans affligeants publiés actuellement sont généralement relayés dans la presse par un vocabulaire critique publicitaire: « époustouflant », « passionnant », « phénoménal », etc. Pourtant, personne n’est dupe : ces ouvrages semblent le plus souvent sortir de la même matrice tant ils mettent en œuvre des techniques d’écriture identiques et des intrigues communes, généralement coupées de toute tradition littéraire et précisément scénarisés à l’instar d’un téléfilm. Tu soulignes dans le premier chapitre de ton Sterne que, aujourd’hui, le lecteur doit être « dégoûté par ces flopées d’écrivains qui roulent sur la pente du néant et se méprisent eux-mêmes avec des cris lugubres, assommé par tous ces livres-moins-que-rien-que-c’est-pas-la-peine ». Comment, d’après toi, un tel système hypocrite peut-il fonctionner alors même que nous cessons d’entendre des lecteurs s’en plaindre et exprimer leur déception quant à ce qu’ils ont pu avoir le malheur d’acheter ? Comment – alors même qu’il s’agirait de produire une œuvre « libre » et « librement » contre cette dérive (c’est un euphémisme) – échapper à l’assimilation, au broyage ou à la récupération de ces tentatives par le système lui-même ? Comment écrire à contre-courant aujourd’hui ? Penses-tu qu’Internet offre une alternative possible à l’édition et conduise, de gré ou de force, le système éditorial à se transformer ?
Vous mettez le doigt sur la disparition de la critique littéraire proprement dite (celle qui serait capable de distinguer la nouveauté du frelaté ou d’apprécier les réels apports artistiques en fonction d’une culture littéraire authentique) et son remplacement par l’instance universelle du compte-rendu et de la promotion. Vous pointez aussi une tare bien connue des éditeurs, des producteurs, des commerçants et des médiatiques (ce sont les mêmes !) : la sous-estimation permanente des goûts et des aspirations du public. Ceci étant, un écrivain n’a pas à penser d’abord au « système » et à le vitupérer, mais à ce qu’il écrit. On a beau dire, je ne crois absolument pas que des chefs-d’œuvre littéraires dorment dans des tiroirs faute d’avoir trouvé éditeurs. Quant à Internet en tant que nouveau support médiatique et système d’auto édition, gageons qu’il fonctionne aussi comme exutoire à la frustration et au ressentiment, sorte de Tonneau des Danaïdes des subjectivités en mal d’épanchement tous azimuts. Un des nouveaux enjeux pour le système éditorial est sans doute l’apparition du livre électronique avec téléchargements payants, etc., bref : tout un nouveau modèle économique en cours de redéfinition dont je suis bien incapable de vous entretenir ici.

13 – Warhol avait prédit que l’art deviendrait « de la mode artistique ». Penses-tu que la littérature prenne ce chemin et ne devienne peu à peu « de la mode langagière » dont la production ne s’adresseraient finalement qu’à deux populations : aux bobos et aux téléspectateurs ? Que ferais-tu si la littérature disparaissait complètement pour ne laisser place qu’à des ouvrages d’écriture expérimentale ou des romans de divertissement ?
« Mode artistique » ou « mode culturelle », le mot important est bien sûr « mode ». Soit, en surface : phénomène transitoire, éphémère, lié à l’air du temps, etc. En réalité, et c’est ainsi que se décrypte le cycle perpétuel d’apparition de nouveaux produits unilatéralement et autoritairement décrétés à la mode parmi lesquels se trouvent les livres, leur disparition est déjà inscrite dans leur apparition, sortes de déchets programmés où se dit quelque chose de leur destin. Ce phénomène est aujourd’hui massif, à la fois angoissant et passionnant, mais encore une fois, demeurent des interstices ou se faufiler. À la faveur d’un malentendu (et c’est plus fréquent qu’on ne croit), il n’est pas impossible que la mince brèche se retrouve boulevard… Parvenus à ce point de notre entretien, j’ai l’impression que vos questions sont surtout inspirées par la situation française et ne prennent pas en compte la littérature étrangère. Loin de sacrifier au tropisme aussi ridicule que masochiste consistant à trouver tout génial ailleurs sous prétexte qu’il s’agit de romanciers américains, anglais ou d’Europe centrale, la probité commande de dire qu’on a pu lire récemment d’ambitieux et de remarquables romans – je pense notamment à 2666, de Roberto Bolaño, ou au Tunnel de William Gass.
14 – Ton essai sur Sterne est intitulé L’Écrivain le plus libre dont tu dis que l’idée du titre t’a été inspirée par Nietzsche. De même, tu écris – te concernant – dans l’introduction de ce livre: « Je suis seule et libre dans un lieu inconnu (tout ce que j’aime) […] ». Tu seras d’accord avec nous (et beaucoup d’autres !) pour estimer que la liberté est au principe de la littérature qu’à la condition de considérer cette dernière au principe de la liberté, de toutes les libertés. Car on peut légitimement dire que c’est de la littérature qu’est née la liberté dont aujourd’hui, une société fétichiste de démocratie se prévaut. Or, tu l’auras sans doute remarqué, ce sont ceux qui ne jurent que par la démocratie, qui, dans le même temps, redoutent précisément la littérature parce qu’elle produit cette liberté. Peux-tu nous définir plus précisément l’idée que tu te fais de la liberté pour un écrivain ? Cette liberté dans l’écriture comprend-t-elle des limites et de quelle nature ? À tes yeux, les écrivains peuvent-ils s’exprimer tout à fait librement aujourd’hui dans une société comme la nôtre, dite « démocratique » ? Si oui, penses-tu que cette liberté se retrouve dans les œuvres de certains et qu’elle inocule une pensée propre à une évolution constructive de la société ?
Qu’un écrivain soit un esprit libre devrait être un pléonasme mais ce n’est évidemment pas le cas tant la servitude volontaire, l’autocensure et l’absence d’esprit critique battent leur plein. En le dédiant aux « esprits libres » à l’occasion du centenaire de la mort de Voltaire, Nietzsche a dit tout ce qu’il fallait sur la question dans son Humain trop humain. Ceci étant, la liberté n’est pas un concept abstrait mais s’incarne avant tout dans des corps parlants, ainsi que l’a montré l’exceptionnel moment libertin français au 18e siècle. Ce n’est pas la littérature qui produit la liberté mais un corps et un esprit libres qui sont peut-être susceptibles d’en écrire. Il va de soi que les autres noms de cette liberté sont la lucidité, l’absence de crédulité, un « athéisme » radical sur le plan sexuel, familial et social. J’ajoute que l’écrivain doit selon moi se contrefoutre de « l’évolution constructive de la société », laquelle est immémorialement indécrottable. Car la société a beau avoir promu la liberté comme valeur (au sens « formel » comme disaient les marxistes), l’histoire et l’expérience prouvent qu’elles entrent toujours en conflit. De plus, un écrivain est une solitude s’adressant à une autre, certainement pas quelqu’un délivrant un « message » à une communauté.
15 – Dans un autre ordre, tu dis dans ton Sterne qu’écrire « prodigue la joie de vivre dans une dimension parallèle de l’existence non contingente et comme issue de la lettre elle-même ». Expliques-nous ce qu’est cette joie de vivre et si elle rejoint finalement cette liberté que tu évoques ?
Cette phrase est liée au fait que, contrairement à l’opinion commune, un écrivain n’écrit pas ce qu’il vit mais vit ce qu’il écrit. En d’autres termes, l’expérience de l’existence, avec son riche clavier sensuel et émotionnel, n’a d’intérêt qu’à être incessamment raisonnée et pensée – c’est-à-dire exprimée dans du langage. Là-dessus, je ne peux que renvoyer aux fameuses pages du Temps retrouvé dites de « L’Adoration perpétuelle », quand Proust découvre qu’un authentique artiste n’est au fond qu’un « traducteur » de lui-même et que c’est précisément cette traduction qui rend heureux.
16 – Il n’est pas rare de lire ou d’entendre des propos contre tels ou tels écrivains de génie, voire même contre des écrivains contemporains talentueux. Dans ton Saint-Simon sous-titré L’encre de la subversion, tu soulignes ton étonnement d’avoir pu lire tant de critiques sur ses Mémoires dont tu dis qu’on « ne saurait trouver à un état plus pur ce déni de littérature qui équivaut à faire de l’écriture un symptôme ». De même, tu rappelles dans ton Debord que l’Irlande, par sa banque, après avoir persécuté Joyce, met en circulation en octobre 1993 un billet de dix livres à son effigie. Penses-tu qu’aujourd’hui, de tels écrivains seraient enfin reconnus et célébrés de leur vivant ou seraient-ils encore mis au banc de la société et leur œuvre dénigrée ?
Vous connaissez certainement le gag commis naguère par Dominique Noguez (mais aussi par d’autres) consistant à envoyer chez les éditeurs, sous d’autres titres et après avoir changé les noms des principaux personnages, les manuscrits des plus grands chefs-d’œuvre littéraires – tous évidemment refusés… Ceci étant, le moment de l’histoire littéraire auquel vous faites allusion s’inscrit, avec tout son ancien potentiel de négativité, dans un contexte métaphysique aujourd’hui caduc qui nécessite de poser la question autrement. Car aujourd’hui, même l’ancien régime de la postérité a muté. Sait-on ce que deviennent les supposés « grands hommes » dans la mémoire de ceux qui leur survivent ? Ne tombent-ils pas instantanément dans une sorte de trou noir ? Sait-on même qui est encore vivant ou mort (il m’arrive souvent de douter) ? Soit dit en passant, cette question est celle qui anime de bout en bout Warhol Spirit car la personnalité de Warhol comme l’époque dans laquelle il a vécu la problématisent admirablement. La célébrité ayant chassé l’ancienne notion de grandeur et l’amnésie étant assurée par le présent perpétuel, quid de l’ancien exercice du tombeau, cet éloge d’un grand homme disparu ? Néanmoins, je ne crois pas que Joyce, Proust ou Artaud soient « reconnus ». Faussement célébrés, oui ; récupérés mécaniquement par ouïe-dire comme des fétiches, certainement ; mais franchement, pensez-vous que le grand public sache précisément expliquer en quoi ils sont grands, profonds ou tout simplement géniaux ? Comme disait Céline, si on devient plus facilement fétiche mort que vivant, ce serait trop beau que le tombeau garantisse la disparition du déni.

17 – Tu publies deux préfaces conséquentes à deux ouvrages tout aussi conséquents : l’une pour les 50 lettres du Marquis de Sade à sa femme (2009) et la seconde pour les « conférences » données par Vladimir Nabokov entre 1948 et 1958 dans plusieurs universités américaines où il enseignait la littérature européenne (Littératures, 2010). Qu’ont représenté pour toi ces expériences de lecture et de relecture ? Qu’est-ce qui, chez ces deux maîtres absolus de la littérature, t’a le plus touchée et fait réfléchir ? Quelle expérience d’écriture et sur l’écriture en as-tu retirée ?
L’enthousiasme que j’ai eu à relire comme à écrire sur ces deux auteurs si implacablement énergiques et « souverains » tient au fait qu’en dépit des circonstances ou d’un environnement défavorables (des décennies de prison pour Sade, l’exil et la nécessité de changer de langue pour Nabokov exilé aux Etats-Unis), ils ne cèdent jamais sur leur désir, ne sont préoccupés que de jouir et de livrer la guerre la plus absolue à tout ce qui viendrait entraver cette jouissance à celle de créer et d’écrire. Quels meilleurs modèles ? Quelle meilleure leçon ?
18 – La « littérature » publiée aujourd’hui, dans sa grande majorité, ne l’est que pour participer à la société du spectacle. Or, tu soulignes dans ton Debord que la société du spectacle est toute entière puritaine. Cela n’entraîne-t-il pas fatalement le fait que « personne » ne lise (plus) « vraiment », pire – comme tu le rappelles dans ton Debord – qu’un tiers (!) des écoliers ne sait pas lire en classe de sixième ? Autrement dit, comment expliques-tu que l’on ne cesse de nous rabâcher les oreilles avec la promotion et la défense de la lecture, et que dans le même temps, il est bien difficile de trouver en France (66 millions d’âmes) ne serait-ce que 1 500 lecteurs avertis en littérature, capables de nous parler de Bataille, de Lautréamont, de Heidegger, de Rimbaud, de Ponge, de Bolaño, de Barthes, de toi… comme si… comme si, on ne tenait pas à ce que la littérature puisse être lue en dehors des ouvrages spectaculaires, donc puritains, que l’on sait ! Vois-tu un lien entre formatage de l’écriture, augmentation de l’illettrisme, désintérêt grandissant pour la littérature et les sciences humaines ?
Évidemment ! Est symptomatiquement promu ce qui disparaît ou a disparu, mais encore faut-il que la Société du Spectacle occulte soigneusement les raisons pour lesquelles l’illettrisme augmente, la capacité de lire diminue, les manuels d’enseignement du français au lycée deviennent si indigents, etc. Tout cela fait l’objet d’un silence de plomb – un silence déjà pointé par Debord dans ses Commentaires sur la Société du Spectacle – et pour cause ! Si la propagande assénée à la fin des années 80 sur la supposée disparition des « Grands Récits » et la « fin des idéologies » s’est appuyée sur le triomphe planétaire de l’économie libérale, force est de constater que ce triomphe est irradié par un autre processus d’une grande violence : le bouclage biologique et technique de l’espèce humaine dans l’achèvement de la métaphysique. Les conséquences de ce « dressage humain » en termes de désensibilisation et d’animalisation sont à la fois incalculables et parfaitement vérifiables dans l’ordre de ce qui s’exprime, s’énonce, se (non) pense et ne s’écrit pas. Si comme le disait Debord « pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire il faut savoir vivre », que signifie « savoir vivre » à l’ère du nihilisme accompli ?
19 – On trouve tes ouvrages généralement dans les rayons de critique littéraire ou d’art plastique (dans le cas du Warhol) et jamais en littérature à proprement parler ! Dans ton Sterne, tu soulignes toi-même la difficulté pour un lecteur d’acheter un « bouquin dépourvu de la sacro-sainte mention « roman » sur la jaquette » tout en ajoutant que le terme de « roman » ne veut de toute façon plus rien dire de nos jours puisque, en effet, n’importe quoi est publié sous ce label comme « on prescrit du Prozac ». Ainsi, sans être des romans au sens propre, tes livres sont bel et bien des œuvres littéraires écrites avec un souci propre aux seuls vrais écrivains. Dans ton Sterne, tu cites Nabokov qui avait dit avec raison qu’un écrivain digne de ce nom « n’est jamais obligé d’écrire des romans ». Cependant, comment présenter tes ouvrages qui ne sont ni des romans ni des essais biographiques mais plutôt des œuvres d’épistémologique littéraire (à la croisée de l’art, de la littérature et des sciences humaines) ? Est-ce un nouveau genre qui voudrait échapper à tous les anciens tout en reprenant certaines de leurs caractéristiques en proposant finalement, une autre approche, une autre manière de penser… une autre manière d’écrire ? As-tu abandonné définitivement l’idée d’écrire des « romans » ?
Partant du principe qu’il y a des « livres » et des « non-livres » (le critère de différentiation étant leur aptitude à « tenir dans le temps »), je ne me suis non seulement jamais souciée de la question totémique du genre mais me suis permis certaines libertés dans celui de l’essai. Car l’essai est un genre littéraire à part entière dont je revendique qu’il puisse être un art au même titre que le roman. Si Marthe Robert a bien montré en quoi la grandeur et la richesse du roman tenaient à sa possible inclusion de tous les genres et registres, l’essai peut également inclure de la fiction, de la biographie, du récit, et nécessite de toute façon une forme, un style, un registre rhétorique qui sont chaque fois à trouver en fonction du sujet. Sinon, j’ai déjà publié un roman (Le Musée national, 2000), et n’ai abandonné en rien l’idée d’en écrire d’autres à de même que récits, théâtre, poésie…

20 – Crois-tu qu’en littérature, il soit possible à partir de cette idée très flaubertienne de Warhol, de « traiter le rien comme s’il était quelque chose. Faire quelque chose avec rien » ?
Sur ce point, je ne peux que vous renvoyer au célèbre Monologue de Novalis qui me semble la quintessence même de la « »chose ». Méditons seulement cette phrase : « Précisément ce que la parole a de propre, à savoir qu’elle ne se soucie que d’elle-même, personne ne le sait ». Il existe en effet un lien entre la parole, la gratuité et le rien, qui ouvre sur l’incommensurable d’un trésor. À la fois secret et à portée de main, relevant du plus « simple » et ouvrant à l’énigme de l’Être, c’est celui de l’expérience poétique elle-même qui ne coûte et ne rapporte rien, radicalement située hors-marché, « sans prix » comme dit Rimbaud.
21 – Pourrais-tu refaire le schéma que tu présentes p. 24 de ton Warhol en prenant que des noms d’écrivains ? Autrement dit, comment ton schéma peut-il s’adapter à la littérature ? Quelle a été dans ton existence ta première émotion littéraire ? La retrouve-t-on dans ce schéma d’une quelconque manière ? Existe-t-il un ou plusieurs livres écrits par les auteurs que tu cites dont tu aurais aimé être toi-même l’auteur ?
On pourrait effectivement reproduire de semblables schémas (forcément sommaires) avec les surréalistes, les situationnistes, Tel Quel, bref : tous les mouvements littéraires d’avant-garde qui ont reclassé et repensé la Bibliothèque à partir des coordonnées historiales qui étaient les leurs. En ce qui me concerne, ce schéma n’aurait aucun sens même si, comme tout le monde, certains auteurs m’ont plus influencée que d’autres. Je pense notamment à Baudelaire et Pascal qui, dès le début de mon adolescence, m’ont enthousiasmée à ainsi que Nietzsche, lu vers 14 ans sans rien comprendre mais jamais lâché depuis. J’en déduis que ce qui me touche au nerf est lié à une grande sûreté assertorique de pensée (c’est sans doute un pléonasme !) à laquelle la beauté est intrinsèquement liée. S’il est métaphysiquement impossible de répondre à votre dernière question, la seule chose que je puisse dire, c’est qu’il m’arrive d’être bluffée au point d’envier certaines trouvailles ou visions de ceux qui sont mes stricts contemporains. Je pense, par exemple, à Prolongations, le dernier roman d’Alain Fleischer, ou dans un tout autre registre, au livre de Thomas Clerc : Paris, musée du XXIe siècle : le 10e arrondissement.
22 – Damien Hirst ou Jeff Koons – pour prendre deux exemples très connus – sont-ils des nouveaux Warhol ? Leur démarche artistique peut-elle engendrer un renversement dans l’art en changeant certains paradigmes ? Ont-ils une influence seulement dans leur champ ou touchent-ils toute la société en engendrant des gestes autant provocateurs que « définitifs », c’est-à-dire poussés au plus extrême ? Aussi, pour poser autrement la question, il semble qu’il se passe des choses dans le champ des arts plastiques qui ne se passent plus en littérature… où sont les auteurs qui renchériraient sur Sterne ou Debord aujourd’hui ? Faut-il être en danger de mort à cause de ses engagements politiques comme Shi Tao, Orhan Pamuk, Salman Rusdhie, Nawal El Saadawi, Raùl Rivero et surtout le dernier en date, Roberto Saviano pour compter en littérature de nos jours ?
Damian Hirst et Jeff Koons sont des épigones de Warhol au sens où ce dernier a prophétisé l’avènement du « business art », c’est-à-dire au sens où la valeur d’échange de l’art a absorbé toutes les autres, ce qui est la définition même du marché. Certains les achètent ou les exposent parce qu’ils sont chers – achats et expos qui font encore plus monter leurs prix. Ils ne renversent rien, ne changent aucun paradigme mais au contraire les durcissent, participant à fond au Spectacle et l’alimentant dans de variables proportions d’ironie kitsch. En ce sens, ils sont infiniment plus cyniques que Warhol chez qui la part d’innocence et de candeur signe une fraîcheur manifeste au premier coup d’œil. Que se passe-t-il de si notable dans le « champ des arts plastiques » ? Sans doute brasse-t-il des sommes gigantesques (et encore, sur une tête d’épingle). Sans doute déclenche-t-il sporadiquement quelques faux scandales tant il a érigé la pseudo-provocation au rang d’instrument marketing (le « tatoué » de Wim Delvoye, les prestations plus ou moins hardcore de X lors de la dernière Fiac, etc.). Mais dans l’ensemble, avec son lourd tropisme porno, son obsession incessante de traiter l’être humain comme un déchet et de l’animaliser, sa grande misère symbolique, ce « champ » fait majoritairement figure de laboratoire live du nihilisme dont les acteurs seraient les collabos directs… Ce qui pourrait exister de différent, on ne le voit pas et on n’en parle donc pas…
23 – À la fin de ton Debord, tu conseilles de le « reprendre au début »… ce que nous avons fait. Nous avons ainsi pu relire le livre autrement, le redécouvrir alors même que nous le connaissions. Pourquoi cet effet ? Était-il prévisible ? Qu’est-ce qui fait que ce livre n’est pas un simple livre de commentaires, mais construit une véritable pensée directement reliée à l’œuvre de Debord ? Est-ce parce qu’écrire, c’est-à-dire écrire de la littérature, au fond, c’est faire corps à la pensée de ce qui a eu lieu, c’est – pour te citer ( !) – « citer les écrivains qui vous ont tissé » ?
Cet effet vient sans doute du fait que le livre comprend de nombreuses citations de Debord qui, de son propre aveu, est « facile à lire mais difficile à comprendre ». Écrit sous forme de fragments reprenant la densité aphoristique qui les caractérise tout en les modulant dans un ordre logique par forcément facile à distinguer, le livre semble, en effet, ne pas être épuisable à la première lecture. En résulte aussi une sorte de ventriloquie où l’on se sait plus qui parle. Par ailleurs, il est fondamental pour l’interprétation de pouvoir prendre appui sur le maximum de temporalité, d’être capable de rapprocher des pensées et ouvrages situés à des périodes très éloignées les unes des autres, de faire sauter constamment le verrou de l’historicisme.

24 – Quelle place la fiction possède-t-elle dans l’ensemble de ton oeuvre et de projet d’écriture ? Comment la lectrice méticuleuse que tu es de Sterne et Debord conçoit-elle la fiction, l’écriture d’une fiction ? Il y a quelques décennies, dans une radicalisation de certaines options esthétiques propres au 20e siècle, on avait envisagé la conception d’une fiction sans histoire, obtenue par une écriture au présent, sans sujet autre qu’une voie narrative descriptive d’une progression du récit aboutissant à la métaphore chaque fois recommencée du récit lui-même, se décrivant à mesure dans l’énonciation indéfinie de ces procédures. Plus généralement, il s’agissait de faire du neuf au niveau des formes. On a ensuite dénoncé cet extrémisme au profit d’un plaisir du texte, celui de raconter des histoires mais il apparaît bien désormais que le simple fait de raconter quelque chose ne suffise pas au plaisir de lire. L’impératif de faire du neuf contre des formes anciennes n’étant plus, qu’est-ce qui motive aujourd’hui un auteur à faire de la fiction, indépendamment du plaisir de narrer ?
Au point où nous en sommes, ces débats théoriques me semblent un peu vains, même s’il est évident que « raconter une histoire » ne me motive pas. En ce qui me concerne, j’ai abandonné pour le moment ce que vous appelez mon « roman sur l’Inde » (il excédait néanmoins ce thème) car mon essai sur Warhol (je sais que cela peut paraître bizarre) a absorbé une partie des thèmes qui y étaient mobilisés. En ce moment et parce qu’un projet spécifique me requiert, j’envisage la « fiction » comme l’écriture-témoignage d’une « expérience » personnelle (elle peut être physique, historique, psychologique, spirituelle et/ou métaphysique) nécessitant peut-être un « dispositif », mais dont la dénomination éditoriale m’importe peu car à partir de l’ « écriture de soi », récit, roman ou mémoires sont également recevables. Au fond, il ne s’agit que d’agencer, phrase après phrase (comme frappe après frappe), selon sa sensibilité et son idiosyncrasie artistique propres, un « texte » dont j’espère qu’il sera empreint (comme mes essais) d’un goût, d’une énergie, d’une liberté, d’une certaine tonalité psychique à ce que d’aucuns, dont je fais partie, nomment un « style ».
Entretien © Cécile Guilbert & Caroline Hoctan – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum
(Paris, juin-sept 2009)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.