«
Préparatifs en vue d’un papier fût-il anarchique [1], il ne s’agirait pas en ce cas d’en tirer tout à fait gloire, soit la prévision d’emblée d’un défaut, s’il va seul, s’il ne s’en distribuera pas quantité à compter de ce qui ici commence. D’un papier constitué, ainsi qu’il apparaîtra, de plus d’une note, non pas — dérogeant à la règle jusqu’alors non inquiétée (et peut-être cela fera-t-il règle) — sur un(e) auteur(e) unique, mais plus d’un(e). Notes de lectures, donc, ayant en commun, outre qu’elles auront distinctement marqué, leur récence. Lectures parfois inachevées, et achevées, appelant au moins une relecture, moins défectueuse, avec les accessoires de rigueur ou petit attirail (papier, stylo) prenant note, lisant en vue de ces notes.
Trois livres, à dire de chevet comme l’est ce quatrième, Le Monde des amants / L’Éternel retour de Michel Surya, mais dont l’écriture d’une note à son sujet est reportée. Les quatre semblent exiger plus qu’une note, trois livres. La Vache nettoyée, d’Alin Anseeuw ; Flamboyants au crépuscule, de Christian Dufourquet ; et Aberrants & dinosaures, d’Amandine André. La Vache nettoyée compte, d’entre les trois, comme le moins récent se fiant à son année de parution [2] (1985) or tout se passe, à sa lecture, comme s’il venait de paraître — parvenu en tout cas ici l’automne dernier (la note, ici, est hivernale). Et il n’y a pas, éparses au fil des pages, les marques d’une altération temporelle où s’évaporeraient des qualités présumées (confer « l’enthousiasme » médiatique, critique qu’il y a, sitôt tel livre paru, tel autre, forçant artificiellement l’effet de nouveauté comme s’il était la seule qualité). Non.

Et toute qualité faisant défaut à de tels livres, survient le constat obligé qu’ils vieillissent et meurent, mal donc. C’étaient les généralités en un trait (ou succinctement l’établissement d’un contexte, à l’existence de La Vache nettoyée qui y figure — sans commune mesure et distante peut-être, ou en retrait, ailleurs en tout cas). Telle corne faite au livre, l’unique sauf méprise (p. 118), sans la précision au crayon à papier, en sa marge, de la séquence à relire — puisque c’est là tout le sens de « corner » —, et qui ce soir fait se rouvrir le livre, sur cette page même, avant même l’incipit su par cœur. L’unique « corne » serait l’anomalie relisant La Vache, soit vache unicorne ou alors dont une deuxième serait à rechercher dans le volume. La page, donc, est relue, pour ce qui alors en justifia la corne — autre recherche — et c’est : telle image de la déchirure oculaire revenue à l’esprit. S’il y a lieu de s’arrêter sur une image scripturale (de plus de force en l’occurrence que photographique, attendu qu’il y a les mots mobiles de ce qui se formule), de ne s’arrêter qu’à l’une d’elles et ce qui en décide, telle est la question. Faisant droit au sensationnel dans la pensée. La phrase : « Dans le tableau, la déesse volage qui deviendra peut-être un jour, pour quel spectateur aux yeux déchirés, pour quel lecteur aux yeux révulsés : le corps sadique et mental ». Retour aux premières pages ; d’avant ce qui est dit être l’énervement, et après quoi reprendre plus studieusement toute phrase : « Il s’énerve au bout de deux pages. Voudrait reprendre, s’arrêter. Ou le tombeau entre les jambes. [La citation, exprès, va plus loin, là où l’écrit va plus loin et sidère, en sa chute] Le temps tourne. Sur une terre « insupportable ». Et sur l’arme grise du chevilleur — des gestes sans fracas, sans fantaisie. Étrange et éloquente hauteur d’une parole pourrie dans le sang du visage ».
Il y aura ici le défaut, s’agissant des trois, de n’aller pas assez dans les profondeurs, mais le mot note, fussent-elles plusieurs, dit bien ce qu’il dit (que c’était comme la clause), l’impossibilité même et la circulation de surface, interceptant des objets inouïs afin de les exposer au regard. À peine plus loin dans La Vache, où le nom de poésie circule allait s’écrire en pleine prose mais alors aussi dense, intensément dense qu’il arrive au poème de l’être (il se dit encore, se croyant quitte d’une telle expression, l’ayant prononcée : prose poétique, et c’est comme justifier jusqu’à l’érotisme qu’il y a, qu’il ne soit pas insoutenable) et semblant venir défier les commentateurs d’époque future, comme s’ils ne pouvaient d’avance que tout manquer, d’importances éparses. Plus loin, donc, en telle séquence, étendue, d’aphorismes : « Poésie je t’appelle. Mais tu n’as pas de visage mesurable ». Ou encore : « La poésie, un désert à traverser. À côté, les bruits du monde, la tempête sans bruit. Son camp, son théâtre de moineaux ». Ailleurs, où elle voudrait être définie plus [ou comme] définitivement : « La poésie n’est pas action, ni aventure. Le poète doit maîtriser le désir qui le porte » (p. 50). « Dans le monde des apparences, la poésie salit le regard » (p. 66). (Salit n’est pas le moindre des mots, ne peut avoir été hasardé dans le livre, une indemnité est en cause, de cela qui peut-être ne peut être nettoyé). Note : Il a été dit — livre de chevet ; la relecture en cet instant même indique ou constate qu’il en faudrait mille autres, condition de parvenir à telle qualité du commentaire qui ne heurtât rien des phrases en présence. Il en irait avec ces lectures de davantage qu’un plaisir, à voir réapparaître mais comme pour la première fois ce qui n’avait été lu qu’avec précipitation, presque, d’intérioriser l’ensemble.
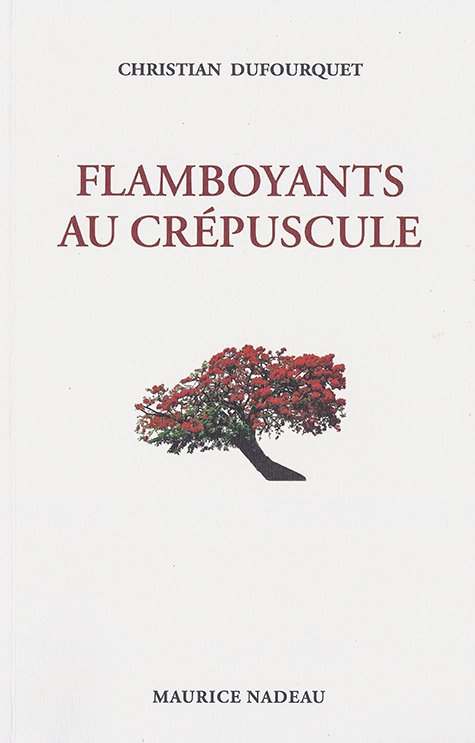
Flamboyants au crépuscule, dont il y eut lecture linéaire quand était-ce ? D’avant, tristement, la mort de l’auteur ; livre qu’il [Christian Dufourquet] aura pu voir paraître de son vivant, avec prescience* toutefois qu’il s’agirait-là de son dernier, rejouant une scène des adieux de plus d’une décennie antérieure s’agissant de poésie, de sa poésie (et plus théâtrale alors, d’un théâtre cependant d’autant de cruauté qu’il est possible d’accomplir en une écriture, depuis et avec Artaud. Je renvoie ici à Je la nuit). D’une telle lecture — ou plutôt de cela que l’on dit être le fil de l’action, attendu d’un roman, d’un récit — il n’en reste ici de mémoire qu’incertaine (cas de l’attente comme inattentive, l’attention venant se porter ailleurs, et plus précisément : sur ce qu’il se passe dans le texte, avec cette écriture [revisionner tout à l’heure le documentaire qui lui aura été consacré, accessible sur la Toile — ce qu’il y dit magnifiquement du style] que tout vivant doté de regard reconnaîtrait à l’œil nu s’il s’y enfonçait. Profondeurs. Disons-les aquatiques, à ne jamais cesser d’y penser — réserve d’oxygène, le souffle rare — à ses écrivains de prédilection, de Rilke à Lautréamont (« ô Isidore » [3]), de Proust à Kafka. [Le documentaire évoqué, donc, titré Un pas, un mot, je transcris ici quant au style : « Mon style : la griffure de ma présence sur un support. Par contre, c’est la présence entière qui est dans l’écriture. Je n’ai pas dit que c’était quelque chose d’évanescent. Je pense que c’est ce qui est au plus profond de soi […]. Griffure de quelques mots dans le néant ».]. La forme de Flamboyants pourra sembler — mais alors avec quantité de guillemets — classique, de prose étendue, encore que traversée de séquences devant immensément au poème, poésie pratiquée dans la jeunesse et dont il y a éparsement échos : « Il était une fois un garçon ou une fille ou un animal perdus dans une forêt profonde. Il était une fois un père et un fils en train de gravir ensemble le bas, l’extrême bas de la montagne de Dieu. » L’écho en est notamment, ici, du poème sur lequel se referme Je la nuit : « […] où nous sommes et l’attente / après la destruction patiente par nos larmes / d’un regard peint pour personne / sur la montagne de Dieu ».
Note n° 5 : Quant à Flamboyants dans le titre, Flamboyants au crépuscule, il est précisé dans le texte ce dont il s’agit — rien d’une emphase rapportée à soi ou alors en filigranes, avec ironie grinçante : une seule espèce végétale* dont la couverture donne l’image. « Il se souvient de l’odeur des poivriers, des frangipaniers, de l’explosion des flamboyants au crépuscule, lorsqu’il emprunta, ivre de fatigue et de senteurs inconnues, une avenue puis des rues que de rares loupiotes éclairaient… »
L’astérisque : arbre des régions tropicales aux fleurs rouges, dit le dictionnaire.
Note n° 7 : L’épigraphe du livre, d’importance. Kafka, en cette place même, donc, d’ouvrir le volume, Kafka, si présent — de mémoire presqu’en toute page : « Tu parles toujours de la mort et tu ne meurs pas. — Et pourtant je vais mourir. Ce que je dis est précisément mon dernier chant […] ». Flamboyants accomplirait, accomplit le dernier chant de l’auteur, si c’en est un — en arrière de la surface graphique, surgissant par endroits. Il y aura eu ainsi le temps de ponctuer, d’un signe comme magique, si infime pourtant, le plus infime des signes, d’où pouvoir mourir (réalisant la mort, quoi qu’il en soit de toute tristesse).
« Une entourloupe contre l’apocalypse du moment », voici qu’arrive, mais en vérité revient revenant* — le troisième ; formule provenant de la quatrième de couverture, d’Aberrants & Dinosaures. Sa lecture, donc, à reprendre, écrivant dans les marges mais au crayon à papier au cas où il importerait, la note achevée, d’en tout effacer, tout : toute inscription ou marque jusqu’à celles, plus difficilement discernables, déposées par les yeux (accessoires effleurant, comme s’il en était des rayons, fleurets invisibles, le papier même). Page onze. Le texte est sous mes yeux. Il faut le lire. Ceci va sans les guillemets qu’il faudrait, il s’agit ici d’une citation intériorisée d’Aberrants, page onze, et tombant à pic, phrase que l’on s’adresse, ayant à écrire au sujet du livre, étant entendu qu’il aura été lu déjà (une autre lecture cette fois, de telle page, telle autre, rappelle graduellement l’ensemble). De côté : « Un texte est une surface dure et résistante les yeux se cognent dessus ». Il doit dépendre, sans doute, du texte, voire du contexte de lecture (« En hiver, les textes sont froids »). Et c’est alors une vérité, comme cette autre : « Les choses n’arrivent qu’à ceux qui peuvent les raconter ». Voici, rapportées, les phrases — sentences — qui auront marqué (s’il importe seulement de raconter le cognement), décidé qu’il y aurait cette petite chose, écriture sur l’écriture. Le volume s’ouvre, c’est à noter, sur l’ennui, l’ennui comme socle, condition de ce qui vient — afin d’en tout rompre. « L’ennui arrive. Il est là il me sent. Il me cherche. Par la fenêtre. Il serait là, par la fenêtre s’il devait être là. C’est infini, l’ennui est infini. Il me pèse. Il va me peser il approche. Seulement il ne m’a pas encore attrapé. L’ennui est infini parce qu’il est giratoire ». D’en tout rompre, par micro-récits où affleure, par énigmes, jeux énigmatiques, le poème en prose (Henri Michaux entrevu — à ce qu’il semble — comme le prochain même : « Pour tenir je ne sais quoi, j’avale ma langue, j’avale mon bras gauche, j’avale ma main droite. Nous sommes l’esprit de la poussière de béton et de la cendre des champs) ; notes oniriques, fussent-elles du rêve éveillé, là un indiscernable, entre rêve et rêve, précisément ce qui intéresse ; fragments théoriques (« Les délires de la tête de nos têtes et le délire du corps de nos corps sont autre chose. Techno-magique peut-être. Proto-sonique sans doute. C’est une question de comportement. C’est certain. Nous avançons des hypothèses et des hypothèses sur notre existence spécifique de personnages poétiques ». Tout le fragment serait à citer, indice que le possible d’une pensée soutient ce qui a lieu, ce qu’il se passe avec cette écriture précisée sans pareille. Et alors qu’une incise dans les notes, telle phrase, allait mentionner le rire parfois — fût-il silencieux lisant (et sous-tendant l’écriture) — survient cette phrase : « Seule la nuit est pour tout le monde, alors j’enregistre les fous rires que je propage dans l’univers. Et je prête mon petit pyjama, même aux araignées ».
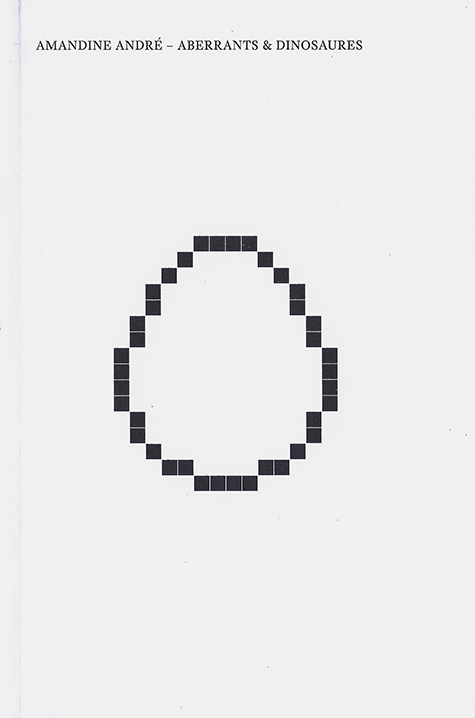
De ces trois textes, impossible de revenir (confer le « je n’en reviens pas »), mais y revenir autant de fois qu’ils en décideront dans le temps de vie. Ils auront semblé pouvoir être réunis en ce papier, ce papier appelé papier ; tenant lieu chacun de stimulation — plus qu’intellectuelle s’entend — de ces derniers temps.
Texte © Denis Ferdinande – Illustrations © DR
Combinaisons poïétiques est un workshop d’analyse poïétique in progress de Denis Ferdinande.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
[1] Ce mot qui est comme l’explosif même pour nos temps.
[2] Plus précisément, s’agissant de l’époque d’écriture, il est indiqué : « Cette version de La Vache nettoyée, rédigée autour des années 80, a été mise en page […] ».
[3] Alejandra Pizarnik : « ô vie / ô langage / ô Isidore », cité p. 13.
