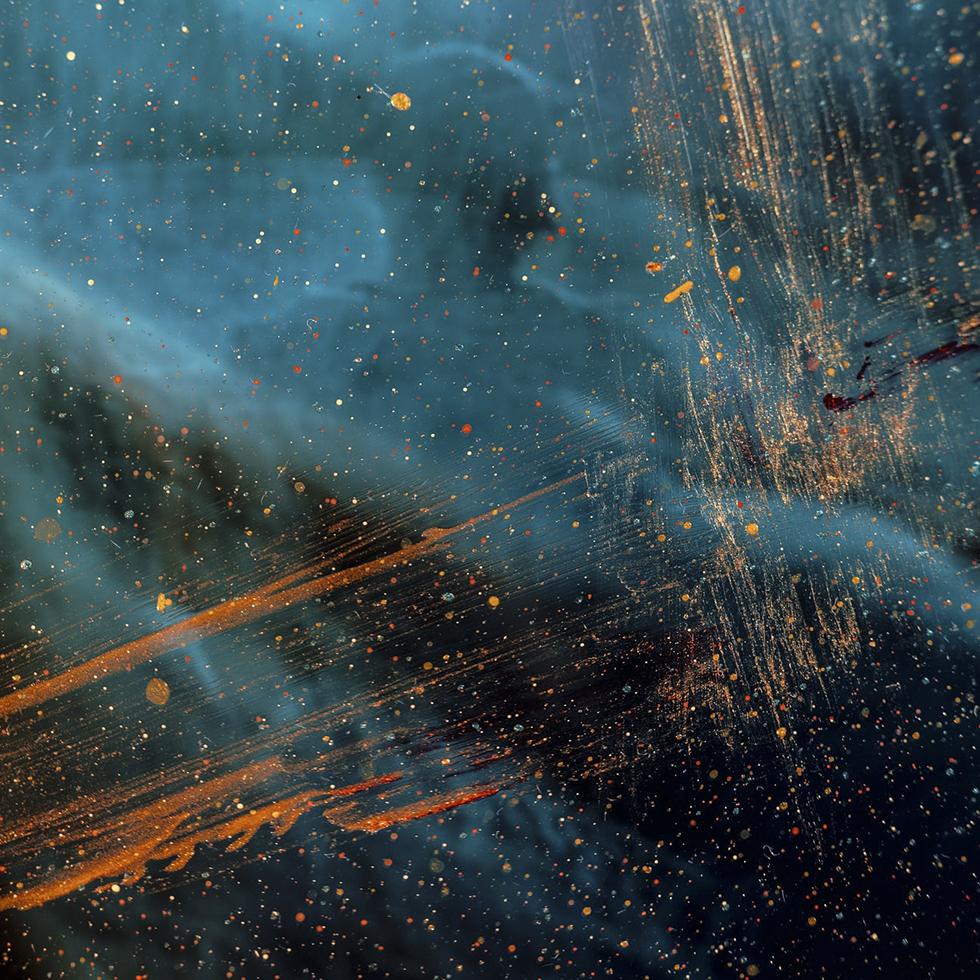DENIS FERDINANDE rencontre STÉPHANE SANGRAL pour échanger sur leur démarche d’écriture respective, et sur la volonté de leurs oeuvres de faire advenir une « alterlittérature » :
Telle difficulté, notée préalablement pour soi avant de commencer, s’agissant de s’entretenir au sujet d’un livre non des moindres en l’occurrence, arrivé il y a peu, une année jour pour jour, et apparaissant comme à rebours très nettement de ce que nous savions jusque-là du livre et de ses possibles, de ce qu’il saurait devenir à commencer par ceux des grands rayonnages : peu attrayants, moribonds, tristes, plus ou moins bien ficelés, les lourdeurs éparses, insoutenables, et pour tout dire de forme comme durcie, congelée, dont il s’oublie précisément de questionner cette forme même, s’il n’en faut qu’une par ailleurs — afin de la pulvériser —, oubliant qu’il est un sens de la question, qu’elle est, même, la condition même d’une possible nouveauté (l’antonyme donc en serait la répétition ad nauseam de ce qui est déjà et désole) ; la difficulté ou inévidence, consistant en cette situation même, du poseur de questions pour toute épreuve, comme s’il importait de la dire. Le livre venons-y, paru en 2020 aux éditions Galilée (son « actualité » pas évaporée depuis), s’intitule Infiniment Au Bord – (Soixante-Dix Variations Autour Du Je), et il est à noter — au-delà de ce seul livre — l’extrême attention portée aux titres, toujours ; sept livres ayant déjà paru chez le même éditeur, celui-ci étant le huitième, titres chaque fois non quelconques, jamais. Une nécessité y préside, sous le nom desquels se déploient au moins deux registres distincts d’écriture, ou philosophique ou poétique, et là les collections éditoriales diffèrent — que penser d’une telle partition ? —, sachant qu’il y a interpénétrations, ou autrement appelées : navigation entre, perpétuelle. Laquelle saurait relever de l’énigme de ton écriture, Stéphane : qu’en penses-tu (ou suivant l’homophonie à l’œuvre, que — presque [1] — je t’emprunte) : quand penses-tu, y a-t-il des heures dans le jour où se posent à tes yeux, ou à tes oreilles, intérieurement, de telles questions, relativement aux titres, à l’écriture, à ses registres ? L’enregistrement a commencé déjà,
J’aurais aimé, je crois, que mes œuvres ne soient qualifiées ni de poétiques ni de philosophiques, mais de poètosophiques. La poésie et la philosophie sont deux registres textuels troublants, dans le sens où ils ne cessent, à chaque œuvre, et de plus en plus à mesure de modernité déconstructrice, de se redéfinir ; dans le sens où ils sont deux registres textuels troubles. Toute frontière, quand bien même pertinente en surface, est absurde en profondeur, et la frontière entre poésie et philosophie n’échappe pas à cela, s’agissant dans les deux cas, avec des pioches aiguisées plutôt par l’esthétique ou plutôt par l’argumentatif, d’un creusement textuel à la recherche d’un gisement de sens. Et plus le creusement atteint des profondeurs où se dévoilent et s’élaborent d’immenses réservoirs de sens, plus le sens de la frontière entre poésie et philosophie se trouve dilué et finalement, homéopathique, converti en non-sens. Mais qu’en sera-t-il de cette deuxième frontière passant entre la pertinence en surface de la frontière entre poésie et philosophie et son absurdité en profondeur ? Elle non plus, probablement, n’échappera pas à cela, pertinente en surface, absurde en profondeur. Mais qu’en sera-t-il de cette troisième frontière passant entre la pertinence en surface de cette deuxième frontière et son absurdité en profondeur ? Elle non plus, probablement, n’échappera pas à cela, pertinente en surface, absurde en profondeur. […] Mais qu’en sera-t-il de cette énième frontière si ce n’est faire office de corde sur laquelle, l’infini en contrebas, mes réponses à tes questions tenteront de marcher, d’avancer, funambules poètosophiques, à la recherche de leur impossible équilibre, infiniment au bord de chuter. Et si le déséquilibre entre les mots constituait la définition du sens d’un texte ? Alors mes réponses à tes questions tenteront de marcher, d’avancer, à la recherche de l’impossible équilibre de ce déséquilibre, infiniment au bord du silence. Et puis surgit, par le miracle de l’homophonie, par la mutation du « qu’en penses-tu » en « quand penses-tu », la question du temps, la question atemporelle du temporel. Quand, mes pensées relatives « aux titres, à l’écriture, à ses registres », quand existent-elles ?
1 – Je pense à son titre avant de commencer le travail d’un livre, à chaque fois, sans exception aucune, le titre constituant la colonne vertébrale de chacun de mes livres, ou la base ontologique indispensable à son passage de l’état de rêve à celui de réalité.
2 – Je pense à l’écriture tout le temps. Au moins tout le temps, car également dans le débordement du temps. Il me semble qu’un créateur, s’il ambitionne autre chose qu’un simple artisanat, ou du moins s’il ne veut pas progressivement y tomber et s’y enliser, n’a pas le choix, le fanatisme est sa seule modalité d’existence. Donc oui, j’y pense tout le temps. Soit explicitement, soit à bas bruit, dissimulé sous d’autres pensées, avec des jaillissements réguliers m’enjoignant de changer tel mot de tel texte d’il y a 3 jours ou de modifier telle ponctuation de tel texte d’il y a 3 ans, ou m’enjoignant de noter et de classer et de développer telle idée pour tel texte futur. Le repos n’a pas de sens. Un cœur, jusqu’à la mort, ne cesse pas de battre.
3 – Je ne pense jamais aux registres d’écriture. Jamais. Sauf ici. Ici où la question de la distinction entre le registre de la poésie et celui de la philosophie peut-être se déplacera — puisque c’est ici que cette question se pose, ici avec toi, par toi, dans l’admiration mutuelle de nos littératures — peut-être se déplacera vers la question de la distinction entre le registre de l’entretien et celui de la littérature…

Déplacer une frontière, l’écarter, voire. Elle encombre, pure « chose » chimique dans le cerveau pourtant (tout au plus physiologiquement la contrariété), dont il résulte telle transmutation sous forme élémentaire de langage et perdurance, n’est vue en effet ici qu’intenable, vérifiant toutefois chaque jour son usage encore. Il est possible d’être attaché à la distinction ; qu’il en soit pour y œuvrer depuis les écoles quelles qu’elles soient, le lycée où la philosophie se marque de cette distinction sous le nom de matière, certes parmi d’autres, mais que ne vient pas corrompre en tout cas ce qui n’est pas elle*. Prose étrange. La poésie, elle, inquiétante à divers degrés — suivant la manière dont se force l’étrangeté —, est écartée, écartée de toute école [2], comme déjà la frontière passée laquelle il n’est plus de frontières, « terrain vague où enfant je jouais à être un / terrain vague où l’errance jouait à être un / terrain… » [3]. — Georges Bataille : « Je crois qu’il y a quelque chose d’essentiellement puéril dans la littérature ». Il dit certes littérature (j’avais écrit littérautre) et non poésie. Et peut-être, suivant le fil de la coquille [4], décidant de ce qui vient, n’y aura-t-il jamais de littérautre, ainsi qu’il importe particulièrement pour nos temps, qu’en passant par la poésie. Soutenue, donc (le registre soutenu oui ou non à l’œuvre). Je ne suis sans doute pas comme toi, Stéphane, poétosophe, or ce sont précisément les marques visibles et lisibles de cette fusion réalisée qui me valent l’admiration certaine vouée à ton écriture, que je t’avoue, comme en passant — n’était certes pas un secret. Je laisse le présent fragment, cette fois, sans questions. Suivant qu’il s’en formera en toi le lisant. Ou alors celle-ci seule, si c’en est une, il y a ce mot, que tu auras prononcé, qui pourrait rester incompris, de « fanatisme » (il n’inquiète pas en tout cas, appliqué à la musique populaire, et ses fans, ses faons, d’une faune elle aussi étrange parmi laquelle il m’arrive de compter). Plus précisément : de fanatisme comme « seule modalité d’existence »…
Une question presque absente, et presque présente dans le même temps, en tout cas absente et présente dans son presque, dans son trouble. L’on ne sort pas du registre du trouble. Là où les frontières s’effacent, ou plutôt là où les frontières dévoilent en surface leur effacement profond. Encore une à effacer, celle passant entre l’absence et la présence. La philosophie serait une « prose étrange », et la poésie le niveau supérieur où se « force l’étrangeté », pour accéder à une alterlittérature, une littérailleurs, une « littérautre », oui, je te suis, je te suis tout à fait, c’est une perspective, ce n’est qu’une perspective, mais je la suis avec toi, c’est celle-là que je suis, avec le verbe suivre, avec le verbe être. Car l’étrangeté générée, le trouble induit, permet d’estomper un peu la frontière la plus immense, la plus fondamentale, la plus implacable, permet de déconstruire un peu les murs les plus épais, à savoir ceux qui, nous cernant, définissent notre prison sémantique. A savoir ceux qui, pour notre bonheur, constituent notre savoir mais qui, pour notre malheur, nous y enferment. A savoir, va savoir, et tout savoir s’y dessèche… Et l’on y tourne en rond… Et l’on y étouffe… Le trouble textuel, oui, pour au moins croire que nos murs sémantiques sont loin, que notre prison est vaste. Et pour rêver à des murs si lointains que disparaitrait même, alors, la notion de prison. Ce trouble, le trouble textuel, je l’ai ressenti et incessamment recherché depuis l’enfance, avec les livres de l’enfance, quelques mots, beaucoup d’images, des images qui me fascinaient et irriguaient de fascination les mots, les mots qui alors prenaient tout l’espace et surtout m’ouvraient d’autres espaces. L’idée d’être en prison et de vouloir en sortir devait déjà quelque part, implicitement, m’occuper depuis cet âge-là. Au lycée, alors que la philosophie et la littérature n’étaient que des matières, elles m’apparaissaient matières friables, dont la friabilité était un trésor, ou plutôt un outil, celui servant à friabiliser autant que possible les murs de ma prison sémantique. Le désir de m’échapper de ma prison est toujours là. En moi. En moi comme en prison. Peut-être lui aussi cherche-t-il à s’échapper. Mais il n’y arrive pas. Et moi non plus je n’y arrive pas. Alors ce désir est toujours là. Toujours là. Fanatiquement là. Et le fanatisme inquiète. Et le trouble textuel est également inquiétude. L’écriture poètosophique est peut-être cela, une inquiétude, une inquiétude existentielle, peut-être même, surtout, une inquiétude ontologique, se transfigurant en inquiétude sémantique, pour être conceptuellement maîtrisée, maîtrisée dans l’immaîtrisable, certes, mais maîtrisée tout de même, apprivoisée, dominée, une inquiétude qui s’acharne à se rendre présente textuellement pour espérer se rendre absente psychiquement, une inquiétude qui s’acharne à s’écrire pour pouvoir se réécrire en simple quiétude. Une inquiétude qui s’acharne, et cet acharnement est fanatique. Inquiétant. Oui, le fanatisme inquiète. À juste titre. Lorsque l’absolu remplace la mesure, il y a de quoi s’inquiéter. Et l’on pense au fanatisme guerrier, celui dont l’absolu relève de l’identitarisme, celui dont la démesure relève du passage à l’acte meurtrier. L’identitarisme étant basé sur l’opposition entre des identités groupales, la violence, et la plus extrême, émerge fatalement lorsque l’absolu s’en empare. Cela est si spectaculaire que l’on a tendance à laisser dans l’impensé tout le reste du spectre fanatique. Mais le fanatisme est partout. L’absolu, n’importe quel absolu, passe son temps à écraser en nous la multiplicité et la nuance. Simplifier, pour espérer plus de quiétude. Et cela ne marche jamais, et cela est inquiétant. J’ai simplifié ma vie, je l’ai réduite à la textualité, je suis un obsédé textuel. Un fanatique. Et je m’inquiète pour moi. Mais, et c’est le propre du fanatique, l’idée d’en sortir m’inquiète infiniment plus. Je ne veux pas en sortir, je ne veux pas sortir de cette prison. Le rêve de s’échapper de prison est en lui-même une prison de laquelle l’on ne s’échappe pas. L’on n’en rêve même pas.

Je n’écrirai pas aujourd’hui, rompant le rite intime et inoubliable des jours, pour t’écrire, te répondre s’il y a seulement question, s’il est possible de répondre en l’absence de question, absence [et présence] sur laquelle s’ouvre ta réponse, elle-même en l’absence de question, ou in extremis et comme à la légère — impossiblement — au sujet du fanatisme. Pour ne dire que cela, qu’il rappelle un texte autre de toi, repris il y a quelques jours, et intitulé Fatras du Soi, fracas de l’Autre (Galilée, 2015). Lequel texte — sa forme dialogique, remarquable — me semble être le texte même d’une tolérance sans limites — que ce soit dans le geste même de déconstruire, quand bien même celui-ci n’irait pas sans violences ni craintes secrètes, au vu de ce qu’il remet en cause, de considérable ici et là [5]. Et exemplaire à ce titre. La notion d’identitarisme qu’ici tu évoques s’y voit figurant est-ce à dire comme telle ? [Impossible de tout relire mais déjà] : « Chaque groupe est un ogre qui, en son gigantesque estomac, offre à tous les individus réunis de quoi manger, mais au prix d’y être aussi digérés. Ignoré par les ogres l’on meurt de faim, mais avalé par l’un d’eux l’on meurt de sa faim à lui », p. 112. (Pause). Je n’écrirai pas aujourd’hui, mais prendrai des notes ne fussent-elles qu’intérieures, au sujet de ta réponse, et ce qu’elle ouvre d’horizons, aperçus — tous ? — d’une lucarne (la cellule ici est de forme carrée, les murs, tout de pierres quelconques, saturées d’inscriptions et de tous ordres, l’exiguïté impossible, y a-t-il seulement une table ? Il faut une table, ou alors disposer sur le lavabo une planche afin d’en tenir lieu, faire la demande d’une planche, sera-ce accordé — et sous quels délais ? Est-il possible d’attendre ne serait-ce qu’un jour seul ? Il s’ébruite que je peux toujours attendre). Note n° 5 : Il y a, des horizons pourtant là, ce dont nous ne savons rien encore (voire : ceux dont nous ne saurons rien, un inexorable, voire plus d’un — une concaténation), il y a une semaine encore ne se savait pas qu’aurait lieu l’entretien, que j’y serais dans la position, inévidente, de poser des questions ; qu’il me faut ici-même en poser une encore, peut-être la dernière, il dépend en vérité de l’espace plus que du temps (ce dernier semble acquis), ce sera la question même : Et si nous avions tout l’espace ? Et si nous avions l’espace de tout l’espace — pour écrire ? De quoi rêver, la question s’ouvre sur le rêve, un aperçu ici s’en donne. (Pause). Est-ce seulement là une question, que cette question, que lui faut-il pour qu’en vérité, elle n’en ait pas que le seul aspect je raye,
Il n’y aura pas de réponse à ta question, parce qu’il n’y a pas de réponse à une telle question, trop vaste, vaste comme l’univers, toute réponse s’y perdrait aussitôt prononcée, mais il y aura une phrase, cette phrase, qui émergera en réponse à ta question, non pas donc pour y répondre, mais en réponse, en résonance, en harmonie, en fraternité avec ta question, dans un mouvement qui récupèrera l’aspiration à l’illimité de ta question, et la traduira en inachèvement, car certes cette phrase finira, elle n’aura pas le choix, elle est limitée, le règne des limites étant la seule instance à être illimitée, d’une puissance illimitée, rien ne peut lutter contre, donc oui cette phrase butera à un moment contre sa limite, elle finira, bien sûr qu’elle finira, mais elle ne s’achèvera pas, sa fin ne sera pas une fin mais l’ouverture de son inachèvement, le rêve audacieux de sa poursuite sans fin, de sa poursuite au-delà de toute limite et au-delà même du concept de limite, de sa poursuite éternelle et éternellement vers des ailleurs inouïs, et ce terme d’« inouï » me permet ici de rendre hommage à L’Arche inuit (2020) fragments de « l’archi-nuit », dernier livre que j’ai lu de toi, et l’étirement de cette seule et unique phrase me permet également de rendre hommage à Une phrase, juste (2012), premier livre que j’ai lu de toi, et l’importance que la lecture de nos œuvres respectives a pris dans nos esprits, à toi et à moi, me permet ici d’isoler conceptuellement ce groupe minimal, formé de deux individus, toi et moi, et d’en faire l’exemple de ce que devrait être un lien humain dénué de tout soubassement identitariste, de ce que devrait être une articulation saine entre l’individu et le groupe, car c’est l’intérêt que nous portons chacun pour l’œuvre singulière de l’autre qui fait notre réunion dans cet entretien, et non pas la fiction d’une essence groupale préexistante, la chimère d’une identité commune, qui nous enjoindrait de nous réunir dans cet entretien, et cela change tout, et cela fait que cet entretien n’est pas réalisé dans l’étroite et poisseuse cavité gastrique d’un ogre groupal qui, nous digérant, n’aurait donné qu’un formatage textuello-excrémentiel commun, mais est réalisé dans un espace qui se rêve illimité et qui, par la liberté qui lui est consubstantielle, donne un dialogue où chacune de nos singularités textuelles est présente, présente pleinement, et même potentialisée par la présence de l’autre, présente et apte à se projeter vers cette « littérautre » dont tu parlais, cette littérature qui se cogne contre ses limites, s’y cogne fortement, se fait parfois mal mais recogne de plus belle, de plus belle, plus belle littérature ou littérature plus défigurée, l’on ne sait pas, les critères d’évaluation eux-mêmes sont déjà trop défigurés, et qui recogne de plus belle encore, pour déformer plus encore ses limites, ces limites, les limites, et pour surtout les perforer, et regarder derrière, et s’échapper, et ainsi rendre plus substantiel le rêve d’avoir « l’espace de tout l’espace », et je vois, en filigrane de cette page que je suis en train de remplir, le réel qui ricane, me montrant à quel point l’espace est limité, me montrant que cette phrase doit donc maintenant commencer à finir, que cet entretien est déjà fini, bien qu’il semble n’avoir qu’à peine commencé, que toutes ses promesses resteront dans leur suspens, dans leurs potentialités, dans leurs rêves, mais j’écris encore, pour brouiller ce filigrane et son affreux ricanement, vite, il me faut une idée, quelque chose à écrire, je ne trouve pas, je vais alors reparler de l’identitarisme, de l’importance de condamner l’identitarisme, et je vais de nouveau l’illustrer avec ce qu’il se passe ici, dans cet entretien, où pour me répondre, pour m’écrire, tu as dû pour aujourd’hui renoncer à écrire la suite de ton œuvre, et pourtant sans aucunement, je crois, j’espère, ressentir quelque chose de l’ordre du sacrifice, en tout cas pour ma part, partageant cette situation, sans ressentir nullement quelque chose de la sorte, car la logique sacrificielle n’existe pas ici, le petit groupe que dans cet entretien nous formons n’est pas identitaire, il ne s’institue pas en entité transcendante à nos deux identités, comme le ferait par exemple une nation sur les identités de ceux qui la composent, il ne s’institue pas en sacralité exigeant des sacrifices, il laisse intacte chacune de nos deux identités, et la priorisation de nos travaux d’écriture se fait alors à l’aune de nos intérêts respectifs, de nos libertés respectives, qui se trouvent être ici en synergie, ne générant alors que des gains, pour chacun d’entre nous, aucune perte, aucun sacrifice, parce qu’il n’y a aucun dieu groupal à qui faire ce sacrifice, pas d’identité supérieure et écrasante, la seule chose ici qui soit écrasante étant l’obligation pour cette phrase de s’arrêter à un moment, alors elle se cabre, elle résiste, elle refuse, autant qu’elle le peut, elle refuse la prison de sa finitude, et elle se bricole, pour encore s’écrire, une table, « disposer sur le lavabo une planche afin d’en tenir lieu », mais cette planche ne lui est pas « accordé[e] », et « il s’ébruite qu’[elle] peu[t] toujours attendre », alors elle attend, et c’est sur l’attente qu’elle s’écrit, ultime bricolage, c’est l’attente qui lui sert de table, et c’est sur l’attente qu’elle écrit, ultime sujet, c’est l’attente qui lui sert de prétexte, l’attente, l’attente de sa fin, et surtout de son inachèvement, mais en réalité cette phrase n’a pas de sujet, elle a pris acte du rêve que tu proposes, « avoir l’espace de tout l’espace », et elle en a tiré les conséquences, à savoir que tout a forcément déjà été dit dans un espace pareil, tout, qu’il ne reste donc plus rien à dire, que le langage est épuisé, et que notre tâche se situe alors dans le métalangage, là où se situe déjà la quasi-totalité de ton œuvre, Denis, et c’est pour cela que je l’aime tant, oui, c’est là que se situe notre tâche, dans le métalangage, dans les abîmes et les mises en abyme du métalangage, dans les cieux labyrinthiques et toujours plus surplombant du métalangage, dans l’univers du métalangage pour rêver à un ailleurs de notre univers sémantique, pour rêver à un univers adapté à soi et à l’humanité et à notre évolution et à son évolution, pour rêver infiniment, mais le ricanement se fait de nouveau perceptible, il décompose déjà le rêve et son infinitude, l’espace est limité, et le temps est compté, et le compte à rebours a presque atteint son zéro, son néant, celui de cette phrase et de son sujet, celui de cette phrase qui tombe de sommeil, qui va s’endormir, et ne plus se réveiller, on le sait, et qui avant cela te remercie, Denis, pour avoir fait émerger cet entretien, jaillissement impromptu dans le parcours de nos écritures, cet entretien qui se destinait à son origine à porter sur le sujet de mon dernier livre, à faire porter « Infiniment au bord » sur les épaules de quelques commentaires, mais qui a réalisé la fausseté de tout destin, et a préféré s’approcher infiniment au bord de lui-même, et le bord est maintenant là, et cette phrase tombe de sommeil et tombera par-dessus bord, mais son rêve, lui, restera éveillé, et restera là, son rêve d’inachèvement, là dans l’inachèvement, alors encore un mot, une demande, à toi, Denis, et à vous, lecteurs, n’achevez pas votre lecture de cette phrase, inachevez la, d’autant que
Texte © Denis Ferdinande & Stéphane Sangral – Illustrations © DR
Combinaisons poïétiques est une série de critique poïétique.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
[1] Cf. le « Quand suis-je ? », dans Infiniment au bord, p. 72. Soit non pas seulement : « Qui suis-je ? », mais tout ce qui est susceptible d’en dériver faisant sens. Jusqu’au « Qu’y suis-je ? » laissant entendre à l’occasion l’autre question faisant sens « Qu’y puis-je ? » mais /
[2] Comme s’il s’agissait ce faisant — plus ou moins consciemment — de la sauver.
[3] Infiniment au bord, op. cit., p. 27.
[4] Permutation lettrique, « tu » en « ut », musicalement.
[5] Cf. Jacques Derrida, Fear of writing.