
Guerre aux châteaux, paix aux chaumières.
(Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)
En janvier 1950, Julien Gracq fait paraître le pamphlet La Littérature à l’estomac. En quelques dizaines de pages, il attaque férocement les mœurs littéraires françaises de l’après-guerre, le milieu littéraire parisien, le carriérisme des auteurs, la putasserie de la critique, le bavardage culturel, la littérature divertissante et la littérature édifiante, – l’ensemble inféodé aux nouvelles techniques médiatiques et aux méthodes publicitaires afférentes. Debord n’avait pas encore écrit La Société du Spectacle et Vaneigem son Traité du savoir-vivre à l’usage des jeunes générations.
Nous sommes en 2020 : force est de constater que 70 ans plus tard, rien n’a changé : les petits copinages des prix récompensant des livres d’une médiocrité absolue, l’analphabétisme du journalisme dit « littéraire », ses connivences et ses complaisances, le germanopratisme en voie de décomposition ultime, la lutte des places des auteurs, leur intarissable soif de pouvoir, la double consécration de la feel-good littérature et d’une autre, dégoulinante d’indignation morale.
Nous sommes en 2020 et en ce début d’été plusieurs livres de Jean-Patrick Manchette viennent successivement de paraître : La Table ronde publie son importante correspondance (préfacée par le merveilleux Richard Morgiève) et dans la foulée ses chroniques de jeu parues dans Métal Hurlant, Wombat ressort l’intégralité de ses chroniques ciné (le livre était introuvable) et Gallimard réédite L’Affaire N’Gustro, qui signa l’entrée fracassante de Manchette dans la Série Noire (agrémenté d’une superbe préface de Nicolas Le Flahec).
Quel est le lien entre ce dernier paragraphe et les précédents, au ton atrabilaire ? Il est assez simple en fait : Jean-Patrick Manchette s’est toujours tenu éloigné de ce milieu littéraire français, n’a jamais cherché à faire carrière, il ne s’est pas adonné à la bassesse du courtisan face aux journalistes, il n’a pas fait allégeance au monde universitaire, il n’a pas rampé devant les institutions, il n’a jamais occupé une quelconque position de pouvoir, il n’a pas prostitué son art dans la facilité (alors qu’il aurait pu devenir un rentier du « polar ») ou l’indignation factice – il a laissé la fausse conscience à ses contemporains. Au contraire, avec une ténacité, une intégrité et une lucidité sans égales, obsédé par la nécessité historique, il n’a cessé de s’en tenir à sa ligne générale, de cheviller son art à la critique unitaire de ce monde tel qu’il ne va pas pour porter l’écriture à son incandescence stylistique et politique. En somme, comme Dashiell Hammett, jusqu’au bout Jean-Patrick Manchette aura incarné la droiture et l’intransigeance. Peu d’auteurs en ont fait autant dans la période contemporaine. Mais, au surplus, nous savions qu’il était un romancier de première importance. Avec la publication de sa magistrale correspondance (et de son Journal en 2008), nous avons maintenant la confirmation que son œuvre déborde le cadre strict du roman, du genre ou de toutes les épithètes pratiques accolées à lui. Comme l’écrit Richard Morgiève dans sa préface : « Le talent de Patrick ne se bornait pas à l’écriture d’histoires. Il savait entrer en relation, transmettre ».
On a beaucoup glosé sur le silence de Manchette, sur sa prétendue « panne » d’écriture. La parution de ces livres jette un désaveu cruel sur ce grossier contresens. Avant tout le monde, Manchette avait compris le bourbier dans lequel la littérature « blanche » s’était enlisée, condamnée à réchauffer des produits culturels surgelés. Et avant tout le monde aussi, il avait compris que « la contre-culture » (BD, SF, polar) allait devenir l’inévitable segment du marché que l’on connaît ; que désormais, passé la phase de l’inessentialisation du travail, la « Culture » se confondrait avec le « Capital ». C’est parce qui lui fallait prendre en compte cette métamorphose du capitalisme – la crise de la valorisation (ou de la valeur qui s’auto-valorise, pour parler comme Marx) – que Manchette restait circonspect. Ce qu’il pressent dans ces années 80, c’est la réduction de tout par la marchandise et, concomitamment, l’évanescence de la valeur. En réalité, il n’a jamais cessé d’écrire et l’écriture chez lui participait d’une saisie dialectique du monde qui fait affreusement défaut à toutes les grandes têtes molles de notre époque, des représentants de l’ultra-gauche postmoderne aux sous-produits de la culture en cage. Manchette écrivait comme il aurait dégainé une Winchester 73, une carabine à deux coups (calibre .44-40 WCF) : la philosophie politique d’un style et le style d’une philosophie politique. Car Manchette était un grand styliste, mais pas que : il était obsédé par l’idée de cohabiter avec le négatif. Manchette, c’était Flaubert qui aurait lu les « Grundrisse » et aurait affirmé sa sympathie pour la Commune. Lui n’a pas laissé la lutte des classes à la classe dominante, devenue aujourd’hui la classe de la conscience. Cela transpire dans chacune de ses lettres, où l’on sent bien que la posture de l’énonciation n’est pas la même en fonction de son interlocuteur : courtois, mais glaçant avec les institutionnels, chaleureux et généreux avec les modestes (par exemple, avec les élèves d’un lycée professionnel de Dordogne qui lui envoient un questionnaire). Manchette, était un grand seigneur, gentilhomme. Un écrivain qui connaissait parfaitement sa place dans les rapports de production, à la recherche de la grande forme. Or, quelle forme élaborer quand ne subsiste plus qu’un pastiche de négatif ? Que des luttes et des conquêtes de la modernité, il ne reste plus que des signifiants vides ? Que tout cela participe d’un « mouvement général de quadrillage répressif du monde », qui fait que « l’ordre ne se maintient qu’en tenant à la fois le pouvoir et l’opposition » comme l’écrit Manchette dans une lettre à Pierre Siniac en novembre 1981 ? (On voit bien aujourd’hui ce qu’il en est avec les luttes des « minorités »). Toujours chez Manchette persiste cette volonté de récuser les fausses alternatives, celles qui voient les forces en présence s’entendre en creux sur leur présupposés, en somme de refuser les deux mâchoires de la tenaille ; parler à ce sujet de « pessimisme réactionnaire » (Jean-Pierre Bastid), c’est encore une manière de se laisser prendre au piège du Spectacle, de lui laisser toute latitude pour recoller sa pseudo unité. « L’organisation de l’apparence » (Vaneigem) règne, tandis que les morceaux du vers de terre poursuivent leur vie autonome. Hier comme aujourd’hui, le Spectacle n’existe plus qu’en tant que séparé : « Il ne se reproduit plus que par scissiparité », écrit encore Manchette dans son journal. Telle est la logique culturelle du capitalisme tardif, d’une époque satisfaite, engluée dans la frivolité de la valeur, abandonnant la chose morte pour glisser ad nauseam sur le tourniquet des signes – c’est peu dire qu’elle a déjà été jugée par Manchette. Les situationnistes rêvaient d’un dépassement de l’art. On sait ce qu’il en a été. Leur amère victoire a bien sûr un goût de défaite. Manchette a réussi là où Debord et les siens ont échoué. Soyons persuadés que là où il est, il rit.

Retour sur cette œuvre majeure en compagnie de Doug Headline, Gilles Magniont, Jeanne Guyon, Nicolas Le Flahec, qui ont établi cette correspondance et Frédéric Brument, éditeur de ses chroniques ciné, Les Yeux de la momie. À chacun, nous avons posé les questions suivantes:
1 – Comment avez-vous découvert Manchette ? Quelle résonance son œuvre a-t-elle pris et prend-elle encore aujourd’hui tant dans votre vie de lectrice et de lecteurs qu’au quotidien ?
2 – La réception des livres qui viennent d’être publiés a été excellente. Le reconnaissance de l’œuvre de Manchette est indéniable, mais elle reste tardive et encore limitée et partielle. Limitée car l’institution ne s’est pas encore emparé d’elle (faut-il s’en réjouir ou le déplorer ?), partielle, car elle continue d’être cantonnée au « noir », alors qu’elle l’excède largement et semble plus qu’au-dessus de la grande majorité de la production romanesque dite « blanche ». Comment expliqueriez-vous cette incongruité ?
Doug Headline
1 – Grandir auprès d’un écrivain, c’est se trouver exposé en permanence à l’acte d’écrire, jour après jour, ça me semblait un mode de vie, plus qu’une profession. Quand j’étais enfant, je le voyais travailler sans cesse, il ne s’arrêtait jamais d’écrire, il passait le plus clair de ses journées dans son bureau à taper à la machine (Hermès 3000.) Et parfois, le soir, il nous lisait des passages de ce qu’il avait écrit, quand il en était particulièrement satisfait. Et en fin de soirée, il recommençait à écrire, le plus souvent son journal ou des notes de lecture. En le regardant travailler, j’ai pris conscience de l’effort de concentration et de réflexion que représente la confection d’un livre, d’un chapitre, d’une seule phrase même. Je lisais énormément quand j’étais môme, j’ai lu des romans dès l’âge de 4 ans, et j’étais alors fasciné par les auteurs prolifiques, comme Jean Ray ou ces romanciers américains qui écrivaient dans les pulps des années 1930. Mais, même si je le voyais continuellement absorbé par l’écriture, je ne me rendais pas vraiment compte qu’il était lui-même des plus prolifiques. Entre ses romans, son journal, ses chroniques, ses scénarios, sa correspondance, ses traductions, il aura rédigé des dizaines de milliers de pages. Chez lui, ça paraissait naturel, c’était un trait constitutif de sa personnalité… Il a ainsi accepté de venir parler de son métier à mes camarades de classe, à la demande de ma prof. de français, au cours de mon année de 3e je crois. Du même élan, il répondait encore au questionnaire sur l’écriture d’une classe de lycée professionnel quelques mois seulement avant sa mort. Il n’aimait rien autant que lire et écrire, et partager cette passion. À sa mort, que j’ai ressenti comme une profonde injustice et une perte terrible pour les lecteurs autant que pour moi personnellement, je n’ai rien décidé consciemment : le chemin s’est ouvert tout seul devant moi. Je n’avais pas d’autre choix possible que tout tenter pour que son œuvre continue d’être lue, éditée, traduite, adaptée, découverte par de nouveaux lecteurs. Il avait disparu physiquement, mais je refusais l’idée qu’il pourrait disparaître des librairies et de la conscience collective. C’était aussi une manière de prolonger notre relation au-delà de la mort. Pendant 25 ans, j’ai passé une grande part de mon temps plongé dans ses textes et cela m’a permis d’entendre sa voix comme s’il était encore là. J’ai compris beaucoup de choses à son sujet et j’ai appris à mieux le connaître.
2 – Si l’on regarde attentivement les nombreux articles qui ont accompagné la parution de sa correspondance et des autres volumes sortis cette année, on peut constater que, dans une certaine mesure, la reconnaissance dépasse maintenant le seul champ du roman policier. Plusieurs articles ont choisi de l’appeler « un des plus grands écrivains français du 20e siècle » ou « de la seconde moitié du 20e siècle ». Il me semble alors qu’un cap a été franchi. Comme toute chose, ce sera sans doute éphémère, et je ne sais même pas s’il était souhaitable d’en arriver là. L’acceptation institutionnelle reste un grave danger, elle banalise et affadit les auteurs et leurs textes, elle les rend parfois même illisibles. Je refuse par exemple qu’on utilise des extraits de ses romans dans les manuels scolaires. De la même façon, il détestait « l’animation culturelle » qui noie le sens sous les bavardages… Néanmoins, en ces temps d’avalanche littéraire perpétuelle, il est tellement rare de voir demeurer présent dans les mémoires un auteur disparu depuis un quart de siècle, auteur de genre qui plus est (même si, en effet, il dépasse de loin la notion de genre), que je ne peux que trouver ça merveilleux et m’en réjouir. La qualité supérieure de son style ne peut pas passer inaperçue. C’était le cas de son vivant, ça l’est encore 25 ans après. Espérons que ça durera encore un peu.

Gilles Magniont
1 – Ma première découverte de Manchette fut très tardive : les Inrockuptibles de septembre 96, avec son visage derrière un rideau de fumée et la sentence « le polar, c’est mort ». Je ne crois pas qu’il ait écrit ça mot pour mot dans ses Chroniques (qu’éditait alors Rivages), mais cette couverture du magazine était diablement séduisante. Et à l’intérieur se trouvait reproduite la réponse qu’il adressa à une classe de lycée professionnel, et qui finit maintenant les Lettres du mauvais temps. Des Chroniques sur le polar (qui me révélaient donc Manchette tout en m’ouvrant un monde de livres, de pensées et d’Histoire), je suis passé à celles sur le cinéma, aux romans, etc. En m’y prenant à plusieurs fois pour ces romans, d’une élaboration si savante – derrière l’évidence des intrigues – qu’ils s’en trouvent peut-être moins évidemment aimables que les proses d’idées (articles, lettres, et même journal intime) où se diffuse immédiatement le charme de l’écriture. Voilà pour moi, aujourd’hui, la première « résonance » de l’œuvre : l’émotion du style, à savoir une joie toujours renouvelée. Jusqu’aux projets laissés en plan, tous ces textes se tiennent ; je peux les lire, les relire, les redécouvrir, les partager. Manchette s’est ainsi forgé un instrument qui lui permet d’aller partout, de se saisir de tout, avec une infinie souplesse. Il n’est jamais ennuyeux. L’autre résonance est une sorte de recours. Il est peu de trajectoires comme la sienne, impeccable dans ses errements mêmes, et se retourner vers Manchette revient alors à s’affermir, par les mauvais temps qui courent. L’époque n’est pas très prodigue en intellectuels de gauche inquiets et conséquents : je me figure alors un oiseau rare, ses efforts admirables pour penser le monde et ajuster à cette pensée son art comme son existence.
2 – Je me permets de répondre un peu à côté, n’ayant pas d’idée très ferme sur la place qu’on continuerait de refuser à Manchette. Du côté de la critique littéraire, divers articles ont quand même rendu compte des parutions récentes sans avoir recours aux usuelles périphrases (du type le-pape-du-néo-polar), qui ne semblent plus subsister qu’à l’état de survivances paresseuses ; du côté de l’institution, et y appartenant, je dois reconnaître que j’ai pu sans mal consacrer cours ou colloque à Manchette (ce qui certes l’amuserait, et permet en tout cas de toucher de jeunes générations). Si je partage cependant l’impression d’une réception « partielle », c’est que ses propos se trouvent régulièrement mis à distance, comme conjurés. On peut le comprendre, vu la teneur de nombreuses lettres et chroniques : quand (par exemple) Manchette décortique pour ses correspondants la « multiplication des festivals », des « sponsors » et des « compromissions », ou qu’il ouvre Les Yeux de la momie par la prosopopée des identités souffrantes : « »Nous avons bien mal au cul, interrogeons-nous sur les causes de cette douleur ». Les réponses à cette interrogation sont variables – la mort de Kennedy ; le Vietnam ; être une femme ; être un homme ; être un nègre ; habiter Lausanne« . Ici Manchette saisit comme nul autre l’émergence de cette société où nous nous ébattons, et esquinte allègrement les phénomènes politiques et culturels dont s’enchante, en 2020, une large part du lectorat. Pas étonnant qu’on le prenne alors avec des pincettes en évoquant en certains endroits son « intransigeance », en d’autres sa tendance au « complotisme », bref qu’on ne veuille pas tout à fait l’entendre. Faut-il s’en attrister ? Cela continue en tout cas de vérifier la conclusion d’une de ses chroniques, écrite il y a quarante ans : « Soyez tranquilles, nous aurons à cœur de mécontenter tout le monde« .

Jeanne Guyon
1 – Cette question claire et simple devrait appeler une réponse simple. J’ai découvert Manchette en chair et en os dans les bureaux de la Série Noire, peu avant le cinquantenaire de la célèbre collection pour laquelle je travaillais en ce temps-là. Nous préparions, avec Patrick Raynal, le recueil Noces d’or, un « cadavre exquis » pour lequel Manchette devait ouvrir le bal. Pour moi, c’était un mythe en costume de velours gris, descendu de son piédestal dans la cave de la SN. La véritable réponse est beaucoup plus compliquée, car j’ai commencé par ne pas découvrir Manchette. À l’époque où je me suis mise à lire sérieusement des polars, entre l’âge de 20 et 30 ans, ma culture et mes goûts étaient très majoritairement anglo-saxons et je voyageais entre Conan Doyle, Ed McBain, Donald Westlake, Ellery Queen, Mildred Davis, et surtout Hammett, Chandler, McCoy, puis Crumley et Harry Crews. Le polar en langue française se résumait à Maurice Leblanc, Simenon, Jean Amila-Meckert, et Léo Malet. Ledit « néo-polar » n’était tout simplement pas dans ma galaxie (à l’exception d’un coup de foudre pour Thierry Jonquet), même si on ne pouvait en ignorer l’existence, puisqu’on en parlait beaucoup. Déterminée à ne pas mourir idiote, je me suis dit qu’il fallait s’y mettre et, fidèle à mon éducation classique, j’ai commencé par le commencement : L’Affaire N’Gustro. Peut-être pas le plus facile. Je n’ai pas compris le livre, je n’avais tout simplement pas les outils pour cela. Je me dédouane un peu car, comme le souligne Nicolas Le Flahec dans sa préface à la récente réédition du roman, les gens d’Albin Michel et une partie de l’équipe de la Série Noire ne l’avaient pas compris non plus. Je n’avais certes pas imaginé « un auteur parachutiste », mais je m’étais attachée à « l’histoire de gangsters », c’est-à-dire à ce qui n’intéressait pas Manchette (voir ce qu’il en dit dans son Journal), c’est-à-dire à la surface. Je n’avais pas vu le fond, pas perçu la portée politique car elle ne s’exprimait pas comme chez Hammett, pas suffisamment décodé les allusions, pas apprécié le brio narratif, bref j’avais été vaguement déçue et en avais conclu que ce n’était pas pour moi. Coïncidence amusante, c’est lorsque j’ai quitté la Série Noire, l’alma mater littéraire de Manchette, pour rejoindre Rivages/noir que les choses ont changé radicalement. Quelque temps après la mort de Manchette, François Guérif et Doug Headline ont le projet de publier La Princesse du sang et de réunir en un volume les fameuses chroniques sur le polar parues dans Charlie et dans Polar. Collaborant à cette édition avec Frédéric Brument (futur fondateur des éditions Wombat), j’ai eu ce qu’on ne peut qualifier que d’épiphanie en lisant l’intégralité de ces textes critiques. Éblouissement devant le style, la vigueur et l’intelligence de la pensée, la jubilation suscitée par cet écrivain qui donne lui-même une envie puissante de lire les autres, qui stimule notre propre réflexion sur un genre qu’on croit connaître un peu, comme le flash d’une drogue inconnue. Droguée je suis restée. C’est donc en lisant ce que Manchette a écrit sur les autres que j’en suis venue à le lire, comme s’il avait, de manière invisible et souterraine, aussi chroniqué ses propres œuvres et s’en était fait l’avocat le plus convaincant. Pour boucler une boucle hautement signifiante (car pour moi la valeur de son travail littéraire se mesure aussi à ceci, qu’il cite dans ses « Notes noires » de janvier 1995 : ‘’Il me semble d’ailleurs qu’on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent (…) un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous’’ et qui est emprunté à Kafka), pour boucler cette boucle, donc, disons que mon « Manchette » préféré aujourd’hui est Fatale, un livre qui fut si peu aimé— et compris— au premier abord qu’il ne parut pas à la Série Noire, qui l’avait refusé.
2 – Il faudrait supprimer le « encore » car la lecture de Manchette — que ce soit sa fiction, son journal, ses chroniques ou sa correspondance — est un compagnonnage qui dure. Richard Morgiève, dans sa superbe préface aux Lettres du mauvais temps fait très bien ressentir la qualité et la force du lien qui s’établit entre Manchette et ceux qui le fréquentent. Ce n’est pas ce qu’on pourrait qualifier superficiellement de « charisme », c’est plus profond. Et que dire de l’amitié que nous laissent deviner les lettres qu’il écrit à Pierre Siniac ? De la complicité qui s’établit avec Jacques Faule, avec Ross Thomas, ou Robin Cook ? Lire Manchette, c’est à notre niveau, correspondre avec lui. Nous observions avec Doug Headline que, dans une époque qui se lasse très vite de tout et vénère le changement, Manchette n’avait pas vraiment connu de traversée du désert. Ce n’est en fait pas étonnant. C’est lui qui toujours nous étonne, alors même que nous arrivons à connaître des passages de ses livres presque par cœur. Ils ont quelque chose d’absolument inusable, c’est une alchimie qui échappe à l’analyse critique. Le mot « résonance » est à cet égard on ne peut plus juste : les phrases de Manchette résonnent en nous avec leur poétique propre (« Et parfois il arrive ceci : c’est l’hiver et il fait nuit« …), leurs rythmes, leurs échos, leurs mots qui semblent n’appartenir à aucun âge, ni à aucun registre ou niveau de langue définis parce qu’il se les est réappropriés : il a fait un hold-up sur le dictionnaire qui, sous sa plume, est juste devenu du Manchette. J’aime chez lui l’emploi du verbe « commander » comme dans « commander une attention » à quelque chose. Voilà ce qu’il fait vibrer en nous : l’attention au style, au langage d’une manière générale. C’est bien sûr une affaire politique et morale (un mot qui revient chez lui), qui appelle toute notre vigilance en cette époque dangereuse où les mots sont trop souvent piégés et vidés de leur sens. Citons ce qu’il écrit à Paul Buck le 20 janvier 1988 : « La destruction du langage est une composante de la destruction du monde, de la vie elle-même ». Cette œuvre que, encore une fois, il serait artificiel de séparer en catégories, nous rappelle que la littérature est chose sérieuse. Ce qui ne signifie pas qu’il faille se draper dans l’esprit de sérieux. Il suffit de lire les chroniques de jeux signées du « Général-Baron Staff » pour être emporté par la jubilation pure qu’elles procurent, leur drôlerie, leur fraîcheur. Cela aussi, ça nourrit le lecteur, nourrit le citoyen, même si souvent la causticité, la dérision (surtout pas le ricanement) de Manchette ressortissent à un humour de potence. Mais cet humour-là, c’est une éternelle cigarette du condamné qu’on fume (sans filtre) et qui chaque fois repousse un peu notre mort, en tout cas celle de notre esprit. La lecture de Manchette, pour quelqu’un qui fait profession d’éditer des livres, est un signal d’alerte constant. Un appel à l’exigence, mais aussi à l’ouverture d’esprit. Il est tout à fait remarquable qu’il se soit intéressé à des domaines aussi variés que « la pensée allemande » (cf. lettre à Marianne Pini du 16 octobre 1978), le marxisme, le situationnisme, la traduction (qui n’était pas qu’une activité alimentaire), les jeux de société, la musique de jazz, la science-fiction, la bande dessinée, le cinéma (sous toutes ses formes), etc. chaque fois avec cette fameuse « attention ». Ce qui frappe aussi chez Manchette, c’est la sincérité dont il fait preuve (ce qui n’empêche pas une roublardise de bon aloi !), la conviction, la capacité de dire non (voir toutes les lettres où il refuse quelque chose !), en un mot l’intégrité. Cela aussi est un enseignement. Être un esprit libre, se départir des modes, se moquer du monde mondain. Se poser des questions, se remettre en cause jusqu’à la contradiction (les Chroniques en sont parfois la preuve), écrire contre — ce qui réclame du courage— mais jamais écrire contre lui-même (contrairement à ce que certains ont pu affirmer). Pour résumer ce qui n’est pas résumable, j’emprunterai à Alain Marciano ce qu’il exprime dans Benzine : « Lire Manchette a toujours provoqué chez moi cette excitation fébrile qui va avec l’excès de café — sans le mal à l’estomac mais avec la légèreté de l’âme en plus« . On ne saurait mieux dire. Quant à la réception des œuvres, vaste question. Je ne suis pas sûre que la reconnaissance de l’œuvre de Manchette ait été tardive (mais encore faudrait-il définir la nature de cette « reconnaissance »), il me semble, au contraire, qu’elle a été rapide et qu’il a été érigé en mythe de son vivant (ledit mythe ayant retardé ma propre reconnaissance de l’écrivain car la statue cachait l’œuvre). On a vu l’impact que sa chronique dans Libération a eu sur le décollage des ventes d’Ellroy et sur l’établissement de sa réputation. Un impact si fort que Manchette a réussi à renverser une tendance idéologique qui, sans lui, eût écarté l’auteur de Lune sanglante de la sphère des lecteurs « de gauche ». Alors, que l’institution ne se soit pas encore emparée de Manchette (il est en Quarto, pas en Pléiade) est peut-être incongru (scandaleux ?) à nos yeux de fanatiques convaincus. Mais l’est-ce vraiment ? Et est-ce à déplorer ? Personnellement, je salue cette incongruité que Manchette lui-même aurait sans doute revendiquée. Terrain glissant, faire parler les morts, mais on a des preuves : il suffit de lire la correspondance pour savoir ce qu’il pensait de la littérature dite « blanche », cette littérature de « première classe » au sein de laquelle il n’avait vraiment sauvé que Jean Echenoz. Dans une de ses lettres à Jacques Faule, il confesse la déception que constitue pour lui le fait d’avoir été salué par la critique respectable et intello à propos de Fatale. Cette incongruité est plutôt rassurante ; elle démontre que 25 ans après sa mort, Jean-Patrick Manchette n’a toujours pas été absorbé, récupéré, toutes choses qu’il combattait de son vivant. Il suffit de regarder les émissions animées par Bernard Pivot où il avait été invité pour percevoir combien il détonnait dans ce paysage salonnard (plus la première fois parmi une brochette de flics « écrivains », moins la seconde car il y avait quand même Léo Malet et ADG…). Flop : il ne joue pas le jeu social attendu. Ne pas être là où on l’attend a toujours été, me semble-t-il, la ligne directrice de Manchette. Plutôt être là où il voulait être. Il aurait pu « pondre » des Série Noire modèle Tarpon et satisfaire le public. Au lieu de quoi, il écrit Le Petit Bleu de la côte ouest et Fatale. Il aurait pu jouir d’être considéré comme le chef de file du « néo polar », il décide plutôt de clore le cycle des romans criminels de type hard boiled avec La Position du tireur couché et d’aller dans une autre direction, celle du cycle des Gens du mauvais temps. Aller là où l’on n’est pas attendu est évidemment la marque des grands créateurs, c’est aussi l’assurance de conserver sa liberté et de ne pas être ravalé au rang de marchandise culturelle, de ne pas aboutir à « devenir une jolie marchandise rouge, comme la cocotte Seb » (lettre de JPM à Henri Droguet du 29 mai 1981). Manchette s’étant rigoureusement tenu à cette ligne de conduite, il n’est donc pas surprenant qu’il n’ait pas été vraiment adoubé dans le camp du « blanc ». Ou alors seulement à la marge. Gilles Magniont et Nicolas Le Flahec ont déjà beaucoup travaillé à faire resplendir l’œuvre de Manchette au sein de l’université (ils ont organisé le premier colloque international consacré à son œuvre à l’Université de Bordeaux, qui a donné lieu à un passionnant ouvrage, Manchette et la raison d’écrire (Anacharsis, 2017), mais sauf erreur, il n’est pas encore au programme de l’agrégation. Que démontre cette salutaire incongruité ? Que le noir, ce « mauvais genre », n’est pas encore réduit à l’état de cadavre. Qu’en dépit de la frivolité qui imprègne ce qu’il est convenu d’appeler le « polar » (en fait une véritable auberge espagnole), il subsiste une poche de résistance peuplée d’auteurs, d’éditeurs, de critiques et de lecteurs, qui s’efforcent de ne pas être de « grandes têtes molles » en « affirmant sempiternellement de tel ou tel ouvrage qu’il est davantage qu’un ‘’roman policier’’. » (Chroniques). Vive cette résistance ! Prenons le terme dans ses deux sens : la solidité et le dispositif conducteur de chaleur. Car s’il y a bien une chose que démontrent la correspondance et les chroniques, c’est que l’écrivain se révèle formidablement conducteur. Il donne envie de lire, il partage avec enthousiasme et générosité. Même lorsqu’il a la dent dure, c’est le signe que le matériau ne s’effrite pas ; la rigueur intellectuelle n’est jamais synonyme de hauteur ou de mépris. Même lorsqu’il est énervé, l’homme du mauvais genre trouve des formules merveilleuses, plus drôles que foncièrement méchantes : « Éteins-toi, petite chandelle » (à Noël Godin) ou « Allez vous faire lanlerre » (à Z Éditions). Il ne se pose pas en gardien du temple (comme trop souvent l’establishment littéraire) et n’invite surtout pas ses lecteurs à l’être. La salve d’articles élogieux, de commentaires laudatifs sur les récentes publications « manchettiennes » donne matière à se réjouir (et d’ailleurs, que faisons-nous sinon ajouter une pierre à l’édifice ?). Nombre de ces articles et commentaires mettent en valeur l’écrivain, au-delà de tout clivage entre le blanc et le noir, c’est à saluer. Cependant, la vigilance, qualité cardinale chez Manchette, reste de mise. Le basculement dans l’ère numérique a bien sûr aggravé tous les défauts de la société du spectacle et de la marchandise prête à consommer, modifiant profondément nos perceptions, notre rapport à l’espace et surtout au temps, Xavier Boissel en fait état. Alors le risque demeure de voir Manchette transformé en icône pop, en gourou de la contre-culture, en dandy, en reclus dans sa tour d’ivoire, en ce qu’on voudra, sa fin prématurée ajoutant encore à la mythification, donc à la possible récupération par la « littérature de première classe ». Manchette n’a jamais cessé de se définir comme un artisan, quelqu’un qui exerce un métier (voir à ce sujet la belle réponse qu’il fait aux élèves de lycée professionnel qui lui demandent en quoi cela consiste d’être écrivain). Certainement pas à passer du temps sous le feu des projecteurs, à serrer des mains et à fréquenter les cocktails. Il s’est situé avec une justesse miraculeuse à la frontière entre l’artisanat et l’art, entre le noir et le blanc. En cela son œuvre est unique.
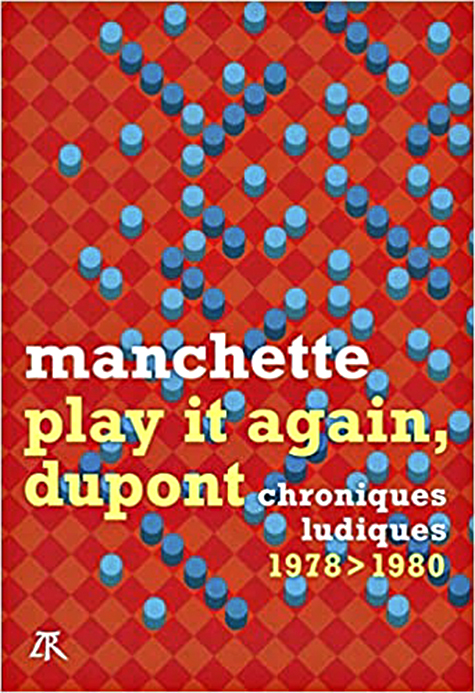
Nicolas Le Flahec
1 – J’ai découvert Manchette par hasard et en ignorant tout de lui. C’était il y a une quinzaine d’années, mais je garde un souvenir très vif des heures durant lesquelles j’ai lu La Position du tireur couché. C’est peu dire que j’ai été impressionné par ce roman. J’ai ensuite consacré un mémoire de Master à Manchette, avant une thèse qui occupe encore une bonne partie de mon temps. Depuis une petite dizaine d’années, il ne se passe sans doute pas une semaine sans que je me plonge dans l’un de ses textes, et je n’éprouve pas la moindre lassitude. Je crois qu’ils ne sont pas si nombreux, les écrivains qu’on peut relire sans cesse avec le même plaisir, tout en continuant à être surpris. La résonance de cette découverte, en ce qui me concerne, est colossale. Plus le temps passe, plus je mesure ce que Manchette m’a apporté. Il fait tout simplement partie de ces écrivains qui m’ont appris à lire et à réfléchir. Et puis je n’en finirais pas s’il fallait faire la liste de tout ce que Manchette m’a permis de découvrir ou de redécouvrir. Je lui dois notamment ma lecture des pères fondateurs du roman noir qu’il évoque dans ses indispensables Chroniques. Je dois à ses traductions d’avoir pu me plonger dans des œuvres aussi importantes que Les Faisans des îles de Ross Thomas, Kahawa de Donald Westlake ou les Watchmen d’Alan Moore. Je lui dois ma rencontre avec certains textes de Guy Debord ou avec le formidable Hommage à la Catalogne de George Orwell que je viens tout juste de lire. Je lui dois d’avoir mieux compris Hegel et même d’avoir mesuré la beauté de certains extraits de La Phénoménologie de l’Esprit, ce qui n’était vraiment pas gagné. Je lui dois d’avoir vu des films que je n’aurais pas regardés sans Les Yeux de la momie, et d’avoir écouté des musiciens dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. Bref, pour le dire simplement et en pesant mes mots : ma dette est immense.
2 – Cette question de la réception est complexe, sans doute parce que l’œuvre de Manchette est complexe et résiste assez bien aux cadres qui voudraient en délimiter les contours. Manchette a ainsi toujours privilégié des formes populaires, avec constance et sans posture, tout en saturant son écriture de références littéraires, historiques ou philosophiques. Il a pris soin d’utiliser les ingrédients traditionnels du polar, tout en prenant des libertés avec les règles du genre. Il a pris acte de « la mort historique de l’art« , tout en continuant à créer. Ses textes sont parfaitement accessibles, avec un plaisir de lecture immédiat, mais aussi particulièrement retors. De même, c’est un grand styliste, mais il n’a jamais sacrifié le fond sur l’autel de la forme, bien au contraire. Il sait aussi, dans le même mouvement, être incroyablement drôle et parfaitement sérieux. Je ne vais pas continuer à multiplier les exemples de tensions qui traversent et structurent ses textes, mais on le comprend : même si elle est de son temps, et aussi de son espace, cette œuvre demeure relativement inclassable. Dans ces conditions, quelle forme de reconnaissance peut-elle espérer ? Que certains cantonnent encore Manchette au roman noir ne me semble pas problématique, même si tout le travail qui a été réalisé depuis plus de vingt ans pour publier ses chroniques, ses nouvelles, sa pièce de théâtre, une partie de son journal, ses scénarios ou encore ses lettres, démontre l’inanité de certaines frontières. Le roman noir reste malgré tout la forme qu’il a choisie et habitée durant plusieurs années. S’il est parvenu à la faire évoluer, à la bouleverser et sans doute à la dépasser, il ne l’a jamais reniée, à l’inverse de certains. Bien sûr, il y en aura toujours pour regarder le roman noir de haut, mais on les oubliera. Manchette, lui, est toujours bien présent dans les esprits, et cette reconnaissance est effectivement indéniable. Évidemment, j’aimerais qu’elle le soit encore davantage. Je pourrais, pour évoquer Manchette, reprendre à mon compte ce que Pierre Michon dit au sujet de Faulkner : « Si je suis heureux enfin [qu’il] soit lu, loué, admiré, traduit, commenté ? Oui. Et ce n’est pas assez, jamais assez« . Pour autant, je ne sais pas si cette réception est si limitée. Je trouve que Manchette s’en sort même assez bien, surtout quand on voit ce qui se lit et ce qui se vend bien souvent autour de nous. Je me demande si un autre écrivain français ayant été essentiellement publié dans les années 70 pourrait bénéficier, 25 ans après sa mort, de pleines pages dans Le Monde, Libération, L’Humanité, Le Figaro, Sud Ouest, L’Express, Marianne, Le Point, Lire ou encore Le Magazine littéraire, et la liste est loin d’être exhaustive. Même Perec n’a pas rencontré un tel écho lors de la récente publication du volume rassemblant des centaines de pages d’entretiens, de conférences et d’inédits. De ce point de vue, on peut dire que l’institution médiatique, que Manchette n’a pourtant jamais ménagée, a reconnu l’importance de son œuvre. Évidemment, ce succès s’accompagne depuis les années 70 d’une forme de récupération, ce que Manchette avait d’ailleurs parfaitement anticipé. Si on le célèbre avec enthousiasme, il arrive aussi qu’on déforme plus ou moins volontairement son propos. On le fait parfois passer pour un austère théoricien (lui qui manie si bien l’autodérision), pour « le pape » (un comble) d’un mouvement inventé pour plaisanter, ou encore pour un aimable styliste (ce qui est bien commode). Mais n’importe lequel de ses livres vient tranquillement balayer tout cela. On peut déplorer ces simplifications ou ces mensonges. Je les déplore souvent, et je suis agacé quand je vois que certains se contentent encore de recycler des clichés usés jusqu’à la corde au lieu de lire vraiment ces textes. Reste que c’est mieux que l’oubli dans lequel sont tombés tant d’autres écrivains. L’essentiel, c’est sans doute que ces textes arrivent encore dans les mains des lecteurs, quel que soit le chemin qu’ils empruntent. Je crois qu’on peut leur faire confiance, comme cela a été parfaitement souligné ici : ils sont assez solides et ils agiront comme ils l’ont toujours fait en créant cet effet de choc auquel Manchette tient tant dans ses critiques comme dans ses romans. L’œuvre poursuit ainsi son travail de sape et de contrebande. Et peut-être que cette incongruité, à laquelle Manchette n’est pas tout à fait étranger, est aussi une chance : elle lui offre une place singulière. Quant à l’institution scolaire, le fait est qu’elle ignore encore largement Manchette, ce qui, me semble-t-il, ne l’attristerait guère. Les choses bougent tout de même, à différents niveaux. Finira-t-il un jour au programme de l’agrégation ? Il y retrouverait Hammett ou Flaubert : il y a pire compagnie. Sera-t-il un jour reconnu comme un classique et trouvera-t-il sa place dans les programmes scolaires ? Ce serait une issue savoureuse et ironique, bien sûr, quand on sait la radicalité de l’œuvre. Mais tout ce qu’il risque, au fond, c’est d’être davantage lu, et je fais encore confiance à ses textes pour secouer les esprits et se jouer des normes qui voudraient les écraser. Et peut-être que Manchette en mènera d’autres que moi vers Hammett, Marx, Orwell ou Hegel. Ceux qui doutent encore de l’importance de Manchette en le cantonnant dans telle ou telle case en seront donc toujours pour leurs frais. Ce que nous montre cette belle réception, c’est qu’il est en train de gagner la difficile bataille de la postérité. Ceux qui l’ont découvert dans les années 70 ou 80 sont loin de l’avoir oublié, et beaucoup le lisent encore. J’avais une dizaine d’années à sa mort, et je le lis encore. Les lycéens, puis les étudiants avec lesquels j’ai pu travailler ses romans depuis que j’enseigne, le lisent encore. Certains commencent avec un roman avant de m’avouer, en fin d’année, qu’ils ont lu tout le Quarto. Ce n’est pas rien, par les temps qui courent. C’est même beaucoup.
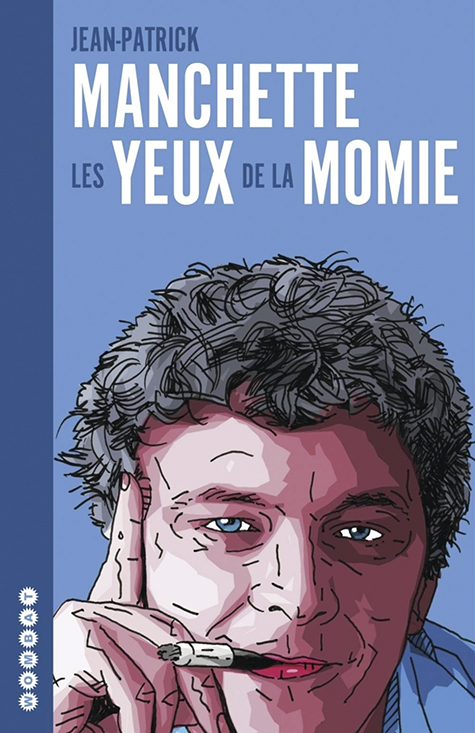
Frédéric Brument
1 – Ma découverte de Manchette s’est faite en quelque sorte « à l’envers ». Adolescent dans les années 1980, passionné de BD et de SF (le polar est venu plus tard), je l’ai d’abord connu comme chroniqueur de polars et de cinéma dans les revues Charlie mensuel et Charlie hebdo, qui avaient alors disparu mais que je collectionnais, sans oublier le scénario de Griffu dans la revue BD. C’était à mon goût (après la période Delfeil de Ton) l’un des écrivains les plus virulents et drôles de l’hebdomadaire. Lorsque je me suis vraiment intéressé au polar, dans les années 1990, parallèlement à des études littéraires, j’ai lu ses propres romans, à rebours d’ailleurs : La Position du tireur couché, dont j’avais eu un avant-goût en « feuilleton » dans les pages de Hara-Kiri, puis Fatale (sans doute attiré par la couverture de Tardi), ensuite les autres. Et j’ai pris comme guide, pour explorer ce genre, les conseils délivrés dans ses chroniques ; je lui dois notamment la lecture de Donald Westlake, qui demeure un de mes favoris, ou encore de Pierre Siniac. Là encore, l’humour n’y est pas étranger. Manchette fut donc aussi un « passeur » : sa réflexion sur l’écriture, la forme et le style, la manière d’aborder et de lire le genre « polar », sont restées prégnantes chez moi. Le point de départ est son analyse de Dashiell Hammett, révélant tout le potentiel de critique sociale du genre « hard boiled« . Lorsque le Journal est paru, j’ai aussi trouvé chez lui un compagnon de pensée et de réflexion. Lui était issu du situationnisme, moi de l’École de Francfort (Adorno, Marcuse, Habermas, etc.) à travers mes études de philosophie. Les proximités d’une certaine vision du monde « post-marxiste » (pour faire court) sont évidentes, mais aussi l’intérêt profond que je partageais pour les genres dits « mineurs » (BD, SF, polar). Dans sa correspondance, Manchette peut citer Adorno dans une lettre, puis dans la suivante, défendre avec acuité la qualité du scénario des Watchmen, le chef-d’œuvre d’Alan Moore qu’il traduit alors et qui va révolutionner le genre « comics de super-héros ». Ses Lettres du mauvais temps publiées aujourd’hui, parce qu’adressées à des correspondants, révèlent enfin une autre facette, celle d’un homme chaleureux, touchant et plein d’humour, malgré sa lucidité sur l’état du monde, ce qui me le rend d’autant plus proche et présent.
2 – La reconnaissance universitaire est en cours il me semble, à preuve l’excellent ouvrage Jean-Patrick Manchette ou la raison d’écrire paru chez Anacharsis. Tant mieux, car les regards portés par des lecteurs-chercheurs d’une nouvelle génération, tel Nicolas Le Flahec, enrichissent notre approche de l’œuvre. On ne va pas se plaindre que Manchette ait apporté au polar certaines « lettres de noblesse », en plaçant la barre très haut en termes d’écriture et de propos. Et qu’il influence toujours des auteurs de roman policier comme de littérature générale. Les polars médiocres ressassant de sempiternels poncifs ne risquent pas de venir à manquer (voir les listes de best-sellers). Mais il n’y a pas de raison que le genre se complaise dans cette médiocrité, pour éviter je ne sais quelle « récupération ». Quant aux distinctions entre genres littéraires, elles me semblent beaucoup moins tranchées et pertinentes aujourd’hui que dans les années 1970. Et encore, même à cette époque (pour prendre deux exemples d’auteurs classés « SF » que Manchette appréciait), on pouvait parfaitement lire Substance mort de Philip K. Dick ou L’Île de béton de J. G. Ballard comme de la littérature générale. Manchette, comme on le constate dans la correspondance, s’intéressait beaucoup aux auteurs de New Worlds, qui formaient une avant-garde dans ce domaine et faisaient exploser les limites du genre. Ce que lui-même va accomplir avec le polar. Encore, pour y réussir, faut-il avoir une connaissance et une compréhension approfondie des codes du genre en question. Les Chroniques polar de Manchette prouvent son sérieux en ce domaine. On découvre aussi dans sa correspondance que Manchette a tenté d’adapter pour le théâtre (projet qui n’aboutira pas) le roman Adios Schéhérazade de Donald Westlake : justement un texte qui ne relève pas du genre policier, mais de la comédie. On sait que ses propres influences étaient avant tout littéraires (Flaubert par exemple), et qu’il s’enthousiasmera dans une de ses dernières « Notes noires » (pourtant publiées dans la revue Polar) pour l’œuvre d’un auteur classé d’avant-garde comme Arno Schmidt (qui lui faisait exploser stylistiquement la littérature même). Lorsqu’on relit L’Affaire N’Gustro, ce roman aurait pu être publié, tout comme Fatale, dans une collection de littérature blanche. Il fut d’ailleurs proposé à un éditeur généraliste (Albin Michel) avant d’aboutir à la Série Noire. C’est sans doute cette opportunité, à savoir la porte qui lui fut ouverte par cette collection spécialisée, qui l’a conduit à écrire ensuite des romans s’inscrivant plus nettement dans les codes de ce genre précis. L’Affaire N’Gustro est son premier « vrai » roman, celui où il distille aussi le plus d’éléments autobiographiques (il dira y avoir mis ses « tripes »). Son anti-héros fréquente le milieu du cinéma érotique bis et tente de placer un scénario à des producteurs, comme lui. Certains passages, par leur style très vert et argotique, leur dimension presque grotesque et humoristique, évoquent Céline et Siniac. Ce style est très différent du behaviorisme « hard-boiled » très épuré qu’il développera par la suite, cette écriture dite « froide » (à tort, car l’ironie y est omniprésente) qui deviendra pour beaucoup la marque de Manchette. Bref, j’espère que cette réédition venue à point nommée permettra aux lecteurs, même peu amateurs de polar, de découvrir un autre aspect de l’écrivain passionnant et complet qu’était Jean-Patrick Manchette.
Textes © Les auteurs – Illustrations © DR
(Paris-mai-juin 2020)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
