BERTRAND LECLAIR s’entretient avec CAROLINE HOCTAN à propos de son essai PUISSANCES DE L’ART OU LA LANCE DE TÉLÈPHE (Éditions MF, 2024) :
1 – Bertrand, tu es un écrivain incontournable de la littérature française. En effet, cela fait maintenant plus de trois décennies que tu échafaudes une œuvre qui se présente sous la forme de fictions et d’essais singuliers et profonds. En parallèle, tu mènes une activité de critique, non pas en « rapporteur » dans le sens même de rendre compte, mais en véritable lecteur, c’est-à-dire à travers la qualité d’une lecture propre à l’art de la critique, comme il n’en existe plus ou quasi plus, art qui chez toi peut avoir pour modèle celui de Blanchot, Bataille, Barthes ou encore Benjamin. La lettre B (le beth, la maison) doit avoir certainement un sens ici, mais ce n’est pas la question, disons que ce sont des noms qui définissent – pour de multiples raisons – ton niveau et ta qualité d’analyse. Tout ça pour dire que tu es un lecteur habité et exigeant, un œil sur les mots, un deuxième entre et le troisième dans une vision globale des textes. En ce sens, tu incarnes un personnage étonnant pour le commun des mortels, de ce bas monde, en cette basse époque : entre scribe et fou littéraire. De quoi te ranger pour certains au musée d’Histoire naturelle, sinon dans un cabinet de curiosités, tandis qu’à nos yeux, à la manière de Gloria Foster dans Matrix, tu fais office d’Oracle. Plus encore aujourd’hui où j’ai non seulement dévoré ton dernier essai comme Saint Jean dévorant Le Livre de Vie (Dürer), mais aussi été dévorée par lui tant il est impossible de ressortir détaché et inébranlable après une telle lecture qui est donc une « révélation ». Non pas que ce livre soit dévorant au sens propre : il n’a rien de zombiesque, mais il nous attrape et ne nous lâche plus, et parfois aussi il représente ce coup de poing dont parlait Kafka, mais qui assomme moins qu’il ne nous réveille assez subtilement. Ainsi, pourrais-tu nous exposer de quoi cet essai est-il le titre (mis en abîme par l’un de tes deux exergues) ? Et ce faisant, pourrais-tu nous expliquer comment ce livre s’inscrit dans ton œuvre critique tout en la dépassant, en la transformant, c’est-à-dire en la mutant d’une forme de critique « extérieure » – propre à l’inférence, au savoir – en cette forme de critique « intérieure » – propre à l’herméneutique, à la connaissance, à une interprétation quasi exégétique de la littérature – telle que ne la renierait pas un Wladimir Weidlé, aux yeux de qui, ton essai répondrait parfaitement à ses si admirables Abeilles d’Aristée ? Et si tu nous permets une question plus personnelle, plus intime, peut-on voir dans la nature même de cet essai une évolution de ta conscience qui découlerait d’un sorte de point de bascule dans ton parcours d’auteur comme dans ton existence ? Où se situerait-il alors, qu’est-ce qui l’aurait déclenché, et pourrait-on le qualifier aussi de révélation pour toi-même ?
Je te remercie de ta lecture généreuse et de ton engagement dans cet entretien. D’emblée, je voudrais préciser que Puissances de l’art ou la Lance de Télèphe doit la deuxième partie de son titre à une formule extralucide que le très jeune Samuel Beckett a placée en ouverture de son Proust, son tout premier livre paru en 1929 à destination du public britannique. En exhumant la figure mythologique de Télèphe sans rien en dire (accidentellement blessé par la lance d’Achille et guéri ainsi que l’avait prévu l’oracle par la rouille prélevée sur la même lance), Beckett a en somme signifié que, dans l’oeuvre proustienne, toujours le poison se révèle l’unique remède (selon À la recherche du temps perdu, l’imagination comme la vérité empoisonnent ou blessent, mais hormis le triste renoncement, il n’est aucun autre contre-poison possible qu’un surcroît d’imagination ou de vérité).
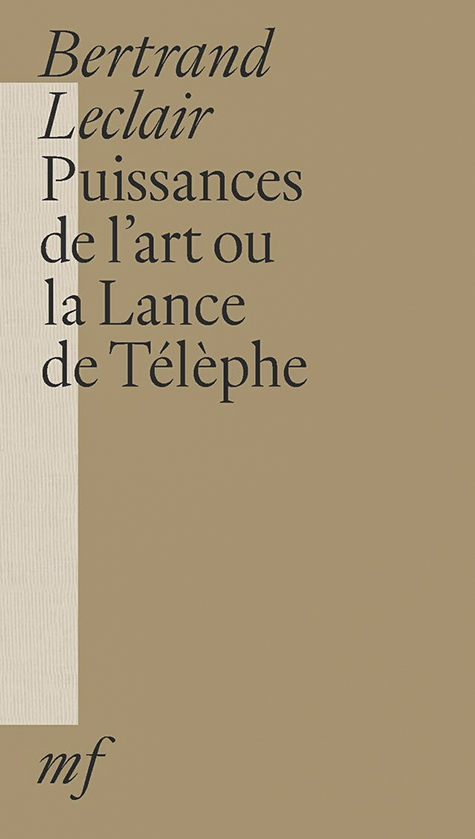
Cette clé magique a été l’un des déclencheurs du livre, écrit à la croisée de mes pratiques d’écrivain et de critique, mais aussi de mon expérience plus récente de la transmission en ateliers et autres séminaires d’écriture. Conscient pour autant du caractère paradoxal de ma démarche, puisqu’il s’agissait de témoigner des puissances du geste artistique depuis l’expérience que j’en ai (lisant, écrivant), mais par une sorte de méta-discours artistique (comme l’on parle de méta-discours amoureux), j’ai éprouvé à l’époque du confinement le sentiment que je pouvais enfin élucider mon entêtement à l’art, disons, afin d’en partager quelque chose. C’est pour une part illusoire, bien entendu, car le propre de la pratique artistique est que toujours tout est à refaire en la matière, cette pratique ne relevant pas d’un savoir susceptible de se construire, s’étayer, se thésauriser, mais d’une quête de connaissance par nature infinie : la connaissance, au contraire du savoir, n’existe qu’au présent de ses effets ; elle n’existe qu’à l’état liquide et nous coule entre les mots comme l’eau entre les doigts – les oeuvres vraiment vivantes en gardent la trace, cependant, offrant dès lors les indices suffisants pour nous convaincre sans autre preuve que, oui, cela a nécessairement du sens de s’aventurer à son tour en littérature, cette terra incognita où vibre l’inconnaissable. Reste que ce sentiment d’être en mesure d’élucider quelque chose vient également, comme je l’ai dit, de mon goût pour la transmission.

J’ai découvert voici une dizaine d’années le bonheur, non pas d’enseigner, mais de partager les fruits de mon expérience dans une démarche en somme d’initiation. Et j’ai la très grande chance, depuis, d’être suivi et accompagné par un groupe d’une vingtaine de personnes qui, au départ, ont voulu poursuivre l’aventure entamée dans le premier des ateliers d’écriture que j’ai menés au sein des éditions Gallimard – ateliers que j’anime à ma façon des plus singulières, s’il faut le préciser, c’est-à-dire en interrogeant bien davantage le pourquoi que le comment du geste artistique, le second étant nécessairement conditionné par le premier (comme le disait Kandinsky dans Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, un art qui ne se préoccupe que du « comment », ainsi que le firent les artistes dits pompiers à la toute fin du 19e siècle, est un art castré : il atteindra peut-être des prouesses inédites techniquement parlant, mais il est condamné à demeurer stérile, ne se reproduira plus – il perd du même geste toute puissance de déflagration et tout accès à la connaissance au seul profit de la perfection technique à laquelle il aspire). Ce groupe d’une vingtaine de personnes m’a non seulement accompagné dans les chantiers successifs, me permettant d’en partager les enjeux et les découvertes depuis sept ou huit ans, mais il m’a aussi amené, sinon contraint, à formuler mes interrogations de manière précisément à pouvoir les mettre sur la table : les exposer.

En ce sens, Puissances de l’art ou la Lance de Télèphe s’inscrit dans la continuité du petit livre que j’ai publié en 2019, Débuter, comment c’est, sous-titré sans vergogne aucune « Petit traité souvent drôle et toujours intelligent sur l’art et la manière d’entrer en littérature afin d’y tracer un chemin ». C’est également dans ce compagnonnage que j’ai pu écrire Le Train de Proust, et mener à bien mon prochain livre, Transformations, déclenché par une relecture bouleversante et bouleversée de La Métamorphose, de Kafka, relecture qui m’a ouvert la possibilité d’aborder enfin la question de la folie quand elle fait irruption au sein d’une famille, ce qui jusqu’alors me hantait de ne pas pouvoir être raconté. Une fois précisées ces conditions matérielles, qui ne sont pas négligeables dans une époque où les écrivains sont de plus en plus maltraités par l’industrie éditoriale, le cheminement avec ce groupe m’a amené au long des années à la nécessité de ré-interroger à nouveaux frais la notion de vie spirituelle, en faisant l’effort de dégager cette notion de toute emprise religieuse. L’oeuvre de Proust est essentielle sur ce cheminement, quand À la recherche du temps perdu est avant tout, à mes yeux, un long récit initiatique de bout en bout tourné vers l’avenir – je me contente ici de rappeler cette affirmation que Proust a posée très tôt, dès sa préface à la traduction de Sésame et les Lys, de Ruskin, préface parue en 1906 dans laquelle il éprouve le besoin de prendre ses distances avec ledit Ruskin après lui avoir consacré plusieurs années, en particulier lorsqu’il assène :
Tel est le prix de la lecture et telle est aussi son insuffisance. C’est donner un trop grand rôle à ce qui n’est qu’une initiation d’en faire une discipline. La lecture est au seuil de la vie spirituelle ; elle peut nous y introduire : elle ne la constitue pas.
Les livres témoignent de cette vie spirituelle nécessairement solitaire en chacun ; ils en perpétuent la possibilité et le partage précisément par cette qualité de témoignage, mais ils ne sont pas une fin en soi : Proust délaisse ici et définitivement la tentation de l’érudition et de l’esthétisme, celle qu’incarnera le personnage de Swann dans la Recherche, en bien des points le double du narrateur, sinon que Swann ne franchira jamais le seuil de la création, et donc d’une vie spirituelle qui n’est autre que « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue » et que peut délivrer la pratique littéraire, agissant loin dessous les conventions et les apparences qu’impose l’existence sociale.

2 – Cet essai se découpe en six chapitres – ce chiffre symbolisant à nos yeux, comme tu le sais, l’astre même de la littérature – et les titres que tu as donnés à chacun, ont une dimension qui nous semble, entre autres, fortement astro-schopenhauerienne (philosophe notamment influencé par la spiritualité moniste de l’Inde antique), tant dans l’approche du « monde » qu’il était le sienne, que dans la conviction qu’il portait, à savoir que toute métaphysique est liée à son éthique, et qu’en ce sens, l’art offre une possibilité de négation temporaire de notre volonté par lequel « le connaissant et le connu coïncident ». Ton premier chapitre s’intitule ainsi : « Ce présent qu’est le monde ». Comment la philosophie a-t-elle inspiré ton essai ? La pensée philosophique est-elle pour toi de nature aussi littéraire et poétique que la fiction ? D’après toi, doit-on parler de « littérature » lorsque des œuvres ne sont pas insufflées par une pensée métaphysique ? Si la littérature ne peut être un produit, c’est-à-dire un « objet », à savoir une « marchandise », est-ce parce que justement elle est d’abord une philosophie, et particulièrement une « philosophie de vie », qui, tel que tu l’exprimes évoquant le sens profond de La Recherche du Temps perdu de Proust « invite à devenir, non pas sage, mais un sage » ?
Et devenir un sage implique de ne pas l’avoir toujours été : c’est la grande leçon que le peintre Elstir offre au jeune narrateur dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs en revenant sur son propre parcours et, ce faisant, en esquissant en sous-main ce que sera le parcours du narrateur sur la voie de l’art, et donc, sur la voie d’une forme de sagesse, ce qui revient, par l’un de ces fascinants tours de force de Proust, à résumer par anticipation le livre que l’on est en train de lire. J’aime, de fait, la littérature qui pense, qu’elle l’affiche ou non : c’est la condition sine qua non pour que la littérature puisse se mettre à dé-penser, c’est-à-dire à dé-faufiler joyeusement la trame de la pensée commune et des habitudes routinières pour retrouver dessous la puissance vitale. Alors, il devient possible de se confronter à l’ignorance qui demeure la nôtre quels que soient les savoirs accumulés au long des siècles, et quelle que soit l’idéologie contemporaine qui nous invite à « ignorer l’ignorance » pour bâtir un monde qui se veut toujours plus efficient dans sa capacité à s’améliorer (et courir ainsi de catastrophe en catastrophe, comme grinçait Pierre Klossowski après Nietzsche dénonçant dès La Naissance de la tragédie l’indécrottable optimisme de la « raison » occidentale). Un des enjeux primordiaux de Puissances de l’art, c’est d’esquisser une pensée qui serait de nature spécifiquement artistique (littéraire), quand cette pensée artistique ne relève pas d’un savoir constitué, mais d’une quête sans cesse renouvelée. Quand je dis que j’aime la littérature qui pense, je n’évoque pas les livres qui s’appuient sur la philosophie, la sociologie, la psychanalyse ou encore la physique, même s’il est important, évidemment, qu’un écrivain soit capable, non pas de maîtriser, mais du moins de traverser ces savoirs constitués. Ce que j’essaie de mettre au jour ici, c’est un mouvement de pensée, et dès lors, une manière de penser que seul le geste artistique peut libérer. L’une des convictions de départ, c’est qu’au fond tous les grands artistes, lorsqu’ils ont pris la peine de réfléchir leur pratique, non pas répètent tous la même chose, mais tournent tous d’une manière ou d’une autre autour de la même question de la connaissance et du vide afférent. Je puise donc avant tout dans la longue histoire des écrits d’artistes visant à une forme d’approche théorique, et tout particulièrement, au moment de l’effondrement de tous les académismes qui est consécutif à l’effondrement du religieux en Occident, à la charnière des 19e et 20e siècle. Pour ne citer qu’eux, outre Kandinsky déjà nommé, je songe ici aux écrits de Gauguin, de Rodin, au Contre Sainte-Beuve de Proust, bien sûr, auxquels il faut impérativement ajouter désormais les inépuisables Cours de poétique de Paul Valéry qui n’ont été publiés qu’en 2023 (d’où l’ajout à Puissances de l’art en guise d’appendice du long article que j’avais consacré à cette parution dans AOC).
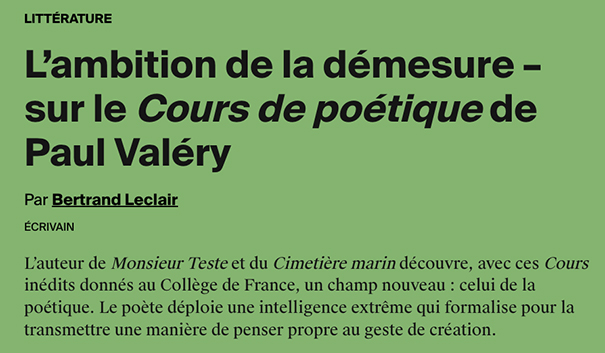
Bien entendu, je n’oublie rien de l’oeuvre de Nietzsche – assurément plus importante dans ma démarche et mon parcours que celle de Schopenhauer – Nietzsche qui est un artiste autant qu’un philosophe, poète trop ignoré en France, musicien au talent avéré. Je viens d’ailleurs de relire avec grand étonnement La Naissance de la tragédie, son premier livre paru en 1872 (il avait 27 ans), avec lequel il a pris ses distances dans une sévère auto-critique de 1886, ayant entre temps écrits ses livres majeurs, Le Gai savoir et Par-delà le bien et le mal, sans oublier évidemment le vaste poème de l’éternel retour qu’est Ainsi parlait Zarathoustra. Bref, j’avais lu voici longtemps La Naissance de la tragédie sans jamais y revenir ensuite, contrairement aux autres livres, puisque j’étais au fond assez d’accord avec ladite auto-critique de Nietzsche qui, outre la dimension de dithyrambe wagnérien prétexte à célébrer on ne sait trop quelle « essence du germanisme », déplore de s’être à l’époque – je cite – « péniblement efforcé d’exprimer en formules schopenhauriennes et kantiennes des jugements de valeur insolites et neufs qui étaient foncièrement contraires à l’esprit comme au goût de Kant et de Schopenhauer ». On pourrait ajouter que la partition qu’il propose entre les arts plastiques qui relèveraient de « l’apollinisme » et l’art musical qui serait par excellence le lieu du « dionysisme » est très schématique – une fois l’académisme mis à bas, tout l’art du 20e siècle, en peinture comme en musique, s’est employé à le démontrer. Nietzsche, cependant, insiste a posteriori sur le fait que La Naissance de la tragédie, d’une certaine manière, contient potentiellement tous les livres qui suivent par une percée qui est essentielle à sa pensée :
Le fait est que, dans ce temps-là, j’avais réussi à saisir ce fait redoutable et dangereux, ce problème à cornes qui sans être nécessairement un taureau était un problème neuf, je dirai aujourd’hui que c’était le problème même du savoir; pour la première fois le savoir était envisagé comme problématique et suspect.
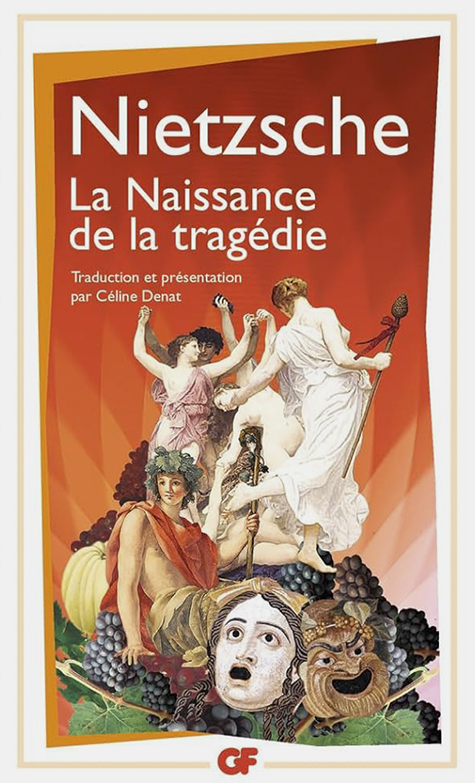
À le relire récemment, c’est un peu éberlué en réalité que je constate que nombre de problématiques avancées d’une manière si différente dans Puissances de l’art ou la lance de Télèphe trouvent, ici, un étrange écho par anticipation ; la dualité entre l’apollinisme et le dionysisme qu’élabore Nietzsche est une autre manière d’affirmer ce que je développe à partir d’un ensemble de dichotomies dont je joue en réseau, puissance versus pouvoir, connaissance versus savoir, art versus culture, être versus exister, etc., ces dichotomies entretenant toutes un rapport étroit avec celle, fondamentale à mes yeux, qui lie et oppose réel et réalité, ce qu’a le premier formulé Georges Bataille, grand lecteur de Nietzsche s’il en fut, avant que Jacques Lacan la reprenne pour la mener très loin. Pour aller vite : alors même que, étymologiquement, le signifiant « réel » désigne « ce qui est », ce réel demeure insaisissable au langage grâce auquel nous élaborons collectivement une réalité qui ne sera jamais qu’une représentation du réel, une représentation admise par le plus grand nombre pour élaborer le lieu commun où construire nos existences dans l’illusion du pérenne et de la solidité – et cela rejoint assurément la critique du socratisme qu’élabore Nietzsche dans La Naissance de la tragédie pour dénoncer l’optimisme de la raison raisonnable, qui implique de nier la part obscure non pas tant des individus que de la communauté des hommes et de nier le tragique qui lui est consubstantielle, cette part obscure que peut libérer par instants tragiques et/ou magiques ce qui s’incarne, selon Nietzsche, dans le « dionysisme ». Et pour le dire très simplement, je pense profondément que les grands livres, les grandes oeuvres plus généralement, sont celles qui viennent trouer un court instant la trame de la représentation qui nous tient lieu de réalité pour y laisser jaillir à nouveaux frais quelque chose du réel opaque et aussi insaisissable que la vérité depuis qu’elle ne nous tombe plus du ciel – c’est le fameux coup de hache du tout jeune Kafka dans la mer gelée qui est en nous. Cela bien évidemment rejoint toute la problématique de l’instinct et, partant, celle de l’ordre et du désordre qui sont centrales dans Puissances de l’art. D’où le fait que, à force d’évoquer, au sein de l’espèce de séminaire informel dont je parlais plus haut, l’opposition entre le profane et le sacré tels que Roger Caillois les a définis dans L’Homme et le sacré, publié en 1939, j’ai fini un beau jour par entendre ce que je disais aussi lorsque je prononçais le mot « sacré » : mais « ça crée ! », évidemment, au sens aussi bien où Lacan a creusé une différence flagrante avec la pensée freudienne en affirmant : « mais, ça parle ! ». C’est également toute la leçon du Contre Sainte-Beuve de Proust :
Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence. Chaque jour je me rends mieux compte que ce n’est qu’en dehors d’elle que l’écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions, c’est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même et la seule matière de l’art. […] Et cette infériorité de l’intelligence, c’est tout de même à l’intelligence qu’il faut demander de l’établir. Car si l’intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c’est elle seule qui est capable de la décerner. Et si elle n’a dans la hiérarchie des vertus que la seconde place, il n’y a qu’elle qui soit capable de proclamer que l’instinct doit occuper la première.
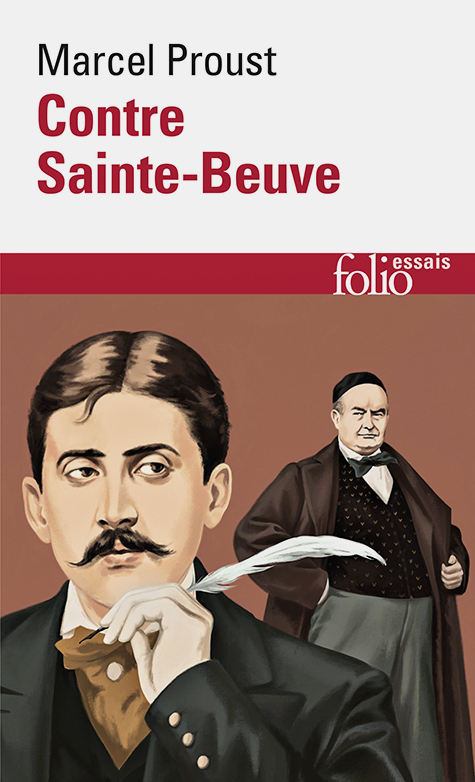
3 – Tu évoques l’industrie éditoriale et elle en prend pour son grade – avec à-propos – tant ses produits labellisés par des titres de boîtes de conserve (par exemple : Un été avec Machin, Un été avec Bidule, etc.) s’inscrivent finalement dans aucune autre « expérience » que celle de la reproductibilité marchande. Or, cette industrie prétend toujours être la représentante de la littérature quand les labels et slogans sensés authentifier l’excellence de sa production ne sont, au fond, rien d’autre que des éléments de langage vides de forme et de sève – dans le sens de ce qui vit ou est vivant. Plus encore, ils sont les labels et les slogans d’une marchandise interchangeable et reproductible à l’infini au point même où ChatGPT pourrait les rédiger sans que personne n’ait à se fatiguer à le faire, puisqu’il n’y a dans ces produits aucune dimension subjective ni créative, seulement commerciale, donc fakematée – dans le sens de ce qui est sans vie, de ce qui passe avec les saisons, sinon de ce qui est déjà mort avant même d’être oublié. Ainsi peu importe qu’on nous propose l’été ou l’hiver, on pourrait tout aussi bien nous vendre Mars ou la Lune, ces produits procèdent de la même intention qui est, précisément, de ne pas en avoir, c’est-à-dire de n’avoir aucune intention qui découle d’une pensée comme d’une praxis essentielles à l’existence, mais surtout d’aucune véritable « expérience » dont tu rappelles que cette dernière est l’unique « voie d’accès à une forme de connaissance » qui est « au principe de l’art » même. Or, comme tu l’exposes magnifiquement, cet art seul représente la « vérité » de notre existence, sinon la vie même. L’excellent Jan Zábrana – que je ne cesse de lire depuis des années – exprimait ainsi que « qui a réussi, de son vivant, à se dégager de sa tombe, récolte la haine. Jamais on ne lui pardonnera cette insolence opiniâtre. Jamais », à commencer par la religion dont toute le pouvoir repose sur les valeurs mortifères. Pourrais-tu donc revenir ici sur cette idée de « vérité » propre à la littérature ? Comment expliques-tu que la société rejette toujours la vérité que nous délivre la littérature pour lui préférer cette pseudo vérité que nous impose cet « asile de l’ignorance » (Spinoza) qu’est la religion ? En quoi la modernité n’a finalement rien su, ou pu changer, ou à la marge, à cette situation ? Qu’est-ce qui explique cette haine viscérale que la société a toujours vouée à la littérature – qui est pourtant une forme de vérité complète – en lui préférant tout ce qui entretient ce « mensonge érigé en ordre mondial » (Kafka) qu’est la religion, et dont les complotismes de tout acabit semblent finalement découler assez naturellement aujourd’hui ? Baudelaire et consort apprécieront sans doute d’outre-tombe, mais comment expliquer ce soudain revirement du Vatican envers elle, en la personne du pape François qui s’arroge le beau rôle de la défendre aujourd’hui après des siècles de persécution et de vilipendement ? Est-ce le signe d’un aveu non seulement d’échec quant à la religion, ou bien le signe d’une angoisse face au Désastre qui vient et contre lequel la religion est toujours plus prompte à la morale qu’à l’expression d’une quelconque vérité ? En quoi, pour toi, sauver la littérature (le langage, l’écriture) participerait-il du même mouvement que de sauver le vivant de la destruction globale qui a cours, destruction que l’on peut aussi nommer « ignorance », celle d’une inconscience, précisément inculquée par la religion ? Peux-tu nous expliquer ainsi pourquoi cette ignorance n’aurait rien à voir avec un problème de « savoir » ni même de « progrès », mais bien avec un problème de « connaissance », le déclin de cette dernière laissant précisément la place à ce que tu nommes « l’obscurantisme progressiste » qui, sous ses petits airs cartésiens dont il a fait une véritable religion, a donc tout d’une ignorance plus crasse encore, puisqu’il s’agit de celle concernant le « savoir-vivre », cette fameuse « vie bonne » dont il n’a cure ?
D’abord, ta question m’invite à reprendre à ma réponse précédente, parce que tout cela se tient évidemment, se tient tellement bien qu’on éprouve parfois le sentiment désespéré de tourner en rond entre deux trouées de lumière dans l’opacité de la langue, ce qu’il faut sans doute admettre, à reprendre donc pour ajouter que je partage la méfiance de Proust, dont la pensée est très proche de celle de Nietzsche à bien des égards, envers la philosophie en tant qu’elle se constitue en savoir. Proust est persuadé que nous nous protégeons sans cesse, dans la vie ordinaire, de la vérité (parce que nous nous protégeons, non pas de la mort, mais de la peur de la mort), et que les tenants de la philosophie n’y échappent nullement – ce que Deleuze a magistralement résumé, en « philosophe artiste », au tout début de Proust et les signes. Selon Proust, et il faudrait évidemment moduler cette affirmation d’après Deleuze :
… le tort de la philosophie, c’est de présupposer en nous une bonne volonté de penser, un désir, un amour naturel du vrai. Aussi la philosophie n’arrive-t-elle qu’à des vérités abstraites, qui ne compromettent personne et ne bouleversent pas. « Les idées formées par l’intelligence pure n’ont qu’une vérité logique, une vérité possible, leur élection est arbitraire ». Elles restent gratuites, parce qu’elles sont nées de l’intelligence, qui ne leur confère qu’une possibilité, et non pas d’une rencontre ou d’une violence qui garantirait leur authenticité. Les idées de l’intelligence ne valent que par leur signification explicite, donc conventionnelle.
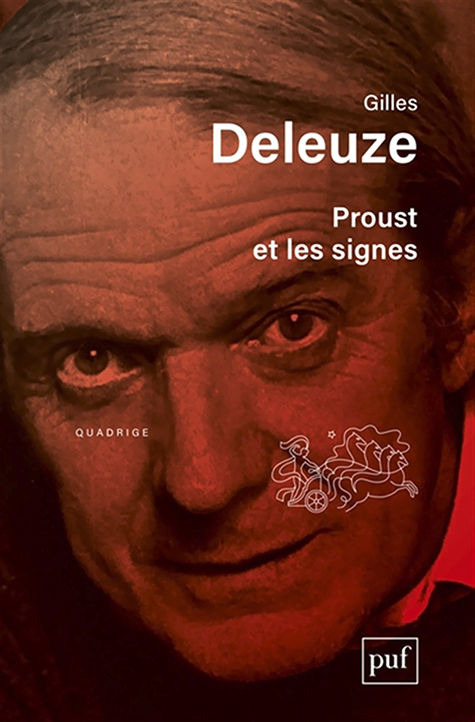
Et je tâche de répondre en reprenant, à présent, le mot « ignorance ». Ce mot peut désigner deux choses extrêmement différentes, tout à la fois liées, et radicalement opposées. Il y a, d’une part, ce qui relève de l’inconnaissable, notre ignorance collective et individuelle qui touche aux mystères de la vie (l’origine et la fin, c’est-à-dire la mort, mais également, la finalité de la vie, qu’elle soit collective ou individuelle) et sur laquelle le savoir humain, aussi considérable soit-il – et il l’est toujours davantage – n’a fait, au long des siècles, qu’empiéter. À titre d’exemple fortuit, je lisais une interview de l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan qui évoque la matière noire et l’énergie noire, expliquant que :
pour étudier la formation des galaxies, il faut connaître le contenu en masse et en énergie de l’univers. Or, 95% de la composition de l’univers nous échappe encore ! Nous ne connaissons que 5% de sa composition : 0,5% de matière lumineuse, comme les étoiles, et 4,5% de matière noire « normale », c’est-à-dire faite de protons et de neutrons. Je dis normale, car il y a aussi 27% de matière noire « exotique », composée d’autre chose qu’on ne connaît pas. On a déduit sa présence, car sa gravité empêche les galaxies de se désintégrer. Sans elle, comme les étoiles se déplacent très vite au sein des galaxies, et les galaxies très vite dans les amas de galaxies, elles se seraient disloquées depuis belle lurette. Et enfin, il y a la plus grande énigme, l’énergie noire, qui représente 68% de l’univers. On n’a aucune idée de ce que ça peut être ! On ne connaît pas sa nature, on sait simplement qu’elle est anti-gravité : elle repousse, au lieu d’attirer. On croit savoir beaucoup de choses, mais l’univers nous remet constamment à notre place.
On pourrait prendre mille autres exemples de notre ignorance, évoquer l’incapacité où les physiciens demeurent, aujourd’hui, d’articuler ce qui est démontré de la physique quantique et ce qui est démontré de la relativité générale. Mais l’exemple de l’astrophysique me semble particulièrement intéressant pour toucher au mystère de l’origine qui demeure entier, en miroir du mystère de la fin qui lui est bien évidemment lié (la fin de l’univers, sa finalité). Dans nos existences individuelles, l’inconnaissable est le même. Cette ignorance générale a de fait longtemps été l’apanage du sacré, c’est-à-dire du religieux – quand le propre du sacré est de séparer, de mettre à part, et c’est toute la question du tabou : mettre à part ce qui relève du mystère le plus épais permet au monde profane de s’élaborer, se construire sans que les individus qui le trament ne se posent de questions risquant d’entraver son bon développement (si j’ose simplifier à ce point).
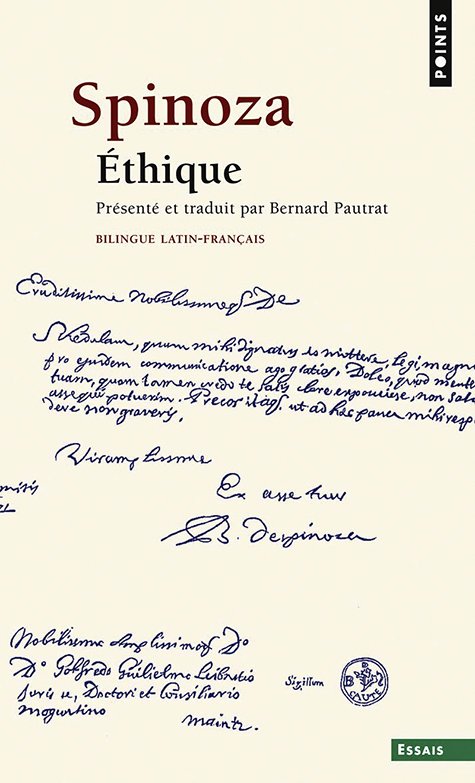
C’est pourquoi la religion est l’asile de l’ignorance : le lieu du sacré, clairement séparé du profane. L’effondrement du religieux, en Occident – effondrement que je ne regrette évidemment pas une seconde tant je partage ton sentiment de l’emprisonnement que constitue le religieux qui interdisait toute démarche de connaissance empiétant sur son domaine réservé – l’effondrement du religieux donc, sous les coups de boutoir de la science, de l’art et de la pensée, a libéré l’ignorance, ou plus exactement, la confrontation à cette ignorance constitutive, mais par réaction, la raison raisonnable, la raison profane s’est constituée en forteresse tout au long du 19e siècle pour s’en protéger de cette ignorance que plus rien n’isolait : il « fallait » que le monde capitaliste en plein essor puisse tourner sans que les individus destinés à l’alimenter ne se posent de questions inutiles à son développement, questions qui, vu d’aujourd’hui, n’auraient pas été inutiles à la préservation du vivant, c’est le moins qu’on puisse en dire !… C’est aussi pour cela que la mécanique capitaliste nous « fantômise » de jour en jour, et que l’art qui restitue le corps vivant a nécessairement, par ce fait même, une dimension politique, au sens le plus fort du terme. Mais c’est surtout, bien entendu, ici qu’apparaît l’autre sens du mot « ignorance » : une ignorance pour le coup entretenue, voire volontaire, qui est l’aveuglement de ceux qui ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, préférant se tenir, comme le répète incessamment Proust, au petit confort des habitudes et de la raison raisonnante, raisonnable, ordinaire, qu’on ne les confronte surtout pas au mystère du vivant, à l’origine obscure ou à la mort ! D’où ce que tu poses dans la question suivante, y compris les conséquences désastreuses de cet aveuglement volontariste, qui est bien entendu la motivation profonde du divertissement de masse considéré comme un remède à l’inquiétude, mot qu’il faut entendre dans toute sa profondeur étymologique.

4 – Tu analyses longuement les racines de cette « ignorance » dont tu montres que, « après l’épisode si bref et libérateur des Lumières, l’obscurantisme catholique aura ainsi laissé la place à un étrange obscurantisme rationnel prétendant embrigader sciences, techniques et philosophie sous la bannière du Progrès […] ». Ce qui est saisissant dans le déroulé que tu en donnes, c’est de constater qu’en France – au 20e siècle, à peine plus de deux décennies après la Seconde Guerre mondiale – la presque totalité de nos concitoyens, sinon nous-mêmes, avons grandi dans une famille « où les enfants étaient le dimanche envoyés à la messe par des parents qui s’en dispensaient » alors même que la plupart d’entre-nous apprenions souvent tard – par inadvertance ou par nos propres moyens – que non seulement Jésus était le roi des Juifs, mais que la responsabilité de la chrétienté dans la construction de l’antisémitisme et l’impensable de l’extermination était plutôt problématique (sans même parler de l’esclavage, du colonialisme, etc). Si chacun de nous avait évidemment lu Spinoza, Montaigne, La Boétie, Diderot, etc. au lieu d’être abreuvés de niaiseries religieuses qui rendent, à la fois, aussi incultes qu’inconscients, sinon blasés et dépressifs, sans doute aurait-il été plus aisé de croire en nous aujourd’hui, d’être heureux de vivre et d’aller de l’avant, mais aussi, il aurait peut-être été plus aisé de faire face à nos responsabilités et d’arrêter de geindre sans cesse. Je ne sais plus quel est l’historien qui a expliqué que toute la culpabilité de la France, au sortir de la Guerre, venait du fait que nous faisions partie des « perdants », mais surtout, que nous refusions de regarder en face notre « culpabilité » – et donc d’y faire face – notamment en ce qui concerne notre antisémitisme et notre xénophobie quasi génétiques. Ne parvenant pas à l’analyser, à la nommer, cette culpabilité nous ronge de ce qui nous hante et que nous refoulons, refoulant par-là même toute vérité que recouvre peu à peu cette ignorance dont l’effondrement de la littérature n’est finalement, aujourd’hui, que le symptôme le plus visible, avant l’effondrement même de tout langage, et évidemment de toute conscience… Marie Cardinal en son temps avait pu décrire comment la quête de sens au cours de sa psychanalyse l’avait aidée à comprendre l’importance du langage, à trouver « les mots pour le dire ». Estimes-tu que la littérature permet plus que jamais d’endosser le rôle que la psychanalyse semble avoir perdu aujourd’hui ? Pour le dire autrement, dirais-tu que la littérature comme l’art, développent une force psychique, à la manière dont on dit que l’activité sportive développe la puissance physique ? Au fond, la littérature et l’art seraient-ils plus que leurs propres mots, leur propre langue, mais un véritable « métalangage », c’est-à-dire un système ou un langage supérieur permettant de décrire d’autres langages, d’autres réalités, d’autres mots (maux) ? En ce sens, la littérature comme l’art seraient-ils une espèce de connaissance de toutes les connaissances rejoignant ce « troisième genre de connaissance » définit par Spinoza ? Ainsi, après une approche schopenhauerienne, en quoi ton essai expose-t-il une connaissance de la littérature et de la création qui serait, pour sa part, inspirée, voire la continuité, d’une éthique spinozienne ?
Je vais m’en tenir ici, plutôt que de m’aventurer sur des terrains philosophiques que je ne prétends pas maîtriser si je les ai fréquentés, à la question de la représentation, qui est évidemment le coeur battant de tout geste artistique, quand bien même ce dernier relèverait de l’abstraction dans les arts plastiques. Tout est représentation autant que tout est représentation, et ne l’a jamais été autant que depuis l’apparition de la presse médiatisant les représentations, puis au fil du siècle dernier les nouveaux médias de masse, et désormais les développements accélérés des outils informatiques générant des univers virtuels et ce que l’on appelle « l’intelligence artificielle », qui n’est qu’un outil, mais un outil d’une puissance stupéfiante, pour le meilleur ici, pour le pire ailleurs (tous les outils ont toujours présenté cette ambivalence, de reste, à commencer par le marteau qui assomme et la lame qui mutile ; même la roue est le nom d’un supplice horrifique). Le divertissement spectaculaire-marchand y a trouvé le moyen de décupler sa puissance d’attrait, si volontiers anesthésiante, alors que l’accélération du temps chronologique nous éloigne toujours davantage de ce que Nietzsche appelait « le sens de la terre », c’est-à-dire d’un ancrage dans le réel, réel qui cependant demeure ce qui nous anime profondément.
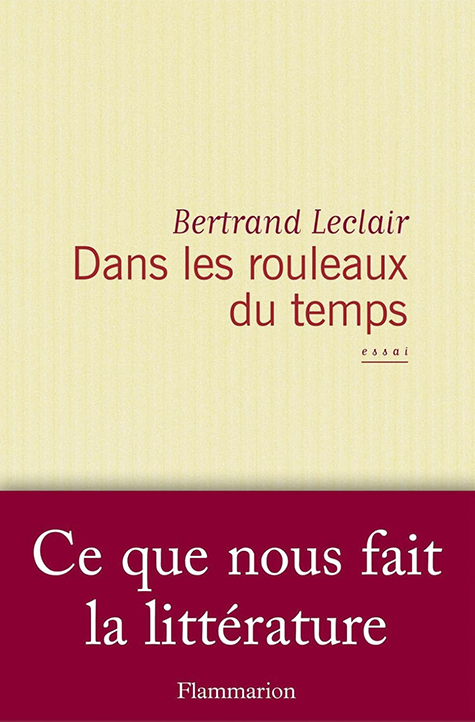
Mais, pour autant, la problématique reste la même : la doxa résulte de ce système de représentation dont la langue est le vecteur premier. Pour le dire tout autrement, je crois profondément que l’art, précisément parce qu’il entraîne une verticalisation dans le temps qui est une ouverture aussi bien à la grande joie proustienne (qui est la même que celles de Rimbaud et de Nietzsche) qu’à la détresse de la perte, qui peut en somme nous aspirer vers le haut dans le vertige enivrant, aussi bien que dérober le sol sous nos pieds pour notre dé-solation (entraînant un dés-astre – la manière dont le deuil ou la jalousie peuvent emprisonner dans un temps de souffrance, un temps qui ne passe plus, est un exemple courant de temps verticalisé), que l’art donc, est avant tout une manière d’affronter le mystère plutôt que de l’enfouir sous l’existence quotidienne au nom des exigences de cette dernière. Affronter le mystère, la question de l’origine et de la fin, ce que l’engagement dans un geste artistique rend possible, c’est se tenir face à la mort – et par le fait y trouver la force de la remettre à sa place plutôt que d’en nier les effets permanents, anesthésier la terreur qu’elle provoque dans le confort routinier d’un temps horizontalisé, rythmé par les échéances, et en somme de l’ignorer, ce qui ne peut que lui laisser le champ libre pour tout contaminer de son empreinte persistante : c’est la dimension mortifère d’une société séculière qui prétend avoir jeté avec l’eau du bain religieux tous les questionnements qui hantent l’animal parlant qu’est l’homme depuis la nuit des temps.
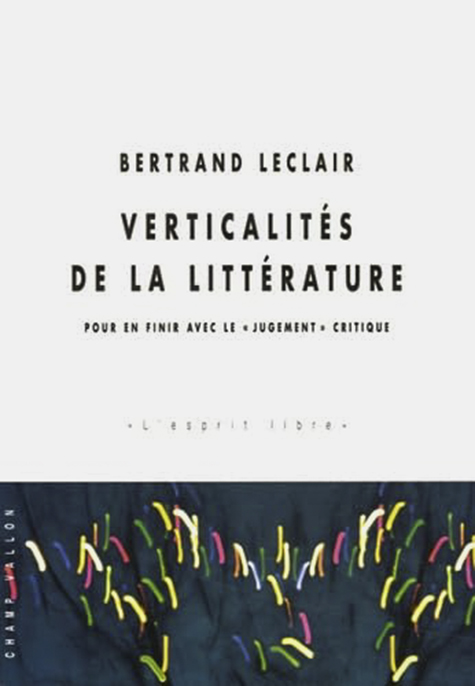
Créer – écrire en ce qui me concerne, et c’est la grande chance de tous ceux qui écrivent (il en va certainement de même des autres arts) – entraîne littéralement à cette verticalité, d’abord et tout bêtement parce qu’une fois libéré du « quant-à-soi », le geste de création permet de faire quelque chose de ce qui nous arrive, de ce qui ne manque jamais de nous arriver, bon ou mauvais. Dès lors qu’on élabore une représentation nouvelle de ce qui est vécu, que cette représentation s’approche de l’autobiographique ou qu’elle en soit fort éloignée, ce qui a été vécu, par exemple un événement tragique, s’estompe derrière ce que l’on en a fait, et qui délivre de la joie, serait-ce une joie impure – délivre ainsi le carburant nécessaire à la quête d’une vérité que l’on sait bien insaisissable. Comme tu l’exprimes vivement tout au long de cet échange, cette chance de l’écrivain, cette liberté inouïe que l’artiste veut toujours entretenir, dont il s’entête à renouveler la possibilité (car tout est toujours à refaire, bien entendu : c’est un chemin qui n’a pas d’autre finalité que d’échapper aux grand-routes de la pensée, aux « autoroutes de l’information » gommant tout ce qui les entoure entre deux péages), cette chance a un prix qui est parfois lourd, et qui en a incité plus d’un à baisser la garde pour produire, non plus ce qui est nécessaire, mais ce que réclame l’industrie culturelle à seule fin d’agrémenter la léthargie commune, cette anesthésie mortifère et politiquement injustifiable.

5 – Dans le chapitre qui reprend précisément les termes de ton titre – « La Lance de Télèphe » – tu expliques à quel point tout savoir est conditionnant, c’est-à-dire restrictif, enfermant, mais aussi que tout savoir est un véritable conditionnement, à savoir une inconscience en face de laquelle notre libre arbitre apparaît lui-même n’être qu’une sorte de « vue de l’esprit » que nous pourrions aussi bien qualifier de « fabrication du réel ». Ainsi, tu estimes qu’il « n’y a que dans la dimension spirituelle de la vie que cette notion de libre arbitre peut prendre sens, en dehors des constructions sociales et historiques qui formatent nos existences ». Ce point m’intéresse tout particulièrement au regard de mes propres réflexions et de mon propre projet d’écriture. En effet, nous sommes les uns et les autres amenés dans la vie à nous confronter au mur du réel, et pour certains d’entre-nous, à devoir nous prendre au coin de la gueule une forme de vérité de ce « mur », attachée à sa fabrication, sinon à sa falsification. Pour le dire autrement, nous pouvons, pour des raisons complexes, être amenés à prendre conscience de ce conditionnement depuis l’autre côté du mur qui se transforme alors en un véritable « miroir » nous dévoilant comment et pourquoi notre existence est à ce point fausse, qu’elle n’est – et n’a jamais été – que l’existence de nos croyances, des apparences que l’on se donne, de la posture que l’on joue, bref… de notre pure vanité. Ce « mur-miroir » nous renvoie ainsi violemment au programme auquel nous répondons sous la forme d’un conditionnement que, en amont (familial) comme en aval (société), nous alimentons nous-mêmes à qui mieux-mieux (certes, tout en geignant et en traînant des pieds, mais en se gardant bien de le remettre en question) dans un but qui, généralement, nous dépasse ou nous terrasse. Ainsi, c’est en acceptant d’effectuer une sorte d’excavation nous permettant de descendre (ou de tomber, chuter) très loin aux origines du « ça », très loin dans l’épaisseur de ce qui est comme « ça » que l’on quitte la superficialité dont on se drape pour briller en société (ce « quant-à-soi » qui se résume trivialement au « moâ »), et donc que l’on peut toucher la réalité, cette réalité que le réel ne peut alors plus manipuler ou falsifier, que l’on peut trouver enfin, non pas son moâ (produit fabriqué), mais son soi véritable dont on se doit d’accoucher pour être enfin au monde. C’est dans ce saut, dans cette excavation de la réalité, que survient alors la rencontre de l’altérité véritable, à savoir celle d’un « Autre » – souvent une bonne âme, mais pas que (sinon ce ne serait pas drôle, c’est-à-dire ce serait trop simple) – qui nous tend la main pour traverser les épreuves qui s’ensuivront. En littérature, il y en a quelques exemples forts, à commencer par Virgile sans lequel Dante n’aurait pas atteint cette « dimension spirituelle de la vie » sur laquelle je souhaiterais que tu reviennes. En effet, il me semble nécessaire de la définir ici – ou du moins de préciser – ce que tu entends par le terme de « spirituel », puisque bien évidemment – j’espère qu’on l’aura compris ! – il n’a rien à voir avec les croyances (familiales, religieuses, culturelles…) qui ne découlent que du seul conditionnement social, et encore moins avec ces activités prétendument de « bien-être » (càd d’apparences) et de « développement personnel » (càd d’exploitation et de manipulation redoublées) qui, elles, découlent toutes d’une économie de cannibalisation de la vie. Cette dimension spirituelle de la vie aurait ainsi davantage à voir avec le quantique, l’épigénétique, la pensée, le langage, et la lecture : l’acte même de lire, d’avancer page après page, de s’enfoncer dans la pensée d’un Autre. Explique-nous comment la littérature est-elle la porte, le passage, l’entrée, l’ouverture, l’issue vers une dimension spirituelle, phénoménologique, de la vie même, du fait que pour toi, « le rapport à la vie et le rapport à l’art ne font qu’un » ? Et comment la clef en est-elle cette « lance de Télèphe » ? Peux-tu nous expliquer aussi pourquoi chacune de nos phrases – lue ou écrite – représente, dans l’énergie et la symbolique, une telle lance ? Pour le dire autrement, comment cette lance est-elle une manière d’expliquer le processus « des mots pour le dire », mais aussi l’énergie de « l’inconnaissable » ? Comment cet inconnaissable représente-t-il, en quelque sorte, l’aimantin de cette lance ? Dirais-tu que l’inconnaissable est « l’esprit » et que la lance en est sa « volonté » ? De là, serais-tu d’avis de considérer la littérature comme un matériau non identifié du fait que sa gestation et sa formation restent inexplicables au fond ? Serais-tu d’accord pour dire qu’il est impossible de faire de la littérature pour quiconque ne serait pas un « humain », cet être de chair et de sang, mais donc aussi cet être d’esprit ? Comment qualifier alors cette écriture digitale générative et automatisée selon des paramètres technologiques où l’absence de vécu et d’affect détermine pourtant une pensée ? De quoi, en ce sens, l’écriture est-t-elle le nom/la voix ?
Je crois que, bien que tu emploies ici les signifiants « réel » et « réalité » d’une toute autre manière que moi, ce que tu avances rejoint ce que j’ai posé en réponse aux questions précédentes. Mais de fait si la machine, quelle qu’elle soit, peut fabriquer de la représentation, il faut être humain plus qu’humain pour la trouer, la déchirer, cette représentation, quand bien même la fatalité voudrait que la représentation rapidement cicatrise, faisant de la cicatrice qu’a provoquée le surgissement d’une oeuvre majeure une couche nouvelle de représentation (ce pourquoi tout est et sera toujours à refaire). Déchirer la trame de la représentation commune qui si souvent nous étouffe, et par là se donner de l’air dans une doxa devenue asthmatiforme, quand se donner de l’air bien entendu c’est en libérer pour les autres, tous les autres, y compris ceux qui ne se sentent en rien concernés par la création artistique, n’éprouvant nul besoin de chercher de l’air (l’industrie pharmaceutique les fournit en Ventoline et autres divertissements à inhaler les yeux fermés). De même qu’on écrit toujours avec toute sa bibliothèque, y compris tout ce qu’on croit en avoir oublié, de même le geste artistique est d’abord, est avant tout un phénomène contagieux. J’écris parce que j’ai lu.

C’est en cela que la lecture, comme le dit Proust, nous amène au seuil de la vie spirituelle : les oeuvres qui nous marquent profondément témoignant d’un autre rapport au réel, témoignant qu’une autre manière de penser et d’appréhender le monde et les autres est possible pour qui est prêt à se risquer hors des sentiers battus et rebattus de la pensée commune. Où aucune machine ne mènera jamais, puisque qu’une machine peut sans doute imaginer, c’est-à-dire « fabriquer des images », mais elle ne pourra jamais imaginer qu’à partir des images déjà existantes, elle ne pourra jamais aller plus loin que la reproduction améliorée de l’existant, y parviendrait-elle avec une perfection inhumaine : il n’y a pas d’altérité possible en ce domaine, quand la question de l’altérité (et de ce qui nous dés-alère, en littérature) est fondamentale. Tout reste à faire, rendu sur le seuil. J’aime beaucoup la courte « parabole » du jeune Gide intitulée Le Retour de l’enfant prodigue : au soir du retour au foyer paternel de l’enfant prodigue, après la fête, dans le secret de la chambre à coucher, son cadet l’interroge. Et le soupçonne bientôt d’avoir renoncé, d’avoir pris peur. Le cadet s’émerveille du peu qu’il entend, cependant, s’émerveille au point de faire son balluchon dans la nuit, bientôt encouragé par l’aîné par la force de l’exaltation : il ira, lui, il ne reculera pas. Prodiges du récit.
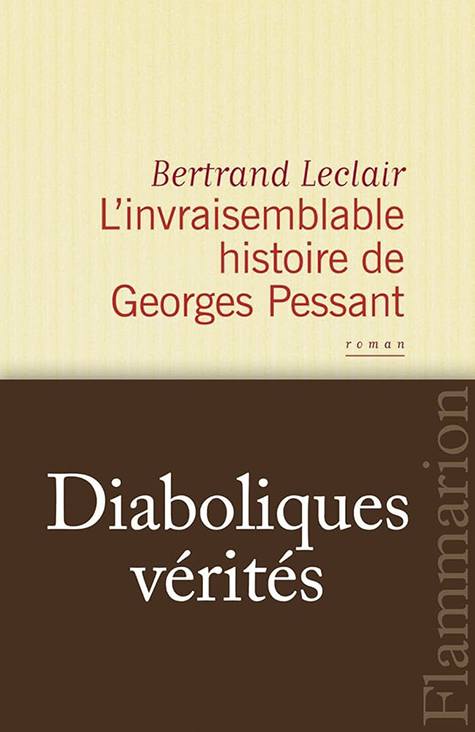
6 – Dans ce rapport à la réalité et à la virtualité, quel est d’après toi l’avenir de l’écrivain sur le « terrain » de cette dualité ? Comment cette situation dépasse-t-elle celle de l’écrivain – souvent seul avec lui-même – pour toucher l’ensemble de la société qui, pourtant, s’en contrefout ? Peut-on faire remonter l’effacement de l’influence de l’écrivain, et de son rôle de sphinx de la société, à partir du moment où il a fallu, pour écrire, être d’abord un auteur crédible dans le système, c’est-à-dire un auteur non plus avec une œuvre qui s’impose à la réalité – du fait de l’ampleur de sa pensée et de son style (étant les deux seuls critères qui déterminent l’importance d’une œuvre) – mais un auteur dont les faits et gestes s’imposent dans la virtualité plus que n’importe quelle écriture sans importance au regard d’un « statut » d’auteur qui fait autorité aux yeux du « public » ? Serait-ce à partir de ce moment qu’un statut fait d’autant plus autorité que l’auteur en question n’est surtout pas un « professionnel », mais un « amateur », à savoir qu’il ne vit pas de son écriture (trop suspicieux, sait-on jamais qu’il pense en plus…), mais qu’il est doté d’une profession « intermédiaire », si possible « institutionnelle » (c’est plus chic pour être crédible…) ou bien d’une dimension mainstream (hyper tendancielle pour qualifier la qualité même d’un statut, d’un influence, d’une autorité) ? Mais si « l’écrivain » – tel qu’on imaginait encore jusqu’à nos jours celle ou celui qui l’était, à savoir un « voyant » – n’est plus qu’un bon petit soldat de la société alors même que cette société ne sert plus que les intérêts d’un système où il n’a plus sa place, pourquoi tant d’auteurs servent-ils donc la soupe (bien que cela ne leur rapporte pas plus la gloire que la bourse) à cette société en lui concoctant des livres qui ne servent absolument plus à rien – non pas qu’un livre doive servir de manière « utile », mais tu seras d’accord qu’il doit au moins servir à faire penser en dehors de la « norme », puisque tel que tu l’exprimes, « la pratique artistique – c’est vrai aussi bien de la lecture – ne peut pas cadrer avec la norme ; l’art ne peut davantage être normatif. Tout art considéré du point de vue des normes est voué à être un art de confort, comme les économistes parlent de médecine de confort » ? Bref, ma question est sans doute mal lancée, mais d’après toi, en quoi ça consiste exactement d’être « écrivain » aujourd’hui ? Quel est encore l’enjeu essentiel de cette activité ? S’agit-il encore d’écrire ce qui fait œuvre, ou bien ce qui peut faire norme, validée par likes et followers ? Comment distinguer les deux ? En quoi sont-elles pourtant indissociablement attachées aux yeux du public et en quoi ce dernier s’en trouve-t-il leurré ? Est-on responsable ou coupable de ne pas relever le défi d’écrire une œuvre si l’on est un écrivain ou d’y renoncer simplement pour lui préférer l’écriture à la petite semaine de produits ficelés aux rendements sonnants et trébuchants ? Peut-on aussi légitimement considérer que s’échiner à écrire comme tu le fais est une autre manière de renoncer ? Mais à quoi ? Un éditeur d’une grande maison d’édition germanopratine m’a récemment formulé qu’être un véritable écrivain aujourd’hui devrait inciter à arrêter d’écrire… Que lui aurais-tu répondu, ou comment lui répondrais-tu au regard de la célèbre parole attribuée à Picasso que tu cites dans ton appendice à propos de Paul Valéry : « Tous les enfants sont des artistes, la difficulté est de le rester » ? Les éditeurs, dans leur ensemble, ne sont-ils plus aujourd’hui que des agents Smith de la matrice, ou bien l’ont-ils toujours été ? L’effondrement de la lecture, et notamment en littérature, ne vient-il pas d’abord d’une renonciation assez paradoxale – mais presque inéluctable – de cette « haine de la littérature » (cf. William Marx) que l’édition elle-même lui voue, généralement pour des raisons mercantiles, mais pas que ? Comment le devenir de la littérature va-t-il donc se rejouer d’après toi à l’avenir ?
Je crois, pour conclure cet entretien dont je te remercie – d’autant que ta dernière question recoupe en plusieurs points ma réponse précédente (et la parabole de Gide – y compris dans cette porte surmontée d’un « sans issue » que tu fais clignoter) – je crois donc que je vais me montrer moins pessimiste que tu ne le fais. Certes, l’édition, y compris ce qu’on a longtemps appelé la « grande édition », la plus prestigieuse, semble basculer ces dernières décennies dans la production servile d’un divertissement qui se prétend encore de qualité, mais dont on se demande si qui que ce soit s’interroge, certains matins plus douloureux que d’autres, quant à son pourquoi, sa raison d’être, c’est-à-dire aussi vite, le « au nom de quoi » ce serait de l’art, quand bien même on pourrait penser que les gens qui décident d’investir le monde de l’édition ont bien dû voir la lumière, autrefois, un jour, pour le désirer. Quel sens ça a, une « rentrée littéraire », en dehors des enjeux économiques qui sont d’ailleurs considérables, mais ne profitent plus, ou de moins en moins, à la création (l’ère de la « péréquation » qui est à l’origine du modèle Gallimard est loin derrière nous) ? Très certainement, l’édition va connaître des séismes dans l’avenir, parce qu’il faudra bien que se réinvente d’une manière ou d’une autre la possibilité de partager et faire vivre la contagion littéraire, c’est-à-dire aussi bien la nécessité vitale pour la doxa de se revitaliser, de se régénérer plutôt que de se scléroser, plutôt que de « perdre connaissance », expression qu’il faut évidemment entendre dans toute l’étendue de sa polysémie, puisque l’on perd connaissance comme l’on perd conscience.
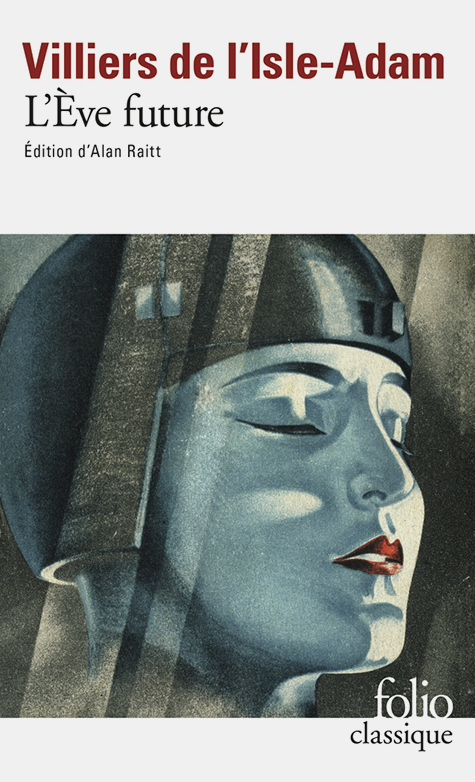
Cela dit, tout change et rien ne change sur ce front : je n’oublie pas, exemples entre mille, que Villiers de l’Isle Adam, un siècle avant que son oeuvre n’entre en Pléiade, cuvait sa dèche dépourvu d’éditeur, malgré l’admiration des jeunes poètes de l’époque et le soutien de Mallarmé ; je n’oublie pas que Proust a dû se résoudre à l’auto-édition pour nous donner, pour « délivrer », Du côté de chez Swann, comme Isidore Ducasse, alias le comte de Lautréamont, avant lui. Dans Puissances de l’art, j’ose une comparaison avec l’ancien monde religieux : il y a toujours eu une lutte entre les gens d’Église (qui sont consacrés par leurs fonctions d’intermédiaires, mais n’en restent pas moins des gens d’administration, et donc de pouvoir) et les mystiques (voués aux montagnes russes de la foi) ; ces derniers sont indispensables à la vitalité de la foi et par conséquent à la raison d’être de l’appareil religieux qui, cependant, s’en méfie, voire les déteste comme autant de fauteurs de troubles potentiels dans l’administration quotidienne de la croyance religieuse. On retrouve l’ordre et le désordre ou, plus exactement, ce qui est du côté de l’ordre et ce qui, ne l’étant pas, ne s’en préoccupant pas, est potentiellement facteur de désordre – et aussitôt de vitalité (toujours la vie fera désordre, nid à pulsions dérangeantes). Je pourrais aussi bien dire que le curé officie du côté de la représentation, quand le mystique la rejette : lui cherche la présence au contraire qui, seule, à ses yeux, peut entraîner la croyance, et l’entraîner absolument. Le mystique témoigne d’une foi vivace, il est l’initiateur qui puise à la source vivante, vivifiante, du sacré, quand cette source seule pourrait justifier la représentation religieuse et l’ordre qu’elle instaure. Le mystique met l’ordre en jeu et donc en danger, mais l’ordre meurt s’il se coupe des mystiques à seule fin de paraître raisonnable : pour le dire brutalement, il se castre (lui non plus ne se reproduira plus). C’est bien pourquoi il convient de distinguer la religion de la foi. On peut, si l’on est croyant, considérer la foi comme sacrée, mais sacraliser la religion, qui n’est rien d’autre que l’administration du sacré (à tous les sens du terme administrer), c’est une ineptie : de la même manière que sacraliser la bureaucratie entraîne une négation de sa raison d’être (au service de la vie commune), sacraliser la religion elle-même entre en contradiction avec la foi. Il en va exactement de même avec la nécessité qu’il faut répéter encore et encore de distinguer la culture de l’art. L’artiste est celui qui cherchant de l’air dans la langue ou sur la toile rend de l’air et du souffle et donc de l’âme (du latin anima) à la doxa – souvent au corps défendant de cette dernière, qui cependant en a besoin pour ne pas se scléroser jusqu’à mourir.
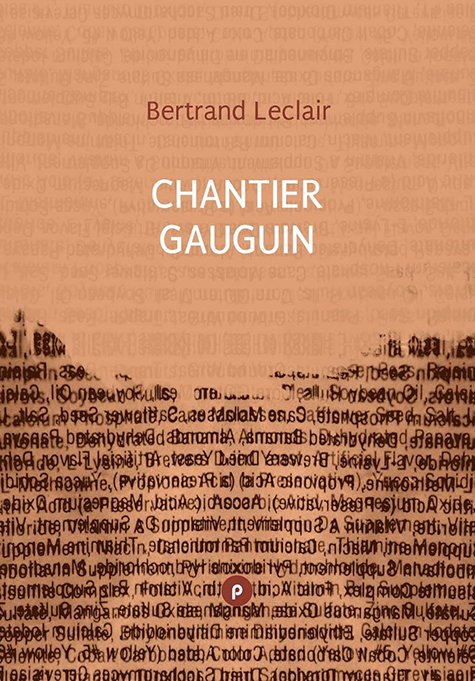
L’exemple le plus frappant de ce phénomène est la manière dont, en peinture, la doxa académique est morte au 19e siècle parce que la vitalité du geste artistique l’avait déserté, à travers les jeunes peintres, les impressionnistes en premier lieu, qui avaient « choisi » de quitter l’atelier où la quête de la beauté n’avait tout bonnement plus aucun sens, sinon celui de satisfaire les bourgeois de l’époque en leur vendant fort chers de somptueux chromos orientalistes à accrocher sur les murs de leurs salons encaustiqués. Et tout recommence ailleurs… puisque l’impressionnisme, quelques années plus tard, est devenu à son tour une façon d’académisme. L’artiste est un loup sans collier, disait Gauguin, qui considérait les peintres pompiers comme chiens de salon, sinon de porcelaine, et c’est un peu grandiloquent sinon grotesque de finir ainsi, mais peu importe : le grotesque a assurément sa part, dans le geste artistique, et on peut l’assumer. Pour autant, au regard de la situation des écrivains dans l’édition contemporaine, je crois qu’il ne serait pas inutile de penser à nouveaux frais la notion d’auteur et ce que ce nom en réalité signifie. La problématique de « la mort de l’auteur », si souvent mal comprise, telle qu’elle a surgi dans les années théoriques, et qui trouve d’ailleurs son origine dans le cours de poétique de Valéry (le premier à affirmer que ce n’est pas l’auteur qui fait le livre, mais le livre qui fait l’auteur une fois entre les mains du public), cette problématique avait toute sa raison d’être pour se débarrasser de la notion d’autorité morale associée à la qualité d’auteur, à une époque où l’on s’adressait aux écrivains de renom, pas forcément les plus vivants et toujours des hommes évidemment, à grands renforts de « maître » ou de « cher maître », symptôme de ce fonctionnement autoritaire et patriarcal qu’il s’agissait dans les années soixante du siècle dernier de mettre à bas.
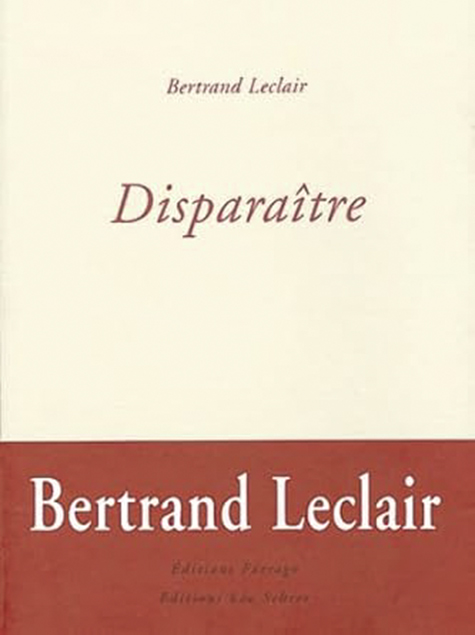
Mais, pour autant, dans la profondeur de l’étymologie, c’est tout autre chose que l’on trouve à la source du mot « auteur » : c’est la notion de « garant ». L’auteur est aussi un garant, et un garant de quoi, sinon de la vie dans la langue, de la possibilité que la langue demeure vivante, vivace en ses puissances, dans un univers où la communication triomphante la condamne à une utilité contingente, la réduit à un outil ? Cette notion de garant, il me semble, est déterminante : c’est avant tout cela qu’il faut défendre, dans notre désert spirituel où l’édition, loin de renoncer à la notion d’auteur, promeut les producteurs de fiction en réduisant les auteurs à une image de marque, une image parmi les autres, une image tout à fait dispensable, au fond.
Entretien © Bertrand Leclair & Caroline Hoctan – Illustrations © DR
(Paris, nov. 2024-janv. 2025)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
