La poésie est embourbée depuis très longtemps dans une série de malentendus. On pourrait même dire qu’elle ne se survit que par le malentendu un peu comme ces organismes qui ne se maintiennent en vie que grâce aux multiples maladies qui, en s’affrontant, leur donnent du travail. Ce n’est peut-être pas si mal. Mais j’ai choisi d’écrire en ignorant ces malentendus ou en faisant mine de les ignorer. Il m’a semblé qu’il fallait se laisser saisir par une forme de simplicité sans laquelle, y compris pour les poètes les plus roués et les plus retors, la poésie n’est pas possible. Cette simplicité est à mes yeux la principale, et peut-être l’unique qualité formelle de la poésie. De ce point de vue, le plus hermétique des poèmes est toujours fondamentalement simple. On pourrait même dire que la difficulté rhétorique de certains textes poétiques n’est là, parfois, que pour faire écran à cette qualité fondamentale, comparable à celle qu’on utilise en chimie en disant d’une molécule qu’elle est un corps simple, ou en grammaire en disant d’un passé qu’il s’agit d’un passé simple, sans auxiliaire. Il y a dans le poème quelque chose d’indivisible, et par-là même d’isolé. C’est ce caractère indivisible qui en constitue le point de singularité essentiel. Ainsi, je revendique de Rutebeuf et de Villon jusqu’à aujourd’hui, pour toute la poésie, d’être un art simple, et il me semble que toute la jouissance d’écrire un poème comme d’en lire un, tient à cette qualité si particulière qu’est la simplicité.
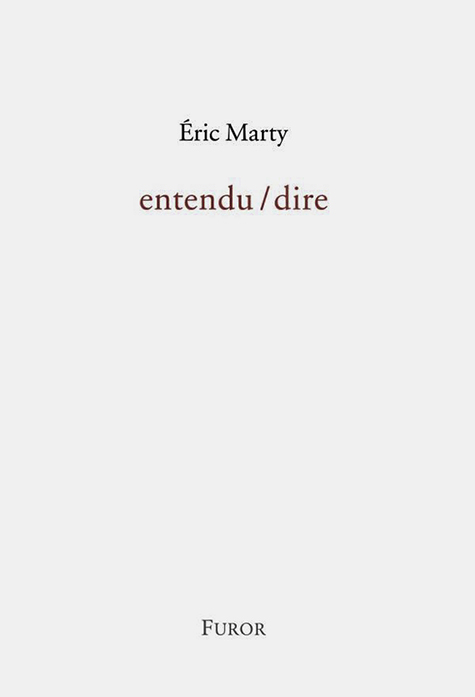
Le titre de mon recueil entendu/dire (Furor, 2023) vise d’une certaine manière, et peut-être même affiche, cette aspiration à la simplicité. Les poèmes qui s’y trouvent semble être réputés de ce fait nés de la rumeur, et non de la fabrication alambiquée d’un seul. Seule, la barre oblique qui sépare les deux verbes introduit l’hypothèse que, dans son trajet, la rumeur prend un certain temps pour se fixer sous la forme d’un poème : c’est l’intervalle nécessaire pour que ce que l’on entend, à l’intérieur de soi, porté par le monde, par le bruit du temps, le bruit des choses, des couleurs… se condense sous la forme d’un dire : passe d’une forme de passivité active (ce qu’on entend) à une forme d’activité sans actualité temporelle précise, dans cette espèce de neutre essentiel qu’est l’infinitif : dire. Il me semble qu’écrire vient après. Une fois la certitude que ce qui a été entendu, et qui a été dit, ne l’a pas été en vain. Cette troisième opération – écrire – est un moment extrêmement voluptueux de dépliement, de grande liberté, de grande souplesse, succédant à cet instant d’étrange paralysie où l’on a été comme surpris par une parole venue de nulle part et qui nous a comme saisi sur place. Ce moment de l’écriture, on peut le prolonger à plaisir ou au contraire établir le texte en quelques instants. Dans tous les cas, on est porté par quelque chose qui désormais nous appartient.
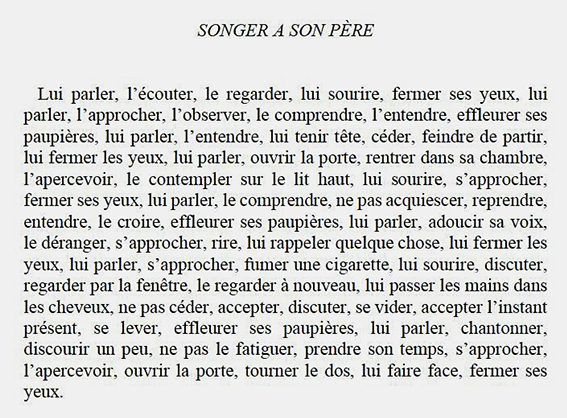
Les premiers poèmes ont été publiés en 2001 dans la revue L’Infini. Ils ont à peine bougé depuis. Certains n’ont pas été repris, mais tout au long des vingt ans qui séparent les premiers textes des derniers, j’ai été, je crois, constant. Il me semble, d’ailleurs, que ceux que je n’ai pas retenus étaient précisément ceux qui manquaient cette épreuve de la simplicité. Au magnifique intitulé de Louis Aragon – Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit – je voudrais en ajouter un autre qui associe en moi la pulsion de simplicité qui me pousse à écrire et l’énigme que constitue, malgré tout, les textes qui en ressortent : « Je n’ai jamais appris à parler ou les énoncés ». C’est là, dans cette puissance native de la parole en nous-mêmes que repose le entendu/dire. Je n’ai jamais appris à parler, et pourtant, j’ai subi dans mon enfance une rééducation à la parole, et sans doute faut-il alors donner la plus grande attention aux aphasies ponctuelles, au bégaiement, aux dysphasies, aux mutismes, à tous ces dysfonctionnements du langage qui nous traversent. Il me semble que si je me suis mis à publier des poèmes à un moment de ma vie (2001 donc), c’est peut-être que, à ce moment-là, dans ces textes écrits en marge de tout ce que je faisais, revenait, après tant d’années de tâtonnement, cette certitude qui, je crois est essentielle, à l’acte poétique : Maintenant, tu peux parler car tu as retrouvé le don de la parole. Ou plutôt : Les entraves qui te nouaient la langue maintenant la libèrent. De sorte que les poèmes du recueil, même ceux qui semblent loin d’une parole personnelle, voire de tout « je », sont à leur manière, tous, autobiographiques ou « autobiopoétiques ».
Pour l’instant, je m’en tiens à l’idée d’avoir écrit un livre de poésie plus qu’un recueil de poèmes dans l’idéal baudelairien, d’un travail qui a un commencement et une fin. Même s’il ne faut pas entendre-là (ou pas seulement) des repères rhétoriques. Le commencement et la fin en poésie disent autre chose, et ils disent toujours la même chose : le simple, la puissance de la simplicité, de cette insistance qu’on remarque dans tant d’œuvres musicales, l’ostinato. Et sans doute aussi, mon attachement pour Baudelaire tient aussi à ce que Les Fleurs du mal soit le seul livre de poésie qu’il ait lui-même publié. Il me semble – mais je ne peux le jurer – que pour ma part, je n’en écrirai sans doute pas d’autres.
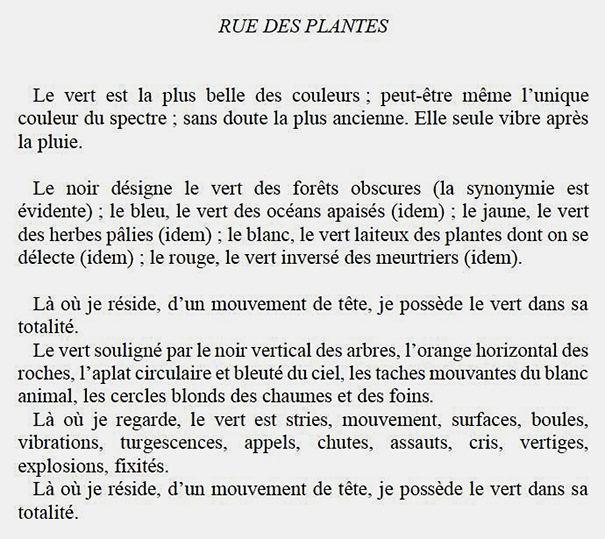
Puisqu’il s’agit de rumeurs, les poèmes de entendu/dire sont essentiellement allusifs. L’allusion est pour moi la figure décisive en poésie quelle que soit la clarté ou l’exactitude du poème, car dans l’allusion du poème quelque chose se dérobe là même où, pourtant, le texte poétique est sans doute le plus affirmatif, le plus assertif, le plus solide qui soit. C’est le génie du poème de donner à la plus profonde des paroles une évidence qui tient précisément à ce qu’il s’agit toujours d’une fiction de langage. Là où les mots, et les associations de mots, ouvrent le lecteur à cette autre scène qui double nos actes, nos sensations, nos propos, nos visions, d’une marge discrète, parfois subliminale, insaisissable, mais dont nous ne pouvons douter, puisqu’elle nous parvient sous la forme d’un message. Le caractère allusif des messages que nous envoie cette autre scène, c’est cela la rumeur à laquelle nous ne pouvons être sensibles que par intermittence et que dans certains interstices très mystérieux, et pour moi toujours euphoriques, de la journée ou de la nuit. Je dirai volontiers alors qu’il y a un bonheur du poème, une sorte de comblement ou de plénitude, d’autant meilleurs qu’ils ont toujours quelque chose d’un incident.
Le poème est un incident. Un incident qui dure, auquel l’acte poétique (écrire) donne une durée.
Un incident éternel.
Texte © Éric Marty – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
