
L’after-punk ne se désole pas, il s’absente.
(Yves Adrien)
Dans un essai pénétrant paru cet automne (recensé par l’ami Max Vincent), Baptiste Dericquebourg formule un constat que l’on ne peut que partager : nous assistons aujourd’hui à une réification du langage, tant en littérature que dans le champ universitaire, où les marginalia ne cessent de se greffer sur le corpus, et partant à une momification des Humanités. L’auteur aurait pu au passage évoquer la corruption (comme le firent en leur temps Pessoa ou Kraus) de toute langue par le journalisme, mais il a préféré circonscrire son propos à la sphère des Lettres, qui sont in essentia, dans une société où règne la division du travail sous toutes ses formes, le lot de fonctionnaires spécialisés – et donc Lettres mortes. On se permettra d’émettre quelques réserves sur les conclusions de cet essai (l’auteur en appelle à un renouveau de la rhétorique et de la parole, à une parole commune) que l’on trouve bien optimistes, faisant fi des questions de pouvoir et du règne du capitalisme à l’ère numérique. On ne suivra donc pas Dericquebourg jusque dans ses propositions, mais on pourra partager les prémisses de son raisonnement, dont le diagnostic nous paraît pertinent et lucide. La rentrée dite « littéraire » en a été encore une formidable démonstration, avec ses produits formatés pour le marché. Inutile de s’attarder sur cette surproduction de mauvais livres, tant sur le versant de la fiction (par exemple, tel livre écrit par une semi illettrée dont la presse vaguement branchouille à l’usage des yuppies dira qu’elle fait du slam) que celui de la non-fiction (comme on dit), le fait nouveau étant peut-être ces cohortes d’essais abordant des questions sociétales (il n’y a plus que des questions sociétales à Gauche, depuis qu’elle a abandonné la question sociale en l’encastrant dans l’économie) d’un point de vue ressentimentaire, mais lui aussi très vendeur, cédant aux sirènes du crétinisme postmoderne nord-américain (qui n’est lui-même qu’une continuation du crétinisme gauchiste).

Assurément, Baptiste Dericquebourg a bien raison d’insister : les livres sont des marchandises, a fortiori depuis le 19e siècle, qui a mis en exergue la contradiction de l’écrivain, au mieux pétri de sympathie prolétarienne, mais lu par des bourgeois (ou condamné par des bourgeois, souvenons-nous des procès de Flaubert et de Baudelaire), ou son absence de contradiction (le mépris que la Commune inspira à la majorité d’entre eux). La littérature est bien un produit séparé et force est de constater que l’écrivain est le plus souvent du côté du pouvoir (hier, protégé par un Grand à l’époque des Belles-Lettres, aujourd’hui, à l’heure de la littérature, condamné à ressasser des formes congelées depuis la double défaite des avant-gardes et du mouvement révolutionnaire, qui ont raté leur rendez-vous). Mais les livres sont aussi des marchandises paradoxales. Si les attaques de Dericquebourg contre la Kulturindustrie et la fausse conscience de la petite bourgeoisie culturelle de gauche sont judicieuses (et délectables dans leur férocité), persiste cependant le sentiment qu’il y a un angle mort dans son discours : il est des livres qui ne se réduisent pas à leur valeur d’échange. Mieux, parfois la littérature l’excède. Il est à cet égard symptomatique que Dericquebourg, à aucun moment, ne nous parle de ses lectures. Mais quoi ? Il n’y aurait plus que des écrivants ? Des plumitifs coupés de leur temps et de leur espace ? Des scribouillards emplis d’eux-mêmes, fétichisant la littérature dans le tombeau de ce que qu’il appelle « le Parnasse increvable » ? Plus aucun livre ne serait traversé par la question sociale ? Il n’y aurait plus aucune production susceptible de rompre avec sa propre clôture ? Dans l’offre massive de cette « rentrée littéraire », n’est-ce pas justement ce que tentent de faire des gens aussi différents qu’un Pascal Quignard, un Jean Rolin ou un Frédéric Pajak (dont le dernier tome du Manifeste incertain vient clore un cycle admirable inauguré il y a dix ans, avec cette volonté chevillée au corps d’évoquer « l’Histoire effacée » et « la guerre du temps »). Un roman d’anticipation comme Trigger Warning d’Olivier Benyahya, où surgit toute la dimension fantasmagorique de notre époque, usant de la métagraphie lettriste et du détournement situationniste, ne vient-il pas contredire la thèse de Dericquebourg sur le triomphe de l’art pour l’art ?
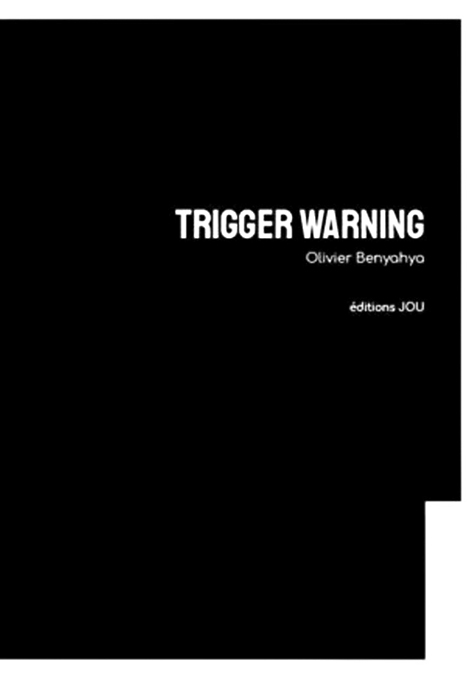
De même, un essai comme celui de Sandra Lucbert, Personne ne sort les fusils – dans sa manière de s’emparer farouchement du procès de France-Télécom en faisant dégonder la langue contre la pauvre langue managériale de la classe dominante -, n’est-il pas lui aussi à sa façon l’illustration qu’une parole littéraire bien vivante dise quelque chose en ce monde, comme l’énonçait à peu près Baudelaire ? Certes, la littérature dite « blanche » offre souvent de pauvres moyens d’échapper aux contradictions énoncées plus haut (même s’il y a des exceptions, par exemple les romans de Patrice Jean), et c’est pourquoi, nous ne cessons de dire notre plus haute considération pour les œuvres de Manchette, ou plus près de nous, de Prudon, de Morgiève ou de Le Corre. Mais il est parfois des œuvres totalement hors normes, qui ne relèvent ni de la « blanche », ni du « genre », c’est le cas du roman de Léo Strintz, L’Empire et l’Absence (Inculte 2020), qui nous paraît être un ovni dans le paysage littéraire français.
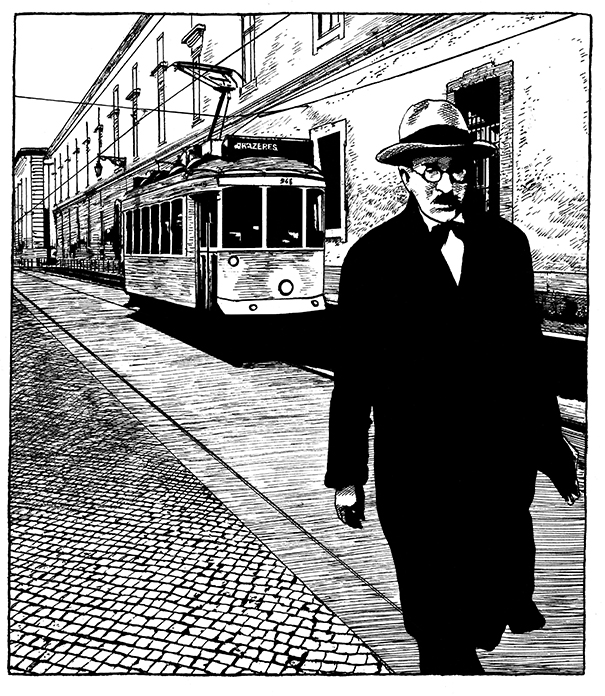
L’Empire et l’Absence raconte l’histoire de Magnus Gansa, un jeune homme qui vit dans une ville où les habitants ont adhéré au « Feuilleton » : leur vie est filmée, montée, aiguillée, mise en forme pour la télévision par Brandon Marsac, dit « le Roi », un démiurge qui se sert de l’existence des habitants de la ville pour nourrir ce grand récit qu’il tisse au quotidien. Adolescent, Magnus lui-même a participé à une fiction lycéenne, un soap opera antérieur au « Feuilleton », en compagnie de Lo DeLilla, l’un et l’autre sous les noms de Dario et Domitille. Mais désormais, il se tient à distance du récit collectif – le « Feuilleton » est la synthèse globale de tous les récits, plus accomplie techniquement et narrativement que les anciennes séries, « broadcastant à vide » -, et cherche une porte de sortie à cette monarchie fictionnelle, à la « membrane de la capture générale ». Dans la ville, il y a les « reste toi-même » qui se désolidarisent du Roi, prétendent résister à son absolutisme fictionnel, mais ils continuent à vivre dans une forme de « course à la représentation ». C’est bien connu, on ne combat pas l’aliénation avec les moyens de l’aliénation. Pour Magnus, fils de Louis Gansa, ci-devant montreur de marionnettes (Kleist et Collodi ne sont pas très loin), seul le rêve reste une issue : chaque nuit, dans son dernier cycle de sommeil, il quitte la ville. Mais il peut y avoir d’autres alternatives au « Feuilleton », qui est « l’empire même des présences » : Atticus, un chanteur masqué qui offre des performances vocales sidérantes en est une ; Lo DeLilla en est une autre : celle-ci s’est en effet lancée dans un projet artistique qui serait une forme de résistance au « Feuilleton » : une série de peintures mentales réalisées grâce à une « Machine » dont « l’algorithme de reconstruction » reproduit son être. Magnus cependant ne la suit pas et choisit une autre voie : il parvient, dans la seconde partie du roman, à accéder à la salle d’archives du laboratoire de Brandon Marsac où, jour après jour, il visionne les rushes du « Feuilleton », remontant à rebours dans les entrailles de la vie narrative, de ses épisodes nus, tus, finissant par découvrir dans le lieu matriciel du simulacre, tel l’agent Mulder son propre dossier dans les archives de la CIA, les chutes d’images du soap opera auquel il participa lycéen, et partant, « la silhouette narrative de son être »… Cette même nuit – et c’est l’une de clefs du récit -, il explorera sous la chambre du Roi une autre chambre où les archives de chair des protagonistes du « Feuilleton » s’empilent dans un labyrinthe de casiers de pierre où l’on trouve « des objets, des signes, des preuves : tout ce qui représente la douleur d’autrui, tout ce qui représente la perte humaine, puisque c’est d’elle qu’il crée un feuilleton ordonné ; tout ce qui lui sert de prise, de fixation, pour l’orientation de sa mission en tant que gouverneur du droit au bonheur. Les turbines de l’empire ; les réserves de la souffrance d’une ville. » ; comme Alice traversant le miroir, Magnus ne reviendra pas indemne de cette descente au centre même de l’Empire, son « noyau interne » – sa « graine ». Nous n’en dirons pas plus sur la suite du roman, tournant sur lui-même comme une bande de Moebius, car ce serait « divulgâcher » le dénouement au lecteur.
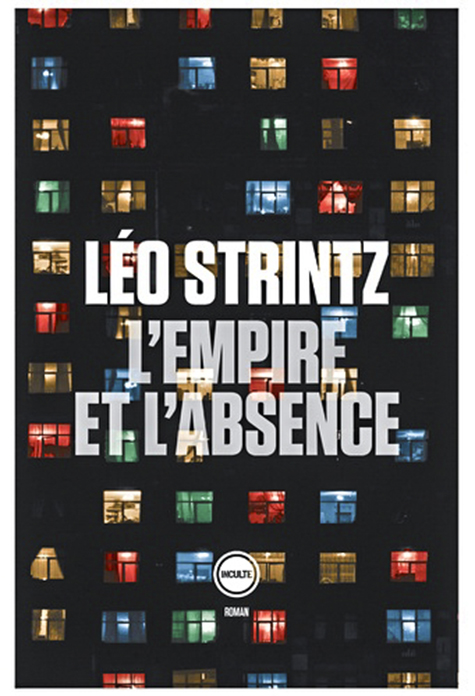
Il y a d’abord une force narrative (et oui !) éblouissante dans ce roman, qui se lit dans une forme de premier degré jouissif. On suit, fasciné, le parcours de Magnus tel le narrateur de L’Invention de Morel de Bioy Casares, emporté dans le flux des images et de la narration elle-même, baignant dans une atmosphère digne d’un épisode de Black Mirror ou d’un film de Lynch. On s’immerge avec délice dans les descriptions oniriques reflétant le « crépuscule intérieur » de Magnus, dont certaines rappellent les visions saisissantes de Ballard. On tourne fébrilement et avec addiction, page après page, pour comprendre et pénétrer le sens de cette architecture narrative, escherienne, où viennent s’abolir, dans un mouvement borgésien, tous les récits. Disons le tout net : cela faisait longtemps que nous n’avions pas lu un roman d’anticipation français aussi baroque (depuis Dantec, peut-être), aussi brillant et subtil, de surcroît écrit dans une langue superbe, fluide, poétique.
Car tout aussi jubilatoire est le second degré que conditionne la lecture de ce roman : la mise en abyme de toute création romanesque que le méta-récit ordonne, la transgression des niveaux de narration qu’elle induit, avec son feuilletage temporel, les permutations entre réel et représentation, les jeux de miroir, les allers-retours avec notre monde (rien que par exemple dans l’onomastique, transparente : DeLilla est bien sûr un clin d’œil à l’auteur de Underworld et Gansa, inspiré directement du nom du scénariste de la série X-Files) et enfin surtout, la dimension théorique-critique qui s’en dégage, qui dit quelque chose de notre monde réellement renversé où le vrai est un moment du faux : la télé-réalité, les séries télévisées, le storytelling, le médium comme message, l’auto-marketing, le narcissisme de masse, le tittytainment (la récurrence dans le roman du motif du sein prothétique et de La Tétine, l’ancêtre du « Feuilleton »), l’œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique (les œuvres de Lo DeLilla, qui tente de capter une aura « au second degré »), en somme, le secret généralisé de notre époque réticulée. Le coup de génie de ce roman se situe là, dans cette double appréhension, le ravissement, dans tous les sens du terme, que l’on a à se plonger dans cette grande narration en s’en détachant. Notre monde n’a plus de Dehors, la langue n’a plus de manteau, notre aliénation est totale. Contester le Spectacle, c’est encore y être, dans la mesure où il n’est plus qu’une grande usine de recyclage des signes ; Magnus Gansa le sait : lorsqu’il descend « dans le ventre de la caverne », il ne trouvera qu’une « illusion narrative, où ne prévaut que le médium, où la sortie du récit est encore un autre élément du récit ». Désormais, tout est intégré, les « structures dissipatives » de notre société (pour reprendre l’expression d’un autre Magnus – Enzensberger, celui-ci) semblent avoir gagné. Mais la force du roman ne consiste-telle pas justement à retourner les armes du Spectacle contre lui-même ? Peut-être est-ce l’une des lectures possibles que l’on puisse faire de cette épopée de notre histoire qui n’en finit pas de finir, redonnant tout son lustre à la grande narration, au grand récit, celui de Magnus Gansa, dont la traversée des signes (la catabase au centre du roman, au cœur battant de l’Empire) consiste justement à faire un trou dans la Toile de nos identités narratives, à tordre le cou de notre aliénation, à nous absenter du monde. Telle serait l’ambition de ce roman-monstre, roman à la fois incarné et cérébral, d’une beauté énigmatique. N’est-ce pas là une nouvelle preuve – et la plus belle illustration – qu’il faudrait songer à remettre à plus tard le « deuil » de la littérature ?
Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
