DOMINIQUE BELLEC s’entretient avec nous à l’occasion de la publication d’Aucune femme au monde de Catherine L. Moore et de Demain le silence de Kate Wilhelm dans la collection DYSCHRONIQUES qu’il anime aux éditions Le passager clandestin :
1 – Dominique, vous publiez coup sur coup deux textes écrits par des femmes peu mises en avant jusqu’à présent dans le milieu de la SF. Le premier, Aucune femme au monde (1944) de Catherine L. Moore, est une sorte de Frankenstein ou le Prométhée moderne, du point de vue non plus d’une créature fabriquée, mais transplantée dans une machine. Le deuxième, Demain le silence (1970) de Kate Wilhelm, est, pour sa part, une sorte de « monde englouti » ballardien. Pouvez-vous nous présenter ces deux textes du point de vue de leur dystopie, c’est-à-dire de cette vision quasi prophétique des problématiques sociétales qui y sont jouées par rapport à d’autres œuvres déjà classiques ou reconnues ? Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans ces deux textes ? Quelle est l’originalité, à vos yeux d’éditeur, de leur approche narrative et réflexive ?
Il s’agit de deux textes très différents. La nouvelle de C. L. Moore peut être lue comme une réflexion sur l’identité, plus précisément sur l’identité de femme et même de femme-artiste – la Deirdre de la nouvelle est une actrice et une chanteuse – dans une société où la légitimité de jugement appartient exclusivement aux hommes. Celle de Wilhelm interroge la capacité des hyper-urbains de la modernité post-industrielle à entrer en relation avec des milieux de vie qui échappent encore à la double tutelle de l’humain et de la machine, des milieux « naturels ». Ce que ces deux textes ont en commun, c’est d’aborder ces questions en s’appuyant sur des outils propres à la science-fiction – à la fois comme genre littéraire et comme expérience de pensée –, en l’occurrence, la projection du récit dans le futur et l’attention spéculative accordée aux formes technologiques, sociales, politiques, etc. émergentes au moment de l’écriture. Moore est une autrice de science-fiction à une époque, les années 1930-1950, où le genre est une chasse gardée masculine. Elle fait partie des très rares femmes publiées alors (avec Zenna Henderson, Andre Norton, Katherine MacLean, Leigh Brackett et quelques autres), souvent sous un pseudonyme dissimulant leur identité de femme. De sorte qu’en dépeignant l’obstination de Deirdre, son héroïne, à remonter sur scène après son accident contre l’avis de ses deux « protecteurs » mâles, Moore sait sans doute un peu de quoi elle parle. Quant au fait que cette Deirdre ne soit pas à proprement parler humaine, mais nous soit décrite comme « un cerveau nu reposant dans un corps de métal » – c’est-à-dire comme un « cyborg », mais quinze ans avant la première apparition du terme – ce n’est pas non plus le résultat d’une quelconque vision transcendante de l’avenir, mais plutôt la conjonction de la curiosité de l’autrice pour les technosciences de son temps – on est alors en plein essor de la cybernétique – et de son imagination poétique. De son côté, dans Demain le silence, Kate Wilhelm joue avec l’idée que le désir de chercher refuge dans le silence des forêts sera stigmatisé comme asocial et comme relevant de la pathologie. Elle le fait sans doute en partie parce qu’elle observe au même moment, aux États-Unis – on est en 1970 –, un vaste mouvement dénonçant l’aliénation des grandes villes capitalistes et les formes de contrôle social qui s’y exercent. En ce sens, on doit regarder ces nouvelles, tout comme de nombreuses autres relevant du même genre, plutôt comme des tentatives de réflexion sur leur époque que comme des « prophéties » hors sol. La science-fiction est définie ici comme un instrument pour interroger le contemporain, comme peuvent l’être les sciences sociales – qu’elle n’exclue d’ailleurs pas. Si elle nous apparait parfois comme « prophétiques », c’est parce qu’elle s’empare de problématiques et d’enjeux qui continuent à travailler nos sociétés aujourd’hui. C’est d’ailleurs le principal critère qui nous pousse à les retenir et à les publier.

2 – Concernant ces deux auteures, on sait de Moore a été une pionnière de la SF. Associée à son mari Henry Kuttner, lui-même auteur du genre, ils ont écrit des œuvres qu’ils signaient Lewis Padgett dont l’une peut être considérée comme un véritable petit chef-d’œuvre, bien que méconnu : L’Échiquier fabuleux (1951) où il est question d’une guerre assez « technique », menée par des scientifiques et des robots, et qui met en scène une machine : un jeu d’échecs obéissant à des règles variables. Pour Wilhelm, dont le mari Damon Knight a également écrit de nombreuses critiques et œuvres de SF, elle a publié un autre texte quelques années après Demain, le silence, qui traite à nouveau des villes devenues inhabitables et de la pollution, roman qui lui, à sa sortie, a été primé et salué : Hier, les Oiseaux (1976). Dans les deux cas, diriez-vous que les textes que vous publiez de ces deux auteures sont déjà le socle de thématiques récurrentes aux œuvres qu’elles ont publiées ensuite ? Quels sont les ressorts et les dynamiques présents chez chacune de ces deux auteures qui définiraient leur style, leur geste, leur esthétique, leur voix, etc. Qu’est-ce qui les différencie et les rapproche, mais qui les identifie néanmoins chacune, et serait donc leur « marque de fabrique » respective ?
Précisons tout d’abord que Le passager clandestin et moi-même n’avons pas conçu cette collection en spécialistes du genre. Notre activité éditoriale nous conduit à publier des essais plutôt que de la fiction ; adolescent, j’ai été un lecteur boulimique et désordonné de SF, mais, avant d’y revenir pour ce projet, il y avait plus de vingt ans que je ne m’y intéressais plus que marginalement. Comme je l’ai dit plus haut, nous publions des textes dont les thématiques continuent d’alimenter les débats contemporains. Ma formation intellectuelle – plutôt l’histoire des idées que l’histoire littéraire, pour simplifier – me conduit à prendre pour point de départ, dans la recherche de textes, des périodes chronologiques au cours desquelles certains des enjeux qui nous intéressent ont commencé à émerger, plutôt que les auteurs eux-mêmes, que, souvent, je ne connais pas de manière assez approfondie pour anticiper les sujets qu’ils et elles auront traités. Cela ne m’empêche pas d’avoir des coups de cœur et, après avoir lu une ou deux nouvelles prometteuses, d’explorer plus systématiquement la production de telle autrice avec la conviction d’y trouver tôt ou tard un texte intéressant pour la collection. C’est le cas de Kate Wilhelm, dont j’avais apprécié la finesse psychologique et la capacité à créer des ambiances à la lisière du fantastique, dans « La Boîte infinie » (1971) ou « Quand Sommerset rêvait » (1969). Et après avoir lu « L’Enterrement » (1972), une préfiguration saisissante de La Servante écarlate (1984), de Margaret Atwood, et « Mesdames et messieurs, cette crise est la vôtre », une satire prémonitoire des reality shows, j’étais convaincu qu’elle pouvait exceller dans le genre dystopique. J’ai donc continuer à lire toutes les nouvelles que je trouvais d’elle jusqu’à ce que je découvre celle-ci. J’avoue moins bien connaître ses romans. Quant à Aucune femme au monde, c’est une référence sur laquelle j’étais tombé au détour de recherches sur les origines du transhumanisme et de la thématique de « l’humain augmenté ». Je connaissais Catherine Moore pour sa contribution – essentielle – au duo formé avec Kuttner, mais je l’associais à cette période de l’âge d’or de la SF et du pulp qui a produit tant d’œuvres ludiques, drôles parfois, mais souvent trop farfelues ou trop marquées par leur fascination délirante pour le progrès technoscientifique pour avoir leur place dans notre collection. Je connais donc mal son œuvre et je laisse aux gens plus compétents que moi le soin d’analyser la place qu’y occupe ce récit en particulier. Les deux textes sont très différents. Une génération les sépare au cours de laquelle les représentations ont été bouleversées par tout une série d’événements (la découverte d’Auschwitz, Hiroshima, la guerre froide, le mouvement des droits civiques, la libération sexuelle, la prise de conscience écologique, pour ne citer que les plus saillants). Pour résumer à gros traits, le genre de la science-fiction est passé au cours de cette période du space opera au post-apo, du lyrisme parfois débridé au réalisme le plus cru voire à un certain nihilisme. Il est donc difficile de les comparer. Ce qu’ils ont en commun, c’est qu’à travers eux, comme les étoiles lointaines, nous parvient un peu de la lumière produite par des questionnements vieux de plusieurs décennies, et qui continuent de nous agiter aujourd’hui.

3 – Abordons votre collection dans son entièreté. Vous avez créé Dyschroniques en 2013 au sein des éditions le passager clandestin dont vous êtes l’un des cofondateurs. Cette collection a l’ambition d’exhumer de la bibliothèque d’Ali Baba de la SF mondiale certains des textes « empruntées aux grands noms comme aux petits maîtres du genre » tel que l’indique sa présentation sur le site web de la maison. La particularité de Dyschroniques est de proposer la réédition de formats courts que l’on nomme communément des « nouvelles », et qui ont été écrits au cours des Trente Glorieuses, couvrant donc ce qu’on appelle, là aussi communément, l’Après Guerre (seul Pigeon, canard et patinette est un texte inédit français écrit et publié en 2016). Pouvez-vous présenter votre collection, sa ligne éditoriale, ses spécificités temporelles, linguistiques et de format, ses enjeux réflexifs, et la manière dont celle-ci s’inscrit dans la production de SF contemporaine ? Et d’ailleurs, de quoi Dyschroniques est-elle le nom ? Quelle raison à son prisme anglo-saxon ?
Comme j’ai un peu commencé à le dire plus haut, l’idée de cette collection reposait sur une hypothèse simple – depuis largement vérifiée : la science-fiction, qui apparaît à l’aube de l’ère industrielle, serait un genre particulièrement propice à l’exploration critique de toute une panoplie de thèmes qui travaillent l’histoire de cette ère et des agencements sociaux qu’elle a engendrés. Contrairement à la fantasy, genre anhistorique par excellence – puisqu’elle peut mettre en scène des lieux et des actions apparemment débarrassés de lien de causalité avec l’espace et l’époque des auteurs qui les imaginent –, la science-fiction ou l’anticipation ont pour ambition de déplier dans un avenir plus ou moins proche les effets de formes (sociales, technologiques, politiques…) contemporaines de l’écriture. Les œuvres qui en résultent peuvent bien entendu faire preuve d’imagination, de poésie voire de la plus grande fantaisie, elles peuvent même emprunter au registre de la caricature ou de l’absurde, mais, par définition, elles conservent un ancrage dans la réalité matérielle et historique de leur temps. C’est en ce sens qu’elles peuvent souvent être lues comme des expériences de pensée, menées avec plus ou moins de rigueur, plus ou moins d’ambition ou de réussite. La question qui se posent ensuite à nous est : est-ce que ces œuvres restent en phase avec les représentations des époques et des sociétés successives qui les reçoivent, et en particulier avec la nôtre ? Certaines ont eu un écho lors de leur première publication, mais peinent à franchir la barrière du temps, notamment parce qu’elles restent prisonnières de préjugés et de schémas de pensée désormais anachroniques – de ce point de vue, il en va de la SF comme de toute littérature. Le pari que nous faisons avec cette collection est que des textes de science-fiction non réédités depuis des années, parfois des décennies, embrassent des problématiques qui travaillent encore nos sociétés, et en déploient les possibilités narratives de façon suffisamment lucide, imaginative et ouverte pour continuer à nous parler – à l’image des romans les plus célèbres du genre (Nous, Le Meilleur des mondes, 1984, etc.). C’est ce qui en fait à nos yeux des textes « dyschroniques », un terme construit autour de la racine dys-, qui exprime le manque, l’écart ou la contradiction et chronos, le temps : « en décalage avec leur temps ». (Ce terme avait bien sûr aussi l’avantage de « faire science-fiction », notamment parce qu’il évoque ces modalités de la SF que sont la dystopie et l’uchronie). Pour marquer les esprits, nous l’avons résumé – quitte à forcer un peu le trait – par cette formule : « Les futurs d’hier sont devenus notre présent ». Ainsi, l’objectif de la collection était de montrer à travers une série de nouvelles ou de novellas – c’est-à-dire d’œuvres courtes, afin d’éviter une trop grande dispersion des thématiques, et parce qu’elles ont plus tendance à être passées sous les radars de la réédition – que non seulement certaines « difficultés » auxquelles nous nous heurtons encore aujourd’hui ont commencé à se manifester il y a déjà un certain temps, mais en outre, comme le montre la relative clairvoyance de ces œuvres, qu’il était possible à l’époque d’en anticiper l’évolution. Un seul exemple parmi d’autres : dans Le Pense-Bête, l’écrivain étatsunien Fritz Leiber imagine une société qui se prend soudain de passion pour une machine portative intelligente dont les multiples fonctionnalités finissent par ôter à leurs porteurs toute initiative ; comme le dit un personnage, elles prennent elle-même « en charge l’effort nécessaire pour supporter la vie ». En quelques mois, la population, toujours à l’affût du nouveau modèle – chaque fois un peu plus miniaturisé – de ce « mémorisateur », se transforme en masse apathique, domestiquée par cet inséparable compagnon cybernétique. Cette nouvelle incroyablement visionnaire date de 1962. À l’époque, l’ordinateur personnel n’est encore qu’un projet (le premier sera fabriqué, à titre expérimental, en 1964), quant au « smartphone », c’est, au mieux, une idée… de science-fiction. Mais quand on se penche un peu sur l’histoire de ces technologies, on découvre aussi que, depuis quelques années, la notion d’intelligence artificielle commence à être débattue au sein de la communauté scientifique, notamment à travers les Conférences de Dartmouth, dont le but était de « prouver que tous les aspects de l’apprentissage et autres caractéristiques de l’intelligence humaine peuvent être précisément décrits afin qu’une machine les simule ». Que Leiber, licencié en philosophie et surtout rédacteur en chef pendant une douzaine d’année d’un magazine de vulgarisation scientifique, se soit intéressé à ces débats pourtant assez confidentiels, c’est plus que probable. Son talent propre, sa fibre philosophique, son humour et son imagination débordante auront fait le reste. La spécificité de cette collection, c’est donc, en republiant des textes oubliés du patrimoine, de s’appuyer sur la science-fiction pour mettre en lumière la profondeur historique de certaines problématiques et la capacité réelle qu’avaient les contemporains de les analyser voire d’en anticiper les conséquences à moyen terme. Quant à la période chronologique qui nous intéresse, c’est en gros celle de la guerre froide, depuis Hiroshima en 1945 jusqu’au démantèlement du bloc soviétique au tournant des années 1990 ; c’est à la fois une période faste pour la SF en générale et pour le format de la nouvelle en particulier ; c’est surtout une époque où des questions qui font par ailleurs l’objet de notre attention dans les autres collections du passager clandestin ont fait leur apparition : l’essor de technosciences de plus en plus autonomes et hors de contrôle (le nucléaire en étant l’exemple paradigmatique), le début des grands mouvements d’émancipation sociale et politique, la prise de conscience écologique, l’envol du modèle productiviste-extractiviste-consumériste, la transformation et la généralisation de formes de contrôle social de plus en plus sophistiquées et invasives au sein des sociétés démocratiques. Quant au fait que la plupart de ces œuvres proviennent du domaines anglo-saxon, et en particulier des États-Unis, c’est à la fois le résultat du dynamisme de la SF dans cette sphère culturelle et la conséquence du rôle central et de l’influence de la « première puissance mondiale » au cours de cette période de profondes mutations dont nous payons aujourd’hui l’addition.

4 – Comment votre collection complémente-t-elle le catalogue du passager clandestin, puisqu’il s’agit de la seule collection fictionnelle de la maison ? En ce sens, pouvez-vous nous expliquez les choix éditoriaux de Dyschroniques par rapport à ceux du passager clandestin, et nous exposer comment – tel que vous le vivez au quotidien – votre collection alimente, suscite, oriente les idées ou les sujets des autres collections de la maison, et réciproquement ? Est-ce une nouvelle manière, de ce point de vue, de publier de la SF, habituellement associée ou naturellement liée aux littératures fantastique, noire, d’épouvante, d’anticipation, d’horreur, etc. dans les catalogues des éditeurs ? En quoi cela renouvelle-t-il le genre, et révèle-t-il au fond, la crédibilité intellectuelle de cette littérature, mais aussi – et peut-être pour la première fois – son influence sur les autres domaines de la pensée, et notamment sur les sciences sociales ? Comment percevez-vous cette influence, comment se concrétise-t-elle, en quoi cela fait-il bouger un certain nombre de paradigmes que l’on croyait pourtant intangibles comme le prouvent, depuis quelques années, l’émergence et la diffusion d’idées à rebours de celles académiques ? Y a-t-il, à ce titre, un avenir de la science-fiction dans les sciences sociales ? Mais aussi, y a-t-il un avenir de la SF non plus seulement comme littérature de « distraction », mais comme littérature à part entière dans un monde où la lecture d’œuvres « littéraires » semble devenue une activité désuète, sinon ringarde par rapport aux séries TV, aux jeux vidéos, aux univers méta ou multi fictionnels, etc. ?
Le passager clandestin a été créé dans le but de contribuer au débat sur un certain nombre de points qu’il nous semblait urgent « d’inscrire à l’agenda » de la discussion publique. L’idée était d’accorder une place dans le champ éditorial à des réflexions, des modes d’actions et des pratiques collectives mues par le souci de repenser en profondeur les dysfonctionnements de nos sociétés. Quand nous avons commencé à publier, en 2007, il existait de nombreuses expériences visant à décaler le regard sur des problématiques centrales de notre époque, mais elles étaient extrêmement minoritaires, très dispersées et largement ignorées par les « grands médias ». Elles touchaient à des questions aussi diverses que l’emprise grandissante des technologiques numériques sur nos vies, le rôle de l’impensé postcolonial sur les rapports sociaux et le fonctionnement des institutions, le fétiche de la croissance économique, la définition du vivant sous toutes ses formes comme « ressources », les perspectives ouvertes par les nouveaux répertoires d’action politique (de la désobéissance civile à l’occupation défensive d’espaces menacés par les logiques de prédation capitalistes), les modalités d’existence humaines tenant compte de la subtilité des relations entre toutes les espèces, etc. Ce que nous nous sommes proposés de faire, c’est, en tant que maison d’édition, tout simplement d’assumer un rôle de passeur et d’aider à la diffusion de ces réflexions afin, d’une part, qu’elles prennent conscience de leurs existences réciproques et des convergences possibles entre elles, et, d’autres part, qu’elles parviennent à toucher un public jusque-là peu conscient de leur actualité. Nous n’étions évidemment pas les seuls et, à l’époque, un certain nombre de petites structures éditoriales, notamment, se sont fondées sur des prémisses similaires. Notre particularité est peut-être d’avoir voulu rappeler que tous ces questionnements ont une histoire, qu’ils se rattachent à des traditions de pensée et de lutte, certes très minoritaires, mais souvent anciennes, et qu’ils ont donné naissance à des expériences collectives diverses et parfois très originales. Cette histoire est donc à la fois celle des innombrables occasions manquées d’emprunter d’autres chemins collectifs et celles des jalons essentiels de la pensée critique à l’heure où nous avons un urgent besoin de nous réinventer. Je laisse le soin aux lecteurs et lectrices que cela intéressent de se reporter au catalogue du passager clandestin pour découvrir sous quelles formes ses enjeux ont été abordés au fil des années. Il est en effet majoritairement composé d’ouvrages empruntant aux sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, anthropologie, économie…), mais parmi eux, une certaine place est faite à ce qu’on peut rassembler sous l’expression « cultures populaires » : la photographie documentaire, le dessin de presse, la musique punk, le récit de vie et, donc, la science-fiction. Ce que nous espérions en créant cette collection, c’est que la science-fiction, en tant que littérature populaire et grâce à sa dimension heuristique – sa manière propre d’identifier et d’explorer des problèmes –, nous permettrait de sensibiliser à tout un éventail de questions un public non lecteur d’essais (c’est-à-dire un public très large, en fait, souvent jeune mais pas obligatoirement), et peut-être d’en attirer une partie vers d’autres formes de réflexion sur ces questions. Une collection en particulier, dans la maison d’édition, les Précurseur.ses de la décroissance, dialogue avec la collection Dyschroniques. Il s’agit d’une série d’ouvrages de synthèse donnant accès à des pensées de toutes les époques, qui ont en commun d’avoir tenté de mettre en lumière les formes multiples de l’hybris humaine et d’avoir fourni des pistes pour imaginer d’autres manières d’habiter le monde. Les deux collections, ce n’est pas un hasard, ont été lancées la même année, et bien des thèmes parmi ceux que j’ai énumérés plus haut sont traités dans les deux. Que des auteurs et des autrices de SF des années 1950-1970 se soient intéressés aux philosophes ou aux sociologues de leur temps – qu’ils et elles aient lu Günther Anders, Jacques Ellul, Lewis Mumford, Françoise d’Eaubonne ou Jean Baudrillard –, c’est plus que probable. Et pour ce qui est de la relation inverse, la fécondation de la pensée critique par la SF, on pourra se reporter aux écrits d’un Fredric Jameson, d’une Donna Haraway ou, en France, d’une Ïan Larue, parmi bien d’autres, pour se convaincre de sa réalité.

5 – À ce jour, une petite trentaine de titres constituent votre collection très singulière et passionnante au regard de ce que ces fictions – toutes quasi prémonitoires bien que datant d’un demi siècle pour certaines – révèlent de notre « réalité » comme sentinelles du devenir sociétal, comme lunettes de projection de nos désastres, et bien évidemment, comme mises en garde de notre toute-puissance. En marquant durablement nos esprits par des écritures directes, efficaces, parfois même percutantes, ces fictions impulsent en nous une prise de conscience, non pas tant d’une désillusion, que d’un saisissement de cette réalité, à savoir de la désintégration, de la détérioration, de la décomposition, en bref de la disruption que celles-ci donnent à percevoir aujourd’hui de nos sociétés humaines, tant du point de vue de leur « nature » que de leur « culture ». Ainsi, il est incroyable de constater que tous les auteurs de cette époque avaient eux-mêmes saisi ces phénomènes en chaîne auxquels nous nous confrontons aujourd’hui sous le terme de « crises » : écologique, économique, ethnique, politique, philosophique… phénomènes qui se conjuguent aux dérives de la société de consommation et de la technologie, et plus précisément même concernant cette dernière, de l’aliénation que celle-ci entraîne pour l’humanité, de par l’évolution de ses mécanismes coercitifs : surveillance de masse, traçabilité, reconnaissance faciale, euthanasie, etc. Comment expliquez-vous que les écrivains de SF en général, et donc ceux que vous publiez dans cette collection – Matheson, Leinster, Bradley, Simak, Silverberg, Gresham, Knight, Spinrad, Sheckley, Reynolds, Leiber, Moore, Asimov, Curval, Andrevon, Aldani, Aldiss, Bova, Anderson, Brunner, Blish, Griffith, Robinson, Saylor – avec un certain nombre de penseurs de la philosophie et des sciences sociales – aient « vu » ce qui nous attendait quand pour les autres, il ne se passe rien si l’on peut dire, sinon les frou-frou et le feel good, ou tout comme ? Qu’est-ce qui, chez les auteurs d’anticipation et de spéculation, génère une telle acuité d’esprit, un tel art d’écrire, faisant déjà de leurs œuvres des classiques pour notre monde actuel ?
Cela tient pour beaucoup à la période considérée, comme je l’ai déjà dit. La Deuxième guerre mondiale constitue une césure décisive dans les représentations que l’humanité, et particulièrement l’humanité dite « occidentale », a d’elle-même. La Grande Guerre avait été un traumatisme et un bouleversement profond, mais surtout pour Europe et le monde ottoman. La guerre 39-45, avec ses dizaines de millions de morts, ses dégâts matériels sans précédent et ses crimes de masse, pousse à des remises en question d’une autre ampleur. Elle a entraîné pendant cinq ans toutes les grandes nations de planète dans une spirale de violence et de haine et elle a fait la preuve du potentiel de mort des logiques industrielles et technoscientifiques ; en définitive elle oblige tout esprit critique à constater que non seulement l’humanité possède désormais les moyens de son propre anéantissement, mais, en outre, que les passions autodestructrices qu’elle cultive peuvent à tout moment balayer les garde-fous dérisoires de ses institutions. La question atomique, à la fois comme expression la plus terrifiante de cette puissance destructrice et comme exemple caricaturale de créature risquant à tout moment d’échapper au contrôle de son créateur, focalise bien entendu l’attention. À partir de la fin des années 1940, des philosophes comme Günther Anders considèrent que l’humanité est désormais en sursis, l’autonomie du système technicien est mise en question par des penseurs comme Jacques Ellul, puis c’est l’expansion urbaine qui devient un objet d’inquiétude, comme chez Lewis Mumford, avant que le lien soit établi entre productivisme et crise écologique par des gens comme Ivan Illich ou André Gorz, ou entre logiques capitalistes et rapports de domination dans la société par d’autres comme Françoise d’Eaubonne ou Murray Bookchin. Tous ces auteurs et bien d’autres ont ébauché dans les années 1950-1970 un grand travail critique largement ignoré en leur temps ; mais leur lucidité et, oui, leur capacité à tirer les conséquences des réalités observées donnent à leur propos une réelle actualité et font qu’on commence à les redécouvrir aujourd’hui. Même si ces gens-là étaient minoritaires et peu audibles, leurs doutes et leurs questionnements ne pouvaient qu’être partagés par d’autres pendant la même période. Pour les raisons déjà évoquées, le genre de la science-fiction était propice à abriter de telles interrogations ; il s’agit d’ailleurs d’un secteur culturel plutôt délégitimé institutionnellement – ce qui incite à la critique des institutions ! –, et nombre d’auteurs et d’autrices du genre se reconnaitront dans la contre-culture et les mouvements contestataires du début des années 1960. Si tous, loin s’en faut, n’ont pas « vu ce qui nous attendait », tous et toutes ont donc fait partie d’une génération plutôt portée à remettre en question les « valeurs » d’une « civilisation » qui applaudissaient le bombardement atomique de deux grands centres urbains comme un progrès de la science, s’engageaient sur des théâtres de guerres à l’étranger contre le désir d’émancipation des populations locales, et s’agrippaient à des systèmes politiques, économiques et sociaux profondément inégalitaires sur tous les plans et destructeurs des milieux de vie naturels par-dessus le marché. Ces gens, généralement jeunes, pratiquaient l’écriture, pouvaient s’adosser à une communauté de lecteurs et de lectrices et à des revues et fanzines extrêmement dynamiques, et étaient enclins par définition à imaginer le futur du monde ; il y avait donc toutes les chances, ne serait-ce que statistiquement, que certaines œuvres franchissent le fameux mur du son et parvienne jusqu’à nous avec une force intacte voire décuplée dans certains cas. On peut par exemple citer le cas d’un auteur comme Lino Aldani – une des exceptions géographiques de notre corpus puisqu’il est italien –, qui, dans 37° centigrades brosse le tableau tragicomique d’une société dystopique entièrement bâtie autour d’une sorte de principe de précaution, et dont les habitants sont quotidiennement soumis à toutes sortes de contrôles visant à s’assurer de leur respect des règles – draconiennes – de santé publique ! Mais notre collection ne doit pas occulter le fait qu’un nombre encore plus important de nouvelles et de romans de SF, y compris, parfois, par les mêmes auteurs que ce que nous publions, ne sont plus pertinents à nos yeux, sinon comme de simples divertissements ; dans certains cas ils sont même devenus carrément illisibles, voire détestables, sur de nombreux plans aujourd’hui – je pense en particulier aux préjugés de genre qu’ils colportent, mais pas seulement.

6 – Pour vous, à l’heure donc où « toute littérature s’effondre » comme a pu l’exprimer le poète Denis Ferdinande, la SF vous apparaît-elle comme le seul « genre » capable de la régénérer, c’est-à-dire de lui faire dépasser son conservatisme béni-oui-oui et ses gémissements testimoniaux, pour lui permettre enfin d’atteindre cette dimension à la fois opérante et nécessaire qui lui redonne du sens et une raison d’être, c’est-à-dire une dimension artistique – et non de divertissement et d’abrutissement – propre à un véritable fictionnalisme, tel qu’a pu le défendre un disciple de Hans Vaihinger, le penseur italien Ciro Giordano Bruni à travers « l’hypothèse fictionaliste » ? En bref, la SF est-elle une échappatoire, une échappée ou un achoppement, par lequel la littérature se doit, à présent, de muer pour redevenir ce « Verbe » qui nous fera revenir à nous-mêmes, c’est-à-dire à notre humanité tant biologique que spirituelle ?
Je ne me sens pas compétent pour parler de « toute littérature » ni même pour discuter le rôle du genre qui nous occupe ici dans sa régénération. Ce qui m’intéresse dans la science-fiction, c’est – pour reprendre le titre d’un ouvrage de Jean-Paul Engélibert sur les « fictions d’apocalypse » (un sous-genre de la SF presque aussi ancien qu’elle) – sa capacité à « fabuler le monde », c’est-à-dire, non pas à le réinventer, mais à ouvrir des brèches dans le présent en situant l’action au-delà des ruptures ou des transformations radicales que les modalités contemporaines d’habiter la terre rendent inévitables. En ce sens, la SF permet de déciller le regard sur des processus déjà en cours, des dynamiques de transformation ou de rupture déjà là, mais que nous ignorons ou refusons collectivement de prendre en considération. Là encore, c’est un genre qui a moins vocation à annoncer le futur qu’à mettre le doigt sur nos aveuglements présents en tirant les fils de leurs conséquences probables. C’est notamment le cas de la cli-fi, la fiction climatique, qui a d’illustres devanciers (Ballard, Herbert, Butler, Atwood), mais prend aujourd’hui une consistance proprement vertigineuse dans certaines œuvres, comme par exemple les romans de Kim Stanley Robinson.

7 – Soulignons qu’il ne faudrait pas uniquement faire un constat négatif de la situation à travers ces textes, sinon même un constat plombant pour le lecteur qui s’apprêterait à découvrir Dyschroniques, car justement, certaines œuvres renversent cette vision étroitement dystopique, non pas en heureuse utopie, mais en une réelle dynamique fictionaliste justement, avec la ferveur que déploient certains auteurs, par exemple, pour la cause des pays du sud, la vie paisible reconnectée à la nature, ou encore, une société d’abondance frugale soustraite à l’asservissement technologique, ferveur portée par un véritable humanisme grandeur nature si l’on peut dire, à la manière dont l’a défendu « The Poet Laureate of Socialism », à savoir le libertaire William Morris, écologiste radical avant l’heure, père de la fantasy et extraordinaire designer dont on peut affirmer que la plupart des auteurs de SF lui sont redevables, d’une manière ou d’une autre, dans cette façon d’appréhender Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre… Ainsi, quels seraient vos arguments pour se saisir de votre collection comme d’une « boite à outils » salvatrice pour dépasser nos difficultés et nos craintes de l’avenir ?
Le terme d’utopie ne doit pas faire peur ou être invalidé trop vite. L’utopie peut être comprise comme une forme d’évasion, de récréation, de fuite hors du réel, mais elle peut aussi traduire en creux, pour nos sociétés, le manque, l’inaccompli, la promesse trahie. C’est un peu l’idée d’« utopie concrète » chère à Ernst Bloch. C’est un horizon de significations et de manières d’être collectivement qui permet, à la fois, de mesurer l’écart avec les réalisations actuelles et de constituer un horizon pour les pratiques de transformation. C’est cette utopie, cette forme sociale juste et accomplie, qu’on sait inatteignable, mais vers laquelle il faut pourtant bien tendre, qui entretient une dynamique de révolution permanente au sein des sociétés ; sans elle, la résignation devient le sentiment social le mieux partagé et la société finit par s’effondrer. Quand l’horizon semble barré, comme aujourd’hui, par la catastrophe et l’effondrement, la faiblesse du discours utopique entretient le sentiment d’impasse et donc la paralysie. Or, c’est un des ressorts possibles de la science-fiction que de s’interroger sur ce que pourrait être la « vie bonne ». William Morris, que vous mentionnez, l’a fait dans un roman, Nouvelles de nulle part, qui peut sembler aujourd’hui un peu désuet (il date de 1890), mais où la société future esquissée s’enracine dans une vision socialiste écologique très originale pour l’époque et profondément liée à l’insatisfaction devant les répercussions de la révolution industrielle. Avec des autrices comme Ursula Le Guin ou Octavia E. Butler, la SF s’est mise, à partir du tournant des années 1970, à prendre à nouveau au sérieux la notion d’utopie, à penser des expérimentations sociales visant à surmonter les problèmes posés par toute organisation collective, sans pour autant ignorer ces problèmes, et même en les affrontant résolument. Cela donne des univers utopiques problématiques, imparfaits, des « utopies ambigües », comme dans Les Dépossédés de Le Guin. Pour un auteur toujours très actif comme Kim Stanley Robinson, l’utopie n’est jamais non plus un état statique et achevé ; c’est « un combat toujours en cours » reposant sur l’idée très nécessaire qu’un autre monde est possible. Or pour lui, la dystopie en SF, c’est aussi de l’utopie, en ce sens que la dystopie est la manifestation de quelque chose qui ne va pas, d’un sentiment d’insatisfaction profonde face à l’ordre présent des choses ; elle est comme un avertissement face aux risques qu’il y aurait à persévérer dans telle ou telle direction. Elle suggère en creux qu’il existe peut-être des orientations collectives plus vertueuses et que la réflexion et l’esprit critique doivent s’exercer en permanence devant les fausses promesses et les futurs iréniques dessinés par l’idéologie dominante. La façon dont nous avons défini la collection Dyschroniques – une perspective anthologique sur l’émergence, au cours de la période de la guerre froide, des grands enjeux de notre temps exprimées dans le registre de la science-fiction – induisait forcément une certaine prédominance du registre dystopique parmi les œuvres que nous allions publier. Mais l’intention n’était en aucun cas d’encourager le défaitisme ou une forme quelconque de cynisme. Il s’agissait de montrer que face à la complexité des phénomènes sociaux, la critique radicale et l’exigence utopique constituent des armes non négligeables et que contre les qualifications de « légèreté », de « divertissement », d’ « idéalisme », d’ « anachronisme », d’ « élucubrations » poético-scientifiques, ou que sais-je, que lui accolent les « gens sérieux », la science-fiction peut nourrir une lucidité, un réalisme et une puissance subversive telles que son actualité peut nous frapper un demi-siècle plus tard. Et puis, il existe aussi des cas où cette acuité du regard sur leur époque peut conduire des auteurs à concevoir des futurs ouvertement utopiques, comme c’est le cas dans la nouvelle à laquelle vous faites allusion dans votre question, La Vague montante de Marion Zimmer Bradley. Mais là encore, ce qui est intéressant, c’est moins l’utopie elle-même, dans ses moindres détails, que ce qui la rend encore aujourd’hui pensable. Pour Robinson, encore lui, l’utopie n’a de sens que s’il est possible de penser le processus historique et politique qui la ferait advenir. Dans la nouvelle de Bradley, une expédition revient sur terre après quatre siècles dans l’espace, enthousiaste à l’idée de découvrir les progrès accomplis par la planète-mère au cours de ce laps de temps. Ce que l’équipage observe en arrivant – une société pastorale qui a fini par maîtriser sa tendance à la démesure techno-industriel – lui semble incompréhensible parce que, à l’instar d’une partie des lecteurs de l’époque, il est incapable de se figurer l’enchaînement des événements ayant pu aboutir à cette situation. Aujourd’hui, cette utopie prend tout son sens, non parce qu’elle serait parfaite, mais précisément parce que, à moins d’être extrêmement peu à l’écoute de son temps, on arrive parfaitement à se figurer les circonstances qui ont pu rendre une telle transformation inévitable. En d’autres termes, aucun de ces récits ne prétend évidemment apporter une réponse toute faite aux problèmes de l’humanité, mais ils nous poussent à concevoir ce qui demeure inexploré dans notre façon actuelle d’habiter le monde, en même temps que les ressources d’attention et d’imagination qu’il nous faut déployer d’urgence pour la réinventer.
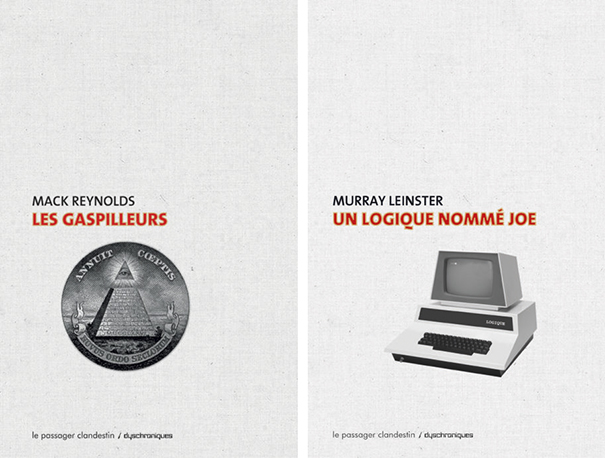
8 – Une dernière question pour la route ! Parlez-nous de votre choix d’avoir publié, dès le démarrage de votre collection, Où cours-tu mon adversaire ? (1969) de Ben Bova. Outre que son bagage scientifique l’ait fait considérer, en son temps, comme un auteur visionnaire, Ben Bova traite dans ce texte d’un sujet amplement plus philosophique que scientifique, puisqu’il s’agit d’une expédition qui consiste en une véritable « quête de soi », mais qui tourne finalement en une « haine de soi »., c’est-à-dire en une haine de l’Autre, quand bien même et surtout s’il a une « forme humaine ». Ce texte met-il le doigt, finalement, sur le seul et unique véritable problème de l’humanité aujourd’hui, celui de toujours rejeter, pour un homme, son « prochain », soulignant ainsi ce que d’aucuns ont déjà pu constater : son problème de « pouvoir », et donc son irrépressible domination sur autrui ?
Où cours-tu mon adversaire ? est une fable sur la propension des sociétés humaines à s’inventer des ennemis. Dans cette nouvelle, l’histoire est racontée du point de vue paradoxal d’un anthropologue spatial acharné à comprendre une ancienne civilisation extraterrestre… dans le but d’en anéantir les derniers représentants. Ce personnage est en effet convaincu que cette civilisation est à l’origine de la destruction, des milliers d’années auparavant, de la terre, berceau de l’humanité. Il découvrira, effaré, qu’elle est simplement un avatar de la conquête de l’espace par les humains, les deux branches de l’humanité – la terrestre et l’extraterrestre – ayant fini par entrer en guerre l’une contre l’autre et se détruire mutuellement. C’est finalement une histoire assez simple et dont on pourra trouver de nombreuses variantes dans la SF des années 1950-1960 : l’antagonisme viscéral des empires et des nations, leur besoin quasi existentiel de se définir contre un adversaire, engendrant des rivalités meurtrières qui continuent à mettre en péril l’humanité tout entière quand on en a oublié les fondements. Inutile de rappeler qu’en 1969, la guerre froide bat son plein, notamment à travers le conflit vietnamien. Mais le texte nous parle aussi plus généralement de la force d’inertie des représentations, de la façon dont celles-ci se cristallisent dans toute une série d’institutions (militaires, industrielles, culturelles, technoscientifiques…) qui entretiennent de manière quasi autonome les antagonismes fondateurs ; elles finissent en quelque sorte par agir à leur insu ceux et celles qui s’en pensent les acteurs. Pour s’extraire de cette logique circulaire, notre anthropologue devra consentir à se dépouiller – littéralement – de tous ses oripeaux et courir le risque tant physique qu’intellectuel de remettre en cause ses préjugés afin d’ouvrir les yeux sur le processus historique et culturel dont il était prisonnier. C’est en ce sens qu’il nous semblait intéressant de placer ce texte au départ de notre collection, car c’est précisément le type d’attitude critique – la souffrance physique en moins, si possible ! – qu’elle cherche à encourager.

Texte © Dominique Bellec & D-Fiction – Illustrations © DR
(Paris, janv.-fév. 2022)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
