MIKAËL HIRSCH s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de ses roman, LES SUCCESSIONS (L’Éditeur, 2011) et LE RÉPROUVÉ (J’ai Lu, 2011) :
Alpha : Mikaël, commençons par OMICRoN. Un seul titre pour deux objets très différents : ton blog et ton roman. Le blog est, aujourd’hui, une catégorie littéraire étudiée à l’Université. Peux-tu revenir sur les circonstances qui t’ont fait ouvrir un blog ? Quelle signification lui donnais-tu dans ton travail à cette époque et comment le vois-tu aujourd’hui ?
J’ai entamé l’écriture de ce blog lorsque j’ai su que mon roman allait paraître. D’une part, la publication annoncée me conférait soudain la légitimité de m’exprimer publiquement sur certains sujets. D’autre part, Je ne souhaitais pas laisser la totalité de la promotion du livre aux mains de mon éditeur. Occuper d’une manière ou d’une autre l’espace médiatique me semblait indispensable. Bien évidemment, cet exercice inauguré comme un tremplin publicitaire s’est tout de suite mué en quelque chose d’autre. Tout simplement parce que je ne suis pas publicitaire, mais écrivain. J’avais alors une perception très négative des blogs, que je considérais comme un déversoir extime et banal de la majorité silencieuse. Je n’ai jamais pu me résoudre à tenir un journal et ne souhaitais absolument pas me lancer dans cet exercice. J’ai très vite réalisé que l’écriture de mon roman, mais également que l’écriture de fiction en général s’était accompagnée au fil des ans de considérations para littéraire qui n’avaient sans doute pas leur place dans un livre, mais qui pouvaient s’épanouir de manière cohérente et articulée sur internet. Je n’y raconte pas ma vie, je n’y propose pas de récit, je n’y fais pas la promotion de mes livres ou de ceux des autres. J’exprime simplement mon point de vue sur la chose littéraire. Dans une certaine mesure, ce blog est devenu la marge de mon travail romanesque, où s’empilent les ratures et les notes, les bribes et les fragments de pensées disparates. Avec le temps, j’ai réalisé qu’il existait deux manières de gérer ses publications électroniques, celle du feuilletoniste et celle du dilettante. Le feuilletoniste cherche à captiver une audience versatile. Il use de démagogie, relate le scandale, l’invente si nécessaire et publie quotidiennement de peur de voir sa fréquentation baisser. Le dilettante n’a pas de calendrier. Il s’exprime quand il a quelque chose à dire et se fout du reste.

Bêta : Au risque de décevoir ses – nombreux – fans, Heinrich Reiss, l’ « obscur compagnon de Schopenhauer », qui apparaît dans ton roman OMICRoN et dont ton narrateur, Thomas Steren, poursuit l’étude, est un fake… qui possède sa bio sur Wikipedia. Tout un pan de la littérature, au XXe siècle et même avant, s’est ingénié à créer de toute pièce des auteurs ou des œuvres imaginaires parfois présentés comme tels, parfois au contraire si bien insérés dans un tissu historique parfaitement reconnaissable qu’ils pouvaient passer pour authentiques. Je crois savoir que ce type d’activité t’intéresse particulièrement. Peux-tu nous en parler, préciser les enjeux à et les jeux à qui en découlent ? Dans cette affaire, le Web semble un prodigieux accélérateur de mensonges parfaitement recevables et propres à modifier la grande Histoire… ?
Je me dois d’insister, mais Heinrich Reiss existe ! Ceux qui s’évertuent à prétendre le contraire sont d’insupportables révisionnistes dont les motivations aussi obscures qu’étranges me désarçonnent. De toute évidence, on ne veut pas d’un nouveau Masque de fer ! Nul doute que la camorra universitaire, spécialiste de Schopenhauer, voit d’un très mauvais œil l’existence de ce double encombrant. Seul son suicide à Francfort, le 16 octobre 1850, reste sujet à caution. La disparition, le même jour et dans le même quartier, d’un homme d’âge et de corpulence identiques pousse certains chercheurs indépendants à échafauder la thèse d’une mise en scène. L’embarquement à Brème, le 19 octobre suivant, d’un certain Heinrich Frei sur le clipper Aulendorf semble étayer cette version des faits. Malheureusement, Le trois mat-brick chargé de machines-outils et de schnaps sombra corps et biens le 20 décembre 1850 près de l’île volcanique de Fatu-Hiva, dans l’archipel des Marquises. On dit que sur certains récifs encore difficiles d’accès de nos jours, de rares autochtones parleraient un créole d’allemand et de polynésien. Après de longues démarches, j’ai tenté d’entrer personnellement en contact avec un certain Temanava Taouaoure-Frei, qui n’a jamais daigné répondre à mes lettres. On n’en saura probablement jamais plus.
Gamma : Dans Pourquoi la fiction ?, Jean-Marie Schaeffer donne une lecture particulièrement fructueuse de la fiction. D’une part, c’est un outil qui, au même titre que l’expérimentation dans les sciences, participe d’une théorie de la connaissance. D’autre part, c’est un stimulus qui mobilise des capacités cognitives inusitées sans elles. Bref, une des conclusions paradoxales de ce livre, c’est que la littérature n’est jamais assez dans et pour la fiction, qu’elle n’est souvent pas au niveau des capacités fictionnelles qu’elle véhicule. Comment te situes-tu dans cette perspective d’une fiction sans complexe et assumant son rôle dans le domaine du savoir ?
Les Chrétiens croient au salut dans l’au-delà. En ce qui me concerne, je crois plus volontiers au salut par la fiction. Il s’agit certainement d’un acte de foi identique. Si « Dieu a fait l’homme à son image », il m’a toujours semblé que c’était justement dans la capacité de créer que résidait la similitude. La fiction est à la fois un baume qui console du réel et un biais permettant de toucher plus efficacement nos semblables. Dès l’enfance, la vie nous immunise progressivement contre le réel. Les chutes à répétition nous désensibilisent. La douleur d’exister devient enfin supportable. La tragédie de Mithridate est une métaphore de l’existence. On ne pleure pas en regardant les actualités, mais on est ému aux larmes par un film. Les artifices conventionnels de la fiction sont des clefs permettant de fracturer l’armure qui nous préserve et nous tient éloignés du réel. Le rapport intime entre fiction et réalité naît dans l’enfance. Si une chose m’a toujours paru pertinente, c’est bien le lien entre la vocation littéraire et ce moment charnière ou l’enfant réinvente sa propre filiation. On s’est tous imaginé être l’enfant d’un roi. Ce père-là, cette mère-là ne pouvaient être nos véritables géniteurs. Il devait y avoir eut un problème à un moment donné. C’est ainsi que l’invention du roman familial, du fait de l’antériorité impossible à percevoir, préfigure en quelque sorte la rédaction du roman tout court. Pourquoi certains d’entre nous finissent par empoigner la plume pour poursuivre ce travail d’invention, d’agencement, d’amélioration de la réalité et d’autres pas, je ne saurais le dire. Lorsque j’étais enfant, je me souviens très bien avoir raconté pendant plusieurs années que mon père était flûtiste de concert, alors qu’il était employé de bureau. Je tenais à cette version jusqu’à m’en persuader moi-même. Bien évidemment, « jouer de la flûte » signifiant aussi « raconter des histoires », les adeptes de Jacques Lacan seront comblés par mes mensonges…
Delta : OMICRoN, le roman, est stylistiquement et formellement très homogène, on peut même dire qu’il est d’une homogénéité frénétique. C’est un récit au passé et linéaire. Pourquoi une telle ligne de conduite ? De même, il porte le nom d’une lettre grecque, les noms des personnages rappellent un imaginaire Mitteleuropa. On pense à Kafka mais aussi à Hofmannsthal, l’auteur de la Lettre à Lord Chandos. Parle-nous de ton rapport à la géographie et à ses incidences littéraires ?
Je voulais écrire une histoire simple, une trajectoire, tendue comme celle d’une flèche, sans que la « machinerie » littéraire soit trop perceptible. C’est un objet que je souhaitais dès l’origine à double tranchant, puisqu’il s’agit au sens propre d’une histoire de doubles. Au premier abord, on trouve une histoire sans flash-back ni prolepse, racontée sur le mode du récit. Ce roman là, bien qu’on m’ait reproché l’étrangeté de l’intrigue, les rebondissements et les nombreuses digressions, peut se résumer aisément, être lu par un grand nombre de lecteurs. Cette simplicité apparente me permet de dissimuler un autre livre dans lequel les enjeux en terme de structure et de symbolisme sont en réalité très complexes. Le positionnement des personnages dans l’espace et leurs rapports aux couleurs sont, par exemple, autant d’indications sur l’évolution de la courbe que suit la narration de manière inexorable. Ainsi, on pourrait désosser le roman en deux parties correspondant chacune à un groupe de longueur d’ondes. Si pour le Rimbaud des Voyelles, l’Oméga correspond au rayon violet, alors l’Omicron doit nécessairement épouser le rouge se situant à l’autre bout du spectre lumineux. Au-delà du violet, on trouve les ultra-violets du soleil chypriote, les rayons X du scanner et, finalement, les rayons gamma de la bombe H qui planent sur le roman comme une menace permanente. En deçà du rouge, viennent les micro-ondes des téléphones portables et les ondes hertziennes de la radio et de la télévision. Ces éléments et leur utilisation dans le récit forment une trame imperceptible, mais cohérente qui sous-tend l’action en toute circonstance. Mon objectif lui aussi était double (comme tout le reste, bien sûr). Je désirais m’adresser simultanément à deux lectorats très différents, sans jamais abandonner l’un pour l’autre, et je cherchais également à convaincre un éditeur… on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre ! Si j’avais choisi de mettre ces tropes au premier plan, personne n’aurait jamais accepté de publier ce texte, susceptible alors de n’intéresser qu’une poignée de lecteurs de toute façon introuvables. En toutes circonstances, il faut avancer masqué (c’est d’ailleurs écrit en toutes lettres dans le livre). J’écris avec mes pieds, en marchant, en traversant des étendues, en traçant au sol une trajectoire qui m’est propre. Je circonscris des périmètres. L’écriture est presque toujours pour moi la superposition d’un espace géographique et d’un territoire littéraire. Je constitue des groupes d’auteurs, des affinités concitoyennes. Il y a ceux qui viennent d’une île perdue dans le brouillard, ceux d’un pays écrasé de soleil, ceux qui vivent sous la terre humide, ceux qui peuplent le ciel des villes. Les textes sont des fragments de continents jetés ça et là dans le désordre. Je range, je trie, j’établis peu à peu ma nomenclature, mes cartes d’état-major. En cheminant, je convoque ainsi les habitants d’une contrée pour m’accompagner. Écrire serait donc venir de quelque part et se rendre ailleurs, revenir sur ses pas ou fuir, tourner en rond, bref se déplacer. C’est pourquoi la toponymie a tant d’importance à mes yeux.
Epsilon : Le Réprouvé (L’Éditeur, 2010 & rééd. J’ai Lu, 2011), ton deuxième roman, plonge dans le microcosme littéraire de l’année 1954 alors que l’Académie Goncourt s’apprête à décerner son millésime à Simone de Beauvoir le 6 décembre. Le personnage principal, Gérard Cohen, âgé de 24 ans, travaille chez Gallimard comme garçon de courses bien qu’il rêve surtout de devenir écrivain. Son travail l’amène, à travers Paris et sa proche banlieue, chez quelques-unes des gloires littéraires de l’époque. Quelles sont les circonstances qui t’ont amené à écrire sur cette époque ainsi que sur Léautaud et Céline en particulier ? Nous devinons bien que tout cela a quelque chose à voir avec ton histoire familiale, ton grand-père Louis-Daniel Hirsch, ayant été le directeur commercial de Gallimard entre 1922 et 1974…
Je n’ai pas du tout cherché à écrire sur Léautaud, Céline, Beauvoir ou le monde littéraire des années cinquante. J’ai cherché à raconter un épisode de la vie de mon père, et par-là même, à m’interroger sur ma propre nature et ma vocation d’écrivain. Mon père a rencontré Léautaud, Céline et Beauvoir, alors, il m’a fallut raconter tout ça pour en venir là où je voulais. Si ma famille avait été dans la boulangerie, j’aurais parlé de Poilâne, ni plus, ni moins. Je voulais montrer comment l’écriture, chez moi, provient du renoncement paternel, ou comment j’écris parce qu’il a tourner le dos à la littérature et cette rupture, dans le livre, prend la forme d’une rencontre avec Céline.

Zêta : Le développement du roman suit l’itinéraire du personnage principal qui, sur sa moto, flâne dans Paris. Cette balade est pour lui l’occasion de raviver des souvenirs liés à sa jeunesse, notamment ceux de la guerre qu’il a vécu – non sans risques – caché à cause de ses origines juives. Or, en 1954, son identité est toujours un problème : pour les uns, ce n’est pas un vrai juif et pour les autres, ce n’est qu’un juif puisque, dans les deux cas, c’est un demi-juif. Pourquoi t’a-t-il semblé important de traiter de ce sujet ? Peut-on dire que l’enjeu du Réprouvé se situe davantage sur ce sujet que sur les portraits que tu donnes de Léautaud ou Céline ?
Les portraits que je donne là de certains écrivains de l’époque sont pour moi anecdotiques et, bien évidemment, des Exercices de style à la manière de Queneau qui apparaît également dans le roman. Je crois d’ailleurs me souvenir que ce petit livre fut la première lecture que me donna mon père. D’une certaine manière, ce livre est également un trait d’union. Je revisite certains événements de sa vie en les interprétant à l’aune de ma propre expérience. Par exemple, il assista en son temps à l’enterrement de Colette et, par le plus grand des hasards, je passe tous les matins devant la tombe de Colette. Il me faut donc évoquer Colette puisque le temps et la géographie en ont fait un lien entre l’auteur et son sujet. La question de l’identité est centrale pour moi. Mon père, qui n’était pas juif aux yeux des siens, puisqu’issu d’une mère catholique, fut tout de même pourchassé par les nazis pour une identité somme toute relative. Cette schizophrénie est une chose qui me hante. Je ne peux que tenter de deviner comment mon père a vécu cette double injustice, être condamné pour ce que l’on est, et de surcroît, ne pas l’être véritablement. J’ai mis dans sa bouche des mots qui sont en réalité les miens… J’ai grandi et vécu jusqu’à présent en devant assumer cette bâtardise, jamais à l’aise avec personne, parce que toujours pris pour un autre. D’une certaine manière, j’ai écrit Le Réprouvé pour en terminer avec ce trouble, pour dire une bonne fois pour toute que je n’appartiens à aucun groupe, quel qu’il soit, en dépit de la bien-pensance et du communautarisme et, s’agissant dans le livre d’un protagoniste écartelé entre deux identités, l’une juive, l’autre chrétienne, il me semblait que le tout début du livre devait, avant toute autre chose, refléter, absolument, cette bipolarité. Or, cette simple phrase « C’est un homme », incipit au vocabulaire et à la grammaire neutres est tout aussi bien le « Ecce homo » (« Voici l’homme ») de Ponce Pilate à propos de Jésus, que le « Se questo è un uomo » (« Si c’est un homme ») de Primo Levi, le rescapé d’Auschwitz. On voit ainsi comment les mots les plus anodins sont en réalités les plus chargés d’intertextualité.
Êta : À la différence d’OMICRoN, Le Réprouvé est écrit dans un style très limpide, souvent avec des phrases courtes et directes. Il nous a ainsi semblé qu’il pouvait parfois donner à lire de nombreux « clichés » bien connus de cette époque dans ses descriptions ou ses dialogues. Etait-il important pour toi d’être davantage accessible que ton premier roman, qui jouait sur une complexité plus subtile dans la langue tant que dans la construction ? Le sujet lui-même du Réprouvé – le milieu littéraire de l’après-guerre – a été jugé par l’ensemble de la critique comme « original » alors même qu’il est d’une grande banalité au regard de tout ce qui a pu être écrit et publié sur ces années et ce milieu, tant dans la fiction que dans les essais. Comment expliques-tu l’intérêt appuyé porté par les critiques comme des libraires à ton livre par rapport à ce sujet ? Est-ce dû au fait que tu évoques Louis-Ferdinand Céline ?
Ces deux romans n’ont pas été écrits de manière consécutive. Il m’est donc difficile d’évoquer les relations stylistiques qu’ils pourraient entretenir. Par ailleurs, je ne cherche pas à « forger » un style qui serait une marque de fabrique, identifiable et certainement profitable d’un point de vue commercial, puisque le public semble privilégier l’habitude à la surprise, mais, au contraire, à produire chaque fois un véhicule adapté à mon sujet. Les phrases courtes du Réprouvé sont induites par les cahots de la route, les changements de direction de la moto, les soubresauts du moteur et les bribes du monologue intérieur. D’une certaine manière, la moto dicte son rythme au récit et lui sert également de métaphore. La lecture qui est faite d’un livre est forcément relative et ce qui peut apparaître d’une grande banalité pour quelques spécialistes de l’histoire littéraire française semblera d’un exotisme absolu pour la vaste majorité des lecteurs. De toute façon, je ne crois pas à l’originalité. Je me situe plutôt du côté de ces peintres japonais qui peignaient cent fois le même paysage avec d’infinies variations. Réaliser que tout à déjà été dit et décider de relever le défi tout de même n’est pas une bravade mais, au contraire, un geste d’humilité total. De plus, je m’intéresse aux clichés, au propre comme au figuré (comme on le verra plus bas). Le cliché est ce qui reste attaché dans le fond de la marmite lorsqu’on a fait réduire tout le jus. Le cliché persiste, traverse les époques. Sa vivacité en fait quelque chose de signifiant qui transcende les modes. L’écriture d’un roman historique nécessite l’utilisation de clichés à des fins de réalisme et de conviction, ce que les Anglais appellent « the supension of disbelief ». Si Napoléon est habillé en cosmonaute, peu de chance que le lecteur s’intéresse au reste de l’histoire. Il portera donc un bicorne et mettra la main dans sa veste. Certes, on l’a déjà vu/lu cent fois, mais c’est justement du fait de cette répétition que l’incrédulité s’estompe et que la fiction prend quasiment tout de suite un accent « authentique » en dépit de la construction, des artifices et de toute la machinerie littéraire. Je ne crois pas du tout que Le Réprouvé soit un texte moins subtil qu’OMICRoN, bien au contraire. C’est en réalité un palimpseste autrement plus compliqué, à triple niveau : procession sur le mode de la Passion, avec montée au calvaire et stations balisées sur le chemin du Golgotha/Meudon, relecture de l’Ulysse de Joyce, auquel il emprunte l’unité de lieu, une ville unique en mode déambulatoire, l’unité de temps, une journée du matin au soir, la prétendue obscénité, une visite détaillée au bordel et enfin réécriture presque ligne à ligne d’Au cœur des ténèbres de Conrad, avec Céline dans le rôle de Kurtz/Brando, Gérard dans celui de Marlow, la moto à la place du steamer, la Seine pour le fleuve Congo et Gallimard dans le rôle de la compagnie des ivoires qui tente de négocier avec son plus fidèle représentant de commerce, perdu pour les hommes et le trafic, quelque part dans la forêt vierge.
Thêta : Tu nous as confiés avoir rencontré beaucoup de difficultés pour trouver un éditeur à tes romans, Le Réprouvé ayant même été refusé par toutes les maisons avant que L’Éditeur ne le publie en 2010. Comment expliques-tu cela d’autant que Le Réprouvé a été immédiatement sélectionné par le jury Femina sur ses listes et qu’il sort aujourd’hui en poche, preuve s’il en est, que ce n’était pas un manuscrit que les éditeurs se devaient de refuser… Que penses-tu donc de tous ces auteurs, parfois importants, et qui sont dans cette situation que tu as connue ? Est-ce une caractéristique de notre époque ou bien, en grand sage, juges-tu cela normal puisque finalement, même Proust ou Joyce ont été refusés et ont énormément galéré ? Finalement, l’édition traditionnelle est-elle vraiment encore compétente au regard de ce qu’elle publie de totalement médiocre à longueur de temps ?
La Littérature a beau être un art, l’édition est avant tout un commerce. Réussir à faire coïncider les intérêts de la culture et de l’industrie tient de la gageure. On entend souvent parler de « politique éditoriale » ce qui n’existe quasiment pas. Il faudrait plutôt parler de « politique commerciale » des maisons d’édition. Les livres qui se vendent peu sont des problèmes économiques, indépendamment de leurs qualités esthétiques. Voilà pourquoi un éditeur aura des scrupules à publier un texte qu’il trouve bon, mais peu susceptible de plaire à un large public. C’est l’inconvénient de la culture de masse. La concentration du capital ayant eu lieu ces dernières années dans le monde de l’édition y est sans doute pour quelque chose. Partout, la marge de manœuvre se réduit car les taux de rendement imposés par les actionnaires sont de plus en plus élevés. L’édition a longtemps été un secteur épargné par la restructuration du capital, mais ça n’est plus le cas. Travailler avec un agent littéraire permet d’être lu par des interlocuteurs crédibles, ce qui n’est pas si mal, mais ne peut garantir qu’un texte plaira, ou qu’il saura répondre à une attente marketing. Bien sûr, les éditeurs se trompent régulièrement. Des best-sellers annoncés connaissent l’échec et certains textes plus ambitieux rencontrent parfois le succès, ce qui rend les a priori obsolètes et d’une certaine façon, pimente le jeu. La donne n’a pas fondamentalement changé. Il faut savoir se frayer un chemin. La compétition, car c’en est une, confine au darwinisme littéraire. Proust et Joyce étaient convaincus de leur talent. Leur ténacité, envers et contre tout, fait partie intégrante de leur génie. L’édition de textes littéraires est pratiquée par des êtres humains, imparfaits de nature, et qui plus est, animés par des objectifs souvent contradictoires. Gide n’aimait pas Proust, Calmann-Lévy a refusé Les Bienveillantes [de J. Littell], Le Voyage au bout de la nuit n’a pas reçu le Prix Goncourt (qui se souvient de Guy Mazeline, lauréat en 1932 ?). On se trompe. On est de mauvaise foi. On est cruel, parfois mesquin. On obéit à des contraintes qui fréquemment n’ont rien à voir avec la Littérature. Chercher à publier, c’est apprendre à supporter l’arbitraire.

Iota : Dans Les Successions (L’Éditeur, 2011), tu traites de l’art à travers le personnage de Pascal Klein, brillant marchand mais frustré de ne pas peindre comme son père. Ce livre nous ramène à nouveau durant la période de la Seconde Guerre mondiale puisque tu évoques une toile de Marc Chagall qui ornait la chambre paternelle du personnage et qui a été spoliée durant l’Occupation. Là encore, nous devinons qu’il y a du vécu personnel. Peux-tu revenir sur l’élaboration de ce roman et ce qui t’a poussé à traiter du sujet de la spoliation et, à nouveau, de l’identité juive comme problématique psychologique pour le personnage ?
Je ne peux pas dire que l’identité juive soit de nouveau au cœur de ce livre. Je ne crois pas que le mot « juif » y apparaisse, ne serait-ce qu’une seule fois. Je serais bien en peine, d’ailleurs, de parler de cette identité, n’étant pas juif moi-même. Si j’ai choisi le patronyme de Klein, c’est justement parce qu’il peut être indifféremment juif ou goy, mais également parce que c’est le nom du personnage interprété par Alain Delon dans le film éponyme de Joseph Losey et qui traite du trafic d’œuvres d’art pendant la guerre. La trame de ce récit est inspirée d’une histoire authentique. Quelques années seulement avant la mort de mon père, j’ai découvert qu’il avait grandi avec un tableau de Chagall dans sa chambre. Je suis ensuite parti à la recherche de cette toile disparue en 1940. Rapidement à court d’éléments d’enquête, je me suis mis à écrire l’histoire du tableau, afin d’atténuer ma frustration. Le tableau est devenu le fil rouge d’une réflexion plus vaste sur l’histoire de l’art, la place des images dans notre société, le glissement de l’art vers l’art décoratif, le pouvoir de sidération des icônes, le regard et la transmission involontaire entre les générations. Une fois le premier jet du manuscrit terminé, le tableau qui avait totalement disparu de la surface de la terre durant soixante ans a resurgi, comme par magie, lors d’une vente aux enchères. Les lecteurs croient le plus souvent que les auteurs écrivent sur leur passé, mais en réalité, ils écrivent sur le futur. Le fait d’écrire provoque des événements, forge l’avenir.
Kappa : La découverte de photographies semble, à chaque fois chez toi, être le déclencheur de ton écriture. En effet, la rédaction du Réprouvé découle d’une photographie de ton grand-père, le 6 décembre 1954, parmi une horde de journalistes. Quant aux Successions, il découle d’une photographie de ce fameux tableau de Chagall que possédait ton grand-père. Tout comme pour W. G. Sebald, la photographie semble être pour toi le support de ré-appropriation de ton histoire familiale. L’enquête que tu mènes à partir des photographies de ta famille te permet ainsi de faire ressurgir cette partie dissimulée de la grande Histoire officielle pour en révéler une toute autre réalité. Ta démarche t’aide-t-elle à comprendre ce que tu es ? Penses-tu que tu écrirais sur des sujets semblables sans ces photographies ? Pourquoi ?
Le Réprouvé et Les Successions sont tout les deux issus du même processus accidentel, la découverte de photographies. Mes textes précédents et ultérieurs fonctionnent différemment, car il ne s’agit pas pour moi d’une démarche systématique, mais d’une rencontre fortuite avec une image inattendue. Ces images m’ont suffisamment bouleversé pour me donner envie d’écrire, non pas à leur sujet, mais avec elles. Ces photos sont devenues des éléments d’une fiction qui prêche le faux pour mieux connaître le vrai. Par ailleurs, j’ai toujours beaucoup pratiqué la photographie. Mes premiers clichés ont été réalisés à l’âge de cinq ans, avec un Instamatic Kodak. Je les possède toujours et certains d’entre eux sont assez troublants. Ils permettent de voir avec les yeux de l’enfant que j’étais. C’est mon père qui, ensuite, m’a appris les ficelles techniques de la prise de vue sur un boîtier 6X6. C’est une des rares choses qui nous unissaient, d’où, sans doute, ma propension à voir des histoires de filiation dans les images.
Lambda : Tu as publié un recueil de poésie intitulé Chants de partout et d’ailleurs (Librairie-Galerie Racine, 2000). Pourquoi ce recueil, c’est-à-dire pourquoi pas en revue plutôt qu’en ouvrage ? Crois-tu encore à la publication de poésies lorsqu’on n’est pas un « poète » reconnu ? Qu’est-ce qui est important pour toi dans l’écriture de poésies formelles ? Ne crois-tu pas que la poésie, de nos jours, doit plutôt être pratiquée à l’intérieur même de la fiction pour aider celle-ci à sortir du lot des « petites histoires » publiées à tour de bras ? Finalement, l’écriture aujourd’hui (quand on parle de littérature) n’a-t-elle pas pour enjeu principal celui de la poésie même, c’est-à-dire de produire une dimension poétique ?
Si j’en crois Borges : « Il existe deux catégories de poètes. Les vrais cessent d’écrire à dix-sept ans et les autres finissent par publier ». J’appartiens donc à la seconde catégorie et dois m’y résoudre. J’ai longtemps écrit de la poésie et uniquement de la poésie. Frustré de ne pouvoir dépeindre certaines situations par ce médium, j’en suis venu à écrire des nouvelles, puis en fin de compte des romans. A posteriori, cette évolution me paraît totalement naturelle. On ne gravit pas les Grandes Jorasses à mains nues dès la première tentative. Un jour, un éditeur m’a dit : « Soyez un poète, soyez un romancier ou un nouvelliste, mais surtout, ne devenez pas écrivain ». À l’époque, j’avais pris ça pour une sentence brillante et sans appel, le genre de réplique qui n’admet aucun commentaire. J’étais resté là, silencieux, les yeux plissés par la réflexion. La peur d’être pris pour un dilettante m’ôtait tout sens critique. Il fallait donc choisir son camp ! C’était indispensable ! Avec le recul, je crois pouvoir dire que cette ineptie est la chose la plus ridicule qu’on m’ait jamais déclarée. Au-delà des cases et des têtes de gondole, en dépit des a priori et des certitudes, n’en déplaise aux censeurs paternalistes, je me sens profondément écrivain. Le roman n’est pas uniquement un genre totalitaire (c’est bien simple, si vous souhaitez être reconnu en tant qu’auteur, même médiocre, alors vous n’avez pas d’autre issue. Il vous faudra en passer par-là). Il exerce son omnipotence dans un paysage littéraire autrement dévasté. C’est aussi le genre hybride par excellence, une bâtardise historique sans règles véritablement définies qui permet à peu près toutes les audaces et tous les styles. Cicéron déclara au futur Octavien qui taquinait la muse : « La poésie est une activité de jeune homme ». J’ai publié ce recueil à vingt-sept ans, après avoir envoyé un seul texte court à un éditeur de poésie qui diffusait également une revue intitulée Les Hommes sans épaules. Je ne m’attendais pas vraiment à ce que cela débouche sur quoi que ce soit de sérieux. Cette expérience m’a donné l’impression d’être le dernier locuteur sur Terre d’une langue morte depuis des siècles. J’ai alors connu la solitude des grands espaces. Ma jeunesse était derrière moi.
Mu : Tes études supérieures t’ont amené à étudier la littérature américaine et notamment, les « grands romans américains » considérés en tant que mythe. Penses-tu qu’aujourd’hui, la littérature américaine domine les autres littératures, notamment la littérature française et pourquoi ? Y aurait-il une spécificité dans l’écriture américaine qui amènent les écrivains de ce pays (et de ce continent à nous pensons à la littérature latinos et à des auteurs incroyables comme Bolaño) à se renouveler sans cesse, voire à réussir à produire aussi souvent des chefs d’œuvre ? Y aurait-il une écriture et une pensée sur ce continent plus en phase avec la contemporanéité que chez nous, en Europe ? Aussi, que penses-tu de la littérature française contemporaine ? La plupart des auteurs publiés correspondent-ils à ta vision de la littérature ou te sens-tu loin de ce qu’ils produisent ?
Je crois que l’intelligence et le talent sont des phénomènes collectifs, fruits d’un milieu, d’une culture et d’une langue à un moment donné, dans un espace donné. Corneille, Molière, Racine et La Fontaine, par exemple, ou bien Hemingway, Faulkner, Dos Passos et Steinbeck. Les volcanologues parlent de « points chauds » pour qualifier temporairement l’endroit où se déroulent les phénomènes effusifs. Du fait de la subduction permanente des plaques tectoniques, les points chauds se déplacent le long d’une ligne de force sur laquelle on trouve des volcans éteints, des atolls coralliens, traces d’une activité passée. Le point chaud de la littérature contemporaine se trouve certainement sur le continent américain. La France a connu dans les années cinquante une période très féconde. Le génie se déplace. Contrairement aux volcans qui essaiment en ligne droite et sans espoir de retour, l’énergie littéraire va et vient au gré de facteurs innombrables qui nous dépassent.
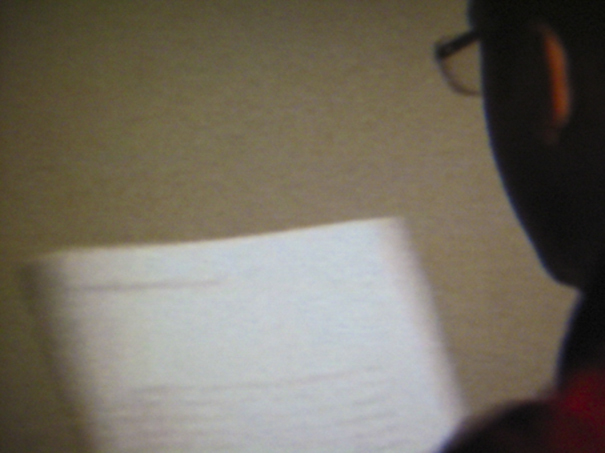
Nu : Pour toi, la présence sur Internet pour un auteur aujourd’hui est-elle indispensable ? Internet par les blogs et les sites mais aussi prochainement par la lecture – en téléchargement sur des readers ou des téléphones – est-il une solution pour rencontrer un public et des lecteurs ? Te sens-tu prêt à publier en eBook ?
Je connais des auteurs qui, négligeant totalement cet aspect, vendent pourtant leurs livres bien que mieux moi. Pour ma part, j’y vois un moyen simple et efficace de continuer à exister entre deux parutions. La réalité de mon activité littéraire n’est plus uniquement tributaire du milieu éditorial. Je suis libre de m’exprimer comme bon me semble, même si publier sur Internet équivaut souvent à lancer une bouteille à la mer. La multiplication des sources d’information nivelle et noie le message. Trouver soi-même sur Internet un texte susceptible de nous plaire consiste à chercher un message d’origine extraterrestre en écoutant une poignée d’étoiles parmi les milliards de la galaxie. Étant d’un naturel pessimiste, je crois illusoire le fait d’imaginer que les nouvelles technologies de la communication permettraient un nouvel essor de la littérature. En tant qu’écrivain, je me vois d’ailleurs comme une survivance totalement anachronique du passé. L’ère de la littérature est sans doute derrière nous et si je savais faire autre chose, je le ferais. J’ai mis très longtemps avant de comprendre qui j’étais et maintenant, j’ai la conviction que cette nature est obsolète. N’est-ce pas la toute l’ironie de la tragédie selon Aristote ? Les gens qui lisaient continueront de le faire sur un support ou un autre, mais les digital natives qui n’ont pas connu le monde avant Internet ne viendront pas spontanément à la lecture au prétexte qu’il y aurait des eBooks. Il ne suffit pas de produire une offre pour engendrer une demande.
Omicron : Vers quels projets d’écriture te diriges-tu aujourd’hui ? Souhaiterais-tu t’arrêter de travailler pour te consacrer uniquement à l’écriture ? Pourquoi ?
J’écris un livre sur la honte, en forme de traité romanesque et sous l’égide de Stendhal. Ensuite, j’écrirai un livre sur la liberté. J’ai longtemps pensé que le temps disponible n’était pas le facteur décisif dans un projet d’écriture. Je le pense toujours, mais ce fameux temps passant, s’accélérant, j’en manque de plus en plus pour mener mes travaux à bien, du moins, comme je le voudrais. Si je ne pouvais faire que cela, je le ferais.
Entretien © Mikaël Hirsch & D-Fiction – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum
(Paris, juin-août 2011)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.