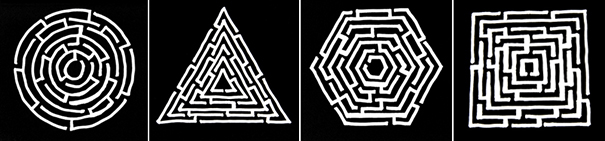
À travers 33 séries photographiques et vidéo qui constituent ce projet à long terme, et qui doivent être envisagées comme autant de dimensions infernales, État de veille traite de thèmes sociétaux à l’heure de la cybernétique globale, à la manière dont Nietzsche nous enjoint de toujours considérer la tragédie des événements comme la véritable « centre-matrice de l’art ».
En effet, toute écriture – et en particulier photographique – semble porter les traces de notre psyché collective et émaner de cette inquiétante fascination que nous avons pour les images du réel. En effet, ces images d’une nature troublante de par leur reproduction infinie, se projettent à notre vue et s’inscrivent durablement dans notre esprit du fait de leur impact, de leur viralité et de leur flux.
Or la représentation ordinaire et même triviale du quotidien que donnent à voir ces images sidérales d’une époque, produit un effet révélateur irremplaçable : la force fictionnelle de l’image.
//
Through 33 photographic and video series that make up this long-term project, and which must be considered as so many infernal dimensions, État de veille deals with societal themes in the era of global cybernetics, in the way that Nietzsche urges us to always consider the tragedy of events as the true “matrix-center of art”.
Indeed, all writing – and in particular photography – seems to bear the traces of our collective psyche and emanate from this disturbing fascination that we have for images of reality.Indeed, these images of a disturbing nature by their infinite reproduction, are projected to our sight and are permanently inscribed in our minds due to their impact, their virality and their flow.
However, the ordinary and even trivial representation of everyday life that these sidereal images of an era give to see, produces an irreplaceable revealing effect: the fictional power of the image.
Texte & Illustration © Isabelle Rozenbaum/ADAGP
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
