Ad Astra (2019), qui m’a beaucoup plu en cela que, en effet, tel que je l’écrivais à propos de The Lost City of Z, et exactement comme Gray le confessait lui-même dans des interviews récents qui m’avaient enchanté (puisque je ne pensais pas que, à peu près seul contre tous dans ma détestation de Gray, ce serait lui-même qui viendrait confirmer au mot près tous mes dires), oui, Ad Astra est un film sur les limites de Gray. Je ne vais pas répéter ce que j’écrivais déjà à propos de The Lost City of Z, mais le principe, le trajet, l’aveu, ici est le même : Gray met en scène son propre vide intérieur, sa propre incapacité à accéder à quoi que ce soit de beau, de vrai, de salvateur. Et c’est lorsqu’un auteur parvient à effectuer ce retournement, c’est lorsque de ses yeux extérieurs il parvient à basculer vers ses yeux intérieurs, qu’il naît en tant qu’auteur, car un auteur au sens propre, c’est l’homme qui s’enfonce dans le trajet inverse à la vie, c’est-à-dire ce qui profondément ne va pas en lui. C’est lorsqu’il opère ce basculement dans sa propre nuit, qu’il peut s’engouffrer sur la voie de son impossibilité.
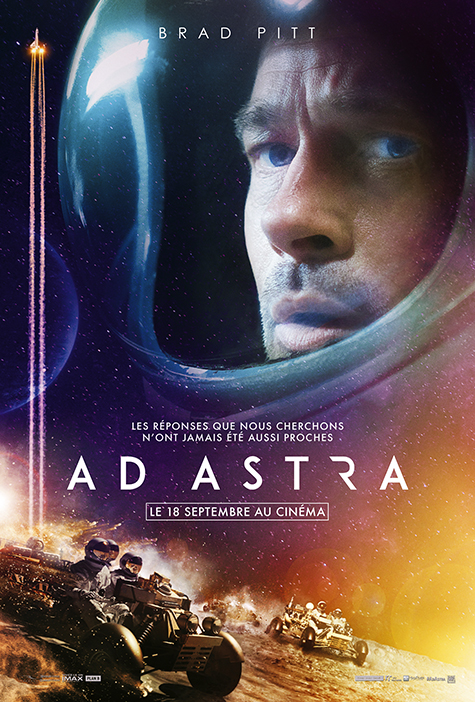
Mais à la différence de The Lost City of Z, ici, l’allégorie de ce vide, de cet axe de néant, est infiniment plus grande : elle dépasse aisément l’exploration psychologique ou la relation père-fils, qui ne sont en soi que des excuses, qu’un voile abstrait nous invitant surtout à projeter en ce réceptacle allégorique notre propre quête. Il s’agit, cette fois-ci, véritablement, d’une pulsion de mort : d’une ascension vers celle-ci. Le père n’est pas un père : le père est l’artiste. Il est l’homme qui ne peut vivre sur la terre, qui ne le veut pas, qui le ne sait pas : qui vit la mort à l’intérieur de la vie. Il est le versant obscur que l’on possède tous. Et il s’agit pour Gray, pour Brad Pitt, pour le spectateur, de plonger dans la nuit vers cette pulsion d’obscurité : il s’agit de la confronter. De la rejoindre. De s’y unir…
Aussi, quand cela culmine, quand Pitt plonge dans l’eau, sur Mars, pour s’infiltrer dans cette fusée, quand résonne dans l’obscurité, où néanmoins, il est éclairé par une étrange lumière chaude, je suis tiré hors du Soleil, vers toi, le film monte jusqu’à des hauteurs insoupçonnées : il parle et montre le plus grand. L’enfoncée de l’homme vers le cadavre, vers l’absence intérieure, vers le fantôme de Dieu. Voilà, en vérité, jusqu’alors, le film nous avait plu : de l’introduction de manière purement cinématographique, où Pitt simplement et littéralement chute (en cela, les critiques chouinant sur la voix over sont à côté de la plaque, étant donné que Gray, quoi qu’on en dise, ne fait que de la mise en scène, représentant toujours l’état mental de son héros en tant que mouvement, en tant qu’action, donc en tant que cinéma – et quand à côté de cela, en plus, la voix over offre des monuments comme je suis tiré hors du Soleil vers toi, et bien l’on oublie ses préjugés conceptuels), à cette course poursuite sur le versant de la Lune (excellemment mise en scène, et là encore une illustration parfaite de l’avancée intérieure du héros), Ad Astra nous plaisait. Mais quand Brad Pitt opère ce regressus ad uterum, cette descente dans le ventre de la Baleine, cette catabase, quand il finit entièrement de passer outre la lumière de la vie pour s’enfoncer dans sa mort, alors là, on est emporté. En vérité, contrairement à la critique, l’on ne pense pas aux autres explorations spatiales cinématographiques, à la 2001, Gravity ou Interstellar : on pense à la seule bonne minute dans la carrière de Luc Besson, à savoir la toute fin du Grand Bleu, en cela que Ad Astra commence là où Le Grand Bleu osait finir. On plonge dans l’espace comme Jean-Marc Barre plonge dans l’eau, et s’ensuit alors, pendant deux heures, une dérive dans la mort. Ad Astra est un film sur le suicide. C’est un suicide.
Malheureusement, Gray, après avoir pris tant de films à parvenir à trouver une entrée vers lui-même, se retrouve enfoncé de manière si profonde, si glaciale, que face à cette vérité, face à ce reflet (celui donc de sa mort désirée), il prend peur. Il rebrousse chemin. C’est d’autant plus clair lorsqu’au bord de ressusciter le père, que l’on rhabille et que l’on relie à soi d’un cordon ombilical, brutalement celui-ci se détache et s’enfonce dans l’espace : ce revirement narratif est un volte-face vis-à-vis de la vérité du film, c’est une erreur organiquement saisissable (en plus d’être pompée sur le Mission to Mars de De Palma). Une narration peut prendre un virage brutal : pas une allégorie qui doit rester directe. Ici, Gray la coupe d’un angle droit – c’est ici, précisément, que réside l’écueil du film et le signe clair de la peur panique de Gray d’assumer la finalité du récit : Pitt devait rester avec son père, et non pas le ramener à la vie, mais mourir avec lui. À rebours de cette ascension irrésistible vers la mort, Gray préfère fuir (mais a-t-il vraiment eu le choix ?) et invente une descente vers la vie. Ce n’est plus Je suis tiré hors du Soleil, vers toi : c’est je suis tiré vers le Soleil, hors de moi. À partir de là, c’est fini : Gray repart dans ses tentatives avortées, pathétiques, de créer du sens, de laisser un message positif. L’atterrissage de Pitt sur terre pouvait avoir cela de touchant que cet échec dans ce retour à la vie semblait presque admis, Pitt ici là comme un enfant n’ayant pas osé mourir jusqu’au bout. On avait presque pitié… Mais quand on se retrouve à un comptoir, comme dans une pub Nescafé, et qu’il est question du moment dont il faut apprendre à profiter, alors on fulmine : plus de pitié, c’est de la colère. Autrefois, Gray était un réalisateur bête : il est maintenant devenu un réalisateur peureux. Long, très long, est le trajet pour lui…
Note : 3/5.
Texte © Léo Strintz – Illustrations © DR
Face au Spectacle un workshop d’analyse filmique et sérielle in progress de Léo Strintz.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
