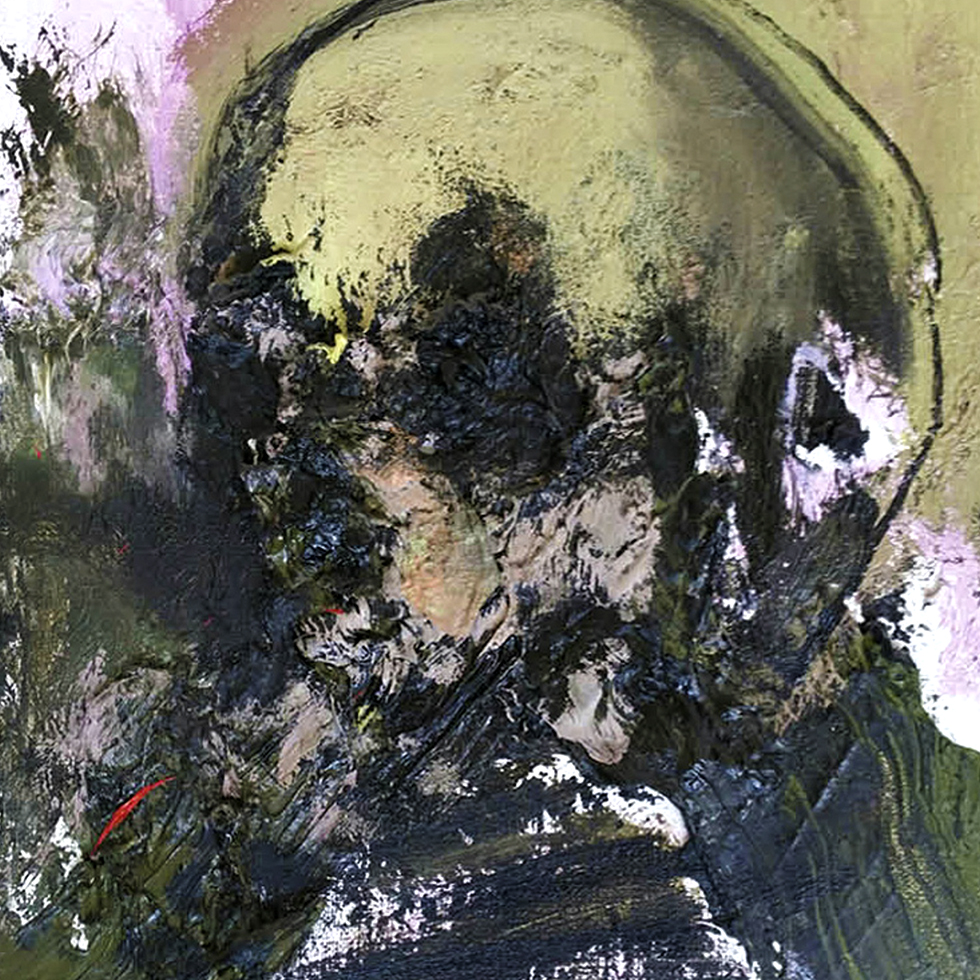Je ne suis pas de ces écrivains qui approfondissent leur style à chaque livre. Chacun de mes romans est écrit en contradiction avec celui qui le précède. Je pars toujours d’une logique d’écriture fondamentalement différente. Mes deux derniers livres, Les Hautes collines (2017) et Apollon dans la poussière (2019), s’appuient ainsi sur les atouts historiques de la langue française – concision, clarté, équilibre, transparence, etc.
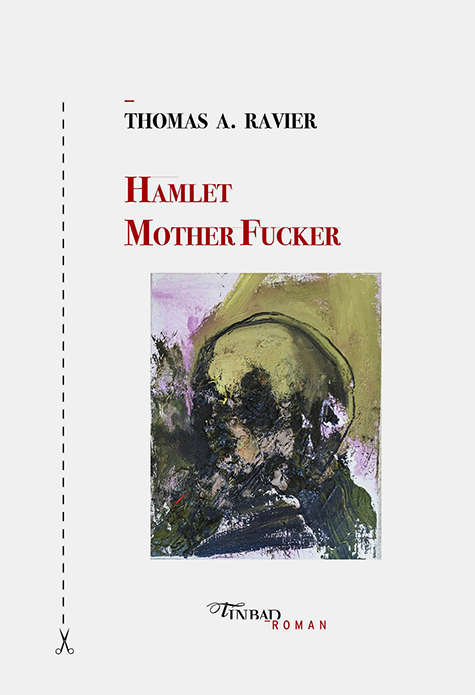
Le parti pris de Hamlet Mother Fucker (Tinbad, 2023) est à l’opposé, fondé sur une critique radicale de cette belle langue française telle qu’elle a été fixée au 17e siècle. Comme le dit mon héros – qui sait de quoi il parle puisqu’il est comédien – le français n’est pas une langue scénique. Son volume théâtral est limité par rapport à celui de l’anglais. C’était l’avis de Joyce : « Les Français, vous avez un instrument pauvre, mais vous en jouez bien ». Joyce dit aussi que le français est « un modèle de modération ». Aussi ne transpose-t-on pas Hamlet dans la langue de Descartes sans trouver, au préalable, des couleurs inédites, des accentuations (de celles qu’offre par exemple le verlan), une intensité syllabique inattendue… En bref, une percussion nouvelle.
Deux événements m’ont guidé pour ce faire : en premier lieu la prise en compte récente de l’urgence à briser enfin cette gangue littéraire qui écrase l’anglais originel, toute cette dimension sur-écrite que privilégient les traducteurs de Shakespeare depuis deux siècles. C’est de cet académisme figé que nous délivre enfin Jean-Michel Déprats dont les traductions shakespeariennes, de l’avis même des comédiens contemporains, sont pensées pour être jouées. Déprats sauve la langue de Shakespeare d’un travestissement poétique imposé notamment par Yves Bonnefoy. Il sort Hamlet de sa fausse vocation à produire un pur objet d’écriture. On se préoccupe enfin de la présence des personnages, c’est-à-dire des corps. Mais la véritable révolution, c’est pour moi la traduction d’Hamlet de Daniel Mesguich (2012). Sans le travail de Mesguich, pas de Hamlet Mother Fucker (HMF). À grands renforts d’assonances et d’allitérations, de jeux de mots-valises et de chromatismes virulents, Mesguich réussit ce prodige de maintenir à flot dans le français le rythme et la vitalité sonore directe de l’anglais.
Et justement, le second événement que j’ai voulu à l’origine de la conception de HMF, comme son titre l’indique, c’est le rap : le coup de théâtre du rap. Ou plus précisément celui du rap français. En effet, après avoir trop longtemps ressemblé à des sociologues en baggy, les rappeurs français ont pris à bras le corps le problème du retard musical du français sur l’anglais. Nous sommes dans les années 2000, celles où le rap, ce théâtre de la cruauté urbaine, représente l’essentiel de ma vie d’auditeur. Et donc, pour réduire leur handicap par rapport au rap américain, il a fallu à la génération des Booba recréer de l’extérieur cette langue française. La recréer là encore à grands renforts d’assonances et d’allitérations, d’images baroques aussi violentes que burlesques. Tout est bon pour se hisser au niveau d’explosivité prosodique de l’anglais. Eh bien, ces deux événements que tout oppose apparemment – culture savante contre culture populaire – n’en sont qu’un pour moi. Et, c’est fort de ce rapprochement que j’ai travaillé de longues années durant afin de mettre au point la forme et l’esthétique conflictuelle de HMF.
Le milieu ambiant de HMF, ce n’est évidemment pas la littérature contemporaine. C’est celui du spectacle vivant. Si la littérature française traverse une période de grande misère, les arts scéniques témoignent, depuis une trentaine d’années, d’une vitalité exceptionnelle. C’est ma fréquentation des salles de spectacle qui a nourri l’écriture de HMF. Ce sont les rencontres avec des corps singuliers. Des personnages vivants, « en colère de corps » pour reprendre une formule d’Antonin Artaud. Celui de Joey Starr qu’il faut avoir vu sur scène à l’époque de NTM. Joey Starr qui sait crier, lui ! Mais aussi, les spectacles inoubliables d’Alain Platel, qui a longtemps travaillé avec des malades mentaux. Platel cherche à inventer ce qu’il appelle « une danse bâtarde ». Son spectacle Pitié !, monté avec des chanteurs lyriques et des danseurs Hip-Hop, reste une des plus grandes émotions de ma vie. Voilà où je vais puiser mon énergie littéraire. Le travail de Clément Cogitore confrontant le Rameau des Indes galantes (1735) à la transe de combat du Krump, voilà des chocs esthétiques, des contrastes auxquels je peux m’identifier en tant que romancier. Le mot Krump est apparemment l’acronyme de Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. Soit littéralement : « Royaume Radicalement Élevé par une Puissante Louange ». Ou encore, dans une traduction de Pierre Guglielmina : « Radicale et puissante louange exhaussée du Royaume ». C’est sublime, non ? Et quelle magnifique définition de la littérature !
Enfin, je n’oublie pas les Haoukas, cette secte nigérienne dont les transes ont été filmées par Jean Rouch. Les Haoukas se sont appropriés les symboles de l’occupation britannique pour les tourner en dérision, sous forme d’exorcisme-limite, avec un sens de la mise en scène stupéfiant, et j’ajoute, une grande intelligence dialectique. Ils brûlent les planches, on peut le dire. Ce sont mes « athlètes affectifs », pour détourner une autre expression d’Antonin Artaud. Dans un passage de HMF que j’ai dû supprimer pour des raisons de composition, mon héros – en proie au doute – pressentant les limites de son métier de comédien qui l’enferme dans le monde inoffensif de la culture, rencontre une nuit dans un fast-food le petit-fils d’un Haouka. S’ensuit une scène d’initiation rocambolesque.
J’ai toujours eu le projet d’écrire une histoire du cri. Avec HMF, j’ai voulu écrire un roman d’ambianceur. De chauffeur de salle, disons chauffeur de bibliothèque… Mon narrateur est un bouffon élisabéthain adepte de l’open-mic. Dans un royaume entièrement faux qui serait celui d’Hamlet de retour au 21e siècle, le principe de la comédie s’impose. J’ai tiré au maximum Hamlet du côté de la farce hallucinée, du vaudeville gothique. C’est ma conviction : plus la catastrophe se déploie, plus elle est incluse dans le principe même de la comédie. La comédie favorise une désinhibition des genres. Dans mon idée de spectacle total – entre le roman et l’opéra, l’étude de mœurs et le concert – intervient une volonté farouche de ne jamais se restreindre à tel ou tel registre d’écriture. Le refus de s’enfermer dans le domaine, aujourd’hui conventionnel, de la littérature expérimentale. La réalité est devenue – pour des raisons de vitesse d’information, de fragmentation du temps, de vertige électronique, etc. – entièrement expérimentale, elle s’est en quelque sorte approprié le genre, tout en le datant. Il faut inventer une nouvelle avant-garde, une avant-garde classique, illimitée dans ses prétentions. Avancer et revenir en arrière simultanément et sans effet d’annonce, de hiérarchie marquée (comme c’était encore le cas avec l’Ulysse de Joyce).
Voilà pourquoi tout cette masse d’énergie noire puisée au rap, aux Haoukas, à la violence des spectacles de Platel – et bien entendue à l’époque, à ma propre vie – je la précipite contre le sérieux de l’édifice plus ou moins conscient de ma mémoire littéraire. Je la projette contre la tentation flagrante dans HMF d’une écriture classique structurant le roman. Autant j’ai voulu que les monologues intérieurs d’Hamlet soient fidèles à ce que, dans le rap, on nomme le freestyle ou l’ego trip ; autant les passages de narration restent volontairement identifiables, travaillés, apparentés à un classicisme identifiable.
En 2023, l’identité littéraire du roman doit devenir indéfinissable, faute d’être à la traîne de l’époque. Et je signe.
Texte © Thomas A. Ravier – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.