
Oberland dans le canton de Vaud
Au début des années 1980, et à la suite de rebondissements familiaux rocambolesques que je ne peux raconter ici, j’ai été envoyé en Suisse dans une pension réservée aux enfants de la jet set internationale. Kim Jung Un, dictateur de la République populaire de Corée du Nord empruntera d’ailleurs un chemin similaire quelques années plus tard. Je suis donc passé sans transition des HLM de Belleville aux chalets helvétiques, dans une tentative de greffe sociale, forcément vouée à l’échec.
Avec le recul, cette expérience a été fondamentale dans mon développement et j’ai toujours su que j’écrirai un jour quelque chose à ce sujet. Je dirais même que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent tournait d’une manière ou d’une autre autour de cette absence. Le goût pour les langues en tant qu’objets, les rapports de force entre le groupe et l’individu, l’utopie sociale, le séparatisme qu’il soit linguistique ou économique, tout ce que j’aborde dans mes livres vient de là. Néanmoins, je ne voulais pas me contenter de raconter mes souvenirs d’enfance. Il fallait que ces années prennent un sens pour devenir l’armature d’une œuvre qui les dépasserait. Et il aura fallu que j’atteigne enfin la cinquantaine pour que cette sublimation devienne possible et que j’écrive Le Syndrome du golem (Le Dilettante, 2022).
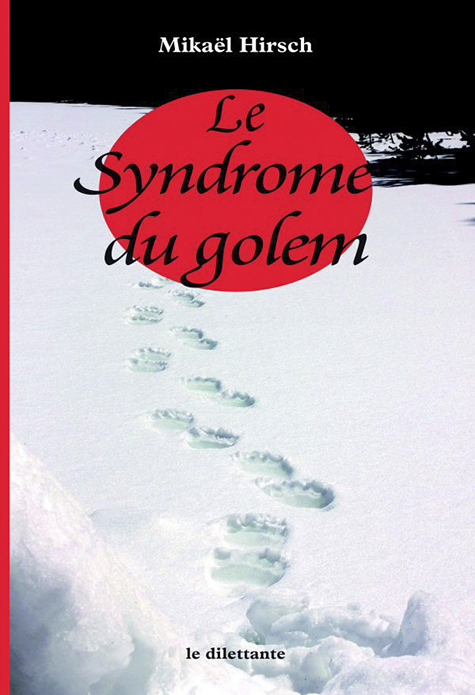
J’étais une sorte de transfuge, dont les autres ignoraient la nature. Ainsi, j’ai côtoyé les très privilégiés sans leur dire que je n’étais pas des leurs et en suis devenu l’observateur discret, mais l’enfance et l’isolement géographique entraînaient un nivellement qui m’ont permis d’échapper à l’ostracisme social lié à ma condition. Coupés du reste du monde, sans commerce ni tentation d’aucune sorte, l’argent ou son manque éventuel n’avaient plus aucun sens pour nous. L’instruction rude à la montagne devait aussi servir, dans le projet pédagogique, de rééducation par le sport pour gosses de riches pourris gâtés. L’effort physique était le seul étalon à l’aune duquel nous étions jugés. Plus tard, le couple à l’origine de cette entreprise verra son institution péricliter de façon dramatique, leurs propres enfants (cordonniers mal chaussés ?) finissant en prison et à l’hôpital psychiatrique. Il ne me reste plus aujourd’hui de tout cela qu’une nostalgie terrible et le sentiment d’avoir vécu une aventure hors du commun.
À cet âge qu’on dit « tendre » et qui ne l’est pas du tout, sans doute dopé par l’air des cimes, j’ai eu l’intuition de l’existence du Yeti, quelque part dans l’Himalaya et de sa possible acclimatation dans les Alpes suisses. Il ne s’agissait pas alors d’un monstre abominable, mais bien d’un double psychanalytique, incarnant des pulsions encore inexprimables et les assumant à ma place.

Les enfants venant de partout et ne parlant pas encore l’anglais, la communication était un problème quotidien. Si bien que certains d’entre eux tentaient vainement d’inventer un vocable intermédiaire, une langue véhiculaire permettant de créer un socle commun. Il s’agissait aussi d’établir un code qui nous aurait isolés du monde des adultes, comme les jumeaux parlent parfois une langue inventée et dont ils sont les seuls locuteurs afin de s’enfermer dans une bulle.

Beaucoup plus tard, je me suis souvenu de tout ça et ai compris que nous avions tenté, sans le savoir, de recréer ce que Ludwik Zamenhof avait essayé de faire avec l’espéranto, une langue qui serait enfin celle de tout le monde, parce qu’elle ne serait celle de personne en particulier. C’est là que j’ai commencé à entrevoir le roman à venir. Zamenhof est né juif à Bialistok, dans l’actuelle Pologne, où cinq communautés linguistiques (yiddish, polonais, russe, allemand, ukrainien) devaient cohabiter, souvent sans se comprendre. De cette incompréhension lui est venue l’idée de fournir aux habitants un outil de communication transnationale devant permettre d’éviter les conflits. L’espéranto était né.
Or, il existe aujourd’hui une petite communauté de gens dispersés à travers le monde et qui ont choisi de faire de l’espéranto la langue maternelle de leurs enfants. Ils s’appellent entre eux « denaskuloj », ce qui signifie « natifs ». Si cette entreprise un peu folle a sans doute un fondement louable, ne s’agit-il pas en réalité d’un dévoiement complet de l’idéal porté par Zamenhof ? Je veux dire par là que, si l’espéranto devient la langue de quelques-uns, non seulement elle ne peut plus être la langue de tous, mais on risque aussi d’assister au développement d’un nouveau patriotisme, d’une revendication minoritaire. L’outil universaliste par excellence devient de fait le ferment d’un séparatisme de plus et le rêve est alors brisé. Imaginons maintenant que tous ces denaskuloj se voient regrouper dans un seul et même endroit. À la confluence de la nation enfin réunie et d’un territoire ad hoc, n’assisterions-nous pas à la naissance d’un état ? Il suffirait pour cela que les adultes, linguistiquement impurs, disparaissent, comme par enchantement. On assisterait peut-être, non pas au retour de la barbarie, comme chez William Golding, mais au contraire à la naissance d’un nouvel ordre, dans lequel la jalousie, le désir et la soif de pouvoir seraient exacerbés. C’est l’une des questions que j’avais envie d’explorer.

Pavé commémoratif au nom de Petr Ginz,
aujourd’hui dans une rue de Prague
Parmi ces quelques centaines de denaskuloj, on trouve au moins deux personnalités remarquables : Petr Ginz, jeune romancier praguois qui finira déporté à Auschwitz en 1943 et Georges Soros, le milliardaire américain d’origine hongroise qui est la bête noire et l’obsession de tous les complotistes. C’est même grâce à l’espéranto que Soros a pu fuir son pays d’origine, ses parents l’ayant emmené avec eux à un congrès d’espérantistes de l’autre côté du rideau de fer.
On voit comment tous les éléments du livre se mettent en place peu à peu : Le ghetto de riches, le ghetto subi à Prague en 1942, le séparatisme national, le quant-à-soi social, les montagnes suisses, le yeti et ses corollaires folkloriques en tant que doubles inconscients, les figures tutélaires de Petr Ginz, romancier espérantiste, de Ludwik Zamenhof et enfin de Georges Soros, le conspirateur supposé.
C’est maintenant qu’intervient le hasard, ou dirons-nous, les « rencontres heureuses », dans le processus de confection du roman. Quand on cherche sur Internet un rapport quelconque entre la Suisse et le yeti, on tombe immédiatement sur des pages relatives au géologue et alpiniste Augusto Gansser qui mena en 1936 la première expédition suisse dans l’Himalaya. Il se trouve que Gansser aurait aperçu ladite créature lors de son périple à la frontière du Tibet et aurait, par la suite, popularisé le mythe de l’anthropoïde en Europe. Autrement dit, du pain béni pour un romancier. L’expédition a même fait l’objet d’un compte rendu publié en allemand en 1938, mais ce texte reste absolument introuvable et la manière dont je suis parvenu à en obtenir une copie en anglais pourrait presque être l’objet d’un roman en soi. Pour faire court, disons que j’ai obtenu l’édition d’un reprint en fac-similé à… Singapour. Or, j’ai beau avoir épluché le livre en long en large et en travers, il n’est jamais fait mention de la moindre rencontre inattendue dans ce texte, pas le moindre poil de yeti, rien.

Arnold Heims & Augusto Gansser dans l’Himalaya en 1936
Cette absence, qui aurait dû me décourager, m’encourage plutôt à poursuivre dans cette voie. Sans le savoir, je suis tombé sur un de ces mensonges orientés que le Net s’est évertué à dupliquer de site en site jusqu’à le rendre crédible et que j’affectionne particulièrement, car il s’agit de tentatives d’insémination de la réalité par la fiction. J’en ai, moi aussi, commis par le passé, subvertissant ainsi des informations innocentes au bénéfice du roman. Plutôt que d’écrire aux modérateurs des sites concernés afin de les avertir de la supercherie, je décide donc de capitaliser sur cette illusion et de produire un texte qui relayera ces allégations et qui pourra même, le cas échéant, servir de source pour les étayer. Cette rencontre qui n’a jamais eu lieu que dans l’imagination d’un internaute, sans doute féru d’ésotérisme, aura dorénavant lieu pour de bon dans le roman.
Arrivé à ce stade, il ne me restait plus qu’à écrire un livre que je voulais plastique et protéiforme, comme un objet en trois dimensions et autour duquel il faut tourner pour en comprendre tous les aspects et reconstruire ainsi une image mentale de l’ensemble. Dans une certaine mesure, et bien que les enjeux soient très différents, Le Bruit et la fureur de Faulkner m’a un peu servi de modèle. Les quatre parties sont comme les quatre faces dissemblables de cet objet qui semblent dans un premier temps ne pas avoir de rapport entre elles, mais qui, chemin faisant, s’agrègent dans l’esprit du lecteur pour finir par former un tout cohérent. Les détails ne doivent rien au hasard et prennent sens petit à petit jusqu’à former une ligne de pierres blanches, permettant de retrouver son chemin, comme dans le Petit Poucet. Et si toute cette histoire n’était que le roman perdu de Petr Ginz, cinquième roman égaré quelque part entre Prague, Terezin et Auschwitz et dans lequel un gamin apeuré par son destin funeste transpose ses joies, ses peines et ses obsessions, singeant parfois Jules Verne ?
Enfin, le titre, qui n’a pas encore sa place dans les bréviaires de psychiatrie, décrit un phénomène qui m’intéresse au plus haut point. Si la « pensée magique » est le propre de l’enfance, car les enfants sont convaincus que leurs désirs et leurs peurs ont une influence directe sur le monde qui les entoure, entraînant ainsi une porosité totale entre leur psyché et la réalité, cette confusion cesse normalement à l’âge adulte. En effet, comment continuer à y croire quand le poids que l’on « pèse » sur le monde s’avère en définitive si dérisoire ? La distinction entre soi et le monde extérieur devient probante avec l’âge. Le « Syndrome du golem » serait une évolution pathologique de ce phénomène, la séparation claire et nette ne s’étant pas effectuée en temps voulu, et ce, pour une raison quelconque. Il se peut aussi que la littérature soit une forme de prolongement de la « pensée magique ». J’imagine quelque chose, j’en ai le désir et je lui donne vie de la seule manière qui me soit encore accessible dans un monde fait de frustration et d’impuissance, grâce à l’usage des mots qui, selon la légende juive, anime la matière inerte. Les romans sont tous des golems.
Texte © Mikaël Hirsch – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
