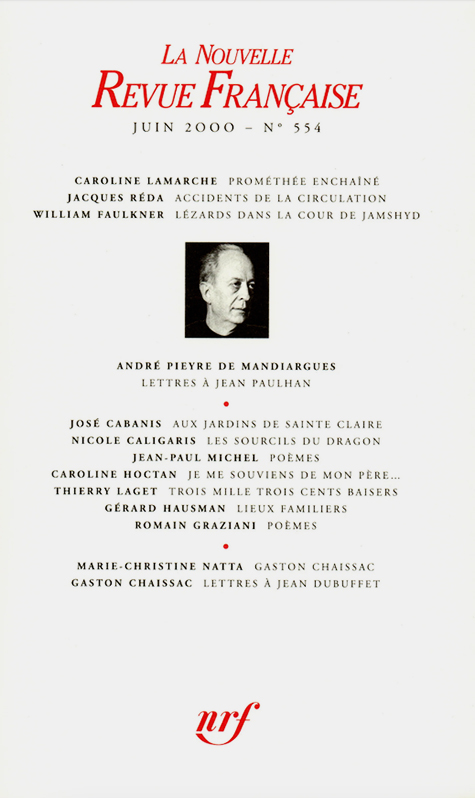Le père as-tu dit, c’est l’autorité de l’absence.
(Jean-Claude Pirotte)
J’aurais très bien pu ne jamais connaître mon père. Mon père est parti à ma naissance. Ma mère s’est mariée avec son voisin de palier alors que j’avais à peine quelques mois. Celui-ci est devenu mon père malgré lui, malgré moi. Il est devenu mon père par la légitimation de son mariage avec ma mère. Personne n’en a jamais rien su.
Durant toute mon enfance, durant toute mon adolescence, mes parents m’ont caché la vérité : celui qui passait pour être mon père n’était pas mon père. Il pensaient sûrement qu’il valait mieux pour moi que je ne sache rien de toute cette histoire. D’ailleurs, l’histoire ne commence pas là. Elle commence depuis toujours car moi, je savais que mon père n’était pas celui que l’on me désignait, que mon vrai père vivait quelque part et qu’il pensait à moi, je le savais parce que je l’entendais : il me parlait.
Longtemps, j’ai cherché d’où venait cette voix qui était la sienne, mais qui semblait surgir au fond de moi.
Un jour, ma mère me présenta un ami de la famille qui était de passage et qu’elle n’avait pas vu depuis des années – un Britannique à l’œil perçant et au visage marqué. Il parlait étrangement. On aurait dit qu’il voulait toujours exprimer autre chose que ce qu’il disait. Pour dire oui, pour dire non, il approuvait d’un même signe comme si cela n’avait pas d’importance, comme si cela revenait au même de toute façon.
Cet homme me regardait fixement. Je le regardais moi aussi, mais sans bien le voir. Il paraissait ne pas être là, ne pas exister vraiment.
Plus tard, j’ai cru que j’avais rêvé, que jamais je n’avais vu cet homme. Cependant, alors que je n’avais aucun souvenir précis, je pensais à lui tous les jours. Souvent, je pensais à lui violemment, c’est-à-dire j’y pensais de la même manière qu’à une chose vitale dont dépendait ma vie. Une chose que je ne parvenais pas à définir, que j’avais perdue, et que je cherchais désespérément à retrouver. Son regard.
Je pensais à lui. Je pensais à sa voix comme à celle de mon père qui, maintenant, résonnait plus fortement encore en moi. C’est seulement au bout de trois ans que je trouvais enfin quelle était cette voix qui était la voix de mon père.
C’était la voix de cet homme.
Ma mère n’a pas protesté. Cela allait trop mal à la maison depuis trop longtemps. À quoi bon continuer à mentir ? Elle n’a pas protesté, mais elle n’a pas cherché non plus à m’expliquer. Elle m’a répondu simplement : C’est bien lui ton père.
Mon père est venu à la clinique. Je venais de naître. Il m’a parlé. Quelques mots. Puis, il est parti définitivement. Seule, sa voix est restée seule. Aujourd’hui, je connais en partie l’histoire. Mais, la véritable histoire, ce n’est pas celle-ci, c’est encore celle qui dure depuis toujours, celle de mon père que j’aurais très bien pu ne jamais connaître.
Il avait soixante-quatorze ans lorsque j’ai été le retrouver pour la première fois. J’en avais dix-sept. Normalement, nous n’aurions pas dû nous connaître. Il était d’un autre pays, d’un autre monde. Il avait failli mourir au moins à trois reprises : d’abord en Inde dans les années trente, puis en France durant la guerre, enfin il y a quelques années, à la suite d’un grave accident.
J’aurais très bien pu ne pas le connaître, ne pas le rencontrer, ne pas le reconnaître. Je l’aurais cherché partout, dans tous les pays, dans chaque ville, parmi les hommes dans les rues. J’aurais continué à le chercher toujours, et surtout en moi, quand vient la nuit.
Quand la nuit est venue, il m’a dit : Je vais te montrer ta chambre. Je l’ai suivi. Les couloirs étaient longs, obscurs, encombrés ; je m’y perdais. Je n’arrivais pas à le suivre. J’ai voulu lui demander de m’attendre. J’ai voulu l’appeler, mais je ne le pouvais pas car je ne possédais pas les mots pour nommer le père que n’avait jamais été mon père, je ne possédais pas les mots qui faisaient de lui un père. Il n’avait qu’un prénom, celui d’un homme comme tous les autres hommes.
Le lendemain, j’ai dit que je voulais rester. Rester ! s’exclama-t-il. Que je voulais rester avec lui encore un jour, deux jours, trois jours. Peut-être tous les jours qui existaient sur le calendrier et même tous les jours qui n’existaient pas, et que l’on pouvait inventer pour que je reste encore un jour, deux jours, trois jours, ainsi que tous les autres jours. Pourquoi, m’a-t-il demandé, rester là encore ? J’ai répondu que je ne pouvais pas repartir ainsi, sans savoir. Que veux-tu savoir ? s’enquit-il. Je veux savoir : Pourquoi ?
Il me dit que l’on ne pouvait pas répondre à ça, que c’était impossible de comprendre. Que ni moi, ni personne ne comprendrait jamais. J’en ai eu les larmes aux yeux. J’ai dit d’un souffle que je voulais rester là, rester près de lui, dormir avec lui, manger avec lui, aller avec lui là où il irait, que je voulais être avec lui partout, toujours et maintenant pour toujours. C’était tout.
Il me regardait de son air fixe : Tu veux rester là, tu veux rester près de moi, tu veux dormir avec moi, tu veux manger avec moi, tu veux aller là où j’irai, tu veux être avec moi partout, toujours et maintenant pour toujours ? J’ai répondus oui. J’ai répondu comme on fait une promesse. J’ai dit que je voulais sentir sa présence, sentir sa chaleur, sentir près de moi son corps déjà usé, sentir dans son corps usé quelle était cette force qui l’enveloppait, cette force audacieuse, noble, cette force sans faiblesse dont je voulais sentir qu’elle m’enveloppait aussi. J’exprimai cela et une chose précise. Je voulais savoir comment il était quand il devenait un père. Je voulais savoir s’il était différent quand il était mon père ou s’il était juste un homme comme les autres ; s’il me ressemblait bien que ce soit moi qui lui ressemblais tellement.
Il me regardait, perplexe. Il ne voulait pas que l’on sache qu’il était mon père. Il a dit qu’il fallait rester comme avant. Il m’a dit qu’il ne voyait pas la différence qu’il soit mon père ou qu’il soit cet homme-là, un homme comme les autres. Il m’a dit que l’on n’allait rien voir, que c’était pareil, que d’ailleurs, il était vieux maintenant, et aussi que je ne comprendrais pas de toute façon.
Pourtant, je voulais. J’ai dit que l’on pouvait faire semblant, juste pour voir ce que c’était. Lui et moi.
Il raconte qu’il y a très longtemps, il vivait ailleurs. Il raconte que sa mère est morte presque immédiatement, que son père est parti en Amérique, qu’il a été élevé par d’autres. Il dit que c’est la vie. Après, il raconte qu’il est parti avec l’armée très loin, en Inde, très loin là où la vie est tellement différente que ce n’est presque plus la vie pour des gens comme nous qui ont une idée bien différente de la vie. Il raconte la pluie, le soleil, les aliments étranges et savoureux, parfois de toutes les couleurs. Il raconte les hommes colonisés, les hommes colonisateurs, l’Empire à l’époque, les sons, les langues, sa langue que je ne parle pas, la langue de son pays qui me manque pour parler avec lui. Sa langue que tout le monde sait parler et que je ne parviens toujours pas à apprendre.
Les autres nuits, je ne retourne plus dans ma chambre qui est loin de la sienne. Je dors avec lui dans sa chambre, près de lui. Je ne dors pas tout de suite. Je fais semblant. Et quand il dort, je vais voir comment il fait. Toute la nuit, après, je pleure de quelque chose d’ancien qui remonte en moi et qui est arrivé trop tard.
Une nuit, je lui demande si ma bouche, c’est sa bouche. Il répond que c’est en partie la sienne, surtout les lèvres. Alors, il touche mes lèvres du bout de ses doigts hésitants et il confirme d’un signe. Je lui demande s’il trouve que nous avons les mêmes cheveux. Il pense qu’en partie oui, mais les siens sont blancs maintenant. Alors, il pose sa main sur mes cheveux, il me dit que j’ai les mêmes cheveux en brun. Je lui demande pour les yeux aussi. Les yeux, c’est plus difficile car ils sont identiques dans la forme, mais ils n’ont pas la même couleur du tout. Les siens sont gris. Les miens sont marron, et parfois jaunes. Ce sont les yeux de sa mère, pense-t-il. Et il trouve quelque part une vieille photographie. J’ai les yeux de sa mère, c’est vrai. Donc, j’ai les mêmes yeux que toi. En fait, oui, approuve-t-il. Mais un peu après, il dit que cela ne change rien.
Une nuit où il fait froid, je veux avoir plus chaud. Il me prend dans ses bras. Je trouve cela agréable. Je dis qu’il faudrait que ce soit toujours ainsi, que pour me réchauffer, il me prenne contre lui, dans ses bras, plus proche de la chaleur de son corps, plus proche de son cœur solitaire. Je lui dis que je suis bien lorsque je suis ainsi. Il me dit qu’il ne faut pas dire ça, que c’est juste une sensation, mais pas vraiment la réalité.
Plus tard, il me frotte le dos et les épaules. Il me caresse le haut du cou et le visage. Je lui demande comment il me trouve. Il me dit que j’ai un beau corps comme lui quand il était jeune. Quand il était jeune, il était très beau. Il plaisait beaucoup. Il séduisait beaucoup. Il en profitait beaucoup. Quand il a connu ma mère, il était vieux déjà, et c’est drôle, dit-il, j’étais très beau encore. Aujourd’hui, c’est fini, c’est le passé, pense-t-il. Je lui demande si, par hasard, il me rencontrait sans savoir, est-ce que je lui plairais ? Il me dit qu’il ne faut pas demander ça, que c’est juste une impression, mais pas la réalité.
Il tourne la tête et regarde par la fenêtre. Ses mains osseuses, veinées à l’extrême tremblent un peu. Elles renferment des désirs secrets. Elles semblent vivantes. Je voudrais les capturer, les emmener quelque part et les cacher. Alors, elles seraient à moi et il n’aurait plus à les tendre à n’importe qui.
Je prends ses mains dans les miennes. J’ai peur. Peut-être, ses mains aussi. Je ne sais pas. La beauté de mon père est une beauté flagrante. C’est une beauté que qu’on voudrait expliquer, mais qui n’est pas explicable, une beauté impossible à décrire. Alors, je lui demande qu’il me raconte encore une histoire à lui.
Il me raconte qu’il y a très longtemps, il y a eu la guerre en France et que, après, les Allemands sont restés pour de bon. Il raconte que des Anglais comme lui étaient sur le territoire pour donner des renseignements. Il donnait des renseignements, c’était son métier. Un jour, un Allemand lui a demandé ses papiers. Il a donné ses papiers. L’Allemand lui a demandé son nom, son prénom, son adresse tout en regardant sur les papiers. Mon père ne connaissait pas le nom qui était sur les papiers : c’étaient de faux papiers et il avait oublié d’apprendre son nom. Il changeait très souvent d’identité, si souvent qu’il ne savait jamais vraiment comment il s’appelait. L’Allemand l’a arrêté. Il se souvient qu’il faisait beau ce jour-là.
Il a préféré interrompre l’histoire pour me raconter autre chose. Je l’écoute, mais il ne parle plus. Il écoute lui aussi des paroles anciennes et qui reviennent de loin. Il semble écouter ces paroles comme si c’était moi qui parlais, mais ce n’est pas moi ; ce sont les souvenirs.
Il se souvient de ma naissance, du moment où il est parti. Il se souvient de ma naissance alors que tout était fini, que le passé était fini. Il ne pouvait pas être père. Je dis oui. Il ne pouvait plus être père. Je dis oui. Il ne sait pas si tout cela est vrai, mais il dit que c’est la réalité. Je lui demande ce que je dois faire maintenant que je suis ici. Il me dit qu’il ne faut rien faire, qu’il est trop tard, que même ça, c’est déjà fini.
J’attends plusieurs jours, plusieurs nuits. Parfois, lorsque j’attends à côté de lui, c’est pire que si j’étais seule à attendre pour toujours. Il ne voit pas ce qui change à ce qu’il soit mon père ou un autre homme. Pour lui, j’aurais été là quand bien même il n’aurait pas été mon père. J’aurais été là après l’avoir rencontré par hasard lors d’un dîner ou sur le quai d’une gare. D’ailleurs, cela aurait été plus facile pour lui, avoue-t-il : Au moins, nous aurions pu devenir amis.
Qu’allons-nous devenir maintenant, lui et moi, devant ce gouffre qui ne finit pas de s’élargir ? Que sommes-nous l’un face à l’autre devant notre incapacité à être l’un pour l’autre, autre chose que des inconnus ?
Quelquefois, je regarde avec lui par la fenêtre. L’hiver est partout dans l’air, sur la terre aussi. Les arbres sont figés, les branches prises par la glace. J’attends avec lui. Un matin alors que la neige tombe à nouveau, il dit : Il ne faut pas rester plus longtemps. Je voudrais répondre. Mais que sont les mots devenus, qui peuvent dire, qui peuvent taire ? Que sont les mots devenus silencieux ? De ces mots, je voudrais revenir là où tout a commencé il y a longtemps, c’est-à-dire, revenir depuis toujours et tout recommencer.
Prononcer le mot qui appelle le père.
Il est à son bureau, il pense. Il pense faire ce qu’il ne parvient pas à faire. Il se dit qu’il aimerait y arriver. Mais, il ne voit pas de solution pour y arriver. Il ressent presque du dégoût à être père, à voir plus longtemps encore la chair de sa chair devant lui qui est plus fraîche que la sienne, la chair de sa chair qui en veut encore, qui n’est pas rassasiée de lui.
Il m’aperçoit et j’entre alors doucement. Je m’assois à son bureau près de lui. Je retiens mon souffle, je serre mes mains entre les jambes pour ne pas montrer que je tremble. Les larmes m’inondent le bord des yeux avant même que les mots, dans mon esprit, soient ordonnés. Puis, tout s’embrouille, tout se perd. Je demande juste quel est ce bruit qui rampe derrière les murs. Il dit que c’est l’eau dans les tuyaux. Il a augmenté le chauffage parce qu’il faisait froid.
Les heures passent, les jours passent. Et je reste avec les heures et les jours, et toutes les nuits aussi. Mon père ne dit rien. Jamais. Il se tient droit, à son bureau. Il attend. Il attend que je dise le jour de mon départ. Il pense à ce départ plus qu’à moi, plus qu’à lui-même me témoignant d’un seul coup la seule affection qu’il lui soit possible de me donner.
Je n’apprendrai jamais rien de plus sur lui aujourd’hui, ni demain après sa mort. Personne n’apprendra jamais rien de plus sur lui, sur nous. Sur ce qu’il regardait par la fenêtre, sur ce qu’il voyait lorsqu’il me regardait, sur ce qui lui apportait de la joie ou de la tristesse, sur ce monde qu’il avait traversé comme il traversait la rue pour changer de trottoir.
Ainsi, j’aurai vu mon père devant moi, comme le matin – lors des réveils douloureux – mon image incertaine dans le miroir. Ne pas sortir du lit, de la nuit fade, mais douce, ne pas sortir de ce corps qui n’est pas tout à fait mon corps, ne pas sortir du passé qui n’en finit pas, ne pas sortir dehors où la vie n’est plus de ce monde, ne pas oublier mon père qui, de son ultime autorité, cherchait à m’effacer sans jamais avoir porté la main sur moi.
J’aurai eu ce père auquel je dois tout jusqu’à l’absence même.
Je choisis le jour. Je choisis l’heure précise. Il dit qu’il faut se méfier de la neige qui peut venir tout perturber, que la neige est imprévisible, presque impossible à deviner. Je pense à la neige un instant. J’imagine mon départ annulé par la neige, j’imagine rester encore, grâce à elle. La neige n’entend rien à nos nécessités. Je voudrais crier. Je voudrais retenir mon père par la manche comme pour mieux retenir ce cri dont je parle et qui n’a rien à ajouter. Mes mains tremblent presque maintenant. Je voudrais tout arrêter. La présence n’est pas un jeu durable ni jouable seul. La présence est un jeu, comme à la roulette, qui n’a aucune conséquence. Que des causes inavouables. On joue pour des causes inavouables, et toujours avec d’autres, bien que seul finalement. On joue son existence, son argent, sa chance. On joue sans cesse à regagner ce qui est définitivement perdu.
Je sais ce qui m’a poussé à venir ici, je sens que c’est mon incapacité à être. Je lui dis : Tu vois, je suis comme toi. Je suis là sans être là ; j’y ai seulement cru. Il répond que nous sommes encore là, tous deux, l’un avec l’autre. Il me dit que nous sommes là ensemble, l’un près de l’autre comme je le lui ai demandé. Je réponds que nous sommes plutôt séparés, éloignés, déportés l’un de l’autre parce que nous le sommes de nous-mêmes déjà depuis trop longtemps pour qu’il soit possible d’être là, ensemble.
Il fronce les sourcils. Il pense que cela est dû au fait que nous n’avons jamais vécu au quotidien dans le même endroit, avec les mêmes jours, les mêmes nuits depuis l’origine. Que nous n’avons pas pu vivre ensemble des choses au quotidien. J’entends mon père faire le constat de ce manque qui prend dans sa bouche une forme matérielle, pratique. Je l’entends expliquer ce qui ne s’explique pas, et j’écoute dans le vide croître l’étendue de notre aliénation.
Puis, le silence se dépose sur nous comme la terre qui ensevelit les morts. Les paroles de mon père ressemblent aux pétales flétris qui tombent sur la table où nous mangeons le soir. Les pétales que d’un doigt nous poussons vers le bord de la table où nous nous retrouvons alors que nous avons oublié de vivre ensemble.
D’une voix blanche, je dis que j’aimerais avoir un enfant pour lui raconter l’histoire de mon père, pour qu’il sache qu’il vient lui aussi un peu de ce père. Je dis, dans le silence intègre, que j’aimerais avoir un enfant pour lui donner ce que j’ai de meilleur. Et je dis que ce que j’ai de meilleur, c’est ce que j’ai de lui, mon père.
Nous nous couchons tard ce soir-là. Nous attendons de trouver une réponse.
Toute la nuit est blanche, de la même blancheur que ma voix, que les draps froissés. Il s’endort le premier. Je le regarde dormir. Il ne bouge plus, il est inerte. Il est très loin de moi, plus loin que tous les êtres que je ne connais pas. Quand arrive le petit matin, je suis encore en éveil. Je me lève et vais à la fenêtre qu’inondent les clartés troubles du jour naissant. Je me tourne vers lui. Il dort profondément. Je me dis qu’il suffirait d’un geste, d’une tentative, et je comprendrais pourquoi mon père est cet homme qui peut dormir à mes côtés et m’oublier.
Il se lève avant moi et fait très attention à ne pas faire de bruit. Le souci qu’il a en toute circonstance de passer inaperçu rejoint son souci constant de paraître absent ou de montrer qu’en fait, il n’existe pas, qu’on l’a rêvé. Je m’aperçois d’ailleurs que ce sont ses disparitions soudaines, ou son absence, qui lui donnent sa réelle présence au monde. Ainsi, dès qu’il n’est plus là, je pense à lui sans cesse.
Je me lève à mon tour. Il est midi passé. Dorénavant, je ne veux plus faire attention à l’heure. Je veux vivre comme je le décide. Je veux avancer sur les chemins sans jamais plus avoir à me retourner. Je veux vivre avec mon père même s’il n’est plus là. Je veux arpenter en sa compagnie tous les chemins même s’il ne vient pas. Je prends cette résolution de tout quitter qui soit de ce monde-ci. Je veux ne plus rien attendre. Je vais le chercher pour lui annoncer mon départ, car j’ai décidé de partir aujourd’hui alors que la neige a recouvert la terre des hommes.
Je vois ses yeux scintiller d’une étincelle noire. Je ne sais s’il m’écoute ou s’il se soustrait à mes paroles pour qu’elles ne lui reviennent pas. Plus tard. Je regarde ses yeux en parlant. C’est l’abysse de nos vies, je pense. Il ne bouge pas. Je m’approche. Il semble qu’il ne bougera pas, qu’il retiendra son souffle jusqu’au bout. Je ne sais si je dois l’empoigner, le secouer, l’entraîner. Je ne sais si je dois lui dire que ma venue quelque part, c’est son arrêt de mort. Je ne sais si je dois le nommer enfin de ce nom qu’il craint plus que tout.
Mon père ne me retiendra jamais, car chaque jour que j’ai passé avec lui est un jour qui n’a pas eu lieu. Il dit : Si tu as l’occasion de revenir ici, passe me voir.
J’entends toutes sortes de cris. Les cris des enfants que l’on sépare de leurs parents avant de partir vers la mort.
Dans le train, je vois une femme qui pleure. Je lui souris. Je lui dis que le malheur vient de ce que nous ne savons pas pourquoi. Je parle à la femme avec conviction. Je lui dis : Regardez, moi je viens de perdre mon père. Elle s’excuse. Elle dit que cela doit être douloureux, que pour sa part, elle a encore le sien, et que le jour où il mourra, ce sera son plus grand malheur. Je dis que, évidemment, personne n’aime perdre son père mais je lui dis : Vous savez, le plus difficile, c’est de l’avoir perdu depuis toujours.
Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR
Ce texte a fait l’objet d’une première publication dans La NRF (n° 554, juin 2000). Nous en donnons ici une version revue et corrigée.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.