CHRISTIAN MOLINIER s’entretient avec nous sur son parcours d’éditeur et d’écrivain, et nous rappelle, par l’expérience qu’il a eu de l’emprisonnement, que s’il existe quelque part une liberté absolue, ce n’est pas ailleurs qu’en littérature :
1 – Christian, si tu n’as aucun lien de parenté avec ton homonyme professeur de linguistique à l’Université de Toulouse-Le Mirail et chercheur au CNRS, aurais-tu, en revanche, un lien de parenté avec l’artiste Pierre Molinier, originaire du Sud-Ouest ? De quoi les Molinier sont-ils le nom ?
Je me souviens d’avoir écrit à l’auteur de la Grammaire des adverbes pour lui dire combien je regrettais que l’Internet semble m’attribuer son savant ouvrage. Je n’ai pas eu de réponse, mais comme en réalité la confusion se rectifie d’elle-même, j’en suis resté là. Ma relation est tout autre avec Pierre Molinier, qui n’est nullement mon parent lui non plus. Dès la fin de mes études, je me suis intéressé à lui parce que je trouvais qu’en mettant son très grand talent de dessinateur, de peintre et de photographe au service de sa singularité, il avait fait preuve de courage et d’authenticité. Certes, cette singularité, faite d’érotomanie et d’obsessions, inscrivait son œuvre dans un registre étroit et répétitif. Mais au lieu de la dissimuler, comme le font la plupart des hommes, il en avait fait la matière de son travail d’artiste. Pourtant, en ces années lointaines, je n’avais pas une vue claire des sources profondes de mon intérêt pour lui. N’ayant pour ma part, pensais-je, ni talent ni singularité, il me semblait que je n’étais pas vraiment concerné, sinon dans un rêve de création qui ne reposait sur rien. À cette époque, je passais mes journées à lire les œuvres des fondateurs de la sociologie et, dans un petit bureau où entrait une lumière de miel, je me sentais heureux, comme envahi par une joie spinoziste. Toutefois, une existence peut comporter plusieurs dimensions, et certains aspects de ma vie étaient moins harmonieux, ce qui me conduisit, au bout de quelques années moralement usantes, à une idée inadéquate qui eut des conséquences graves. Mais nous reviendrons là-dessus. Puisque tu me poses la question, je précise que, dans le pays d’Oc, le nom de Molinier désigne, je crois, celui qui possède un moulin à huile. Or il se trouve que dans mon enfance, j’ai eu l’occasion de visiter la fabrique d’huile d’olive d’un parent. Les olives écrasées répandaient une odeur âcre, lourde, qui emplissait tout l’espace. Ma conscience d’enfant comprenait ce qu’il y avait d’antique et de bénéfique dans cette activité, au point que par la suite j’ai souvent regretté de n’être pas devenu fabricant d’huile d’olive. Après avoir appris à choisir les variétés, à déterminer le moment optimal de la maturité des fruits, à utiliser le conditionnement le plus approprié, j’aurais bénéficié d’une utilité sociale incontestable. Bien plus tard, quand j’ai commencé à publier mes textes, je me suis consolé en me disant que, finalement, mon activité consistait à extraire du vécu par première pression à froid une substance fluide appelée prose, ce qui pouvait aussi présenter une certaine utilité sociale, bien que moins évidente.

2 – Cela fait une trentaine d’années que tu es éditeur, proposant un catalogue où s’affichent autant des auteurs classiques tels que Huysmans, Maupassant, Renard, Schopenhauer, Gautier, Pater, Hume, Tolstoï, Svevo, Burckhardt, De Amicis, Stekel que des auteurs français contemporains – mais peu – que sont Jean-Luc Coudray, Stéphane Chavanis, Michel Choromanski, Gilles Moraton, Alain Bouché, toi-même ou encore Michel Sounalet avec son bouleversant Vivre jusqu’à demain. En résumé, une petite quarantaine d’ouvrages, publiés par tes soins uniquement. Peux-tu revenir sur ta démarche éditoriale ? Par quoi a-t-elle été motivée ? Qu’est-ce qui t’a poussé à appeler ta maison du titre de l’une des œuvres de Xénophon, mais également de Saint-John Perse ? Pourquoi ce décalage dans le nombre de titres consacrés aux auteurs classiques et aux contemporains ? Quel souhait avais-tu en devenant éditeur ? Qu’en est-il aujourd’hui : l’édition de textes littéraires a-t-elle encore de l’avenir et une économie ?
À ma sortie de prison, n’étant plus capable d’enseigner, n’ayant plus envie d’ailleurs d’adresser la parole à quiconque, ayant un bagage universitaire en loques, j’ai suivi un stage de formation aux métiers de l’édition. C’est ainsi que, avec la plus parfaite inconscience, j’ai créé l’Anabase. Dans le récit de Xénophon, ce mot, qui signifie en grec « la remontée », désigne le parcours de dix mille mercenaires grecs depuis le cœur de l’Asie Mineure jusqu’à la mer, d’où ils pourront rentrer chez eux. Il m’a semblé que moi aussi j’avais besoin d’effectuer une remontée, vers quoi exactement, cela restait indistinct car je savais pertinemment que je ne pourrais plus jamais rentrer chez moi, c’est-à-dire retrouver ma vie antérieure. Ce qui pouvait justifier un projet d’édition tenait à une observation simple : il existait un certain nombre de textes d’auteurs importants que la pratique éditoriale négligeait. Et, comme je devais m’en apercevoir assez vite, il existait aussi, par exemple en la personne de Jean-Luc Coudray, des auteurs de grande valeur que le monde de la critique ignorait avec obstination. Bien entendu, à considérer les choses du point de vue de la rentabilité, ce genre d’enthousiasme conduisait nécessairement à la catastrophe. Quand je me retourne vers ce temps lointain, quand je revois les petits et moyens éditeurs de cette époque que j’ai pu fréquenter, quand j’entends par-delà les années leurs propos assurés, suivis quelques années plus tard d’une inéluctable déconfiture, je peux faire le compte des illusions perdues, des énergies gaspillées, des fonds dilapidés. Si j’ai échappé à ce jeu de massacre, cela tient à mon choix de rester petit, microscopique même, ayant pour seul principe éditorial : « Fais ce que voudras », et, bien sûr, cela tenait aussi au fait que j’assurais ma sécurité matérielle en traduisant de gros ouvrages américains.
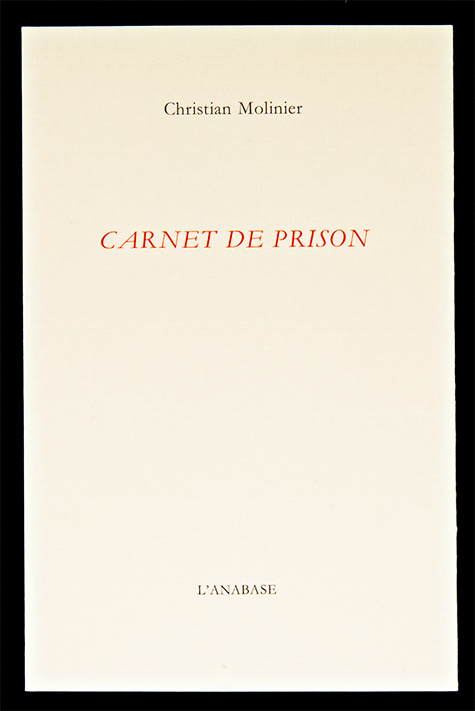
3 – Quel est ton parcours et quelles sont les œuvres de la littérature, françaises comme traduites, qui ont été déterminantes pour toi ? Nous savons que tu lis beaucoup et nous connaissons ta sensibilité proustienne… Comment envisages-tu la lecture dans ton quotidien ? En quoi dirais-tu que la pratique de la lecture est plus nécessaire que n’importe quoi d’autre, et plus que jamais, peut-être que l’écriture elle-même ?
S’il est vrai que, comme le dit La Rochefoucauld : « Il est plus nécessaire d’étudier les hommes que les livres », il est vrai aussi que les livres aident grandement à connaître les hommes. Pendant la plus grande partie de ma vie, j’ai étudié des textes de sciences humaines ou de philosophie dans la journée et le soir je lisais de la littérature. Par la suite, les deux types de lecture se sont partagé mon temps avec un peu plus de liberté, selon l’humeur, selon la fatigue. En littérature, ce sont surtout les œuvres à caractère autobiographique qui m’ont intéressé, le saint Augustin des Confessions, Rousseau, le Stendhal de la Vie de Henry Brulard et des Souvenirs d’égotisme, le Flaubert de L’Éducation sentimentale, Jean Santeuil et surtout La Conscience de Zeno, puis, pour une période plus récente, Le Schizo et les langues, parmi bien d’autres livres de la même veine. La question était : comment un auteur peut-il rendre compte de sa propre vie ? Comment peut-il dépasser sa subjectivité ? Quelle distance parvient-il à établir en lui-même pour se décrire comme un autre ? En quoi consiste cette mise à distance ? Quelles sont, comme aurait dit Kant, ses conditions de possibilité ? Toutes ces lectures, et les réflexions qui les ont accompagnées, ont participé à la substance de ma vie. Souvent, j’ai souhaité que le temps s’arrête pour que je puisse lire le livre sans discontinuer jusqu’à sa dernière ligne. Toute lecture est une relation humaine, une cohabitation avec l’auteur placée sous le signe de l’attention, du respect, de l’affection, et c’est ainsi que, pour chacune des lectures citées plus haut, une relation personnelle s’est tissée avec les auteurs, comme si je les avais connus et fréquentés. J’aurais aimé leur écrire, malgré leur éloignement dans le temps. Je ne l’ai pas fait. Peut-être ai-je eu tort, en dépit de l’incongruité d’une telle correspondance. Je n’ai écrit qu’à Louis Wolfson, dont j’ai pu mesurer l’immense souffrance. Toutefois, je partage l’avis de Proust dans Journées de lecture. Il y a une forme de paresse dans la lecture, de timidité, peut-être de renoncement. Le véritable accomplissement se situe dans l’écriture. Encore faut-il expliquer ce que l’on entend par là. Pour moi, l’écriture est avant tout une description qui, dans son effort de formulation, conduit à une élucidation. Là résident sa valeur irremplaçable et le principal plaisir qu’elle donne car elle est concomitante d’un progrès personnel. Progrès dans l’usage affiné de la langue, progrès dans la sincérité, progrès dans la précision et l’approfondissement, c’est-à-dire dans l’effort pour écarter l’approximation, le convenu, le faux-semblant, l’illusoire. En même temps cet exercice nous apprend que toute prose recèle une musique qui vient des profondeurs de la personnalité, il faut savoir la reconnaître et la laisser déployer sa mélodie. Bien que je sois content lorsqu’un lecteur me dit qu’il a apprécié tel ou tel de mes livres, je sais que l’essentiel est ailleurs, dans l’effort personnel pour mieux percevoir la vie.

4 – De toi en tant qu’auteur, nous connaissons huit titres qui commencent avec Un séjour à Fresnes (1992, rééd. 2011), La Montre (2009) et Quand justice n’est pas faite (2010) pour aboutir à Carnet de prison (2017) tout en passant par Six jours à Capri (sur Malaparte et Munthe, 2014), mais aussi par L’Homme aux rubans noirs (2015, sur Sébastien Bourdon). Ton travail se présente donc sous la forme de récits personnels – il ne serait, pour autant, pas question de les considérer comme de l’autofiction – et traitent, en grande partie, de l’épreuve de ta condamnation, de ton incarcération et de tes rapports avec la justice. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi de rendre compte par l’écriture de cette épreuve ? Aurais-tu écrit si tu ne l’avais pas vécue ? Pour toi, l’écriture est-elle réparatrice ou simplement inévitable, quand bien même elle ne cesse de raviver ton passé ? Dirais-tu que l’écriture est un moyen de réparer le passé, le monde, sa vie, son avenir, les autres, etc., dans le sens où l’on parle aujourd’hui d’une littérature « réparatrice », tel qu’en rend compte l’essai d’Alexandre Gefen (Réparer le monde : la littérature française face au XXIe siècle, Corti, 2017) ?
Lorsqu’on moisit pendant plusieurs années dans une cellule de maison d’arrêt, surviennent des moments où l’on n’aperçoit plus le terme de l’épreuve car le temps circulaire de la prison crée ce qu’on pourrait appeler un effet d’éternité. Le temps tourne en rond comme un vortex. Alors il faut se raccrocher à quelque chose. Pour moi ce fut : « Je dois rester en vie pour rendre compte de ce que j’ai vu. » Car ce que je vivais était suffisamment singulier pour justifier l’écriture. Alors on peut expliquer le désir d’écrire comme la volonté de se libérer d’un traumatisme, de réparer un passé disloqué. Je ne voyais pas cela ainsi. Percevoir de l’intérieur le monde de la justice et de la prison permet d’en saisir la face cachée, la face soigneusement dissimulée : le trucage de la procédure judiciaire, la fausse dignité des magistrats, ce qu’il faut bien appeler leurs crimes, car certaines de leurs décisions se traduisent par des suicides ou des années perdues derrière les barreaux, leur mépris de la procédure légale. En ce qui concerne la maison d’arrêt, il me paraissait important de montrer cet univers clos, étroit, totalitaire, concentré de bêtise et de misère, ce monde inversé, imprégné de vice, de privation affective et traversé par l’alcoolisme et la folie. Si je regrette de n’avoir pas bénéficié d’une notoriété plus grande en tant qu’auteur, c’est uniquement parce que j’aurais aimé qu’un plus grand nombre de lecteurs prennent connaissance de cette réalité-là.
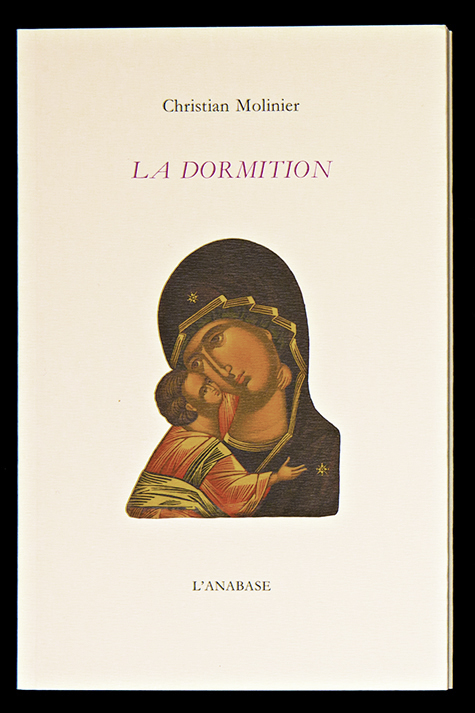
5 – Dans La Dormition (2016), tu évoques un frère disparu dont les relations « quasi inexistantes » avec toi sont le prétexte de rencontres avec ceux qui l’ont connu durant sa vie de prêtre, mais aussi de ce livre en question où tu dresses un portrait de ton frère te permettant d’en conserver un souvenir différent, c’est-à-dire « plus vivant et plus juste », que celui que tu entretenais jusqu’alors. Tu écris aussi : « À la fin du dîner, Béatrice m’apporte quelques objets ayant appartenu à mon frère […] Je choisis de prendre l’icône dans l’intention de la remettre à ma mère. Je ne veux pas que par ces objets, mon frère s’installe post mortem dans mon existence. Le moulin à café, la photo, c’est la famille. Mais ce qui lui était personnel, non. » En quoi ce qui se rapporte à la « famille » en général te semble moins lourd et douloureux à supporter que ce qui est directement lié à l’un de ses membres en particulier, dût-il pourtant être si peu présent dans ta propre vie ?
Il est banal de remarquer que l’intérieur d’un appartement est un lieu intime, consubstantiel à la personnalité de celui qui y habite. Un objet, une photo non désirés y introduisent une perturbation. Bien que j’aie fait un pas vers mon frère après sa mort, je n’ai toujours aucune affinité avec lui et je ne souhaite pas avoir chez moi quoi que ce soit qui rappelle son souvenir. La configuration de ma famille et l’expérience que j’en ai eue ne m’ont jamais disposé à leur accorder une place dans ma vie, bien que la plupart de ses membres se soient montrés bienveillants envers moi, et même plus que cela à l’occasion. Mais il y avait une différence de nature entre nous. Toutefois, avec le temps, et comme ils sont tous morts, je suis devenu plus indulgent et je leur ai pardonné leur incompréhension. Tel objet ayant appartenu à mon père ou à ma mère marque un moment dans mon parcours de vie, alors pourquoi ne pas le placer dans un coin de la bibliothèque, à condition qu’il y demeure avec la discrétion et l’innocuité des vieilles choses.
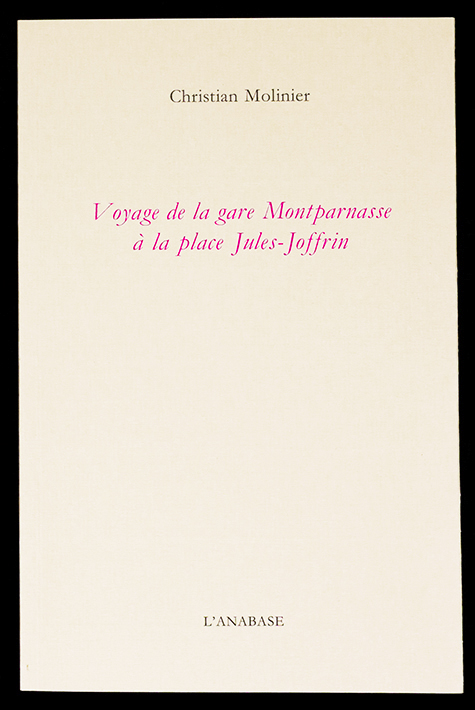
6 – Avec Voyage de la gare Montparnasse à la place Jules-Joffrin (2016), nous sommes embarqués dans une véritable psychogéographie entre le 14e et le 18e arrondissement, une déambulation que n’aurait certainement pas reniée un certain Guy Debord. Tu y parles toutefois d’un voyage dans le temps plus que dans l’espace. Peux-tu nous retracer cette aventure purement parisienne et ce geste d’écriture absolument « situ » ? L’esprit « situ » t’a-t-il influencé d’une manière ou d’une autre ? Compte-t-il pour toi comme mouvement, que ce soit pour les œuvres qu’il a produites ou les idées qu’il a générées ? Quelle importance accordes-tu encore aujourd’hui à Paris et à sa banlieue où tu résides en partie ? La littérature te semble-t-elle y avoir toujours une influence ou n’y figure-t-elle plus que comme un élément décoratif et divertissant ?
Dès l’origine, vers 1967, j’ai trouvé l’idée de psychogéographie particulièrement pertinente, et j’en éprouve la vérité chaque fois que je me déplace. D’une façon générale, le mouvement situationniste m’intéressait. L’opuscule De la misère en milieu étudiant me semblait bien rendre compte du mépris dont les étudiants étaient l’objet de la part des instances universitaires, administratives et politiques. Enfin, l’idée de « société du spectacle », reçue d’abord avec perplexité, a progressivement démontré sa validité. J’aimais également le style XVIIe siècle de Guy Debord, parce qu’il comportait, dans le prolongement du cardinal de Retz, une dimension aristocratique. Il invitait à une certaine tenue, à une distance de bon aloi, et il engageait à aller vers ce que chacun peut apporter de meilleur. Le destin ultérieur de Debord, son jeu des exclusions aboutissant à la mise en valeur de sa propre personne, m’a déçu. Je crois que son drame a été de sentir son incapacité à créer. Il pouvait imiter, il pouvait de manière fructueuse s’inspirer de tel ou tel, par exemple d’Henri Lefebvre, il pouvait provoquer, il pouvait inventer des insultes pittoresques, mais la création véritable restait hors de sa portée. Toutefois, le sentiment de libération ressenti à la lecture de ses livres demeure un précieux moment. Sa pensée suivait une voie que je trouve juste, celle d’une critique de la vie quotidienne reposant sur notre condition culturelle. Les forces dominantes de la société voulaient nous imposer, afin de servir leurs intérêts, un certain type d’existence et même de personnalité qui nous semblait correspondre à une insupportable réduction de l’être humain. À la même époque, des groupes communistes, trotskistes, maoïstes ou gauchistes faisaient beaucoup de bruit en ressassant de vieilles formules. Par leur froideur, leur intolérance, leur aveuglement et leur volonté obtuse de destruction, ils faisaient penser aux Démons de Dostoïevski. Je me souviens, dans l’un de ces groupes, d’un garçon au pâle et fin visage, un étudiant travailleur, intelligent, engagé fanatiquement dans la lutte contre le capitalisme. Les années ont passé, je l’ai revu, affadi, épaissi, sénateur socialiste. Il y aurait beaucoup à écrire sur le Paris d’aujourd’hui et sur sa banlieue. Mais je ne me sens pas qualifié pour le faire, je songe plutôt à les fuir. Pour dire mon sentiment profond, Paris me semble à la fois le centre de la beauté la plus raffinée, un genre de beauté associé à une vieille civilisation, et un lieu qui porte atteinte à la sensibilité. Il y a le grondement sourd de la ville, comme celui d’un monstre assoupi, il y a ces grincements stridents, ces bruits rageurs, ces sirènes, la brutalité mécanique de la circulation, et puis il y a ces visages marqués par l’égoïsme et la fatigue. Quant à la banlieue, le hasard m’a conduit à Montreuil voici quelques années. J’ai eu du mal à m’en remettre. Pourtant, dans tout cela, il y a une logique, comme il y en a une dans la folie. Mais peut-on encore essayer de la dire ? Est-ce permis ?
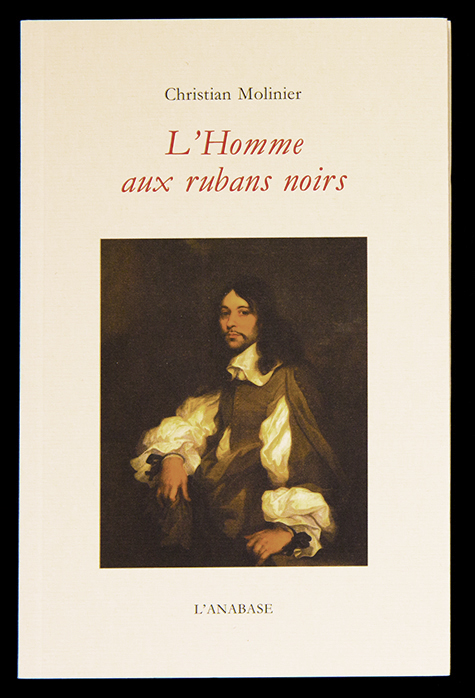
7 – Une dernière question : que penses-tu de cette « communauté inavouable » qui lie politiquement, intellectuellement et amicalement des auteurs entre eux, à la manière dont l’évoque Maurice Blanchot dans son essai. Estimes-tu possible, aujourd’hui, que de telles communautés ressurgissent et permettent à la pensée, à la création, et surtout à la littérature, d’ouvrir de nouvelles perspectives humanistes dans nos sociétés ?
En étudiant les auteurs du 19e et du 20e siècle, j’ai constaté qu’ils étaient, grâce aux salons, grâce aux enterrements, grâce à la vie même de l’édition, en relation les uns avec les autres. Il me semble que cela n’existe plus aujourd’hui, ou plus de la même façon. Trouve-t-on encore des relations semblables à celles de Gautier et de Balzac ou à celles de Gide et de Valéry ? Aujourd’hui l’écrivain paraît limité à son propre parcours, sauf à participer soit au journalisme, soit au spectacle médiatique. Deux voies de la perdition. Au fond, il s’inscrit dans les conditions générales de la vie sociale, caractérisées par une forme d’atomisation. Mais d’un autre côté, l’écriture s’est en quelque sorte généralisée. Beaucoup y trouvent un accomplissement salutaire dans un monde où, comme le dit Tocqueville, chacun est enfermé dans sa subjectivité. Cela donne des manuscrits envoyés avec un espoir déraisonnable aux maisons d’édition. Le plus souvent, ces textes sont à la fois intéressants et imparfaits. Mais comme les maisons d’édition publient souvent des livres de valeur moyenne, les auteurs inconnus se disent : pourquoi pas moi ? Il serait évidemment ridicule de prétendre formuler un jugement sur la littérature contemporaine, qui a pris une dimension industrielle par la rapidité et l’extension de sa production. Parmi les livres d’aujourd’hui, certains me plaisent beaucoup. Ce ne sont pas les plus connus. D’autres me semblent atteints d’obésité. Leur prose se déverse sans retenue. Ou bien l’auteur adopte ce style pseudo-américain, factuel, au ras du vécu, qui endort l’intelligence. Enfin, une tendance récente conduit certains auteurs à faire penser et parler des personnages historiques comme s’ils avaient eu accès à leur cerveau. N’y a-t-il pas là une forme d’imposture ? Pour revenir à ta question, il serait bien sûr agréable de rencontrer d’autres auteurs. Cela m’est arrivé parfois, presque par accident. Et il est vrai que, en refermant le dernier livre d’un auteur croisé ici ou là, s’esquisse parfois un sentiment d’amitié. Lui aussi a essayé de comprendre.
Entretien © Christian Molinier & D-Fiction – Illustrations © DR
(Rambouillet-Montpellier, fév. mars 2018)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
