BÉATRICE COMMENGÉ s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son nouveau livre, ALGER, RUE DES BANANIERS (Verdier, 2020) :
1 – Béatrice, ton nouveau livre, qui se présente comme une traversée existentielle, a pour trait commun avec certains de tes précédents le thème du voyage, mais ici d’un voyage plus intérieur qu’il n’y paraît puisqu’il est question d’un voyage à travers les livres que ton père a accumulés par centaines durant toute sa vie, à travers les souvenirs de ton enfance, mais aussi à travers cette « petite » histoire de celles et de ceux que tu évoques, et qui se mêle à la « grande » histoire. Peux-tu revenir pour nous sur l’idée de ce livre et de son enjeu d’écriture pour toi puisqu’il s’agit d’un ouvrage où tu assumes ton attachement pour un pays et son histoire donc, au moment même de son effondrement politique : l’Algérie française ?
Le déclencheur fut une double prise de conscience : celle, avant tout, qu’il était possible, après soixante ans d’indépendance de l’Algérie, de porter, sur cette période de « l’Algérie française », le même regard distancié que l’on porterait sur le destin d’un homme. Elle était née, avait vécu, était morte. Sa vie avait duré cent-trente-deux ans – ce qui m’apparut soudain très bref. Et, au cœur de cette brièveté, venaient se loger les destins de quelques uns de mes ancêtres, ainsi que ma propre enfance. J’ai alors décidé de franchir le pas et de tenter de plonger au cœur de cette double histoire. Le défi était d’éviter à tout prix les prises de position idéologiques et de me concentrer sur le réel des « lieux » et des « moments », c’est-à-dire d’avancer dans la grande histoire comme dans une suite de « tableaux » vivants – d’où l’importance donnée aux couleurs, aussi bien dans leurs contrastes que dans leurs harmonies. Le premier exemple me fut offert par ce « triangle blanc » qui frappait – et enchantait- tous les visiteurs – et plus spécialement les artistes, peintres et écrivains – qui eurent très vite envie de fouler le sol de cette « deuxième France ». Ce blanc, contrastant, naturellement, avec les bleus mouvants de la mer – une mer que je ne pouvais m’empêcher d’imaginer brassant les chairs et le sang des centaines de victimes, parties à la conquête des richesses de cette côte africaine, depuis les attaques menées par Charles Quint, Louis XIV et autres pirates. Je souhaitais donner une image concrète de cette terre convoitée depuis des siècles en isolant ce petit morceau d’espace sur lequel j’allais naître.
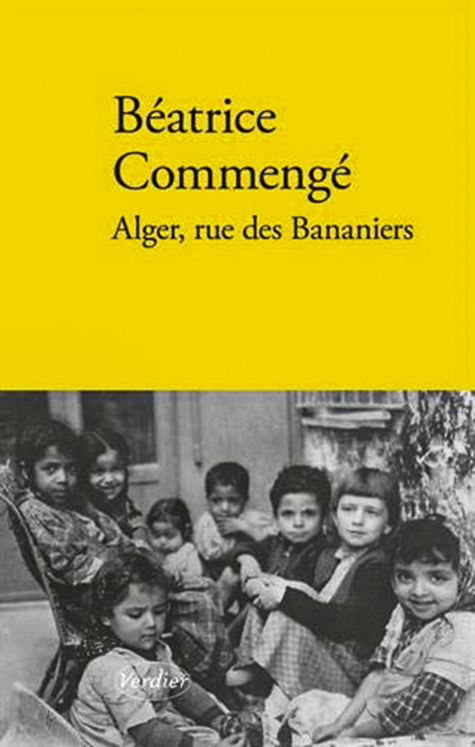
2 – Tu reviens donc tout au long de ce livre à ce qui te rattache à l’histoire de l’Algérie au moment de sa période « française », pays où tu es née et où tu as vécu jusqu’à l’âge de 12 ans. Or, cette Algérie dite « française » se situe entre 1830 et 1962 et ta naissance a eu lieu en 1949. En quoi, comment et pourquoi l’histoire de ce pays qui précède celle de ta naissance t’a-t-elle à ce point marquée ? Ton sentiment pour ce pays et son histoire, tant vécue que non vécue, sinon à travers celle de tes grands-parents et de tes parents, est-il une sorte de mélancolie, à la manière dont Flaubert soulignait que « la mélancolie elle-même n’est qu’un souvenir qui s’ignore » (lettre à Louise Colet, 13 septembre 1852) ?
J’aime beaucoup cette remarque de Flaubert mais, dans le cas présent, je ne souhaiterais pas que se dégage la moindre mélancolie, si ce n’est cette sorte de « nostalgie », mais une nostalgie « heureuse » que l’on peut éprouver pour tout ce qui ne sera « plus jamais ». Quant à l’intérêt que je porte à ceux qi m’ont précédée, je crois que son explication se trouve tout entière contenue dans un des exergues que j’ai choisis : « Les générations mortes pèsent sur le cerveau des vivants »… qu’on le veuille ou non, qu’on y pense ou pas. C’est en ce sens que j’ai souhaité m’approcher de ces vies qui m’ont précédée, et plus particulièrement, j’ai recherché ce qui avait pu conduire mon arrière-arrière-grand-mère maternelle, une certaine Jeanne Martres, à traverser la mer en 1864. Mes recherches dans les archives m’ont appris qu’elle était née en 1830 dans un petit village de Haute-Garonne, et qu’elle s’était retrouvée sans parents ni mari à trente ans. Qu’est-ce qui l’a poussée à partir ? Je ne le saurai jamais, et cette ignorance même m’intéresse. Ce geste du départ, dont j’ignorerai toujours la cause, est l’un des maillons qui conduit jusqu’à ma naissance.

3 – Samuel Ferdinand-Lop aimait à dire, pour sa part, que « le culte du souvenir, c’est le respect de l’Histoire ». C’est en ce sens que ton livre œuvre. Il est un point de vue romanesque et personnel, mais rend parfaitement compte de son évolution historique, de ses « nœuds », de ses rebondissements, de ses tragédies et de ses évènements sociaux, en réussissant la gageure de rappeler toute la richesse du pan culturel et humain de celle-ci et dont, d’habitude, on ne se préoccupe pas, ou l’on n’ose se préoccuper de peur de soulever un débat sans fin. Sans devoir faire donc débat ici puisqu’il n’est pas de notre ressort de le faire, ni même revenir sur les atrocités de la guerre d’Algérie et sur les raisons pertinentes ou fallacieuses de la présence française en Afrique du Nord, il est toutefois intéressant de noter tel que le rappelle l’historien Jean Sévillia que « le terme d’Algérie est lui-même une création française. Il apparaît pour la première fois en 1838, sous le règne de Louis-Philippe, dans une instruction du ministère de la Guerre ». Ainsi, tu évoques dans ton livre un sentiment que beaucoup dans les cultural studies jugeraient à ce jour inentendable, sinon politiquement incorrect : « « En 1830, les Français commencent la conquête de l’Algérie. Le général Bugeaud, commandant les soldats français est vainqueur du chef arabe Abd el-Kader ». Ce sont des faits. Des faits historiques. On ne les commente pas. On les apprend aux enfants. Les enfants respectent les vainqueurs. J’aimais ma maison, ma rue, mon école, ma ville. J’étais heureuse que Bugeaud ait gagné. Sans lui, je ne serais pas ici ». Toutefois, de nombreuses études menées à ce jour sur la présence française en Algérie dévoilent une réalité que l’on peut objectivement qualifier de problématique au bas mot, avec une société à deux vitesses, l’algérien musulman étant considéré non pas comme un citoyen à part entière, mais bien juste un indigène de seconde zone, la colonisation permettant d’instaurer, de surcroît, « un grand safari sexuel » comme a pu le montrer l’historien Pascal Blanchard. Concernant cette guerre sans nom, tu écris d’ailleurs : « En France, à la télévision, de Gaulle a promis que 1962 verrait « l’aboutissement d’un drame cruel » en Algérie. Ainsi, nous n’avons jamais été « en guerre ». Nous avons seulement compté les morts. Cette dernière année : mille six cents Européens, treize mille musulmans ». Estimes-tu donc possible, un jour, une « paix » et une entente entre la France et l’Algérie à l’heure où cette dernière attend toujours nos « excuses » ? Les écrivains algériens comme français peuvent-ils faire bouger les lignes ? La littérature a-t-elle un quelconque pouvoir pour une prise de conscience réciproque ? Ses récits, comme le tien, ou encore celui de Claro publié en mars dernier, peuvent-ils représenter une forme de réparation, de réconciliation, de pardon, de compréhension mutuelle, de paix intellectuelle et morale, surtout entre les peuples et leurs historiens ?
Merci de tous ces rappels fort opportuns. Si j’ai cité ce livre d’histoire pour enfants, c’est avec toute l’ironie requise. Je voulais rappeler, noir sur blanc, ce qu’on apprenait aux enfants de six ans sans le moindre commentaire explicatif. Ces données, apprises et répétées, s’impriment dans les jeunes cerveaux et rares sont ceux qui, plus tard, tentent d’en savoir davantage. Dans mon cas personnel, les « événements » (comme on les appelait, refusant d’utiliser le mot « guerre ») ont éclaté à l’âge où j’apprenais à parler – sinon à penser… Ce que j’ai souhaité restituer ici, en tentant m’immerger au plus près des sensations d’une enfant plus curieuse de son environnement immédiat que de l’affrontement terrible qui se joue autour d’elle, c’est justement ce réel des journées – de mes journées – vécues dans un cadre où le hasard m’avait plantée, cette Rue des Bananiers, où se côtoyaient plusieurs communautés – ce qui fut ma chance… chance accrue par la liberté que m’accordaient mes parents. Tout souvenir est, forcément, une re-création, mais celle-ci, dans la mesure où elle se limite scrupuleusement à restituer des images demeurées imprimées dans le cerveau, répond, je l’espère à ce « respect de l’Histoire » dont parle Ferdinand Lope. Quant à la deuxième partie de ta question, cet espoir d’une « entente » possible entre les deux rives et les deux pays, on essaie de la résoudre depuis plus de soixante ans et je crois, foncièrement, qu’elle ne pourra pas se réaliser avec des excuses, qui ne font que nourrir le ressentiment. Or, la nietzschéenne que je suis, connaît tous les dangers du ressentiment. Le temps qui passe fait son œuvre, évidemment, et les survivants de « l’Algérie française » commencent à se faire rares. Mais cela ne suffit pas. Ce qui serait souhaitable, c’est que l’on parvienne à considérer cette « occupation » du territoire comme un moment de l’Histoire, une sorte de queue de comète d’une longue période de colonisations commencée avec Christophe Colomb, ou presque…

4 – L’exil, puisqu’il en s’agit d’un pour toi qui a quitté cette France d’Afrique du Nord pour une France continentale que tu n’as finalement jamais considérée comme étant ta « Terre-Mère » (dirait elle-même Ursula Le Guin), l’exil donc, comme notion, comme douleur, est-il cette faille originelle de l’écriture chez toi ? N’es-tu jamais retournée vivre un temps à Alger ? As-tu eu l’espoir d’un retour là-bas ?
« Exil », plus encore que « nostalgie », est justement une notion qui m’est absolument étrangère. Si, en effet, ce départ définitif m’a rendue « apatride » en quelque sorte, j’ai toujours considéré cela comme un « plus ». Le pays où j’ai grandi n’existe plus et, si j’ai eu envie de le revoir, une fois, à l’âge de trente ans, c’était avec une sorte de curiosité enfantine : je voulais revoir les lieux, les rues, les trottoirs, les arbres, les détails des maisons et ce voyage avait été sans douleur. J’étais, je m’en souviens, en train d’écrire mon premier manuscrit, et peut-être est-ce là qu’est née mon obsession des lieux, comme si, de la vie d’un homme, on ne pouvait espérer le « reconnaître » qu’en le suivant « à la trace »… ce que j’ai fait pour Nietzsche, Miller, Rilke, Durrell ou Modiano, etc. Suivre un corps dans l’espace m’a toujours fascinée. Que je le veuille ou non, que je le ressente ou non, ma « terre-mère » (si tant est que je comprenne cette expression), c’est la France, et il ne faut pas oublier que pendant cette période de mon enfance, l’Algérie « c’était la France », Alger était le 91e département français. Je ne saurai jamais si cette rupture, cette « faille » fut le déclencheur de l’écriture, je crois plutôt que seule présence la bibliothèque de mon père a joué un plus grand rôle. D’abord, en m’écartant de la lecture : elle était trop envahissante, et peut-être trop intimidante, pour que j’aie envie de vraiment lire… mais l’inconscient faisait son œuvre. Quant à y retourner aujourd’hui en Algérie, j’ai beaucoup de mal répondre à cette question. Ce n’est ni un « surtout pas » définitif, ni un « oui » de curiosité. Je le répète, le pays que j’ai connu n’existe plus.

5 – Au-delà de ton écriture toujours fluide, évocatrice, presque parfumée des lieux et de cette terre, ton livre est une véritable prouesse psychogéographique qu’un Guy Debord aurait sans doute appréciée. Ainsi, tout part dans ton récit de la rue des Bananiers : « « La Villa » existait encore en ces années où l’histoire de la France et la conquête de l’Algérie nous étaient résumées en trois lignes par la maîtresse de l’école Au soleil, au bout de la rue des Bananiers ». Cette rue est effectivement le prétexte d’une déambulation algéroise à couper le souffle faisant de ton livre un guide bleu sous forme romanesque : tout y est consigné, décrit, analysé à la perfection jusqu’aux souvenirs qui sont les tiens et qui deviennent peu à peu ceux du lecteur tant ils ont la force du récit qui est celui de la littérature française dans ce qu’elle a de meilleure : l’ambition de l’écriture de soi comme œuvre artistique et non pas comme autofiction, c’est-à-dire l’ambition du style et de la pensée. Parle-nous de ton rapport à l’écriture et aux écrivains. Tu as toujours eu le souci d’inscrire tes livres – essais ou romans – dans la littérature, faisant entrer sa langue, ses auteurs, ses œuvres, sa propre histoire, dans tes ouvrages. Quelle est pour toi l’importance d’écrire et de faire œuvre en s’inscrivant et en se réclamant de la littérature elle-même ? Mais aussi, comment as-tu mis en oeuvre cette déambulation dans Alger au-delà de l’aide d’anciens ouvrages, de vieilles cartes, des photographies d’époque, et de tes souvenirs ?
Merci de cette analyse et, si je suis parvenue à cette « prouesse », j’en serais ravie… En effet, la littérature, pour moi, ce n’est pas simplement « se raconter », ou « raconter une histoire ». Je dirais qu’il y a trois points fondamentaux, il me semble, dont je tente de ne pas m’éloigner : être au plus près de la sensation (et non du sentiment), s’efforcer de penser en rythme et ne pas oublier la « bibliothèque » – qui, comme les « générations mortes » dont je parlais plus haut, devrait toujours peser (avec bonheur ! ) sur le cerveau des vivants. Quant à la « déambulation » elle-même, c’est justement en tâchant de m’inscrire au cœur même de mes sensations d’enfant que j’ai voulu avancer, à partir des lieux mêmes du souvenir. J’ai toujours imaginé le livre comme une suite de tableaux – au sens le plus concret du terme – de « choses vues », ressenties en un lieu précis. Et de même pour les événements historiques, je ne peux que répéter ce que j’ai tenté d’exprimer plus haut : de mes recherches, j’ai voulu retenir des « images ». C’est pourquoi, j’ai traqué dans les livres d’histoires et dans les journaux intimes, les descriptions détaillées de batailles et autres massacres, laissant de côté les analyses historiques.

6 – Ce livre est également un bel hommage à ton père, et surtout à sa bibliothèque. Borges déclarait ainsi : « Me sera-t-il permis de répéter que la bibliothèque de mon père a été le fait capital de ma vie ? La vérité est que je n’en suis jamais sorti ». Est-ce ton cas ? Comment le vis-tu à l’heure de la digitalisation du monde, de la destruction du « goût », de la mise au rancart des œuvres littéraires pour le storytelling, la fiction « testimoniale », et les mièvreries du feel good book qui sont à la littérature ce qu’est le glyphosate à l’alimentation, à savoir un poison indétectable, mais mortel pour l’intellect, la pensée critique, la santé mentale, et finalement pour l’imaginaire, l’art, le rêve, la beauté, l’intelligence ? Penses-tu que la littérature sortira indemne de cette époque obscurantiste comme elle su survivre aux précédentes, et que in fine, elle restera le meilleur moyen d’émancipation, d’évolution et de formation pour un être humain ?
Je partage malheureusement ton analyse du présent de la littérature. J’ai néanmoins l’impression que survivent quelques « sociétés secrètes » de lecteurs et d’écrivains et que, grâce à elles, se transmettra non seulement ce goût, mais ce besoin d’une vraie pensée, et d’une approche poétique du monde. Mais la résistance sera difficile, à moins qu’avec quelques degrés de plus sur la Terre, tout cet édifice, au fond si fragile, basé sur des sources d’énergie épuisables et sur une technologie si périssable, bouleverse tout l’ordre des choses. Bref, la vie est courte, l’art est long comme disait le sage. Alors, continuons à « œuvrer » – au singulier, à déposer notre petite pierre.
Texte © Béatrice Commengé & D-Fiction – Illustrations © DR
(Domme, août 2020)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
