GUILLAUME VIRY s’entretient avec BRUNO LECAT à propos de son premier roman : L’APPELÉ (Le Canoë, 2024) :
1 – Guillaume, tu es comédien de théâtre et de cinéma. Tu es également réalisé plusieurs films entre fiction et documentaire. Et c’est durant une résidence à la Fondation Jan Michalski en Suisse que tu as écrit ton premier roman pour lequel j’ai voulu te proposer cet entretien : L’Appelé. Je m’arrêterai d’abord sur son titre que j’entends au sens militaire, celui d’un jeune homme – Jean – « appelé », selon la formule consacrée, « sous les drapeaux », pour aller servir en Algérie en 1962. Voilà pour la cadre historique. Mais l’appelé « Jean » – au sens de celui qui a reçu un prénom – devient l’appelé « Julien », prénom du neveu de Jean, par une confusion du père, Joseph. De sorte que, c’est ce neveu qui entend l’appel car le fils se substitue au frère disparu. Troisième glissement : c’est l’écrivain Guillaume Viry qui prend à son compte cet appel, cette sommation à répondre. Bref, l’article défini « L’ » du titre est investi tour à tour de plusieurs noms. Peut-on dire que tu parles avant tout pour Jean? Cette fiction repose-t-elle sur une réalité familiale ? Et considères-tu, dans ce cas précis, qu’il revient à la littérature ce rôle de parler pour celles et ceux qui en ont été empêchés ?
Le titre a surgi comme une évidence juste une fois le texte terminé. Oui, l’appelé c’est Jean, avant tout Jean. Mais le mot peut effectivement également se déplier. Tous les personnages sont appelés, happés, par l’histoire de Jean, et chacun y répond comme il peut. Jusqu’à moi, oui, appelé, obligé, à écrire le texte. Le point de départ de la mise en mouvement de l’écriture du texte est familial. Un frère de mon père a été appelé en Algérie. Mon père m’en a très peu parlé, me disant seulement que cela ne s’était pas bien passé. Ce peu de paroles de mon père était en même temps toujours extrêmement habité. Ce silence était comme trop plein. Il débordait. Absolument, les vies empêchées me bouleversent. Depuis la vie empêchée d’un enfant par ses parents, aux vies empêchées par un contexte social, politique, religieux. J’entends le mot « empêché » dans le sens de l’impossibilité à dire, à mettre en mots, à faire récit, à tisser, à nommer. Un empêchement à s’extraire d’un espace innommable. Être submergé, acculé, à un tel point que la parole, et donc le désir, ne peut plus se frayer un chemin. Écrire ce texte, c’était faire écho à ce qui ne pouvait cesser de parler, sans jamais avoir pu être dit. Rendre grâce, justice. Pour revenir sur le mot « empêché », je ne peux pas ne pas le retourner : je pense à la fameuse phrase d’Albert Camus : « Non, un homme ça s’empêche. Voilà ce que c’est un homme, ou sinon… ». C’est exactement ce que n’ont pas fait certains militaires de l’armée française en Algérie, s’empêcher du pire.

2 – J’en viens à la forme que tu as adoptée : L’Appelé est un roman. Tu as fait le choix de la fragmentation, qui tisse plusieurs temporalités : le vécu de Jean à Berrouaghia en Algérie, son retour en Haute-Marne, en 1962 ; 1970 et son père Louis, à Saint-Dizier ; 1969 et le séjour de Jean en asile psychiatrique ; les recherches du neveu Julien et la découverte du dossier psychiatrique de son oncle, nous sommes en 1964 ; et cinquante ans après, l’appel téléphonique de Joseph le père, à son fils Julien, qu’il prend pour Jean. En outre, pas de numéro de chapitre, mais de simples astérisques qui délimitent une trentaine d’unités. Enfin, l’absence totale de ponctuation, de majuscules en début de phrases, par ailleurs éclatées. Tout cela concourt à une extrême fluidité, qui n’exclut pas – j’y reviendrai – le ressassement. Dans quelle mesure ces choix formels se sont-ils imposés à toi ? Julien déclare vouloir « donner forme à l’informe ». S’agit-il de cela ?
Longtemps, je n’ai pas trouvé la forme, ni même le moyen, le médium pour raconter cette histoire. Au départ, je pensais en faire un film. Une fiction, un documentaire… Je ne savais pas bien. J’ai écrit des débuts de scénarios. Mais cela ne m’allait pas vraiment. J’ai alors laissé tomber ce projet un moment. Puis, quelque chose s’est imposé à moi, je ne sais pas comment, mais c’est devenu une évidence que le roman était le meilleur endroit pour raconter cette histoire. L’endroit où je pourrais être le plus libre. Ou en tout cas qui me convenait le mieux. Je savais dès le début que je voulais faire entendre la voix-tu de Jean, que c’était là le cœur battant du texte. Mais également les échos de cette voix-tu. Concrètement, c’est ce qui donne lieu à ces sauts temporels. Si j’ai précisé des dates, c’est surtout pour ne pas perdre le lecteur. Parce que, au fond, je raconte un temps arrêté, figé, autour de cette guerre. J’aurais pu aussi bien écrire 1961-Algérie, à chaque début de chapitre, puisque je ne fais que tirer le fils de l’innommable de ces trois mois en Algérie, ce temps arrêté autour de ces trois mois. Plus largement, je n’arrive pas à écrire sans une architecture forte. Des contraintes. Je dois me fixer un cadre fort, pour pouvoir y aller. Je dois voir l’architecture, ce n’est pas une image, véritablement la visualiser comme un dessin, une photographie ; pour pouvoir me lancer dans le langage. D’ailleurs concrètement, je ne passe pas par les mots à ce moment-là, je dessine, je fais des croquis, des gribouillis… Je cherche une image mentale. J’ai d’ailleurs la sensation que l’architecture d’un texte est une photographie, si c’était possible, de la manière dont est structuré l’inconscient de son auteur. Concernant l’absence de ponctuation, de majuscules notamment, c’est arrivé comme ça, sans que je le théorise. Peut-être parce que, une fois l’architecture trouvée, j’écris vite, dans un geste, un souffle. Maintenant, après coup, je me dis que cela participe d’une pensée plus générale que j’éprouve : pourquoi mettre des « choses » dont on peut finalement se passer. Si ponctuation et majuscules ne sont pas absolument nécessaires, pourquoi les garder ? J’en reviens à l’absence. Peut-être que l’écriture n’est que faire des cercles autour de l’absence. Et nombreux sont les absents ! Georges Perec que j’admire, ne parle que de ça. « La disparition » pourrait être le plus merveilleux titre de tous les livres du monde ! J’ai un peu l’impression qu’on n’écrit qu’autour de ça. Enfin, moi… Mon projet est de ne pas écrire dans l’étalement, horizontalement, mais verticalement, en forant, en creusant à partir de peu de mots. Je voudrais écrire sans mot. Je veux dire, les mots ne servent, ne sont intéressants, que pour le silence qu’ils créent. J’enfonce sans doute des portes ouvertes ! C’est dans le silence qu’émerge l’être profond de celui qui écrit. Et donc la rencontre possible avec l’Autre, le lecteur. Le lecteur est l’autre moitié du livre, pour que cette autre moitié existe, il faut lui laisser la place. Être discret. C’est quand même déjà tellement présomptueux cette affaire d’écrire que la moindre des politesses est d’y aller un peu « sur la pointe des pieds », en tout cas de laisser la place à l’Autre.
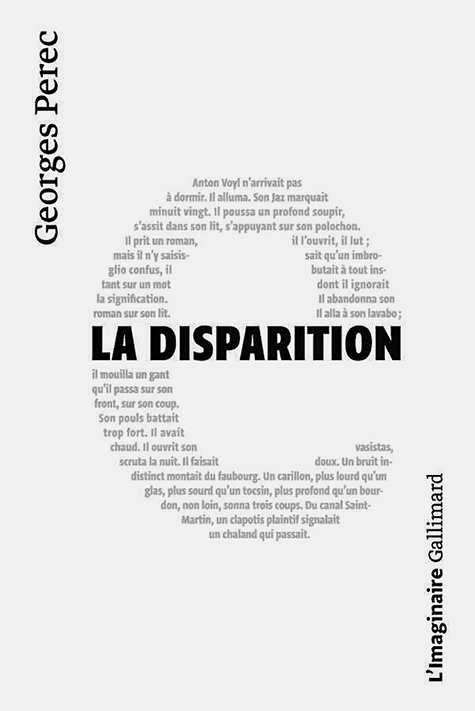
3 – L’un des thèmes essentiels de ton roman est le secret de famille, et la « fiction familiale déposée en [lui, Julien] », fiction du suicide de Jean à son retour d’Algérie, qui des décades durant fera écran à la vérité : Jean est mort à l’asile psychiatrique de Saint-Dizier le 28 mars 1969. Comment appréhendes-tu ce rôle d’une fiction littéraire qui se frotte à une fiction familiale ? En d’autres termes, quand tu écris « quelque chose pousse », s’agit-il du désir de rétablir la vérité des faits, quitte à conférer au couple Jean-Julien une valeur symbolique ? Car l’on sait que la génération des militaires qui ont servi en Algérie s’est imposée et s’est vue imposer le silence, comme le montrent les travaux d’historiens sur cette période.
J’ai l’impression – et c’est seulement aujourd’hui, le livre écrit et publié – que ce ne sont pas des faits que je cherchais. Concrètement, je n’ai pas fait d’enquête, ou très peu. J’ai seulement eu accès au dossier militaire et psychiatrique de mon oncle. Aussi lacunaire que laconique, les deux. Je n’ai fait qu’écrire. Je devais écrire. C’est ce que je cherchais, qu’il y ait une écriture. Tracer des signes sur une page sur laquelle il n’y avait aucune inscription. Écrire une histoire, à la place de rien. Ce qui compte pour moi, c’est que, aujourd’hui, il y ait quelque chose plutôt que rien ; je ne sais pas comment le dire mieux. J’ai finalement remplacé une fiction silencieuse par une fiction avec des mots.

4 – Dans le même esprit, L’Appelé éclaire un aspect sociologique du retour des militaires dans leur foyer : je veux parler de l’attitude de la famille de Jean, ses parents Louis et Jeanne, du déni dans lequel Louis s’est enfermé ; du silence de Joseph, frère de Jean, qui a choisi le silence. L’Appelé est-il aussi la tentative de comprendre, après coup, ce qui a pu se passer dans cette famille ?
C’est avant tout mettre des mots. Comme on plante des arbres. Si tu veux, au départ, c’est une terre aride, un désert, où rien ne pouvait plus pousser. En écrivant ce texte j’ai la sensation d’avoir planté quelques oliviers. Maintenant, ils sont là. Ils existent. Je n’y connais rien en arbres, mais je crois que les oliviers sont presque éternels, ils peuvent vivre jusqu’à 3 000 ans… Comprendre ? Comprendre quoi ? Pour moi, c’est impossible. Je ne peux que questionner. Comment comprendre un homme qui se fissure entièrement ? Comment comprendre ceux qui s’autorisent le pire ? On ne peut que témoigner et questionner. Une question ne renvoie jamais qu’à une question. Autrement, c’est le commencement des pires bêtises.

5 – Jean est témoin d’atrocités commises par son unité : massacres et viols. Ses supérieurs l’obligeront à assister aux tortures à la génératrice, et au meurtre d’un Algérien. La psyché de Jean n’y résistera pas. Pour rendre compte de cette démolition, tu vas utiliser le motif du ressassement, qui fait revivre à Jean les scènes d’horreur ; stylistiquement, tu uses de la répétition (« je ressasse ») ; et structurellement, le lecteur réalise qu’une même date ouvre et ferme le roman, enfermant ainsi la fiction dans une boucle. La forme conventionnelle du récit est abandonnée au profit de versets. Tu brouilles la frontière entre prose et poésie grâce au fréquent retour à la ligne. Comment ce choix s’est-il imposé à toi ? Le Tombeau pour cinq cent mille soldats (1967) de Pierre Guyotat, récit en prose, est découpé en « sept chants ». La guerre d’Algérie (1978) de Franck Venaille fait alterner paragraphes courts sur une page et textes plus longs, et propose une double page où, comme tu l’as fait dans L’Appelé, un texte en prose est brisé en vers par un retour à la ligne. Ce que je souligne ici, c’est la recherche formelle d’auteurs qui dépassent les conventions du récit en prose pour aller vers une liberté poétique. Te reconnais-tu dans ce constat ?
Absolument. J’ai écrit précédemment des scénarios de film, et je m’y suis toujours senti à l’étroit. Le roman, c’est l’endroit de tous les possibles, le lieu où l’on fait ce que l’on veut, notamment parce qu’il n’y a pas les contraintes d’argent d’un scénario à tourner. Dans un scénario, chaque ligne écrite a un coût très concret lors de la production et réalisation du film. Les « romans-romans » m’ennuient assez vite : je veux dire ceux qui reposent sur l’histoire, le sujet. Ce qui m’intéresse, c’est la forme et le style. Céline le disait déjà, rien de neuf : les histoires il y en a plein les rues, mais l’écriture, c’est autre chose ! Quand Charles Juliet écrit Lambeaux (1995), ou justement Perec, W ou le souvenir d’enfance, tout repose sur l’architecture des textes. C’est le génie de leur création d’une forme et évidemment leur style, qui créent l’émotion. Il me semble qu’une politesse quand on écrit, c’est de faire surgir une forme, une architecture et une langue personnelle.

6 – Il est des images qui témoignent de la difficulté du narrateur Julien à répondre à l’appel de son père : celle des « filets de la parole calme du père », mais se détache celle du « fleuve des histoires silencieuses », et d’un narrateur en « pirogue » qui « pagaie » pour « poursuivre dans le pays inconnu ». Est-ce une réminiscence d’Au cœur des ténèbres de Conrad et de la quête de vérité entreprise par le capitaine Marlow ? Si oui, pourquoi Conrad ?
Autant l’avouer : Je n’ai pas lu Au cœur des ténèbres. Il est pourtant dans ma bibliothèque. Je l’ai donc acheté. J’ai beaucoup de livres que je ne lis que des mois, des années après les avoir achetés. Celui de Conrad en fait partie. Repartons sur la pirogue ! Elle est arrivée assez vite. Elle a même été davantage présente au tout début de l’écriture. J’ai dû la calmer un peu ! Je ne voulais pas que Julien prenne une place trop grande. Cela a été un des enjeux de la construction du récit. Que Jean reste au centre et que Julien – le narrateur, s’il on peut dire – ne devienne pas central. C’est une affaire de morale, que Julien reste discret. Oui, l’histoire le concerne, oui c’est par lui qu’elle est racontée, mais il ne devait pas être au centre…
7 – J’ai perçu des échos du Voyage au bout de la nuit quand la famille de Jean veut croire que le bon appétit est la solution, comme « un petit bout d’espoir qui traîne », et là, le narrateur prend le récit en main, explore l’état d’esprit d’un soldat à Berrouaghia, dans une violente décharge scatologique : « Ça lui dégouline de partout mais il se croit toujours bien propret c’est l’avantage qu’on se voit pas devenir une ordure ». La diatribe, à nouveau, est politique, et s’en prend à l’absence d’éthique de certains militaires sur le terrain. Es-tu d’accord pour parler ici d’un clin d’œil à Céline ? Et plus généralement, te nourris-tu de textes déjà écrits sur le sujet : je pense à Des Hommes (2017) de Laurent Mauvignier et à Après la guerre (2014) de Hervé Le Corre, par exemple ?
J’ai écrit ce passage d’un trait, comme tout le texte. Puis, le lendemain de son écriture, j’ai commencé ma journée d’écriture par relire ce que j’avais écrit la veille. Donc, en le relisant, j’ai failli le couper entièrement, parce que je lui ai trouvé des accents céliniens. Ce passage a été longtemps sur la sellette. À cause de l’écho que j’entendais avec Céline. Je l’ai finalement gardé parce que ce n’était pas un clin d’œil conscient, mais parce qu’il est sorti comme ça. Le lien est sans doute aussi « médical ». Je veux dire, Céline comme Joseph sont des médecins. Peut-être aussi que tu en parles parce que c’est un des rares moments où les phrases se déploient, notamment sans retour à la ligne. Je lisais une interview de Jean-Philippe Toussaint où il parle de son écriture. Il dit qu’au début, dans ses premiers textes, notamment La Salle de bain, il ne s’autorisait pas de phrases longues, comme si c’était trop risqué. Puis, au fur et à mesure de ses textes, c’est arrivé. J’entends très bien ce qu’il veut dire. Peut-être que plus tard, je m’autoriserai des phrases plus longues. J’ai lu Des Hommes de Laurent Mauvignier, c’est un texte fascinant. Tout, la construction, le style. Mais au moment de l’écriture de L’Appelé – en résidence d’écriture – je n’ai absolument rien lu, je n’ai même pas emporté de livres avec moi ! À la fondation, il y a une bibliothèque immense, un lieu incroyable, je n’y suis entré qu’une seule fois pour découvrir l’endroit, mais pas pour y emprunter un livre, et encore moins un livre sur le sujet. Je ne peux pas lire dans les moments où j’écris. Les très grands textes sont trop impressionnants. Cela coupe l’herbe sous le pied. Ma mère a passé sa vie à lire. Et à la fin de sa vie, elle en a fait son « métier », en interviewant des auteurs pour une radio locale à Dijon. Je lui ai souvent posé la question : « Pourquoi tu n’écris pas ? ». Elle m’a toujours répondu : « Que pourrais-je écrire de plus, après tant de grands livres ? ». C’était l’absolue modestie de ma mère et je suis bien d’accord. Mais, dans le même temps – et si c’est absolument nécessaire, si on y est en quelque sorte contraint, obligé – la question ne se pose plus : on doit y aller. Georges Bataille le dit très bien : « À quoi bon un livre, auquel son auteur, visiblement, n’a pas été contraint ? ».
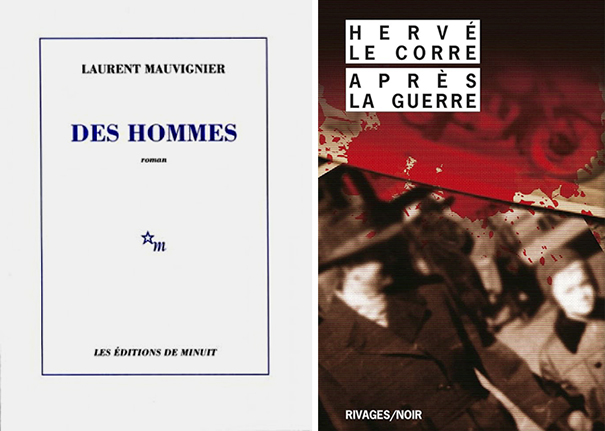
8 – Dans un autre registre, le blanc est un leitmotiv. À rebours des connotations positives qui lui sont associées, le blanc, dans L’Appelé, est la couleur de l’institution psychiatrique ; de la cour de la maison familiale, où les cailloux coupants sont indolores sous les pieds de Jean, « bien anesthésié ». Couleur de la « lourde fumée » lors de la partie de chasse entre Jean et son père, où Jean est victime d’une hallucination et prend deux sangliers pour les têtes de Grand Con et Grand Mou ; blanc des feuilles Canson où Jean dessine après-coup les parpaings de la « nouvelle maison de la turbine » qui va étouffer les cris des victimes de la torture, en Algérie. Mais aussi, le blanc envahissant vers lequel roule Joseph quand il apprend qu’il est arrivé quelque chose à Jean. Blanc de la crypte psychique dans laquelle Jean s’enferme : il monte peu à peu un mur blanc. Blanc, enfin, du linceul de Jean. Tu associes donc ici le blanc à la négativité. Pourquoi ce choix ? A-t-il à voir avec la page blanche, non pas le poncif éculé de l’écrivain en mal d’inspiration, mais métonymie du travail de l’écriture, quand Joseph se « heurte aux mots », qu’il découvre que « les mots ne disent rien » ?
Oui, cela me saute aux yeux maintenant, avec un peu plus de recul sur le texte, qu’il y a beaucoup de « blanc » ! Blanc, le mot et blancs entre les mots. Je m’en suis rendu compte en écrivant que ce « blanc », le mot, revenait. Je n’ai pas cherché à effacer, remplacer, ces « blancs ». Plus qu’une négativité, ce blanc renvoie davantage au mystère pour moi. C’est aussi une affaire de goût, c’est un choix. J’aime écrire avec peu de mots, et donc, que les mots reviennent et qu’on les entende alors autrement. Pas tant dans leur sens, signification, mais dans leur sonorité. Qu’ils résonnent autrement. Que le même mot ouvre d’autres espaces. Également, j’ai le sentiment que quoi qu’on puisse écrire, et d’ailleurs sans doute plus on écrit, plus on fait face au blanc. On se heurte toujours à l’impossibilité à dire. Au fond on n’y arrive pas. Au fond écrire est impossible.

9 – Je perçois par ailleurs combien est ironique le parallèle entre les soins par électrochocs que l’on va administrer à Jean, et la séance fatale à la victime de torture à la génératrice. On rapproche, bien sûr, les deux victimes, et l’on se demande, sans que le doute soit levé, si c’est la séance d’électrochocs qui a été fatale à Jean, faisant de lui l’égal de l’Algérien torturé, ou s’il s’agit d’autre chose – Jean serait en fait déjà mort de ce qu’il a vu en Algérie. Quoi qu’il en soit, la charge critique de ton roman est portée contre les représentants de l’armée française, en l’espèce, deux gradés, nommés Grand Con et Grand Mou. Partages-tu cette analyse ? L’utilisation des majuscules, ici, vise-t-elle à les essentialiser ?
L’écho, pourtant absolument voyant, aveuglant, entre les électrochocs et le générateur électrique, est inconscient. Mais j’écris dans une certaine inconscience. Dans cette zone, un peu comme dans un demi-sommeil, ou pendant la sieste. C’est une de mes blagues lorsque je vais faire la sieste : je dis que je vais travailler ! Mais ce n’est pas une blague, c’est vraiment à ce moment-là que les choses surgissent. Des fulgurances, des bribes de textes. Autrement, c’est lorsque je cours. Mais à l’occasion de ces joggings, ce sont davantage des choses liées à la construction et à l’architecture du texte qui m’apparaissent. Évidemment, aujourd’hui, ce parallèle me saute aux yeux. Absolument, les électrochocs ne sont sans doute que le point final d’une existence déjà totalement fracassée, anéantie. Grand Con est arrivé comme ça. Et après Grand Con, comment nommer son supérieur ? Je ne pouvais pas lui donner un prénom, ni un nom. Il devait rester dans la ligne. Oui, cela raconte que ce sont deux parmi d’autres. Des Grand Con et des Grand Mou, il y a sûrement dû en avoir un certain nombre. Et Grand Con et Grand Mou ont quitté, par leur bêtise, la terre des Hommes. C’est d’ailleurs un mystère absolu pour moi : tous, nous portons la bêtise en nous. Enfin, davantage ici que la bêtise, la saloperie, l’immonde… Tous, nous en sommes capables. Mais comment se fait-il qu’à un moment quelque chose ne nous arrête pas ? Comment ont-ils poursuivi ? Comment est-ce possible ? Je n’ai aucune réponse. Sans doute que cela tourne autour de l’idée de croire que l’on détient la « vérité ». Peut-être cela…

10 – L’Appelé serait aussi un chant incantatoire, ou encore une mélopée. Tu es aussi homme de théâtre. Pourrait-on envisager un récitatif qui montrerait la porosité des frontières entre les arts de la scène et la littérature ?
J’ai lu et vais continuer à lire des extraits du texte lors des rencontres en librairie. Et ça m’a frappé en lisant, oui, le texte peut être dit, lu, joué. J’ai aussi eu de nombreux retours de lecteurs qui m’ont dit qu’ils ont lu le roman à haute voix. Donc, oui c’est possible ! D’ailleurs, le texte vient d’être traduit en allemand, et une maison d’édition allemande de théâtre va le représenter pour le faire jouer sur scène. Tu emploies le mot « porosité ». C’est cela. J’aime ça. Je n’aime pas que les choses – ou pire, que les gens – soient assignés à une place. C’est tellement réducteur et mortifère. On est toujours une chose et une autre. Je pense à Bergman qui réalisait des films. Mais pour moi, Bergman est autant un romancier, un poète, évidemment un cinéaste, un dramaturge, un expérimentateur de formes neuves, qu’un scénariste. Et puis, aujourd’hui, les textes de ses films sont édités et se lisent comme des romans. Les œuvres les plus intéressantes sont au croisement de plusieurs arts. Les artistes qui me passionnent le plus expérimentent souvent plusieurs champs. Je pense à un texte que je viens de lire – un roman, Ma mère rit – de Chantal Akerman, connue avant tout comme cinéaste, son texte est bouleversant.

11 – Tu as écrit pour le théâtre Quand j’étais ton père (Moires, 2022). L’Appelé est ton premier roman, et tu reviens sur la question de la place assignée à chacun dans la famille, sur fond historique. Cette question de la place dans la famille semble importante pour toi. Est-ce le cas, à la fois pour des raisons personnelles et pour des raisons sociétales ?
Quand j’étais ton père est un dialogue, une tentative, entre un père et un fils. Pour L’Appelé, c’est différent, cela se déroule sur trois générations. Je rebondis sur le mot « place ». C’est un mot qui me glace. Rien de pire qu’être assigné à une place. Et c’est pourtant un usage courant. Dans les familles et dans la société. Mais autrement, j’ai le sentiment que ce sont des cryptes, des trous, qui ont déclenché ces écritures. Il fallait raccommoder, retisser. C’était ma nécessité.
12 – Ce mot « crypte » résonne en moi : en refermant L’Appelé, l’image de « crypte blanche » s’est imposée à moi – voilà qui fait le lien avec la couleur blanche que nous évoquions. Que peux-tu nous dire du passage du théâtre au roman ? Enfin, as-tu un nouveau projet d’écriture en cours ?
Oui, ta « crypte blanche » synthétise tout à merveille ! Le passage de l’écriture de mon texte « purement » théâtral à L’Appelé, c’est justement que cela soit impur. Je veux dire de ne plus écrire en me disant que le texte doit être ceci et pas cela. C’est vraiment le cas pour L’Appelé : le mot poésie est souvent employé pour parler du texte. Il sera peut-être joué sur scène et en librairie et il est présenté comme un roman. Cela me va très bien ! Pour la suite, mon deuxième roman, il sera également publié aux éditions du Canoë. Il est écrit. C’est une voix. La voix d’une femme polonaise, obligée à l’exil parce que juive, jusqu’à la fin de son existence au matin de la Rafle du Vel d’Hiv. À nouveau une existence empêchée, cela me saute aux yeux en le disant. Un mot sur Colette Lambrichs : elle a dirigé, avant le Canoë, les éditions de La Différence, autant dire qu’elle a publié de forts merveilleux écrivains et artistes. Et encore aujourd’hui, elle lit tous les textes qu’elle reçoit. Sans autre considération que le texte. C’est une chose absolument unique ! On devient écrivain lorsque l’on est édité. Être édité par Colette Lambrichs – pour qui j’ai la plus grande admiration – est aussi important que joyeux. Actuellement, je suis sur les traces d’un nouveau texte. Mais là, je ne peux pas en dire plus : dire l’écriture avant qu’elle advienne, c’est un peu la tuer…

Entretien © Guillaume Viry & Bruno Lecat – Illustrations © DR
(Paris, automne 2024)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
