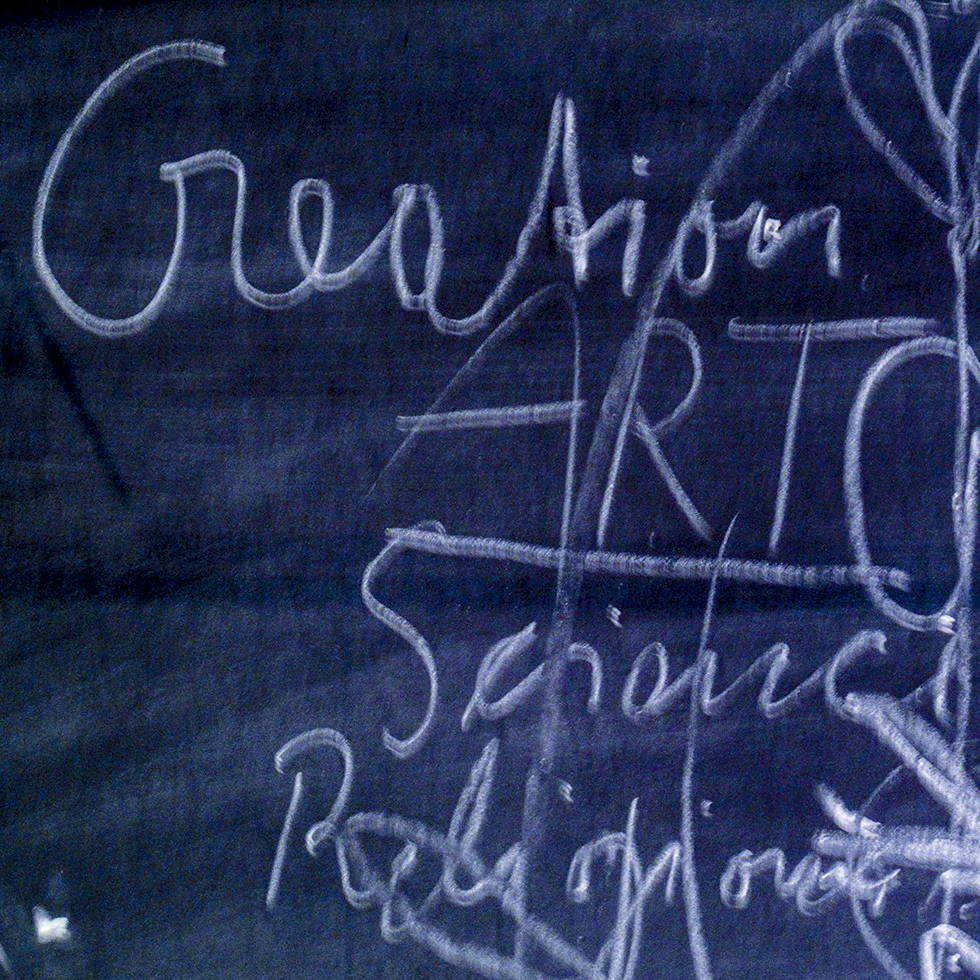Il est vrai que, même quand ils disposent d’un certain humour, tous ces inventeurs s’agitent beaucoup, et ont un air de découvrir la destruction de l’art, la réduction de toute une culture à l’onomatopée et au silence comme un phénomène inconnu, une idée neuve, et qui n’attendait plus qu’eux. Tous re-tuent des cadavres qu’ils déterrent, dans un no man’s land culturel dont ils n’imaginent pas l’au-delà. Ils n’en sont pas moins très exactement les artistes d’aujourd’hui, quoique sans voir comment. Ils expriment justement notre temps de vieilleries solennellement proclamées neuves.
(Internationale Situationniste – 1961)
Du champ, du signe
Repentirs (Gallimard, 2011), le dernier roman d’Hélène Ling, retrace l’irrésistible ascension d’un artiste contemporain, Simon Veyne, véritable « Warhol du Vieux Continent », dont la carrière commencée dans la bohème des années soixante-dix de Montparnasse et les Beaux-Arts de Paris, poursuit sa trajectoire dans le clinquant des années quatre-vingt, jusqu’au mitan des années deux-mille, apothéose planétaire marchande des arts plastiques. Simon Veyne, on le comprend très vite grâce au narrateur, est un imposteur de l’art, un histrion, habile opportuniste qui aura su épouser toutes les tendances de son époque pour asseoir son succès, sinon sa gloire. Lire ce roman comme une énième charge contre l’art contemporain, se contenter d’y déceler des réminiscences critiques unilatérales (celles par exemple d’un Jean Clair) et les émarger au registre de la seule satire, relèverait, selon nous, d’une forme de confort intellectuel tout en surface qui négligerait sa dimension polyphonique, à l’évidence, le pire moyen pour recouvrir les enjeux, tant esthétiques que politiques, de l’entreprise d’Hélène Ling. Circonscrire ce qui se joue dans ce roman suppose d’abord de remonter en amont de la sphère littéraire et artistique, plus précisément, aux origines de la constitution de ces deux disciplines en tant que champs spécifiques. En France, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la déliaison des Beaux arts et des Belles Lettres par rapport aux pouvoirs (politique, institutionnel ou économique, etc.) signe le tournant majeur de la modernité, celui qui permettra à l’écrivain ou l’artiste de tirer sa légitimité de son œuvre. Certes, les velléités d’émancipations ne manquèrent pas au Grand Siècle, mais si un Cyrano de Bergerac rêvait son autonomie sur un mode amer, c’est bien avec Flaubert et Baudelaire que s’opéra la rupture ; si le premier n’hésitait pas à se dire prêt à devenir pion de collège « plutôt que d’écrire quatre lignes pour de l’argent », chez le second, le motif de la prostitution (comme l’avait naguère relevé Walter Benjamin) prend une place centrale au sein de l’œuvre, ce qui n’a rien d’innocent, comme si l’auteur des Fleurs du Mal anticipait la condition de l’écrivain pris au piège du marché – à cet égard, le célèbre aphorisme de Fusées, « Qu’est-ce que l’art ? Prostitution », est on ne peut plus clair. Ce bref récapitulatif apporte, il nous semble, un petit éclairage sur le personnage de Simon Veyne. Rastignac de l’art contemporain, il cristallise en effet à lui seul tous les retournements et les ruses du champ artistique depuis un demi-siècle, dont on peut dire qu’il est devenu, a fortiori sous le haut patronage d’un Jack Lang dans les années quatre-vingt, le lieu central de l’hétéronomie. De fait, c’est précisément ce qui s’était conquis de haute lutte à la fin du XIXe siècle (ce que Pierre Bourdieu a appelé « l’autonomisation du champ »), et qui aura débouché sur la synthèse utopique de l’esthétique et du politique concentrée en avant-garde, qui est jeté au pied du pouvoir par Simon Veyne. Idéal-type de la génération lyrique, véritable limaille au gré des forces du champ artistique (nous y reviendrons), il est cet arriviste qui en aura occupé toutes les positions, participant à la kitchisation de la culture, sinon à sa prostitution, procédant, pour paraphraser la lucidité de Bernard Lamarche-Vadel, à « la configuration des œuvres en vue de leur destinataire » : curateur, mécène, collectionneur – aujourd’hui, le marché des changes ; du capitaine d’industrie Justin Lenoir des années quatre-vingt au jeune financier anglais Edward Thrust des années deux-mille (qui voit dans la finance une guerre sublimée), Simon Veyne aura su trouver avec roublardise ses commanditaires, bouclant ainsi la boucle de l’économie politique postmoderne. À sa façon, il referme la parenthèse ouverte à la fin du XIXe siècle, clôt l’aventure de la déliaison initiée en leur temps par Flaubert et Baudelaire, plus proche en cela d’un artiste de la Renaissance qu’apôtre d’une transgression sans péril dont il n’aura cessé de se proclamer le héros, si bien que les analyses de Baxandall dans L’Œil du Quattrocento (ou d’un Arnold Hauser) pourraient lui convenir à merveille : l’œuvre n’est jamais qu’une transaction entre l’artiste et son client. Peu importe, du reste, que ce dernier soit un banquier florentin du XVe siècle ou un vulgaire affairiste des années quatre-vingt, comme Justin Lenoir, chez lequel n’est-il pas tentant de deviner « un espoir aux ailes rognées d’opérer une transaction d’ordre supérieur à toutes celles qu’il avait menées jusque là, et qui lui donnerait cette fois, en échange de son argent, enfin quelques bribes du domaine (comme il aimerait peut-être lui-même le formuler) de l’esprit ? ». Du champ, et de son autonomie, ne reste plus que son signe extérieur de richesse, le principal intéressé se contentant, sur les ruines de cette coquille vide, de jouer à qui perd gagne.
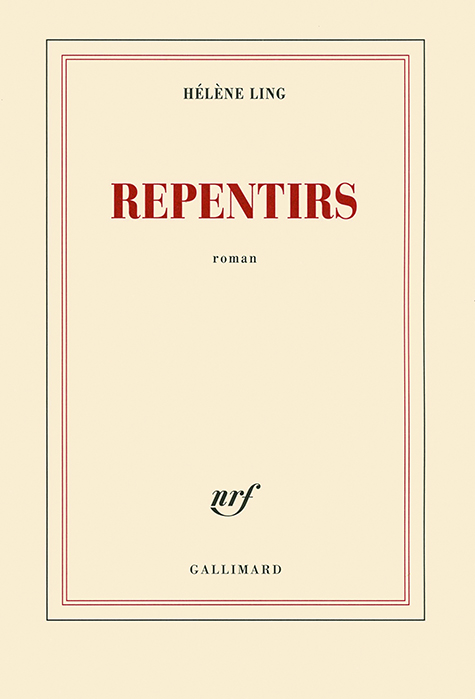
Iconomie
L’art est un fossile de la vie économique. (Michael Baxandall)
On se souvient que l’Internationale Situationniste, dans le bulletin de son premier numéro (juin 1958) distinguait une phase active de la décomposition culturelle, « démolition effective des vieilles superstructures – qui cesse vers 1930 -, et une phase de répétition, qui domine depuis » ; de fait, depuis un demi-siècle, les avant-gardes bégaient et s’épuisent à singer le geste inaugural de la modernité artistique, celui de la fracture duchampienne ; cette répétition qui n’est jamais qu’un académisme de la rupture vide bien sûr tous les enjeux du geste – et de la geste – modernes. Si peu ou prou, jusqu’aux années soixante, l’utopie artistique a pu se définir comme une tentative pour arrimer l’esthétique au politique, d’expulser la première de son orbite académique pour la propulser dans la vie quotidienne, la radicalité même du geste s’est perdue, et l’on n’en conserve aujourd’hui que la posture. Ainsi, truqueur, falsificateur, piétinant sans vergogne l’audace de ses prédécesseurs, Simon Veyne est cet habile faiseur qui a parfaitement intégré les codes esthétiques de cette modernité, qu’il se contente de recycler académiquement, déclinant dans un premier temps l’expérimentation propre aux arts plastiques des années soixante-dix : on le voit en 1977, dans son appartement de Montparnasse, « faire circuler un pétard expérimental, le tabac coupé avec une boulette de [ses] cheveux », permettant à tous les membres de l’assemblée d’inhaler « à son tour la substance vivante, magnétique, érotisée » par sa présence, eucharistie païenne qui rappelle de nombreuses performances kitsch liées au body art (à l’évidence la Messe pour un corps de Michel Journiac, celui-ci transformant son sang en boudin appelé à être consommé par le public, ou l’épicier en chef post Fluxus, le toujours vert Benjamin Vautier, alias Ben, exposant ses points noirs). Cette déclinaison expérimentale se poursuit dans la dissipation immatérielle du postmodernisme des années quatre-vingt, Simon Veyne ayant trouvé sa marque de fabrique, sérigraphiant tel un « pop concepteur national » la signature digitale de nombreuses célébrités. L’aventure se poursuit, émaillée de multiples provocations et de scandales épousant la posture post Dada d’un Sigmar Polke pour converger fort logiquement vers la folie spéculative du marché de l’art à la charnière du siècle -, si bien que le narrateur diagnostique très justement son œuvre comme « une déchetterie de fin de millénaire, un élevage industriel de toiles, vidéos, photographies, montages, installations, sculptures, collages, voire de courts textes autobiographiques ». Ainsi, comme le réel, l’art devient, selon Simon Veyne, lors d’une scène du roman située en 1984, tandis qu’il se livre à un passage à l’acte (il met le feu à l’une de ses statues en polystyrène), sa propre parodie, « ragoût conceptuel », « recyclage de blagues », « rafistolages académiques », « variations sur le style pompier international », « Singerie » ; lors de cet incident, il avoue que ses mannequins affublés « de vieilles chiffes et de matériaux récupérés » lui ont demandé à peine « trois à quatre minutes de travail », lui apportant une fortune rapide, mais l’obligeant à abandonner son talent de dessinateur, l’empêchant de « jouir de ses pigments comme de ses maladies honteuses », prenant la posture du génie « châtré par son époque ». C’est bien au tournant des années quatre-vingt que le profit s’est nourri d’une accumulation de dividendes, sans travail ; et, comme les travaux très pénétrants de Jean-Joseph Goux l’ont parfaitement mis en lumière, cette métamorphose de l’économie entre en congruence avec celle des arts plastiques : là non plus, le métier « ne paie plus » ; l’économie, comme les arts, sont devenus purement spéculatifs. Ce que dévoilent le propos et l’œuvre de Simon Veyne, c’est à la fois un nouveau paradigme esthétique comme politique : 1984 est bien cette date charnière, celle où les anciens gauchistes recyclés dans l’appareil d’État mitterrandien, les industries culturelles et publicitaires, ont allègrement liquidé le compromis fordien entre Travail et Capital ; nulle coïncidence entre l’alignement de la France sur la politique macro-économique de l’Allemagne fédérale (désinflation compétitive, désindexation des salaires sur les prix, internationalisation des marchés financiers, etc.) et l’auto-dissolution des avant-gardes dans une assomption du sujet qui trouvera son herméneutique (pour parler comme Foucault) dans des récits autobiographiques d’ex-représentants du Nouveau Roman (Robbe-Grillet, Duras), ou dans des installations plastiques d’un cynisme accompli (par exemple le Dadaïsme d’État). Simon Veyne est l’emblème de cette trajectoire : après avoir expliqué au narrateur une nuit d’été 1974 qu’il fallait désormais « s’amputer de soi-même », « vivre dans la gueule du monstre », et privilégier une esthétique de l’inhumain, du « parasitisme sans concession », il expose aux Beaux-Arts cinq ans après une vidéo où l’on distingue sur la trame de l’écran une mygale parasitant un corps humain ; si le motif de l’araignée, récurrent dans la biographie intime de Simon, fait songer, en tant qu’archétype junguien, au sexe maternel dévorant son enfant, l’on comprend très vite que cette mygale allégorise une théorie du parasitage social qu’il mettra en pratique durant les deux décennies suivantes. Tout devient instrumental dans ces années là, c’est ce que met en lumière avec une ironie subtile le roman d’Hélène Ling ; Simon Veyne instrumentalise son art comme il aura instrumentalisé ses proches sur toute une décennie : le trio que constituent le narrateur, Guillaume, Michèle Mink et lui-même, ne fait que répéter une scène de novembre 1975, lorsque suite au visionnage de Salò de Pier Paolo Pasolini, Simon « vole la jouissance » de Guillaume (prisonnier d’un désir mimétique) dans une partouze à trois, avec une jeune fille bien nommée (comme la destruction de Dante), Béatrice ; la même relation triangulaire se répète dans les années quatre-vingt, quand le narrateur quitte Michèle pour une ex-amazone du M.L.F. triomphant, double féminin de Simon, personnage qui n’est pas sans rappeler la Mlle Vatnaz de L’Éducation sentimentale, la féministe engagée (exactement l’opposée de Rosanette, comme Véra Lupai l’est de Michèle Mink) : « elle était devenue à l’instant son jumeau féminin, un écho de la même erreur répétée quinze ans après, le même mirage à haute intensité, plus volatile seulement » ; aussi, Simon Veyne, dans l’ordre de cette nouvelle économie esthétique est celui qui s’inscrit dans ce que Lacan (relisant Marx) appelait le « plus-de-jouir ». Ce « plus-de-jouir » est au cœur du principe de l’ « iconomie » (pour reprendre le judicieux néologisme forgé par Jean-Joseph Goux) politique, les arts plastiques, marchandises idéales, offrant l’opportunité d’un « pari sur le futur, promesse de gain démultiplié, singularité » (Goux). Les Situationnistes aspiraient à la fin de l’économie et la réalisation de l’art ; Simon Veyne aura mis fin à l’art tout en réalisant l’économie, chiasme vertigineux qui signe la fin des utopies et toute la folie de notre époque.
Comment on réécrit l’Histoire
… mêler et réchauffer ensemble les restes d’un autre festin pour en former un petit ragoût… (Goethe)
Simon Veyne, on le voit, est celui qui joue, dans tous les sens de la formule, sur tous les tableaux, prend pour lui tous les atouts, et finit toujours par rafler la mise. Il porte tous les masques, y compris et surtout celui de l’histrion, le plus pratique, car il lui permet de se dédouaner sans conséquence de tout ce qu’il déclare, écrit et conçoit ; chez lui, la transgression est toujours au second degré, il gagne à tous les coups, même quand il brûle ses œuvres ou celle des autres (l’origami géant de l’artiste japonais Hirogashi). Frédéric Moreau, dans L’Éducation sentimentale, hésita tout au long d’une existence velléitaire entre l’art et l’argent pour n’avoir finalement ni l’un ni l’autre – Simon Veyne aura obtenu les deux. Pour cet artiste, tout matériau – plastique comme biographique – est palimpseste, le repentir, jamais moral, toujours esthétique ; la polysémie du titre est à cet égard significative : c’est le narrateur qui démasque Simon Veyne, dissolvant en 2006 un transfert commencé dans un compartiment de train cette nuit d’été 1974, clôturant à la fois une parenthèse biographique pleine de ressentiment, sinon une séquence historique, qui consista pour une génération à lui confier « les déchets de leurs utopies les plus intimes à la garde de cette catégorie, les artistes, espérant peut-être qu’à force de brosser, d’astiquer et de faire reluire l’idée de création, ils en ressusciteraient bien quelque chose ». Simon Veyne (homonyme du Professeur d’histoire antique qui officiait au Collège de France), double de Néron, l’Empereur histrion, affecte ostensiblement son inconstance, qui n’est jamais que le cache-misère de ses multiples palinodies ; mythographe de lui-même et de son enfance, il l’est aussi de l’Histoire, et ce n’est pas un hasard, principalement, de la séquence historique française la plus saturée et chargée d’utopies, celle de Mai 68. Les événements de Mai dans Repentirs, jouent sensiblement le même rôle que les journée de 1848 dans L’Éducation sentimentale, en ce que la mise en récit des deux éruptions émeutières témoignent de désillusions. Ainsi, si très jeune Simon Veyne participe aux journées des 10 et 11 mai, c’est pour rapidement dans les années soixante-dix les renier, dénégation que le narrateur finira seulement par comprendre en 2006 : « Il me devenait soudain pénible aujourd’hui de songer à cette heure, dans l’enceinte de l’hôpital, que la première version de ses confidences teintée de déni et de reniement ait encore pu m’en imposer vers 1977, à l’époque précisément où l’héroïsme de la rue s’en allait rejoindre la liste des clichés juste refroidis. J’avais adhéré à sa fiction dépressive, plus aiguë, plus proche, me semblait-il, de ma propre profession de scepticisme : l’insurrection retournée comme un gant, l’écoulement des modèles historiques dans les égouts, la suave amertume de débâcle qu’il me mettait à la bouche, au bord de la table encombrée de verres, de détritus, de cendres, dans nos tête-à-tête au milieu de la nuit, avec un vague relent de tyrannicide manqué pour l’historien que je voulais devenir, de suicide moral, de répressions dans le sang » ; mais à cette dénégation succède vite une auto-récupération flatteuse des événements, au mitan des années quatre-vingt, lorsqu’il s’agit pour Simon Veyne d’enraciner son art « de plus en plus profondément au cœur de l’insurrection de Mai » et de s’en faire le héraut, porteur d’une nouvelle politique du désir, compilant tous les résidus critiques de l’époque. À l’instar de nombreux semblables de sa génération, qu’ils aient participé au mouvement ou s’aient contentés comme les ex-révolutionnaires professionnels de toute obédience, n’ayant sur le coup rien compris à la chose, de « prendre le train en marche », Simon Veyne opère une fantastique captation d’aura sur les événements, se transmuant en petit rentier de la décomposition culturelle ; c’est dire toute la part de désenchantement que contient ce roman, mais aussi toute sa force : montrer en quoi les années quatre-vingt ont dévitalisé Mai 68, gommé toute sa puissance subversive pour n’en conserver que son écume, effectuant « le passage de la contestation du Spectacle au Spectacle de la contestation » (comme si l’un des slogans de ces journées de mai avait parodiquement anticipé notre devenir) ; c’est bien toute les facultés d’endogénéïsation du nouvel esprit du capitalisme qu’aura sous estimées « la critique artiste », pour utiliser la terminologie de la sociologie néo-wéberienne. D’une certaine manière, le négatif a programmé sa propre métabolisation, la réversion des signes, sinon leur consomption finale : « la transformation incendiaire des rapports sociaux » appelée de ses vœux par un camarade de barricade de Simon en Mai 68 débouche sur l’incendie de l’origami géant d’Hiroshagi ; trente après triomphent le marketing de la contestation et son héros, l’anarchiste couronné. In fine, ce que démontre, en creux, ce roman porté par une haute ambition, exigeant dans sa forme, c’est que dans le Spectacle, le positif – la contradiction en soi – barre le négatif – la contradiction posée, et c’est là même le sens de sa positivité ; il est omnivore et ses capacités digestives sont insoupçonnables. Aujourd’hui, partout sur la planète, c’est toute la réalité du théâtre social qui est inflammable mais ces flammes sont à elles-mêmes leur propre reflet ; la domination a intégré l’image de sa désintégration. « Ces temps nous sont hostiles » comme l’écrivaient à peu près il y a plus de dix ans Alain Tizon et François Lonchampt (dans Votre révolution n’est pas la mienne) et s’il est un repentir tenace que l’on ressent à la fermeture de ce très grand livre, c’est, hélas, que la vie n’attend plus le moment de sa contre-offensive.
Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.