La seconde catégorie, celle des penseurs et philosophes qui entendent séparer l’homme Heidegger de son oeuvre philosophique, comprend par définition des lecteurs hostiles au nazisme, comme le relève Gaëtan Pégny :
La réponse la plus commode consiste à séparer l’homme Heidegger de son oeuvre, ou, lorsque cela n’est plus possible tant le maître s’acharne à lier ensemble sa conceptualité et son engagement, à dégager un noyau philosophiquement estimable d’un corpus entaché. On a alors droit à un Heidegger grand philosophe et par ailleurs nazi.
Ceci peut encore être modulé d’un commentateur à l’autre : certains heideggeriens traitent séparément l’homme et l’oeuvre, quitte à agonir le premier pour mieux célébrer la seconde, quand d’autres s’efforcent de penser ou de justifier pareille séparation, voire d’affirmer pour les plus sophistiqués d’entre eux, que Heidegger serait « un grand philosophe parce que national-socialiste ». Même Hans-Georg Gadamer, qui a bien connu Heidegger, constatant que « par admiration pour le grand penseur » d’aucuns prétendent que son engagement politique n’a « rien à voir avec sa philosophie », reste cependant sur ce terrain-là en ajoutant : « On ne se rend pas compte à quel point une telle défense d’un penseur aussi important était insultante ». Et vend la mèche d’une certaine façon.

Cette séparation, en France, se rapporte autant à des philosophes classés à « droite » (Luc Ferry, à travers la formule « Heidegger, le salaud génial : salaud nazi mais / et génial philosophe ») qu’à « gauche ». Dans leur préface aux lettres écrites par Heidegger à sa femme (« Ma chère âme »), Alain Badiou et Barbara Cassin reprennent la même antienne :
Heidegger est certainement un grand philosophe, qui a été aussi, et en même temps, un nazi très ordinaire.
Très ordinaire, vraiment ? Nos duettistes remettent le couvert trois ans plus tard (2010) avec Heidegger : le nazisme, les femmes, la philosophie. Curieusement les deux préfaciers, qui disent pourtant s’accorder sur le rapport de Heidegger au national-socialisme, le jugent, l’un (Badiou) « circonstanciel », l’autre (Cassin) « essentiel ». Comprenne qui pourra ! Commentant la phrase citée plus haut, extraite du second livre, et prolongée par « Que la philosophie s’en débrouille ! », Emmanuel Faye constate :
Selon Badiou et son interlocutrice, ce n’est pas tant à Heidegger de porter la responsabilité et le poids de son nazisme qu’à la philosophie elle-même. Ce transfert de responsabilités apparaît comme un effet de la stratégie heideggerienne mise en place après la défaite nazie et relayée de façon plus ou moins consciente par différents élèves et disciples.
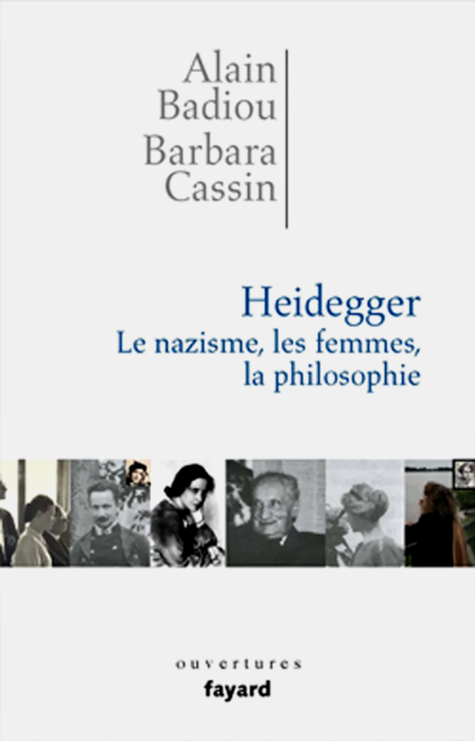
Jacques Derrida a toujours reconnu sa dette envers Heidegger tout en étant insoupçonnable de complaisance envers le nazisme (contrairement à Paul de Man auquel le concept de « déconstruction » doit beaucoup). Sauf que la pensée tortueuse de Derrida emprunte parfois de curieux chemins (de ceux qui ne mènent nulle part, certainement), pour traiter, par exemple, de la question de l’antisémitisme chez Heidegger. Interrogé en 2000 par Antoine Spire, Derrida admet que « sans vouloir innocenter Heidegger », celui-ci « n’a pas échappé au plus banal des antisémitismes de son temps et de son milieu ». Cette tournure euphémique l’entraîne à ajouter « qu’il n’y a pas de texte philosophique antisémite de Heidegger (comme on pourrait en trouver, d’une certaine façon, chez Kant, Hegel et Marx) ». Ce « d’une certaine façon » est délicieux… Comme quoi, l’antisémitisme d’Heidegger se dissout dans la déconstruction derridienne. Derrida n’a-t-il pas appris de Paul de Man que tout texte aurait un sens contradictoire à celui qu’il paraît énoncer !
Dernier exemple en date de cette séparation entre l’homme et l’oeuvre, ici vertigineuse, le phénoménologue Claude Romano, dans un entretien par ailleurs instructif et de bonne tenue (publié dans Critique ), évoque son « dégoût » et sa « consternation » à la lecture des Cahiers noirs. Par-delà les allégeances et les accointances de Heidegger avec la pensée nazie cet antisémitisme se révèle fâcheusement central dans celle du philosophe. Pourtant, Romano estime in fine que « la philosophie de Heidegger conserve un intérêt malgré les stigmates ineffaçables de cet antisémitisme ». Tout en reconnaissant que cette pensée, selon lui « majeure du XXe siècle », est également celle « qui s’identifie en partie avec ce qu’il y a eu de pire dans ce siècle ». Ce qui est pour le moins antinomique : une telle pensée, associée à ce pire-là, ne peut en aucun cas avoir la grandeur qu’on lui prête.
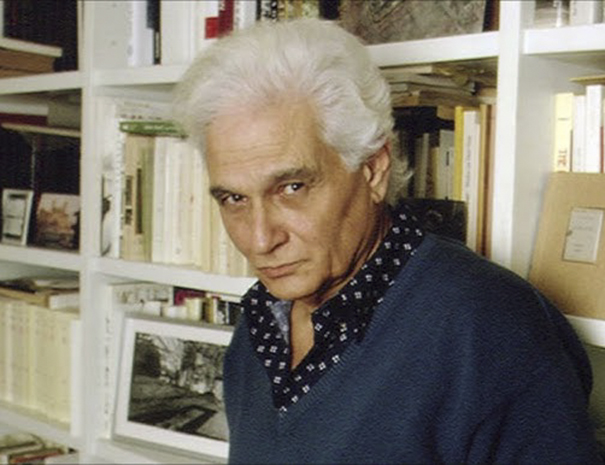
En 1987, Philippe Lacoue-Labarthe publie un ouvrage entièrement consacré à Heidegger, La Fiction du politique (sous-titré : « Heidegger, l’art et la politique »). Ce livre mérite qu’on lui accorde plus d’attention que d’autres pour deux raisons. D’abord parce que sa thèse principale, un brin sophistiquée, renouvelle le genre ; ensuite parce que La Fiction du politique est indirectement – mais directement dans une longue annexe – une réponse à l’ouvrage de Víctor Farías (Heidegger et le nazisme) paru en France la même année, non sans un certain retentissement. Avant d’en venir à la thèse centrale de Lacoue-Labarthe (exposée dans la partie conclusive de son livre), il paraît nécessaire de décrire les différentes étapes y conduisant :
1) L’adhésion de Heidegger au nazisme, puis sa « rupture » avec le mouvement national-socialiste ;
2) L’antisémitisme (ou prétendu tel selon l’auteur) ;
3) Différents états de la pensée de Heidegger ;
4) La question du fascisme.
+ un appendice sur l’ouvrage de Farías.
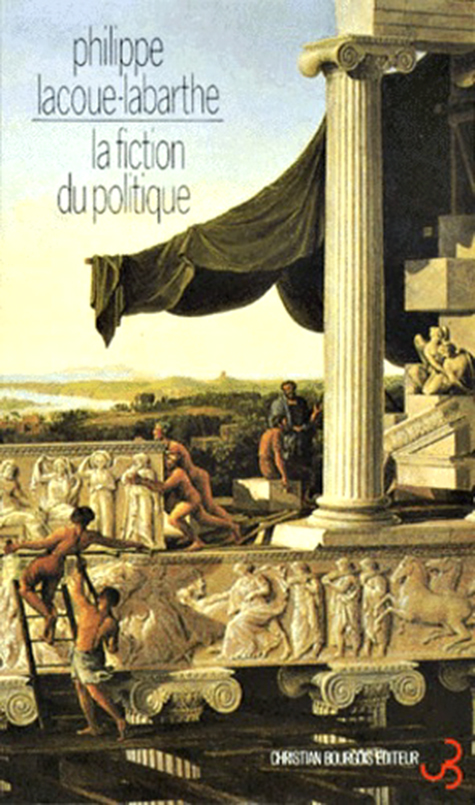
1) Lacoue-Labarthe évoque « l’engagement de 1933 » qui n’est nullement, affirme-t-il, « un simple soutien » au régime national-socialiste, mais un « engagement philosophique entraînant des énoncés de type philosophique ». Nous sommes bien d’accord. Si certains de ces « énoncés seront par la suite nettement abandonnés et récusés », Lacoue-Labarthe reconnaît cependant que « l’injonction 1933 n’en sera pas moins maintenue ». Cela paraît un tantinet contradictoire, mais passons. Notre auteur préfère parler d’une « faute » commise par Heidegger plutôt que d’une « simple erreur ». Pourtant, quand il aborde la période 1933-1934 Lacoue-Labarthe prend pour argent comptant les déclarations faites par Heidegger en 1945 sur son rectorat (en l’occurrence, un texte confié à son fils Hermann dans l’éventualité d’une réédition posthume du Discours du rectorat). En commentant ici « le sens profond de l’engagement de Heidegger », Lacoue-Labarthe relativise, voire dément ce qu’il écrivait précédemment. J’aurai l’occasion d’y revenir. Lacoue-Labarthe revient à maintes reprises sur ce qu’il appelle « la rupture de 1934 » (« le mérite de Heidegger, incalculable aujourd’hui, aura été de ne céder que dix mois » ou « distance prise par Heidegger dès 1934-35, vis-à-vis du régime et de son idéologie » ou « et de fait, sur l’essentiel des positions métaphysiques du nazisme, la rupture était inéluctable »), etc., etc. Comme nous l’avons indiqué plus haut cette « rupture » n’est qu’une fiction, dont l’origine remonte à la lettre écrite par Heidegger en 1945 au président de la Commission d’épuration chargée de statuer sur son sort. Une fable reprise par des générations d’heideggeriens. Dans son annexe sur Farías, résumant « sèchement » la thèse de Heidegger et le nazisme, Lacoue-Labarthe relève pourtant que Heidegger a effectivement participé après sa démission du poste de recteur à « plusieurs projets de réforme universitaire » qu’il cite, y compris « l’Académie pour le droit allemand » (qui n’en fait d’ailleurs pas partie), en s’abstenant de préciser que les travaux de cette Académie (où siégeaient, aux côté de Heidegger, les Schmitt, Rosenberg et consort) ont permis d’élaborer les lois raciales de Nuremberg. Comme rupture, franchement !
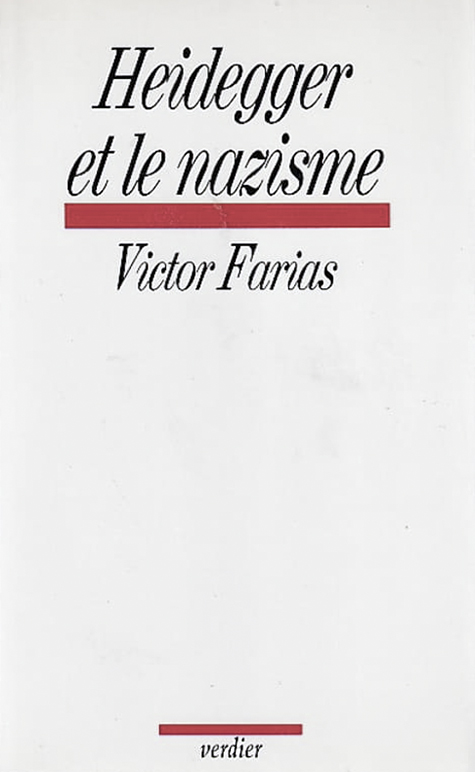
2) Second leitmotiv du livre de Lacoue-Labarthe : le prétendu (selon lui) antisémitisme de Heidegger. En 1987, notre auteur ignorait, il est vrai, les occurrences racistes et antisémites relevées ensuite dans les différentes correspondances de Heidegger publiées à ce jour, et a fortiori dans les Cahiers noirs. Mais la mention par Lacoue-Labarthe d’une « aversion de Heidegger pour l’idéologie raciste et le biologisme des théories nazies maintes fois manifestée dans son enseignement après 1934 » laisse pantois. Là encore, Lacoue-Labarthe se contente de reprendre telles quelles les explications de Heidegger en 1945. Dans le même registre, citons ici « ce contre quoi pourtant Heidegger s’était résolument opposé, l’antisémitisme », là « ce que Heidegger a refusé de la manière la plus nette de fournir la moindre caution à l’antisémitisme et au biologisme raciste officiel », ou encore, « de toute façon l’antisémitisme fait une différence infranchissable » (entre Heidegger et les idéologues du national-socialisme). Bon, on ne va pas accabler davantage Lacoue-Labarthe compte tenu de ce que l’on sait aujourd’hui. Sinon pour tordre le cou à la légende d’un Heidegger parti en guerre contre le biologisme des nazis, Emmanuel Faye (dans Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie) s’est appuyé sur des textes des années 30 (auxquels Lacoue-Labarthe semble se référer, mais sans les connaître assurément, ou en faisant aveuglement confiance à ce que pouvait en dire Heidegger en 1945), pour apporter des preuves contraires. Faye y analyse les cours sur Nietzsche de 1936 à 1941, en particulier ceux qui, selon Lacoue-Labarthe, lavent Heidegger de tout soupçon d’idéologie raciste (opposant en cela le biologiste racial des nazis vulgarisé par Rosenberg à la philosophie de Heidegger). La lecture des textes en question fait un sort à cette artificielle séparation entre le biologique et le philosophique. À la décharge des heideggeriens, reconnaissons-le, le Maître dans l’édition de 1961 de ses cours sur Nietzsche a supprimé (sans le mentionner, bien évidemment…) plusieurs développements à caractère racial, pour ne pas dire raciste. Heidegger peut certes se moquer de tous les mots en « isme » (biologisme compris), mais il sait, en revanche, reconnaître (chez un Spengler) l’importance d’une « interprétation biologique de la volonté de puissance », tout en s’abstenant de citer Rosenberg (Heidegger le méprisait). Chacun dans sa spécialité, Carl Schmitt pour le droit, Heidegger pour la philosophie, n’en défendait pas moins stricto sensu une conception raciste, même si ce racisme-là ne s’expliquait pas uniquement par des facteurs biologiques (et encore, souvenons-nous de ce que Heidegger affirmait l’été 1933 devant un parterre de médecins). Comme insiste Emmanuel Faye :
Il faut comprendre une fois pour toutes que le fait d’insister sur l’importance de l’esprit et d’exprimer des réserves à l’égard du « biologisme » ne signifie nullement une prise de distance à l’égard de la conception hitlérienne de la race.
On croit comprendre qu’il existerait pour Lacoue-Labarthe un racisme à la limite acceptable, et un autre qui ne l’est nullement (l’antisémitisme). Pourtant, reconnaît-il, Heidegger a passé un « compromis » avec un « mouvement pour lequel l’antisémitisme était principiel ». Par conséquent, « en adhérant au nazisme si brièvement et même dignement (sic) que ce fut, on adhérait nécessairement à un racisme ». Lacoue-Labarthe en conclut que ce pauvre Heidegger s’est aveuglé sur la nature du « mouvement » en croyant possible de détacher le racisme de ce mouvement. Cette démonstration s’avère tellement tortueuse qu’elle en devient pathétique vingt-sept ans plus tard, alors que même les heideggeriens orthodoxes (à l’exception de quelques diplodocus) ne récusent plus l’antisémitisme du Maître.
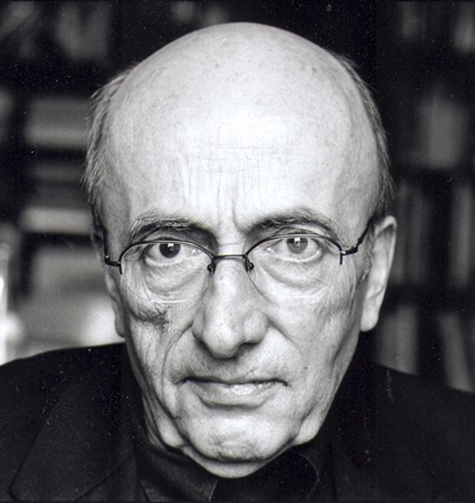
3) Lacoue-Labarthe le répète : Heidegger est sans contestation possible le plus grand penseur de son temps. On est étonné malgré tout – compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment – d’apprendre que « l’engagement de Heidegger est d’une absolue cohérence avec sa pensée ». Ceci contre la tendance dominante heideggerienne ajoute-t-il. Lacoue-Labarthe sort alors de son chapeau (celui de Zozo certainement) la notion de « national-esthétisme » sensée traduire chez le Martin Heidegger postérieur à la soi-disant « rupture de 1934 », le remplacement du « travail » par « l’oeuvre ». Ce qui représente pour Lacoue-Labarthe « une immense différence où se joue pas moins que l’essence du nazisme. Et par conséquent du politique ». Rien moins que ça ! Et Lacoue-Labarthe de nous expliquer que Heidegger, déçu de ne pouvoir réformer l’université allemande selon ses voeux (l’échec du rectorat), privilégie donc dans sa pensée l’art à la science, « en l’occurrence pensée poétique » qu’illustreraient Hölderlin et la Grèce. Il reconnaît que la Grèce de Heidegger, transmise par Hölderlin, « n’a jamais proprement vu le jour ». Mais qu’importe, tout cela fait d’excellents Allemands et « jette une lumière précise sur l’essence, plus ou moins demeurée voilée dans le discours dominant à ce sujet, de national-socialisme ». À ceux qui seraient tentés de discuter historiquement parlant la pertinence de cette notion-gadget de « national-esthétisme », Lacoue-Labarthe répond ne pas se situer sur le plan « historique », mais sur celui historial « cher au Maître ». On croit entendre en écho la fameuse parole d’Arletty : « Historial ! Historial ! Est-ce que j’ai une gueule d’historial ?! » Pour rendre la honte encore plus honteuse en la livrant à la publicité, citons Lacoue-Labarthe dans le texte : « L’antisémitisme est avant tout, fondamentalement, un esthétisme ». Pourquoi pas, puisqu’on apprend plus loin que « le nazisme est un humanisme ». La preuve, dirais-je, que la défense en dépit de tout de Heidegger rend bête des gens intelligents !

4) Lacoue-Labarthe cite plus loin l’adage de Paul Valéry (« Qui ne peut attaquer le raisonnement, attaque le raisonneur »), que Heidegger invoquait, pour nous prendre à témoin du « nombre d’erreurs, de faux bruits ou de franches calomnies » colportés sur son philosophe préféré. Comme Lacoue-Labarthe l’impute à l’absence de « documents suffisants », on se contentera de remarquer que la postérité a remédié à ce souci. Dans la foulée (une longue note de bas de page), Lacoue-Labarthe exhume pourtant quelques documents et témoignages « accablants ». Mais, puisqu’il s’agit ici de travaux d’historiens, il en conclut « qu’il doute cependant que ces travaux puissent apporter quoi que ce soit de décisif ». Là encore, la suite lui donne tort : ce ne sont pas des historiens, mais principalement des philosophes qui ont réalisé ces travaux. Enfin, Lacoue-Labarthe reprend la sempiternelle litanie heideggerienne :
Ce n’est pas dans les petites (ou les grandes) compromissions de Heidegger, ni même dans la déclaration et proclamation de 33-34, encore une fois, que l’essentiel – philosophique – se joue.

Exceptée une pointe adressée à Bourdieu, Lacoue-Labarthe entend surtout défendre le Maître contre ses contempteurs marxistes. Rapidement, il annonce la couleur :
En étant volontiers marxiste vis-à-vis d’Heidegger, on s’exposait inévitablement à manquer l’essentiel de sa pensée – y compris sa pensée politique.
Mais s’il cite au passage Jean-Pierre Faye et Robert Minder, Lacoue-Labarthe concentre son tir sur Adorno. Pas tant, comme on aurait pu le penser, en se livrant à une analyse critique du Jargon de l’authenticité (dont il ne dit mot) qu’à travers une phrase extraite d’un entretien accordé par Adorno à un journal étudiant ! (Adorno disant : « Heidegger est fasciste dans ses composantes les plus intimes »). Lacoue-Labarthe pose ici la question :
Qu’entend donc Adorno par fascisme ?
Et avance alors que Heidegger en a peut-être dit plus sur le fascisme que son insulteur. À condition, recommande-t-il, de ne pas
considérer le fascisme comme un phénomène « pathologique », mais de reconnaître en lui […] la forme politique peut-être la mieux à même, aujourd’hui, de nous éclairer sur l’essence du politique moderne.
Ah bon ?!! Ne pas traiter le fascisme sous le seul angle pathologique, soit. Mais pour le reste ?

Texte © Max Vincent – Illustrations © DR
L’Imposture Heidegger est une série sur le mensonge philosophique en 13 épisodes.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
