MARK FEATHERSTONE s’entretient avec HÉLÈNE CLEMENTE à l’occasion de la publication de UTOPIE DU CRIME-UTOPIA OF CRIME (D-Fiction, 2012) :
1 – Mark, nous connaissons ton travail à travers un corpus d’articles de recherche parus sur des revues en ligne telles que CTheory ou Fast Capitalism. Peux-tu d’abord nous rappeler le cadre général et l’origine de ton engagement critique, en tant que chercheur enseignant du département de Sociologie et de Criminologie de l’Université de Keele, en Angleterre ?
Je suis né à Hull, une ville située dans le Nord de l’Angleterre, au début des années 70. Cette ville était à l’époque frappée de plein fouet par la crise systémique de notre économie, une crise de l’accumulation, lorsque les bénéfices des entreprises étaient partiellement menacés par les revendications de puissants syndicats anglais qui exigeaient des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail. La réponse de Margaret Thatcher à cette crise prit la forme d’un tournant néolibéral radical de notre économie puisqu’elle chercha à privatiser les services publics, à détruire la puissance syndicale et externaliser l’appareil productif vers des régions du monde plus pauvres que la nôtre. Cette évolution fut fatale à Hull, qui était et demeure encore aujourd’hui, une ville essentiellement ouvrière. Nos cités HLM, héritages urbains utopiques des années 60, se transformèrent rapidement en lieux dystopiques sous les assauts des initiatives thatchériennes. J’ai donc vécu personnellement ce profond processus de décomposition industrielle : la société anglaise abandonna littéralement les habitants de Hull à leur propre sort. J’ai grandi contre cet état de fait. D’un côté, ma ville s’écroulait et je le ressentais à travers l’expérience douloureuse du chômage familial, la fermeture des entreprises et la dévastation du paysage urbain et, de l’autre, j’étais happé par un nouvel univers de méritocratie libérale, absurde où l’éducation primait sur tout. Nous devions avancer coûte que coûte. Comment ai-je pu me transformer en membre à part entière de cette nouvelle élite postindustrielle ? Grâce au soutien de ma famille et à la chance. La plupart de mes amis n’y sont pas parvenus. Le monde se construisait contre nous, les déchets du système, et cette intuition ne m’a jamais quitté. Voilà pourquoi j’ai étudié la sociologie. Et mes recherches sont issues de cette expérience personnelle de la dystopie. Aujourd’hui, j’envisage l’enseignement comme une pratique de laboratoire. Toutes les idées nouvelles peuvent y être testées et communiquées. Les étudiants sont pris très au sérieux car ils font partie de ce processus de recherche dialectique.
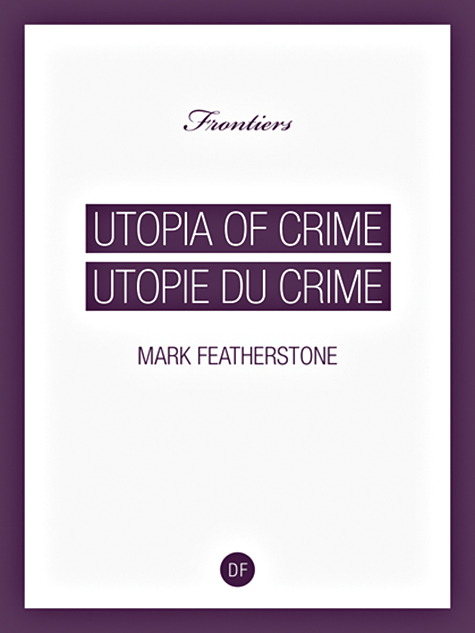
2 – Peux-tu nous décrire plus précisément l’objet de tes recherches, notamment l’étude systémique des espaces dystopiques et la manière dont tu transposes cette étude à l’analyse générale de la société contemporaine capitaliste, globalisée ? Bien que marxiste, tu n’opposes pas la description de ces environnements utopiques ou dystopiques à la réalité du monde politique et social…
Quand j’évoque les notions d’utopie, de dystopie, d’hétérotopie ou de toute autre forme d’organisation spatiale particulière, j’observe avant tout la manière dont la réalité de ces espaces interfère avec d’autres espaces plus vastes au sein d’une société donnée ou du réseau global mondialisé. Je suis profondément influencé par le travail et les idées de Paul Virilio. De la République de Platon au « Dubaï » du Pire des Mondes possibles de Mike Davis (La Découverte, 2006), la structuration spatiale des utopies repose avant tout sur un concept politique. Les utopies contemporaines sont nombreuses, mais leur fondement idéologique est globalement dissimulé. Dubaï est une utopie postmoderne significative du capitalisme tardif. Dans un article récent coécrit avec ma collègue Beth Johnson au sujet d’un film serbe qui a défrayé la chronique et intitulé Un film serbe, je décris comment Milošević, dans les années 90, a conçu la Serbie comme un espace utopique fondé sur le concept de nation ethnique idéale. La dystopie révèle ce qui sépare tout concept politico utopique de sa réalité spatiale. De mon point de vue, c’est véritablement le sujet de toutes les dystopies fictionnelles, comme dans le Nous Autres de Zamiatine : la violence y est dissimulée puisque les individus sont censés s’adapter à l’ordre social imposé par la classe dominante. Dans le cas de Dubaï, la violence surgit dans les rapports de production et de consommation capitaliste. Le film d’horreur Un film serbe démontre parfaitement la relation qu’entretient l’utopie politique avec la dystopie, en transformant sous nos yeux, un état criminel ethnique en dystopie pornographique. J’aime l’idée de Slavoj Žižek quand il décrit la manière dont la Serbie de Milošević s’est transformée en État carnavalesque où la seule règle était qu’il n’y en ait aucune ! Dans le concept d’hétérotopie, il n’y est plus question de qualité d’un espace ni de lieu idéal, de non-lieux ou de mauvais lieu mais plutôt de notion de frontières. Comme dans le concept de « non-lieux » développée par Marc Augé quand il évoque la différence entre lieu et espace : l’espace traversé, le lieu habité. Dans une société caractérisée par le transit et la mobilité, l’individu n’occupe plus les lieux. Encore une fois, il est bien question de qualité. Augé ne s’intéresse pas à la qualité idéologique d’un lieu mais en remarque plutôt l’absence. Ses espaces vides ne renvoient qu’au déplacement. Certes, cet attachement au mouvement et à la mobilité est en soi idéologique. Mais ces lieux sont fondamentalement présentés comme post idéologiques. L’accent est mis sur la frontière et sur la qualité des déplacements dans l’espace. La raison pour laquelle cette notion d’hétérotopie ou de non-lieux prime sur celle d’utopie ou de dystopie marque bien, de mon point de vue, la fin déclarée de l’idéologie. Or si tel est le cas, alors nous devons nous interroger sur l’émergence de tels espaces. Si leur raison d’être n’est ni idéologique, ni caractérisée par leurs différences idéologiques, alors qu’est-ce qui les définit véritablement ? Ma théorie est la suivante : dans notre société de réseaux post politique et ultra capitaliste, l’essence de ces lieux résulte de la fonction qu’ils occupent dans l’espace de l’économie globalisée. En tant que marxiste, je considère l’économie comme primordiale. Je recherche les caractéristiques économiques de Dubaï, « ville-entreprise » multinationale qui agit comme un État, tout comme je recherche les origines économiques de l’utopie serbe. On pourrait considérer que l’utopie ethno nationaliste de Milošević est née de la guerre froide, sur les ruines de la guerre idéologique entre le communisme et le capitalisme. Si l’utopie n’est rien d’autre que cela en raison de la fin des idéologies, l’utopie serbe serait le dernier soubresaut de l’Utopisme. Idée que je partage avec Žižek, notamment. Donc, dans une société où il n’y a, a priori, plus d’utopies, je me concentre sur la banalité des espaces hétérotopiques contemporains en essayant d’en extraire le concept d’inégalité. Je travaille, par exemple, sur les lotissements sociaux au Royaume-Uni, l’équivalent de vos banlieues, et plus particulièrement, sur ma ville natale. Dans les années 60-70, ces espaces tentaculaires ont d’abord été conçus comme des lieux communautaires utopiques, pour accueillir une classe ouvrière vieillissante. Puis, saccagés dans les années 80 et transformés en décharge urbaine pour parquer le nouveau sous-prolétariat des exclus du système économique quand il devient évident qu’ils ne pourront plus s’adapter aux règles du néo-capitalisme. Dans ce volet de mes recherches, je suis très influencé par Loïc Wacquant et son travail sur la marginalité spatiale et l’exclusion sociale. Les symptômes de ce processus sont visibles partout en Angleterre. Derrière chaque lotissement social dystopique, se cache en miroir, une utopie capitaliste étincelante, comme celle des Dockland de l’Est de Londres, par exemple. Bien entendu, ces espaces ne se rencontrent jamais. Ils sont totalement clos, insularisés, séparés les uns des autres par un ensemble de dispositifs sécuritaires, fondés sur les idées popularisés par Oscar Newman dans les années 70, autour du concept d’espaces défensifs. La manière dont ces espaces sont tenus à distances les uns des autres et leurs différences a priori insurmontables, au point qu’ils semblent ne plus appartenir au même monde, génèrent précisément cette illusion post idéologique. Simon J. Charlesworth parle de Royaume des-Unis. La condition post idéologique de dés-union est une condition globale, inscrite dans l’ADN de ces espaces utopiques, dystopiques, hétérotopiques. Mon travail consiste a contrario à les reconnecter entre eux et à remettre le concept politique au centre du discours quotidien.
3 – Comment transposes-tu le concept de recherche d’« Utopia as Method » dans le quotidien de ton enseignement ?
J’ai recours aux dispositifs utopiques ou dystopiques, comme visions fictionnelles engagées. L’utopie comme méthode de recherche fonctionne sur un mode expérimental : dans mes cours, tous les scenarii sont envisagés, éprouvés avec mes étudiants. L’utopie contient toutes les potentialités qui m’intéressent : l’imagination, le jeu interactif, la spéculation, la critique et la révolution. Je demande aux étudiants d’éprouver toutes les hypothèses, de les critiquer, de les pousser à bout. J’expérimente la description des formes sociales jusqu’aux limites les plus extrêmes. J’encourage les étudiants à être les plus critiques possibles, à être ré-actifs. La pensée critique est en elle-même utopique dans notre monde clos et normé. Penser est en soi, aujourd’hui, un acte utopique, de résistance dont il ne faut pas sous-estimer la force. Nous avons tendance à l’oublier, nous souffrons de myopie ou d’amnésie. Car rien ne doit venir rompre le circuit court de notre vision d’un monde parfait, cette utopie froide ou dystopie pour citoyens consentants : l’utopie, pensée comme une ignorance bienheureuse, une figure close, « l’Ile » de Louis Marin, métaphore parfaite de la clôture de l’espace utopique et de la nature circonscrite de son essence.
4 – Dans ton texte Utopia Bodies, tu insistes sur la manière dont le système techno-économique instruit une certaine dissolution du corps social, voire du corps tout court. Tu explores les dangers d’une « crise » démocratique en rappelant les sources idéologiques du Futurisme ou la part sombre de notre devenir cybernétique.
Nous vivons au rythme de la technologie plus qu’au rythme de nos corps humains. Dans « Utopian Bodies » et « Welcome to The Hotel California », je prends comme objet d’étude l’État de Californie, qui est à mes yeux, un laboratoire exemplaire. Il pose les conditions dans lequel l’individu tente d’échapper à la fragilité du corps humain et à sa condition. Une société de consommation où tous les désirs peuvent s’accomplir. Hollywood est la machine culturelle à fabriquer des utopies et des mondes fantaisistes. La Silicon Valley, le lieu où la recherche postule la dissolution du corps dans une pure virtualité. Et l’industrie pornographique hardcore californienne instrumentalise le corps en machine à plaisir. Qu’Arnold Schwarzenegger soit devenu le gouverneur de cet État est très significatif : en tant qu’ancien bodybuilder et authentique Terminator et comme sympathisant nazi. Je vous conseille de lire le grand livre de Laurence A. Rickels sur la condition californienne, The Case of California (Johns Hopkins University Press, 1991). Ce qui me ramène à cette question du fascisme inhérent à toute utopie cinétique de la vitesse sur lequel il nous faut rester vigilant. De Marinetti aux utopies technologiques des années 20 et 30, il y a là une haine absolue de la fragilité humaine, du corps perçu comme une barrière ou une frontière : du corps-tombe socratique et des assauts furieux des premiers chrétiens contre le corps charnel jusqu’aux dernières utopies cybernétiques. En réponse à Donna J. Haraway ou à Stelarc, je pense que toute notion de post humanisme occulte la violence faite à l’humanité dans son passage vers l’état cyborg. Le corps, la densité du corps humain doit être un élément clé dans l’élaboration de notre raisonnement. Virilio défend très simplement le corps, s’attache à la peine qui lui est infligé et coupe court à tout effet de science-fiction lié à la pensée cybernétique.
5 – Tu insistes sur la structuration du temps comme puissant levier de gouvernance des individus. Dans le roman que tu citais, Nous Autres de Zamiatine, le comportement et les actions des individus sont littéralement réglés par une Table des Heures…
Historiquement, la maitrise du temps social a toujours été un outil efficace de contrôle des populations, comme le démontre, Edward P. Thomson, dans son ouvrage The Making of The English Working Class (Vintage Books, 1966) ou Michel Foucault dans son « Homo Economicus ». Nous percevons clairement ce qu’est la dystopie du contrôle social par la diffusion de l’emploi du temps. Les technologies et les systèmes de communication ont tout accéléré, l’élite mondiale est certes hyper mobile mais le temps est toujours puissamment déterminé par le pouvoir. J’utilise volontairement le terme foucaldien de pouvoir car je prends mes distance avec l’idée selon laquelle personne ne superviserait ce nouvel empire du temps. Les technologies cognitives permettent aux individus de voyager en « embarquant » leurs univers de travail sans interrompre les circuits connectés du système productif postfordiste. Je pense que c’est la façon dont Michael Hardt et Toni Negri conçoivent la dimension productive de l’Empire quand ils évoquent la forme communicationnelle du capitalisme. C’est également ce mode de production qui instaure ce que David Harvey qualifie de compression de l’espace-temps. Pour ce dernier, cette compression est l’un des éléments déterminants de l’expérience postmoderne, le rétrécissement de l’espace et du temps par l’immersion de chaque individu dans un univers de haute technologie.
6 – Comment relies-tu cette compression de l’espace-temps et ses manifestations – l’immobilisme politique, la violence sociale – aux métamorphoses de la nouvelle chaîne alimentaire capitaliste ?
Au bout de cette chaine alimentaire capitaliste, à l’opposé d’une élite globalisée traversant la planète de part en part à la vitesse de la lumière, survit une classe nomadisée, constituée de déplacés, de réfugiés de la condition mondialisée. L’anthropologiste français Michel Agier étudie ces populations en démontrant comment les politiques néolibérales s’adressent à elles sur le mode unilatéral de l’enfermement et de la détention. À ce stade, la grande mobilisation du capitalisme global – ce que nous pourrions appeler la mobilisation intégrale en référence à Ernst Jünger – devient un verrouillage général marqué par la prolifération et la diversification des espaces clos pouvant être perçus comme autant d’utopies, de dystopies ou d’hétérotopies. Ils sont le complément inversé des espaces « ouverts », des plateformes de transit et de mobilité. Dans un article publié dans Terre natale : Ailleurs commence ici (sous la direction de Paul Virilio et Raymond Depardon, Fondation Cartier pour l’Art contemporain 2008, rééd. Actes Sud, 2010), Marc Augé développe l’idée selon laquelle les non-lieux ne sont pas simplement l’apanage d’une élite mais également les lieux d’exercice du pouvoir visant à isoler les résidus excrémentiels de l’ordre néolibéral.
7 – Et des possibles conditions de préservation d’un temps de la pensée ?
La mobilisation de l’élite mondialisée s’effondre sous le symptôme psycho politique de l’inertie ou de la lenteur absolue. Que la vitesse exclue ou empêche toute possibilité de penser rationnellement, de relier les causes aux effets, l’instabilité nous empêche d’avoir une prise quelconque sur l’événement. Dans un tel contexte, la vieille idée d’un possible changement social construit, rationnel et motivé est jetée par la fenêtre, au profit de la notion de prise de risque, où chaque individu doit tenter sa chance sur la base de l’intuition ou du pari. Nous sommes dépendants de nos pressentiments et de notre intuition, d’un mode de penser flash. Encore une fois, cette culture, que nous pourrions appeler culture de la cruauté pour reprendre l’expression de Henry Giroux, traduit une expression très particulière du pouvoir dans une société de la vitesse. Notamment parce qu’elle nourrit un type de capitalisme – le néo-capitalisme libéral – fondé sur une conception violente et très combative de la vie.
8 – Tes recherches portent précisément sur l’étude des violences systémiques. Quel regard portes-tu sur les théories du désastre ou les expressions d’un messianisme apocalyptique, y compris dans leur interaction avec les stratégies de pouvoir ?
Les théories sur une catastrophe globale, les écrits de Ulrich Beck, de Paul Virilio, de Slavoj Žižek etc., sont certes extrêmement violents mais ils reflètent la violence de nos États néolibéraux. Comme l’explique Žižek dans son livre sur la violence, la violence systémique endurée par chaque individu au quotidien est l’une des manifestations la plus destructrice de la violence contemporaine. Bien évidemment, il existe des désastres ou des événements proprement apocalyptiques sur une « échelle biblique », mais il ne faut pas oublier la violence permanente du système global qui, pour reprendre les termes de Walter Benjamin, empile décombres sur décombres et produit un système qui se nourrit de ses propres destructions. J’ai publié un article sur la valeur de la ruine, dans le Journal of Cultural Research, dans lequel j’étudiais les liens entre Ernst Jünger et Walter Benjamin, à travers l’exploration de la théorie de la « Valeur des Ruines » d’Albert Speer. Mon argument initial était que Jünger adoptait une position proto-fasciste des concepts de ruine et de destruction, la destruction apocalyptique engendrant de la valeur en permettant l’émergence du surhomme. J’insistais sur le messianisme de Walter Benjamin quand il évoque la nature destructrice de la modernité et le fait qu’il nous est possible de sauver quelques valeurs humaines des décombres de l’apocalypse. Pour Benjamin en effet, ce type d’événement peut être porteur de valeurs utopiques. À l’époque, je n’ai pas élargi mes analyses à la dynamique globale du capitalisme, notamment en explorant la théorie de Joseph Schumpeter sur la valeur créative de la destruction. Plus tard, j’ai été frappé par l’ouvrage de Naomi Klein quand elle évoque que le système capitaliste contemporain se construit sur la destruction et le désastre. Cette conception était déjà présente chez Marx et Schumpeter, mais Klein démontre comment le capitalisme contemporain produit lui-même ses propres désastres – en Irak, comme en Afghanistan, autant de terrains fertiles pour organiser le transfert massif de richesse et de souveraineté depuis la sphère publique vers la sphère privée. C’est le point fondamental, ce même processus est en cours actuellement au Royaume-Uni. En adoptant une approche économique apocalyptique, le secteur privé tire les bénéfices de ce vaste démantèlement, tout ce qui relevait du secteur public relève désormais d’entreprises privées, juteuses pour les actionnaires qui les détiennent (santé, police, armée, éducation, etc.). Nous travaillerons bientôt tous pour Tesco ou Wal-Mart. Bientôt, ces entreprises se tourneront vers le marché de l’éducation. Du strict point de vue du marché, elles se débrouilleront mieux que les universités. Nous étions déjà dans un contexte très difficile, mais cette situation va empirer avec l’élimination planifiée des classes moyennes qui s’en prendront nécessairement à ceux qui sont en dessous d’eux dans la chaîne alimentaire pour justifier leur situation désespérée. Nous assisterons donc, dans la prochaine décennie à l’américanisation progressive de la société britannique. Et par américanisation, je ne parle pas d’expansion du consumérisme mais de la montée du complexe pénitencier industriel, de la montée en puissance des phénomènes de ghettoïsation et de marginalisation avancée. Je ne partage pas l’optimisme de Jean Baudrillard sur nos perspectives d’opposition à la « réalité intégrale ». Le système global génère ses propres désastres, et le cycle est maintenant plus ou moins accompli. Nous habitons une réalité intégrale, toute forme de déviation, de désastre ou de panne est pratiquement irréparable. Nous devons donc dévoiler l’horreur du désert du réel. Ne pas normaliser de tels événements désastreux. Montrer comment ils ont été produits, voire élaborés dans la réalité intégrale du système économique mondial.
9 – Dans tes études sur la violence, tu t’appuies sur les travaux de Henry Giroux qui décrit les conditions d’émergence d’une « culture de la cruauté ». Peux-tu nous décrire ce qu’est cette « culture de la cruauté » et son impact sociétal ?
Dans Le Complexe du loup-garou (La Découverte, 2004), Denis Duclos décrit notre fascination quasi mystique pour la violence. Le fait qu’une minorité d’individus vampirise la classe moyenne ainsi que les plus démunis, ne dérange plus personne. La société est désormais un lieu où s’épanouit l’ultra compétitivité, un espace de confrontation entre gagnants (les élus) et perdants (les damnés). Derrière le Thatchérisme ou le Blairisme, on retrouve le Léviathan de Thomas Hobbes, « l’homo homini lupus », l’homme est un loup pour l’homme. Dans l’Angleterre contemporaine, l’homme est définitivement un loup pour son prochain. Nous ne sommes, certes, pas retournés à l’état de nature mais notre conception de la civilisation résulte d’un mélange violent de socialisation forcée, de répugnance, de mépris envers autrui et de brutalité. Nous devrions repenser à Freud. Le loup-garou contemporain est le capitaliste ultra compétitif, l’homme à peine civilisé qui met à rude épreuve les liens sociaux. Voilà ce qu’il nous faut comprendre aujourd’hui. Le système anglo-américain est largement hégémonique, cette situation est globalisée. Dans ce contexte, le travail de Henry Giroux est essentiel. Bien que la machine économique anglo-américaine ait connu des jours meilleurs, l’imaginaire culturel qui la soutient est en parfaite santé. Il est difficile d’adopter une toute autre perspective. La culture de la cruauté et son « enseignement » normalise la violence. Des séries TV ou des films tels que Saw, des jeux vidéo comme Grand Theft Auto font partie d’une machinerie industrielle et culturelle de normalisation de la violence et de la cruauté.
10 – En quoi, selon toi, sommes-nous à la fois acteurs et spectateurs agissant de cette culture de la cruauté ? Tu fais référence à Sade – que tu qualifies de penseur majeur pour comprendre notre XXIe siècle et l’état de la société contemporaine…
Cette culture est normalisée, puisque la cruauté, la violence et les mauvais traitements font partie intégrante du système dans lequel nous évoluons et de notre société du spectacle. Nous sommes les spectateurs et les consommateurs de ce culte de la cruauté à travers les médias que nous consommons. Nous finissons par oublier que derrière ce spectacle, les gens éprouvent d’abord une grande souffrance. Dans mon essai Utopie du Crime-Utopia of Crime : La culture de la cruauté dans l’utopie cinétique-The culture of cruelty in Kinetic Utopia que je publie chez vous, j’étudie les racines de cette industrie de la cruauté et j’explore l’influence majeure qu’exerce la pensée philosophique du Marquis de Sade. Il est de mon point de vue, le grand penseur oublié du XXIe siècle et un des auteurs clé pour comprendre le néo-libéralisme. Dans cet essai, mon propos essentiel est d’éclairer les liens qu’entretient le consumérisme avec la brutalité et le plaisir. Nous consommons la souffrance d’autrui et retirons du plaisir de l’humiliation que nous exerçons. En détruisant l’autre, j’évolue – en quelque sorte – parmi les outsiders de la grande course sociale. Giroux donne à la logique capitaliste et son concept d’avantage compétitif un tour sadique. Ainsi, après les concepts marxistes et néo marxistes de la valeur – l’utilisation, l’échange et la valeur symbolique – émerge une vision sado marxiste de la valeur capitaliste, fondée sur la jouissance et l’humiliation. L’autre est un objet précieux tant que je peux en jouir et abuser de lui : après la valeur d’usage, la valeur d’abus.
11 – Revenons sur ce concept de « valeur d’abus ». Il nourrit ta vision très martiale de l’économie, proche en cela de Deleuze et Guattari ou même de Freud, la pulsion de mort comme ressort de nos rapports de production ?
Je m’inspire des notions de « machines de guerres » de Gilles Deleuze et Félix Guattari quand ils conçoivent le capitalisme comme une machine de guerre nomade qui s’étend, colonise et brutalise. J’apprécie, par ailleurs, les récents travaux de Scott Wilson sur le capitalisme et la violence, The Order of Joy (State University of New York Press, 2008) et The Great Satan’s Rage : American Negativity and Rap/Metal in the Age of Supercapitalism (Manchester University Press, 2008). Wilson réinscrit parfaitement la pensée de Deleuze et Guattari dans le contexte américain. Nous avons sous les yeux une nation puritaine fasciste – du point de vue de la psychologie si nous nous reprenons les travaux de Georges Bataille sur la psychologie du fascisme. L’essence puritaine traverse cette nation qui cherche à façonner le monde à l’image de Dieu. Cette idée puritaine produit, par ailleurs, toutes sortes de désirs pathologiques pervertis. Compte tenu du caractère répressif du puritanisme, il n’est pas surprenant que le désir émerge d’une façon tordue sous la forme d’une « valeur d’abus ». Cette conception puritaine du monde légitime le fait que chacun se sente bien en prenant plaisir à abuser l’autre, nécessairement déjà « pécheur » et condamné. La torture est un signifiant culturel fondamental de la culture américaine. L’Amérique est une nation hyper morale et hyper sexuelle. Les deux pôles sont indiscernables – le moralisme américain est sexuel et le sexe américain est moralisé. En conséquence, sa moralité n’est pas très morale et sa conception du sexe n’est pas particulièrement sexuelle. Pour le dire autrement, la morale américaine est obscène et le sexe américain est puritain. Obama a tenté, en vain, de s’écarter de la reconnaissance explicite du lien qu’entretient l’Amérique avec la torture (Guantanamo) mais, je pense que cette nation est, et a toujours été, torturée et torturante, entre morale et violence sexualisée exercée contre soi et les autres.
12 – Dans chacun de tes articles, tu fais référence à un registre de langage particulier, qu’il soit visuel, théorique, technique ou scientifique (le « transhumanisme ») – et d’une possible interactions entre les constructions systémiques du capitalisme tardif et leur impact sur le monde dit réel. Peux-tu nous apporter quelques éléments de précision sur ce territoire particulier qu’entretiennent le(s) langage(s) avec le(s) système(s) ?
Je suis, avant tout, un théoricien de la culture. Quant j’étudie la série TV américaine, The Wire, je m’intéresse à l’usage du concept de Jeu. Dans The Wire, la machine autoritaire serbe, que j’évoquais tout à l’heure, est remplacée par « Le Jeu », sorte de machine capitaliste corrompue qui abuse de tout et de tous. Criminels, policiers, politiciens, syndicalistes et journalistes font partie intégrante du dispositif. Quand j’étudie la question du logement social au Royaume-Uni, j’analyse la place du discours politique. J’observe l’interaction entre un espace particulier – un lotissement de logements sociaux – et l’ensemble des discours officiels sur la rénovation sociale ou urbaine, très populaires. Ces brochures gouvernementales sont autant de dispositifs fictionnels utopiques. Les utopies ordinaires, personne ne semble en remarquer la folie. Nous les acceptons et dans une certaine mesure, nous contribuons tous à les faire exister.
13 – Parlons d’un possible aménagement d’un espace imaginaire critique…
Nous devons instaurer un espace critique adapté au monde contemporain de la vitesse en permettant à chacun de trouver la ressource nécessaire pour penser différemment. Cette procédure est évidemment complexe. Comment instaurer un tel espace ? En radicalisant notre vision du monde contemporain et en créant un imaginaire dystopique. Nous devons restituer l’étrangeté de notre monde. La question essentielle est : qu’est-ce que la critique aujourd’hui ? N’importe qui peut percevoir la critique comme la simple expression d’une individualité destinée à interpeler la sensibilité d’un consommateur ou séduire sa quête identitaire. La « Critique » pourrait même passer pour une expression conformiste de l’innovation et de « l’esprit critique ». Je ne suis pas certain qu’il y ait cependant une autre voie. La « Critique » doit atteindre une plus large diffusion à travers des textes « prêts-à-consommer ». Certains parient sur le fait que la teneur critique du texte demeurera, d’autres craignent l’ensevelissement de tout texte critique dans la masse des productions culturelles. Il faut espérer que chacun comprenne la teneur hautement transgressive de nos textes critiques et participent de la diffusion et préservation de ces fonds. La pensée critique n’est pas seulement trop lente ou trop lourde pour une société fondée sur la vitesse, la fluidité et la liquidité, mais nos institutions du savoir transforment la connaissance en pépites d’informations « bankables » sur le marché des connaissances. Nous ne devons pas simplement nous préoccuper de la migration de notre société vers l’info-tainment mais également des conséquences de la ruine de l’Université.
//
Vivre dans les ruines d’Utopie : traduction vidéo
Comme chez de nombreux d’auteurs, mon identité de sociologue est influencée par mon histoire personnelle. J’ai grandi dans les années 70 – 80 au cœur d’une cité urbaine de Hull, située dans le Nord de l’Angleterre. Dès l’origine, dans les années 60, les quartiers de ma cité matérialisaient l’expérience utopique d’une formalisation de l’espace et du vivre ensemble. Les urbanistes pensaient résoudre tous les problèmes de l’après-guerre en restructurant le mode de vie de la classe ouvrière par le contrôle de l’espace. Les circonstances historiques ont démontré le contraire. Dix ans plus tard, les rêves d’accès à la propriété au sein des communautés urbaines utopiques ont viré au cauchemar, ces lieux sont rapidement devenus dystopiques, marqués par un taux de chômage élevé, une fragmentation sociale forte, l’anomie et le crime.
Le concept de grands ensembles était vicié à la racine, puisque le but de ces espaces « innovants » consistait à arracher les individus de leur environnement d’origine, à les parquer ailleurs, mais les changements politiques et sociaux, la montée du néo-libéralisme ont conduit à la transformation de ces endroits en dystopies misérables.
Mon adolescence a été marquée en profondeur par l’expérience du chômage de mes parents, de la pauvreté, de l’absence de perspectives et le sentiment persistant d’un avenir hypothéqué. J’ai exploré les paysages en ruines de Hull, partagé entre inquiétude et curiosité. Pour les enfants que nous étions, partagés entre l’excitation et la frayeur, ces ruines, ces entrepôts désaffectés, ces quais déserts et tous les lieux industriels à l’abandon ont été de grands espaces de transgression à explorer.
Ces ruines racontent aujourd’hui l’histoire d’un déclin, d’une décadence et d’un effondrement. Elles signalent la mort d’une certaine société, celle de ma propre famille et de la vieille classe ouvrière anglaise. Comme nous ne pouvions plus vivre dans ces ruines obsédantes, pourtant calmes et sereines, nous sommes partis vers les utopies des grands ensembles, aménagés à notre intention, alors qu’ils amorçaient déjà leur mutation vers la fragmentation sociale.
Avant ma naissance, ces lieux étaient pourtant porteurs de promesses pour les classes laborieuses, mais ils se sont transformés en prisons urbaines, à l’écart du reste du monde, véritables machines à broyer les individus de l’intérieur.
Dans certaines villes, cette ségrégation était évidente parce que les riches côtoyaient les pauvres, qui avaient alors une conscience aigué de leur propre pauvreté, mais à Hull, ce contraste n’existait pas car toute ville a été ravagée par le déclin industriel. J’ai grandi entre ces ensembles et les reliques urbaines d’une classe zombie, celle des vieux ouvriers qui hantent les nouveaux paysages de l’Angleterre néolibérale, celle d’un sous-prolétariat de morts-vivants.
En évoluant dans un tel contexte, je me suis socialisé par la lutte de classes qui opposait la classe des zombies en voie de sous prolétarisation et la nouvelle élite néolibérale brillante, portée au pouvoir par Margaret Thatcher. Je me vois toujours comme un enfant rescapé de cette guerre de classes. J’ai vu mourir la classe sociale à laquelle j’appartenais comme j’ai vu ressurgir d’entre les morts un sous-prolétariat de morts-vivants.
J’ai vécu l’horreur mais j’étais suffisamment jeune pour migrer vers les territoires des élites éduquées, tout en gardant au fond de moi ce sentiment profond d’appartenance à la classe des vaincues. Jamais je ne pourrai oublier mes origines sociales, le chômage, le découragement de ma communauté, la montée en puissance de la criminalité parmi mes proches qui considéraient le monde comme vide de sens et dans lequel rien ne comptait et tout pouvait arriver.
Projeté dans cet univers Hobbesien Nietzschéen, tout en ne pratiquant pas encore la langue de l’aristocratie économique, ma première expérience sociologique a été la lecture des travaux de Marx sur le communisme. La langue de l’exploitation, de l’aliénation et de la lutte m’a éclairé sur ma propre réalité et influence toujours la manière dont je perçois le monde aujourd’hui. Je n’ai pas seulement compris le sens de l’injustice dans un monde profondément inégalitaire, j’ai physiquement ressenti l’inégalité, l’aliénation et le désespoir et j’ai pu littéralement parcourir ces sentiments à travers les territoires de ma ville et constater à quel point les espaces anomiques de ce nouveau sous prolétariat incarnaient l’état dans lequel j’étais, le produit d’une socialisation chaotique au sein d’une lutte et d’une déchéance sociale.
Cette existence m’a amené à la pratique de la sociologie, plus qu’à la philosophie ou toute autre pratique, sans que l’accès à l’université néolibérale ne représente un idéal ou une utopie. L’université, déconnectée de la nature profonde de mon expérience personnelle, a accentué mon sentiment d’aliénation. La sociologie anglaise me laisse encore indifférent parce que je ne me reconnais pas dans cette idée d’une sociologie comme instrument technique pour penser la société ou la reformer sans remettre en question les relations de pouvoir… Où se situe le monde dans un tel contexte ? Et à quoi servent les expériences humaines dans ce modèle ? Comment s’exprime l’imagination radicale dans ce modèle de pensée ? Où se manifeste le désir de changement ? Il n’y en a aucun. C’est une sociologie sans espérance. Marx conserve aujourd’hui sa puissance d’inspiration, quand il décrit la grandeur humaine, notre potentielle d’action sur le monde, quand il nous pousse à exprimer radicalement notre créativité. Ces qualités, que je retrouvais chez les personnes que je côtoyais enfant, je continue de les voir s’exprimer aujourd’hui, notamment chez les enfants projetés dans un environnement social pourtant peu réceptif à ce type de potentiel.
J’ai toujours eu une vision marxiste du monde comme j’ai toujours rejeté les réponses avilissantes aux horreurs du capitalisme comme le consumérisme et le culte de l’argent. Ces réponses ne comblent pas les failles creusées par le capitalisme.
Au cours de mes recherches et en tentant d’échapper au conservatisme de la sociologie britannique, je me suis naturellement intéressé aux théories critiques des auteurs de l’École de Francfort. Tout comme mon professeur John O’Neill, ces auteurs m’ont enseigné à penser différemment, à considérer la sociologie comme une pratique humaine radicalement imaginative. Cette expérience de pensée m’a conduit à l’étude des théories et des espaces utopiques. En débutant par Platon, puis More et tous les grands penseurs utopistes, avant de revenir aux utopies ordinaires, banales de nos villes contemporaines, aux espaces construits ou détruits sur la base de concepts utopistes, comme à Hull. À l’opposé des défenseurs de la rénovation urbaine qui espèrent sauver ces endroits en leur apposant un nouvel habillage néolibéral, je ne crois pas une seule seconde que le prolétariat puisse y être sauvé, le capitalisme se construit sur un rapport de force, celui des gagnants contre les perdants, en jetant certain d’entre eux dans la grande poubelle de l’Histoire.
C’est la raison pour laquelle ces territoires dystopiques présents ou futurs agissent comme un rappel permanent de la lutte des classes et des crimes du néo-libéralisme. Les ruines industrielles peuvent être étudiées comme autant de scènes de crimes du néo-libéralisme pour une meilleure perception de l’histoire de notre société. Nous avons besoin d’un tel projet critique, plus que jamais, alors que nous sommes entrés dans une nouvelle phase du crash néolibéral, qui engendrera de nouvelles ruines. Nous constatons quotidiennement l’émergence de cette nouvelle ère des ruines, dans nos villes, comme autant de traces excrémentielles nous rappelant comment l’économie apocalyptique s’est emparée de nos vies. J’ai une conscience aigue de notre besoin d’une nouvelle critique du capitalisme. Contre les techniciens universitaires qui cherchent simplement à faire mieux fonctionner la société néolibérale, j’ai la profonde conviction que nous devons résister à cette nouvelle vague de ruines, que nous devons nous opposer à l’idée de l’économie apocalyptiques qui valorise la ruine et l’abandon en milieu urbain, parce que nous ne devons pas condamner nos enfants à vivre l’anomie.
Entretien © Mark Featherstone & Hélène Clemente – Vidéo © Isabelle Rozenbaum – Traduction © Hélène Clemente – Illustrations © DR
(Pantin, mars 2012 – Keele, Staffordshire, déc. 2012-fév. 2013)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.