MATHIAS ÉNARD s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son roman, ZONE (Actes Sud, prix Décembre 2008 – prix du Livre Inter 2009 – prix Candide 2008 – bourse Thyde-Monnier SGDL 2008 – prix Cadmous 2008 – prix Initiales 2009) :
1 – Mathias, dans ton parcours biographique, il y a d’abord – officiellement du moins – à la fois des études d’arabe et de persan, et une pratique de la poésie. Parle-nous de ce choix, vers quel type d’existence te dirigeais-tu à l’époque ? Quels étaient tes rapports à l’écriture ?
Vous avez raison quand vous évoquez une biographie « officielle ». Les choses sont plus complexes qu’elles n’y paraissent ; tout comme l’arabe ou le persan, la pratique de la poésie est accidentelle. Elle vient de la rencontre avec l’atelier Franck Bordas et le lithographe Thomas Marin. À l’époque, ma vie c’était l’art contemporain. Je regardais travailler Gilles Aillaud, Joan Mitchell, Daniel Pommereulle et toute la figuration libre qui triomphait à l’époque, Robert Combas, Hervé Di Rosa, François Boisrond. J’ai sorti quelques-unes de leurs estampes de la machine. C’était ça l’important. La poésie, l’écriture, c’était ce que je savais faire de mieux pour séduire les filles (sans aucun succès d’ailleurs) – c’est-à-dire rien d’important. J’étais (je reste) très mauvais poète. La rencontre avec le monde arabe vient d’une passion dévorante pour les voyages, quelque chose de bipolaire ; je n’avais qu’une envie, c’était de rester à Paris dans ce monde de l’art qui me fascinait, et je ne pouvais pas m’empêcher d’en partir, parce que je ne me sentais pas à la hauteur de mes désirs. Le syndrome du provincial, peut-être ?
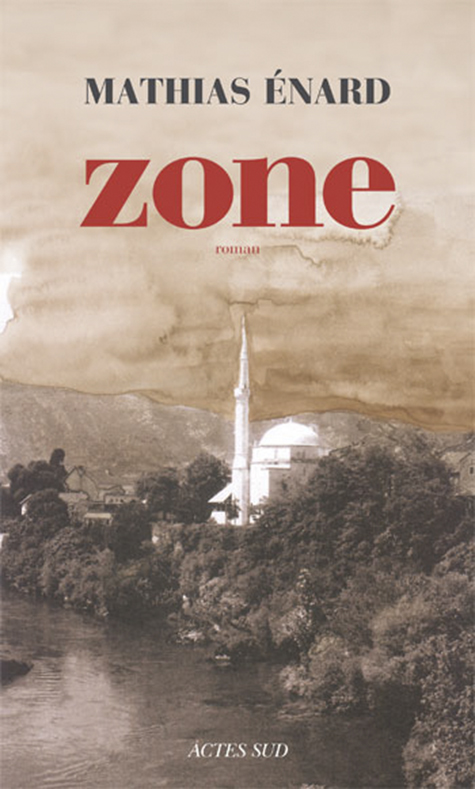
2 – Dès La Perfection du tir (Actes Sud, 2003), tu construis une voix narrative très complexe. Le narrateur, un jeune sniper, raconte au passé, non pas ses aventures, mais son travail de soldat au jour le jour. Cela conduit à un brouillage temporel très spécial qui rejoint l’incertitude spatiale. D’un côté la ville sans nom, que l’on imagine située quelque part à l’Est de la Méditerrané, mélange de Beyrouth, de Dubrovnik ou de Sarajevo et, de l’autre, un décalage temporel où le narrateur ne semble guère prendre de distance avec ce passé : il n’explique rien, d’une certaine manière il n’a pas changé, il est toujours dedans, dans le présent indéfini de l’action en cours mais qui ne l’est plus. Parle-nous de la conception de ce livre, de son process d’écriture, de son dispositif, du choix thématique.
La Perfection du tir est le premier livre que j’ai considéré comme ayant une certaine force, comme pouvant aspirer à une possible publication. Il est né d’une colère. À l’époque je m’étais fâché avec l’université, j’avais quitté Téhéran sur un coup de tête, j’errais entre Beyrouth et Barcelone sans savoir quoi faire de ma vie, j’avais écrit un premier roman nullissime, sans sujet et sans écriture, je n’avais plus de projet professionnel, j’allais avoir trente ans. Dans un coin de ma tête, et de mes carnets, j’avais toutes ces histoires libanaises qui me hantaient, mais que je ne savais pas comment raconter. Et un jour, je me souviens, dans mon jardin à Beyrouth, au tout début de l’an 2000, je me parlais à moi-même sur une feuille de papier. Je savais que j’avais envie d’écrire un livre. Je me suis demandé ce qui comptait à l’heure d’écrire, à part la phrase de Cendrars, selon laquelle il faut savoir aller jusqu’au bout. Le plus important c’est le souffle, j’ai écrit. Et le rapport avec un tireur seul sur un toit m’est apparu immédiatement. Pour plagier Le Lotus bleu : il faut trouver la voix. J’avais trouvé la voix du narrateur, j’avais l’intuition que ces récits ne s’emboîteraient que s’ils étaient tenus par cette voix unique, étrangère à elle-même et au monde dans lequel elle évolue. Une intelligence presque enfantine, à la fois subtile et brutale, qui rêve de remettre de l’ordre dans l’univers, mais qui ne sait s’exprimer que dans la violence. J’ai écrit le livre en m’appuyant sur ce personnage.
3 – À plusieurs reprises, il y a des correspondances qui font du récit un genre de système en miroir ou tel référent renvoie à un autre. Ainsi, le personnage de Myrna est-elle parfois décrite comme une arme à culasse, crosse, trou, etc. Cela renforce la dimension fermée propre au lieu du récit, la ville fermée sur elle-même, en proie à une guerre dont ses habitants ne sortent pas, le siège, etc. Tout se reflète dans tout, les morts dans les vivants, les « copains » dans ceux d’en face, etc. D’une certaine manière, n’est-ce pas une désignation du fonctionnement du livre lui-même ?
Oui et non. Tout se reflète, c’est certain. L’absence de géographie réelle, de noms propres, de toponymie précise ajoute sans doute à l’effet d’enfermement. On pourrait même tenter une approche symbolique et voir dans l’arme du narrateur un sexe inutile, froid et sans amour. Ou au-delà, une métaphore de l’écriture elle-même. Peut-être. Sans doute. Néanmoins je n’y pensais jamais. Ce qui m’intéressait à l’époque, c’était décrire certaines réalités de la violence de guerre, et notamment le plaisir qu’elle peut procurer, le pouvoir, la jouissance, l’amitié. C’est ce qui m’avait le plus choqué dans le témoignage de certains combattants : à quel point, ils regrettaient la guerre.
4 – Peux-tu revenir sur le régime stylistique du livre ? C’est un monologue mais très peu disert, avec des phrases souvent courtes. C’est sans doute ton récit le plus froid, le plus factuel, avec cependant déjà, surtout lorsque le narrateur évoque son art de combat, son rapport au tir, ou bien à la fin, avec la mort de Myrna, une dimension lyrique qui va s’épanouir dans d’autres livres.
Je me souviens que je me suis battu contre moi-même pour éviter le lyrisme, justement. J’ai soigneusement gommé tout ce qui me ramenait à ma période antérieure, celle de la littérature comme niaiserie. J’ai essayé d’écrire un livre qui soit la trajectoire d’une balle, et rien d’autre. La première version était encore plus froide que celle que l’on peut lire aujourd’hui. Glaciale. Finalement, j’ai rajouté du sentiment, un peu de ce lyrisme, comme vous dites, que j’avais si soigneusement retiré.
5 – Quelles étaient tes lectures à cette époque, écrivais-tu « accompagné » ? De manière générale, écris-tu avec des influences précises pour chaque livre ? L.-F. Céline a été très important pour toi…
Le problème, c’est que j’ai du mal à m’en souvenir avec précision. Céline a été une découverte bouleversante, mais bien antérieure à mes débuts dans l’écriture. Que lisais-je à l’époque de La Perfection du tir ? Je ne m’en souviens plus. Je lis trop pour pouvoir dater avec précision mes lectures. Je suis un lecteur quasiment pathologique ; je lis tout ce qui me tombe sous la main, livres, publicités, tracts, revues inutiles, noms de rues, plaques minéralogiques…
6 – Avec ton deuxième roman, Remonter l’Orénoque (Actes Sud, 2005), on entre dans une relation triangulaire presque classique : deux hommes, une femme, tous trois membres du personnel hospitalier à des degrés divers. Il y a un narrateur qui prend en charge tous les récits. Dans certains cas, il est présent, témoin des actions, dans d’autres, il reconstitue ce qu’il imagine. Il y a donc un système métadiégétique très fort (la diégèse contient elle-même une diégèse, par exemple un personnage-narrateur), plusieurs strates qui sont celles du mécanisme d’écriture romanesque lui-même à divers degrés. Avec ce deuxième roman, tu explores davantage certains « vertiges » narratifs. Peux-tu nous en parler ?
Je n’aime pas ce roman. Je pense qu’il est complètement raté, prétentieux et inutile. Ce sentiment s’émousse un peu avec le temps, mais il reste fort. Je n’étais pas content au moment de sa sortie, et comme par hasard, c’est celui de mes livres qui a eu le moins de reconnaissance critique. Cela vient sans doute de ces « vertiges narratifs » dont tu parles, et aussi d’un certain nombre d’horribles clichés qu’il met en jeu. Si je dois en conserver quelque chose, c’est peut-être uniquement le premier et le dernier chapitre. Il s’y joue aussi quelque chose d’assez secrètement autobiographique qui m’ennuie terriblement.

7 – Avec Bréviaire des artificiers (Verticales, 2007), on est dans une comédie où pointe une caractéristique qui culmine pour l’instant avec ta dernière fiction, Zone : celui des références. Le bréviaire est consacré à un art très spécial, celui du terrorisme. Il y a un premier mimétisme avec les traités alchimiques – on doit y réaliser un grand œuvre – avec les productions des corps de métiers à l’ancienne. Il y a beaucoup d’autres références intertextuelles, depuis les Fables de La Fontaine jusqu’à Star Wars… C’est un livre joyeux et ambigu illustré par les dessins de Pierre Marquès. Peux-tu revenir sur la manière dont tu as conçu ce projet ?
Ce livre doit beaucoup à mes conversations avec Bernard Wallet et Yves Pagès des Éd. Verticales. Ils souhaitaient que j’écrive quelque chose sur le terrorisme. Ma source d’inspiration a été, bien sûr, Guy Debord. Reprendre l’absurdité des différents discours liés à la violence politique, essayer de rédiger une petite histoire du terrorisme complètement détournée, où on aborderait le racisme, l’homophobie, le colonialisme, etc., etc. J’avais envie d’écrire un livre grinçant, drôle, mais ambigu. L’ambiguïté provient du détournement, justement. Le travail s’est effectué en deux temps, le texte proprement dit, puis le long travail d’illustration avec Pierre Marquès, complice de longue date. Je lui ai minutieusement décrit, à défaut de les dessiner moi-même, les différentes images que je souhaitais y voir. J’y ai ensuite mis une légende. On s’est beaucoup amusés.
8 – Il y a aussi une relecture caustique du radicalisme politique, spécialement depuis les années 70, avec en mire les grands anciens, les terroristes de 93 et leurs frères de 1917… Quels sont tes rapports à cette Histoire ? Dans le même temps, tu as traduit et préfacé le journal de Youssef Bazzi (Yasser Arafat m’a regardé et m’a souri, 2007)… Comment ces projets sont-ils liés ? Comment se sont-ils nourris l’un l’autre ?
Dans mon adolescence, j’ai cru à la Révolution. J’étais fasciné par les mouvements révolutionnaires et principalement ceux des années 70. Je me sentais d’extrême gauche. Puis, l’absurdité du terrorisme politique m’est apparue en découvrant les situationnistes. La traduction de Youssef Bazzi est postérieure à l’écriture du Bréviaire. Lorsque Bernard Wallet m’appelle pour me proposer de le traduire, je suis déjà enfoncé dans la Zone… À tel point que son coup de fil me trouve au beau milieu du camp de Majdanek en Pologne. La traduction de Bazzi coïncide avec Zone. Elle me confirme certaines de mes histoires libanaises, et notamment la bataille de Beyrouth et les premiers temps de l’invasion israélienne. Youssef est un ami. Zone lui doit beaucoup.
9 – Tu as collaboré à nouveau récemment avec Pierre Marquès pour faire un album illustré d’enfant, (Mangée, mangée, Actes Sud, 2009), où il est question d’une petite fille qui habite près d’une forêt qu’elle pense être pleine de loups. Comment s’est déroulé ce travail d’écriture ? D’où t’est venue cette idée du grand méchant loup ? Qu’est-ce qui t’a amené à vouloir écrire pour les enfants ? Ce type d’écriture te plaît-il ? Qu’est-ce qu’il change à la rédaction d’un roman pour adulte ?
À vrai dire, je n’en sais trop rien ; je suppose que le fait d’avoir une petite fille qui a aujourd’hui presque sept ans en a été le déclencheur. J’avais envie de travailler de nouveau avec Pierre Marquès sur un sujet différent et aussi de retrouver le plaisir du conte, et un de ses éléments, la dévoration. C’est aussi un détournement ; dans Mangée mangée, la petite fille est dévorée deux fois, par imprudence. J’ai écrit toute une série de contes pseudo-classiques, peut-être en publierai-je d’autres, je n’en sais rien. Écrire pour les enfants est évidemment très différent. Longueur, rythme, vocabulaire, situations, personnages… Tout est autre.
10- Passons à Zone (Actes Sud, 2008). Il est considéré comme ton grand roman. Cela t’agace-t-il ?
Non, non, pourquoi ? C’est ce que j’ai écrit de plus long jusqu’à présent, et de loin. Peut-être aussi de plus original, qui sait. Mais Zone est aussi une étape. J’avais besoin de cette liberté pour passer à autre chose, pour mettre la barre toujours plus haut. En ce sens, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants qui sort à la rentrée 2010 est ce que j’ai écrit de plus ambitieux, de loin.
11 – Le fait est que Zone peut être lu comme une synthèse de ce que tu as exploré jusqu’ici dans différents ouvrages : toujours un narrateur au centre d’une multitude de récits dont il est, selon les circonstances, l’acteur principal ou secondaire, le dépositaire, un simple tiers qui en récupère la matière. C’est aussi un compilateur dans la lignée de Pound, de Reznikoff ou de Zukosky : l’œuvre est un lieu de mémoire des œuvres anciennes, des paysages, des architectures, des biographies de l’histoire politique, littéraire, artistique. À noter qu’en politique, les personnages évoqués sont souvent des barbouzes alors qu’en littérature, on voit des grands noms mais dont l’itinéraire de vie n’en est pas moins marqué par la pauvreté, la déréliction et la désapprobation publique : Pound, Lowry, etc. Comment est né le projet de Zone ? A-t-il subi des métamorphoses ? Lesquelles et pourquoi ?
Zone est un long processus. Quand j’ai commencé à compiler ces histoires et ces entretiens, à m’intéresser à certains personnages réels, au Moyen-Orient ou dans les Balkans, j’ignorais ce que j’allais en faire, comment j’allais les rejoindre, les tisser. J’avais l’idée d’écrire un anti-bréviaire méditerranéen, (le livre de Predrag Matvejević) de faire de l’anti-Magris. Montrer un autre aspect de cette Méditerranée, son côté cimetière bleu, comme disent les Serbes. Mais j’ignorais comment. C’est seulement quand j’ai eu l’intuition du personnage de Francis le narrateur que l’écriture a réellement débuté. Le projet était là. Ensuite, tout est affaire d’équilibre, de construction, et une grande part du travail a porté là-dessus, c’est-à-dire trouver des thèmes transversaux, des échos, des liens d’une histoire à l’autre, etc., etc., et en ce sens le roman s’est beaucoup transformé au fil de l’écriture.
12 – Si l’on regarde bien, deux zones géographiques sont présentes dans ton œuvre romanesque : la Méditerranée et l’Amérique du Sud avec les Caraïbes. Pourquoi ce choix ? Parle-nous plus précisément de la Méditerranée. Tu sembles avoir un rapport charnel et conceptuel avec elle ?
Pour moi, les Caraïbes et l’Amérique du Sud sont des lieux de rêverie, dont j’ignore tout. C’est le pays imaginaire, l’endroit de l’utopie. En revanche, la Méditerranée est depuis vingt ans le lieu de ma réalité. Pour reprendre Braudel : c’est peut-être parce que, homme d’Atlantique, j’ai passionnément aimé la Méditerranée, aussi bien sur le plan charnel, celui du blé, du vin et de l’olive que pour son histoire, qui est celle d’une mixité toujours remise en question et jamais détruite, juste recomposée. Je crois que c’est cela qui m’y fascine tant.
13 – Évoquons le dispositif narratif de Zone : c’est un monologue ponctué par un véritable récit interne – un roman sur la guerre israélo-palestinienne acheté dans une librairie des Abbesses par le narrateur. Sur les vingt-quatre chants du livre, trois sont des chapitres de ce livre, ce qui offre un certain chromatisme au niveau stylistique entre, d’une part, le monologue et sa longue phrase ponctuée et, d’autre part, le récit et son rythme de phrases saccadées, tranchées presque. Peux-tu nous en parler, nous détailler les raisons d’un tel choix, à la fois dans l’ordre textuel et thématique de Zone ?
L’apparition du roman de Rafaël Kahla que le personnage lit dans le train correspond à un double choix. D’abord, je voulais briser le monologue intérieur de Francis ; je ne voulais pas que le lecteur s’y habitue à tel point qu’il en oublie, précisément, l’étrangeté, le rythme, la couleur de ces phrases. Il fallait le décontenancer en revenant à une narration plus objective, en troisième personne, avec un rythme plus descriptif qu’introspectif. D’autre part, je voulais parler d’une femme combattante, montrer que la guerre n’est plus, au 20e siècle, uniquement une affaire d’hommes. J’avais le personnage d’Intissar, mais il me semblait que c’était un récit que Francis ne pouvait pas assumer, il ne peut pas non plus tout connaître. Il me fallait donc trouver un moyen de raconter la triste histoire d’Intissar sans passer par Francis. Les deux objectifs se sont rejoints dans le texte attribué à Rafaël Kahla.

14 – Outre le jeu des références directes qui font penser à Pound, il y a aussi tout un ensemble de réappropriations techniques de ce qui a été considéré comme des ruptures en littérature au 20e siècle. Le plus fort d’entre eux étant le monologue et la complexification de la phrase qui en découle. Zone se présente aussi comme une relecture du 20e siècle créateur. Comment te situes-tu par rapport à ces histoires anciennes d’avant-garde, de rupture des codes du roman et du récit ?
Zone n’aurait pas pu exister sans ces avant-gardes, sans ces écoles de liberté que sont Joyce, ou le Nouveau Roman. Mais précisément, aujourd’hui, ce sont des moyens à la disposition du roman, des formes, des possibles ; il ne s’agit plus d’être avant-gardiste. Zone en ce sens est un roman classique, c’est-à-dire qu’il utilise des possibilités ouvertes avant lui. Je n’avais aucune prétention de faire œuvre d’avant-garde sur le plan formel ; si je défriche peut-être de nouveaux terrains, c’est ailleurs.
15 – Tu as pu collaborer à des revues et tu es un des membres fondateurs d’Inculte. Oliver Rohe parlait de cette possibilité « d’élaborer des outils en commun qui en retour, alimentent vos travaux individuels« . Comment vis-tu, pour ta part, cette aventure éditoriale ? Ton esthétique s’en trouve-t-elle changée ?
Inculte a été une formidable expérience, une autre école de liberté. Le travail collectif, la mise en œuvre individuelle d’exigences collectives, la rencontre avec des textes et des auteurs, comme Oliver Rohe, ont pour moi été décisifs. J’ignore si mon esthétique s’en est trouvée modifiée, mais très certainement n’aurais-je jamais oser me lancer dans une aventure comme celle de Zone si je n’étais pas passé d’abord par Inculte. Il y a aussi, dans Inculte, une communauté, une utopie. Nous avons un manifeste, rédigé par Mathieu Larnaudie, une très belle utopie intitulée La Constituante piratesque. C’est le texte qui résume à mon avis le mieux ce que peut être un groupe littéraire aujourd’hui : un ensemble disparate, uni dans un partage d’intentions.
16 – Tu as effectué une lecture de Zone lors d’une soirée à Bruxelles en compagnie de Dominique A à la guitare. Pour toi, la littérature se diffuse-elle mieux, atteint-elle plus les lecteurs, quand elle sort du livre, à savoir quand elle est lue, chantée, filmée, ou mise en scène ?
Je n’en sais rien. La lecture publique me semble une activité importante, qu’il s’agisse de comédiens ou de l’auteur lui-même. Il est magnifique de donner à entendre un texte, même si cela ne remplacera jamais la lecture, c’est une activité différente. En revanche, l’adaptation, qu’elle soit musicale, radiophonique, théâtrale, comme le cinéma, est un déplacement du texte dans un autre champ. Le public est autre, différent, plus nombreux souvent. Mais il ne s’agit plus de littérature. Il s’agit d’autre chose, d’un autre art, d’une autre relation avec l’espace et le temps. Ni pire ni meilleur a priori, juste différent.
17 – La fiction est-elle encore capable d’éveiller les consciences en mettant des mots sur ce que la réalité étouffe, maquille, nie ? Lorsqu’on regarde la marche du monde et le fait que la littérature intéresse finalement que peu de gens, penses-tu qu’elle puisse encore perdurer dans cette tâche ou pour perdurer justement, ne se transforme-t-elle pas de plus en plus en un simple divertissement ?
Le divertissement ne suppose pas nécessairement l’absence d’éveil des consciences ou du Devisement du monde, comme dirait Marco Polo. Divertir, c’est-à-dire détourner, éloigner. Nous éloigner de nous-mêmes pour nous tourner vers le monde. Il doit y avoir du plaisir dans le texte, le plaisir de l’altérité et de la découverte. La fiction reste un des moyens d’y parvenir. Si elle intéresse de moins en moins à l’échelle de la planète, c’est parce qu’elle crée bien souvent des objets qui pourraient être immédiatement remplacés par une œuvre cinématographique. Il ne sert à rien de faire en littérature ce que le cinéma fait bien mieux. Il vaut mieux se concentrer sur la spécificité de l’outil « roman », ce à quoi le cinéma ne peut que difficilement parvenir, des langues, des voix, des mondes. Je prends souvent l’exemple de l’image peinte et de la photographie. La photographie a révolutionné la peinture en lui redonnant sa spécificité. Le roman est passé par la même phase dans son rapport au cinéma : tout roman qui n’est qu’un scénario sans images est un anachronisme mort-né.

18 – Tu as toujours beaucoup voyagé et, depuis 2000, tu vis à Barcelone. Qu’est-ce qui t’a poussé à vivre là-bas ? Écris-tu mieux ailleurs que lorsque tu vivais en France? Que penses-tu de la France aujourd’hui au regard des pays que tu as connus, que tu connais ? Penses-tu, un jour, revenir y vivre ? Pourquoi ?
J’ai quitté la France en 1993. J’y retourne très souvent, et c’est toujours mon pays, ma langue. J’ai vécu d’abord au Moyen-Orient, puis en Espagne, pour des raisons amoureuses et familiales. Il ne s’agit pas d’un exil. Barcelone est à 150 kilomètres de la frontière, ne l’oublions pas. Je suis retourné vivre quelques mois à Paris en 2008, je m’y installerais avec plaisir si les circonstances matérielles et familiales étaient différentes. J’aimerais vivre à Paris, comme j’aimerais vivre à Berlin, à Istanbul, à Oulan Bator. Il y a toujours des choses à prendre quelque part. Ce qui compte, c’est d’être là où on se trouve, ici et maintenant.
19 – Aujourd’hui, sur quoi ou qui écris-tu ?
Je m’apprête à publier Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants qui a été très difficile à écrire, qui est un livre subtil, fragile, et fort à la fois. Un roman historique autour d’un épisode de la biographie de Michel-Ange. J’ai bien cru ne pas y arriver. Cet artiste divin, si connu, si présent dans la culture occidentale pesait très lourd sur ma tête. Il a fallu que je me libère du poids symbolique, que j’en fasse un vrai personnage, que j’oublie le poids de la bibliographie pour me l’approprier. Ça a été une expérience magnifique. Maintenant, je vais essayer d’écrire pour le théâtre, pour la voix.
Entretien © Mathias Énard & D-Fiction – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum
(Das Hotel, Berlin, déc. 2009 – Barcelone, mars-mai 2010)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.