OLIVER ROHE s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son roman, UN PEUPLE EN PETIT (Gallimard, 2009) :
1 – Oliver, peux-tu nous parler de ton parcours avant Défaut d’origine (Allia, 2003), ton premier roman ? Quelles étaient tes lectures, ton rapport à la langue, ton projet d’écriture ?
Jusqu’à l’âge de 22 ou 23 ans, environ, je lisais principalement de la philosophie, des essais, des ouvrages historiques, etc. J’avais bien sûr lu quelques romans (une bonne partie de l’œuvre de Dostoïevski, par exemple), mais la littérature n’était pas encore au centre de mes préoccupations – alors même qu’il m’arrivait d’écrire des nouvelles, des textes par-ci par-là, des choses dont j’ai honte aujourd’hui. Je crois que c’est avec la découverte du Voyage au bout de la nuit que la littérature est devenue, pour moi, un objet d’amour quasi exclusif, avant tout en tant que lecteur. Dans ce livre, il y avait à mes yeux tout ce qu’il n’y avait pas dans la philosophie et les essais : une expérience sensible travaillée par une langue inouïe (cette langue étant même le canal principal par lequel se transmettait l’expérience). C’est aussi un roman qui, ne serait-ce que sur le plan de la connaissance, me renseignait davantage sur la guerre de 14-18, sur le colonialisme, etc., que pas mal d’essais et de manuels d’histoire. J’ai avalé tout Céline dans la foulée, puis par un processus d’arborescence assez banal et heureusement toujours en cours, je me suis mis à lire tout ce qu’un étudiant en lettres ou quiconque s’intéresserait de près à la littérature aurait lu : des modernes, des classiques, des contemporains. C’est donc en lisant tous ces écrivains, dont certains m’ont durablement marqué, que j’ai à la fois (ré)appris la langue – dans sa dimension technique d’abord : ses règles, ses restrictions, ses possibilités grammaticales – et commencé à réfléchir à ce que je pourrais moi-même écrire.
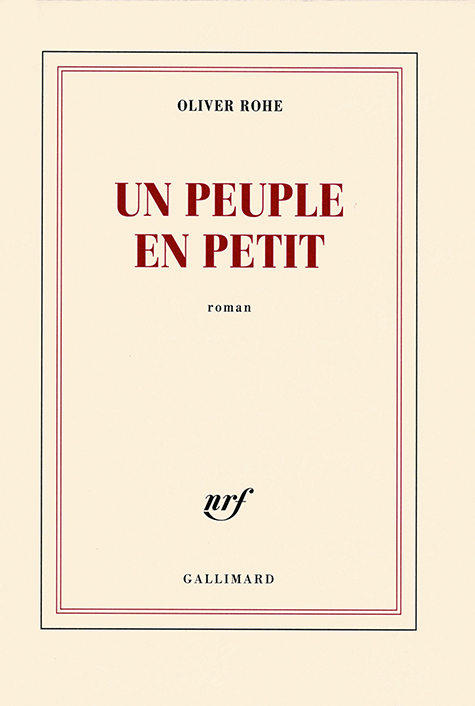
2 – Dans Défaut d’origine, le narrateur prend un avion pour revenir dans son pays d’origine. C’est un texte qui se déroule à haute altitude, dans un lieu clos. Durant tout le trajet, il évoque sa « patrie », mais aussi sa « prétendue langue maternelle », ses « prétendues racines » et sa « prétendue histoire ». Le récit, sous forme de monologue, est tissé par le souvenir des paroles de son ami d’enfance, Roman, qui lui reviennent et qui s’entremêlent à ce qu’il pense lui-même de l’exil, de la nostalgie et du déracinement. Cela amène le narrateur à développer des critiques assez caustiques sur la littérature qui peut en découler, ainsi que du mercantilisme et du sentimentalisme qui lui sont inévitablement rattachés. Parle-nous un peu de l’écriture de ce livre ? Tu y poses, semble-t-il, la question de la littérature et de son fonctionnement par le récit. On peut y lire l’histoire d’un retour d’un individu vers les lieux de son passé, mais aussi celui d’un retour de la littérature à elle-même, à ses interrogations, à sa pertinence face aux autres activités humaines.
C’est un livre que j’ai écrit en un an environ, en tout cas son exécution a exigé un an. La période de maturation a duré plus de deux ans, le temps que je trouve la structure qui puisse rassembler tout ce que j’avais tout bêtement à dire – et qui s’est sécrété aussi au fil de l’écriture – dans une langue conforme au sujet du livre. L’écriture en elle-même a donc été assez fluide, sans grandes plages de doute, d’hésitation, de pannes ; il n’y a pas eu non plus de modifications majeures apportées au texte une fois achevé, si ce n’est les vingt ou trente premières pages, que j’ai revues à l’invitation de mon éditeur de l’époque. Ce que vous en dites dans votre question est très juste : il s’agit d’un double mouvement : celui d’un retour au pays natal, avec tout ce que cela induit comme interrogations sur, précisément, les idées de pays natal, de culture d’origine et de langue maternelle, et d’autre part, une exploration de ce qui compose un texte, la façon dont il est écrit, son rapport conflictuel ou paisible à ses sources. J’ai voulu lier la question de l’identité de l’individu à celle de la singularité en littérature, en les niant l’une et l’autre (d’où l’usage volontaire du véhicule bernhardien, qui exemplifie les forces et les influences qui irriguent chaque livre, telle une loupe qui isole et met en lumière), en montrant qu’elles s’inscrivent toutes deux, l’identité propre et la singularité dont elle se flanque, dans une logique du fantasme : fantasme de l’insularité souveraine, de la langue à soi, du pré carré, de la permanence et de la fidélité à soi dans le temps, etc. Sur la littérature de l’exil, qui est presque un genre à part entière, j’exagère un peu le propos, mais je crois que oui, il y a toujours, dans les livres qui prospèrent sur ce terreau-là, comme un réflexe nostalgique, une inévitable mélancolie des départs à laquelle je n’adhère pas, une espèce de propension systématique à ériger ce qui a été abandonné (le pays, la culture, la langue) en fétiche. Très peu de livres envisagent l’exil sous un angle autre que celui du deuil impossible, de la déploration, de la perte et de la condamnation à l’errance, alors que, pour ma part, c’est du moins ce que j’ai tenté d’affirmer dans ce livre, je considère ces événements (déracinement, errance) comme une chance formidable.
3 – Entrons dans le dispositif de Défaut d’origine. Il y a des décalages remarquables. Par exemple, les turbulences du vol qui relancent et accompagnent les pensées du narrateur. Le fait que le texte comporte en bas de page l’expression « en français dans le texte », comme s’il était écrit dans une langue étrangère. On voit par-là qu’il ne s’agit pas simplement de raconter une histoire, mais de se demander en quoi consiste le fait de la raconter.
Sur ces deux aspects que vous soulignez : tout ce qui se passe dans l’habitacle de l’avion, les interventions du voisin comme celles du personnel de bord, interrompent le monologue du narrateur autant qu’ils le relancent comme vous dites, le font dévier de son cours, basculer d’un thème à l’autre, l’enrichissent de pensées nouvelles. Elles sont là, par conséquent, pour montrer à quel point le flux de conscience est colonisé par le dehors et parasité par lui, que le soliloque du livre, entremêlant déjà la voix du narrateur et celle de son ami Roman, dépend de surcroît des paroles environnantes. L’expression « en français dans le texte » qui figure parfois en bas de page répond à deux objectifs : d’une part, donner l’impression que le livre est écrit en langue étrangère (que ce soit pour le lecteur ou pour le narrateur lui-même, dont le français n’est pas la langue maternelle). D’autre part, pour signaler les expressions toutes faites, les lieux communs que le narrateur débite tout au long du texte ; ce sont à la fois des signes d’aliénation disons (il ne fait que reproduire des assemblages de mots figés dans la langue, nécrosés à force d’être usés et répétés) et des indices de sa propre intégration dans une langue qui n’est pas la sienne. Je veux dire par-là que c’est aussi en reproduisant tous ces clichés et ces expressions toutes faites que le narrateur assimile la langue qu’il parle.
4 – Il y a dans Défaut d’origine, un certain nombre d’indices qui semblent donc indiquer la désignation du texte par lui-même. Le titre n’est pas anodin dans son ironie, puisqu’il s’agit aussi de ton premier livre. Le nom de l’ami du narrateur, Roman, peut prêter aussi à plusieurs sens (genre, double du narrateur, etc.). Le choix de l’avion et la correspondance trajet/récit. Ces différents aspects ne sont pas sans entretenir une grande proximité avec ce qui fut le Nouveau Roman. Tu as écrit d’ailleurs sur Claude Simon. Peux-tu nous en parler ? N’y a-t-il pas eu une gigantesque occultation depuis trente ans de ce courant, taxé d’intellectualisme, alors qu’il ne cherchait qu’à produire de nouvelles formes ?
Je n’étais pas encore très familier des écrivains du Nouveau Roman (hormis Beckett) à l’époque où j’ai écrit Défaut d’origine. Donc si proximité il y a, elle est involontaire. Toujours est-il qu’on arrive à un certain moment de l’histoire littéraire, qu’on en est quelque part le produit. Je ne sais pas si j’étais toujours forcément conscient de toutes ces correspondances dont vous parlez au moment où j’ai commencé à écrire le livre. Par exemple, je n’avais pas choisi le prénom Roman pour sa référence au fameux genre littéraire, mais plutôt pour sa sonorité. Aujourd’hui, je ne suis pas certain que j’aurais opté pour un prénom aussi explicitement chargé… Je crois qu’il y a toujours eu, et il y aura encore, une sorte de querelle du Nouveau Roman ; une dialectique, pour dire les choses de façon sommaire, entre ceux qui s’acharnent à reproduire les formes plus ou moins traditionnelles du roman (une version dégradée du roman balzacien disons, sachant que Balzac fut un novateur en son temps) et ceux qui estiment que ces formes méritent d’être discutées sinon renouvelées, soit parce qu’elles sont sourdes aux mutations historiques qui pourtant les requièrent, soit parce qu’elles ne visent qu’à offrir une image homogène et rationnelle, c’est-à-dire fallacieuse et mensongère, de cette réalité dont précisément elles s’autorisent, comme si cette réalité était une donnée objective, quantifiable, aussi disponible qu’un objet physique quelconque. Proust soulignait déjà cette déficience quasi structurelle du roman réaliste tardif, de même que la pauvreté intrinsèque de son projet, en le qualifiant de « littérature de notation ». Par-delà ses spécificités, le Nouveau Roman pourrait être en quelque sorte le nom générique d’une insurrection esthétique, d’abord minoritaire, contre le classicisme d’une époque donnée, contre les formes fatiguées et au bout du compte anhistoriques qu’elle tend à imposer, mais aussi celui du refus d’une certaine idée du roman dit engagé (pas du politique toutefois, pas du « réel »), lequel conditionne la légitimité et la validité d’un roman à la grandeur de son message, à la qualité de son sujet, à la noblesse d’une morale dont il ne serait in fine que la simple illustration. Ces gestes de refus et de soustraction du roman aux contraintes de l’idéologie ne sont bien entendu ni ressentimentaux, purement négatifs, ni encore moins stériles, car ils se sont presque toujours accompagnés, dans un même élan, de propositions et de tentatives romanesques concrètes qu’il appartient aux autres – écrivains, critiques, lecteurs – de contester, d’entériner, et enfin, de dépasser. Il y a une phrase de Claude Simon que j’aime beaucoup, et qui dit très bien ce moment où la norme fatiguée se fait, doit se faire déborder par le surgissement d’une proposition esthétique radicalement différente (et qui aujourd’hui nous semble si largement admise) : « Si Proust avait voulu écrire dans la langue de son époque, il aurait écrit comme Anatole France »… Pour ce qui est de l’accusation d’intellectualisme et de formalisme : j’avoue ne pas comprendre à quoi ces deux reproches renvoient au juste. Même le formalisme supposé le plus abstrait et le plus gratuit, ce qu’il n’est jamais, représente quelque chose, témoigne de la réalité (ou d’une subjectivité percevant tant bien que mal une certaine réalité), nous éclaire sur la langue, traduit une manière de sentir et de penser. Ces trois éléments (la représentation, la langue, la pensée) participent autant de la fabrication du réel que n’importe quel élément du monde physique. Plus généralement, le procès du formalisme est selon moi un procès de la médiation, et partant, du réel lui-même (qu’ils s’obstinent à envisager comme une entité pure, intacte, accessible en soi, n’étaient cette satanée représentation, ce formalisme artificiel), car le réel n’est que médiation, c’est-à-dire détours, correspondances, renvois d’un objet à un autre, d’un objet à une sensation, d’une sensation à un souvenir, d’un souvenir à l’autre et ainsi de suite. Il faut se souvenir, par exemple, de la manière dont Swann tombe amoureux d’Odette : non pas en la voyant la première fois (il la trouve quelconque alors), mais uniquement lorsqu’il l’aura mise en relation avec une œuvre d’art – et ce qui compte ici, c’est bien le mot relation. Idem pour Françoise, qui ne compatit aux douleurs au ventre d’une domestique de tante Léonie qu’une fois avoir vérifié l’existence de ce mal dans un dictionnaire médical. C’est une des leçons de la Recherche : rien (notre rapport au monde, au temps, à l’espace) n’échappe à la médiation ; et il y a autant de réel « dans les Pensées de Pascal » que dans « une réclame pour du savon »… Ces accusations sont encore moins justifiées dans le cas de Claude Simon, dont l’œuvre extrêmement matérielle – et d’une précision rare dans sa description de notre façon pour le moins trouble et parcellaire de percevoir, d’interpréter et de construire la réalité, dans sa description éblouissante, aussi, du fonctionnement anarchique de la mémoire -, dont l’œuvre donc, tourne pour une bonne part autour des grands cataclysmes historiques du 20e siècle.
5 – Tu as pu écrire dans ce texte que le passé n’est que « mise en forme de lamentables fictions rétrospectives » et qu’à ce titre, l’acte créateur ne saurait être considéré comme une conséquence ou une justification directe de la guerre. Peux-tu expliciter davantage ta pensée par rapport à ton expérience, et ce qui t’a, en dehors de la guerre donc, amené vers la littérature et l’écriture ?
Le passé comme fiction rétrospective désigne, en tout cas pour moi, le processus par lequel nous ordonnons le passé (soit-il ou non en lien avec la guerre). C’est une matière comme chacun le sait si insaisissable, éparpillée, touffue, avec des coordonnées si changeantes, que le seul moyen de le raconter, de le penser, est de le mettre en fiction, de le produire en même temps que nous le pensons et racontons – et cette production contiendra autant de tranches plus ou moins intactes que de fragments altérés, concassés ou condensés par le travail du temps (et le travail de la narration, de l’écriture). On ne se remémore jamais, de la même manière, un épisode du passé lointain ou même proche : des détails surgissent, d’autres disparaissent, etc. au point que le récit de cet épisode sera fluctuant et presque à chaque fois différent, tributaire qu’il est de notre position dans le temps et dans l’espace, de l’état de notre mémoire et d’une infinité d’autres facteurs. Tous ces phénomènes montrent bien à mon sens que l’évocation du passé tient principalement de l’agencement, de la mise en forme, de la fiction… En fait, dans le passage que vous indiquez, j’ironisais surtout sur ceux qui expliquent et leur désir d’écrire et leur impuissance à écrire par une cause unique, la guerre. Que le désir d’écrire naisse d’une expérience de la guerre, ou de toute autre expérience, importe assez peu ; ce qui compte, en définitive, c’est ce qu’on en fait. Pour ma part, je ne saurais dénicher une origine précise à ce désir-là. L’expérience de la guerre doit sans doute y être pour quelque chose (la volonté de mieux la cerner, de comprendre en quoi elle a pu consister, d’abord à mes propres yeux), de même que le reste de mes expériences – qui n’en sont pas moins significatives -, mes lectures, la jouissance que procurent la forme et la narration elles-mêmes.
6 – Pour toi, la famille, la patrie, la langue d’origine elle-même, sont des enfermements dont il faudrait – guerre ou pas – s’échapper absolument pour enfin parvenir à se trouver soi-même ? N’est-ce pas plutôt leur acceptation consciente qui permet de nous en libérer comme un acquis assimilé dont on ne se préoccuperait plus ?
Je pars du principe qu’il s’agit en effet de se déconstruire, de se débarrasser de tout ce qui nous a constitué, de tout ce dont nous avons passivement hérité – de tout ce qui est précisément acquis. Non pour se connaître soi-même (dogme auquel je ne souscris pas, car il présuppose l’idée d’une vérité tapie au fond de soi, et parce qu’il ignore le caractère essentiellement changeant, dans le temps et dans l’espace, de l’identité), mais pour rester dispersé et en mouvement, pour se reconstruire sans cesse, privilégier toujours l’électif et le choisi plutôt que le donné. J’envie ceux qui parviennent à ce résultat sereinement, par des moyens pacifiques et apaisants ; chez moi, cet objectif d’affranchissement permanent passe toujours par le conflit, le rapport de force.
7 – Dans ton deuxième texte romanesque, Terrain vague (Allia, 2005), tu reviens sur la guerre, une guerre achevée. Tu abordes alors le problème de la « reconstruction » dans tous les sens du terme, à la fois reconstruction d’un territoire, mais aussi pourquoi pas, celle du récit lui-même. L’emploi du « je » n’est pas autofictif. Le narrateur qui livre bien des impressions personnelles ne verse pas dans le nombrilisme, mais délivre une pensée neutre, presque universelle, acceptable. Construire un récit à la première personne tout en évitant l’identification avec l’auteur est, selon nous, une caractéristique forte du roman, peux-tu nous en parler ?
Je suis d’accord avec vous : l’histoire du roman nous montre aussi qu’il ne suffit pas de dire « je » pour conclure à une confusion entre l’auteur et le narrateur ; que ce « je » qui parle est une instance autonome qui, certes, joue également de l’ambiguïté de sa position d’énonciation. Je pense que dans la confusion empressée que l’on fait souvent entre auteur et narrateur (et qui ne date pas d’hier !), dans ce refus de l’ambiguïté, donc, se cache peut-être une méprise plus inquiétante : la négation de cet artifice et de cette mise à distance qu’est l’écriture elle-même. Quand on pose à un écrivain une question du genre : « non, mais ce je-là, ce qu’il raconte, c’est bien vous non ? », on dit trois choses en réalité : d’abord qu’on assimile la littérature à la biographie, la première n’étant qu’une extension naturelle et fluide de la deuxième ; ensuite qu’on pense que le registre de la confession intime serait plus attrayant aux yeux du lecteur moyen, qui n’existe pourtant pas ; enfin, et c’est le plus regrettable, qu’on escamote volontairement le processus d’écriture, c’est-à-dire entre autres, le moment où le langage suggère ses propres pistes, le moment où le matériau travaillé se libère plus ou moins des intentions de l’auteur, génère de nouvelles idées et creuse des sillons inattendus.
8 – Un peuple en petit, ce troisième texte romanesque pour toi, est lui-même divisé en trois : préméditation ou hasard ?
Pas tout à fait un hasard dans la mesure où je voulais, dès le début, abandonner le monologue de mes deux premiers romans pour écrire un texte polyphonique. Je savais aussi que les voix qui prendraient la parole l’une après l’autre ne se croiseraient pas. J’avais enfin quelques images en tête, comme l’écroulement final du personnage de Bochum, mais rien de plus.
9 – Il y a donc Bochum, « Personnage Deux », et un journal en temps de guerre qui s’étend sur une décennie… Il y a aussi un quatrième texte, qui est « Un peuple en petit », lequel résulte de la lecture des trois ensembles et des correspondances, liaisons ou décalages qu’on ne peut manquer d’y chercher… Encore une fois, parle-nous de sa composition et des réglages entre les trois textes. T’a-t-il fallu du temps pour l’écrire ?
Ce quatrième texte dont vous parlez si justement, que le lecteur peut investir et combler à sa guise, n’a été possible qu’à la condition que ces trois voix ne se croisent jamais. Moins j’établissais de liens manifestes entre les voix, plus je retirais ce qui pourrait tordre le sens dans un sens ou un autre, plus le texte entier demeurait ouvert, disponible à une multitude d’interprétations… Il m’a fallu un peu plus de trois ans pour écrire ce livre. La difficulté essentielle à laquelle je m’étais confronté était due au protocole d’écriture que je m’étais fixé : écrire les passages relatifs à chaque personnage l’un après l’autre, tels qu’ils apparaissent presque dans le texte définitif. Je ne voulais pas achever l’écriture de chaque personnage d’un bloc pour, ensuite, pratiquer un montage général. Sans doute pour deux raisons. D’une part, pour éviter la double tentation de surplomber mon sujet et de soumettre la matière à un (vague) programme de départ. Il me fallait laisser toute sa place à ce qui ne manquerait pas d’émerger au cours de l’écriture ; suivre et rectifier au fur et à mesure plutôt qu’imposer a priori. D’autre part, parce que ce protocole d’écriture, jouissif en soi, m’obligeait à changer de style et de situations sans arrêt ; de là provient à mon avis la vraie cohérence d’ensemble du texte, sa cohérence souterraine, car il y a des impulsions, des rythmes, des tonalités d’images et de thèmes qui débordent, déteignent et circulent – malgré les efforts et les précautions – d’un passage à l’autre, d’une voix à l’autre. Le seul « montage » que je me suis autorisé à mi-parcours, c’était de replacer les récits de guerre dans leur ordre chronologique, afin de souligner la mue langagière de l’enfant, son entrée progressive dans la langue adulte.
10 – Si dans tes deux premiers romans, c’est le trajet dans un lieu qui permet de construire un facteur temps, dans ce troisième, il semble ici que les choses se complexifient. Le temps est parfois au centre de la structuration des récits et conditionne les postures spatiales. Comment articules-tu ces deux valeurs d’espace et de temps dans tes récits ?
C’est une question très complexe. Je ne suis pas sûr d’être en mesure d’y répondre de façon satisfaisante. Mais, disons que j’ai tendance à attribuer une temporalité spécifique à chaque lieu, à chaque espace. Cette séparation dans le temps (et dans l’espace) n’est pas étanche pour autant : toutes les temporalités se conjuguent en permanence et se projettent l’une dans l’autre. Pour prendre un exemple précis, les récits de guerre dans Un peuple en petit, datés des années 80, sont écrits au présent de l’indicatif (afin de souligner leur survivance dans le présent de la narration, et de produire un effet d’immédiateté, de déferlement violent, à l’image de ce que vit l’enfant), alors que le monologue de l’acteur de Bochum, qui se déroule pourtant dans le présent, est écrit à l’imparfait et au passé composé – le « Personnage Deux » étant balloté, quant à lui, entre les deux, dans un nulle part temporel qui alterne indifféremment passé et présent et qui souligne par la même occasion son rapport pathologique à la réalité et au langage. Je crois que ce télescopage, ce mélange un peu paradoxal de séparation et de confusion incessantes que l’on retrouve dans ce livre (et que j’accentuerai davantage dans le prochain) témoigne ainsi d’une propension chaotique (celle des personnages, la mienne peut-être aussi) à évoluer dans une temporalité et des espaces à la fois immobiles et mouvants.
11 – Philippe Sollers, dans le documentaire Le Trou de la vierge sur L’Origine du Monde de Courbet, explique que la voix ne sort jamais d’un corps, mais qu’elle y entre ; qu’une voix, en quelque sorte, choisit son corps. Pour toi, un personnage habite-t-il une voix ou l’inverse ?
Si l’on entend par-là l’idée (mystique somme toute) d’une voix qui se baladerait comme ça dans l’air, tel un gentil génie ou une gentille fée, et qui viendrait atterrir, pénétrer, prendre possession d’un corps, alors ma réponse est non. Mais la signification de cette analyse est peut-être différente : la fonction crée l’organe, l’existence précède l’essence, l’occasion fait le larron, etc. Auquel cas, j’abonderais plutôt dans ce sens-là : la voix n’est pas un simple attribut du corps, quelque chose d’enraciné et de définitif, une espèce de matricule immuable. La voix se métamorphose autant que le corps (ils se modèlent l’un l’autre) et reste aussi perméable que lui aux variations du dehors, du temps et de l’espace. C’est une construction.
12 – Tu as pu apprendre la langue française dans ta jeunesse à l’école que tu fréquentais comme dans ta famille où tu l’entendais couramment. Lorsque tu es arrivé en France, tu l’as approfondie au cours de tes études et tu as finalement choisi par la suite de t’exprimer avec pour écrire tes livres alors même que tu en parlais d’autres. Quelles sont tes relations à la langue française ? Pour toi, est-ce une langue « naturelle » aujourd’hui, ou simplement une langue « étrangère » que tu maîtrises mieux que les autres ?
En réalité, j’ai été élevé dans le trilinguisme ; un trilinguisme un peu singulier, qui signifiait moins aptitude à passer d’une langue à l’autre sans efforts laborieux que confusion linguistique totale, car chaque phrase prononcée était toujours composée de ces trois langues, qui plus est dans un désordre imprévisible. Après quelques mois en France, constatant que j’avais des difficultés à mener une pensée à son terme et à m’exprimer clairement, j’ai préféré me débarrasser de ce pli assez détestable, comme une mauvaise posture dorsale qu’il convient de corriger… J’ai donc tout réappris, par tous les moyens possibles, sans que cet apprentissage forcené parvienne toutefois à gommer complètement l’ombre ou l’arrière-plan d’origine, le trilinguisme dans lequel j’ai pu baigner. Même si je ne peux aujourd’hui qu’écrire en français, puisque j’ai progressivement perdu la maîtrise des deux autres langues, il me semble que j’entretiendrais toujours un rapport ambivalent – fait de grande proximité et de distance irréductible – à la langue française. Lorsque je parle aux autres, ou me parle à moi-même, j’entends toujours l’accent, certes de moins en moins prononcé, que j’avais lorsque je suis arrivé en France. Pour résumer cette situation un peu spéciale, il faudrait s’imaginer derrière une vitre qui s’amenuiserait sans cesse tout en demeurant fondamentalement imputrescible.
13 – À la fin de Défaut d’origine, tu rends hommage à Thomas Bernhard. Samuel Beckett, dont le français n’était pas la première langue, a peut-être aussi compté pour toi. On a déjà parlé de Claude Simon. Quels sont les auteurs de ta bibliothèque? Comment leurs livres peuvent déclencher les tiens si tel peut être le cas ?
Difficile d’égrener une liste de noms d’écrivains sans être convenu ou forcément incomplet, mais à côté de ceux que vous venez de citer, je rajouterai dans le désordre Faulkner, Proust, Flaubert, Conrad, Novalis, Céline, Laurence Sterne, Shakespeare, Paul Valéry, Robert Musil, Melville, Fritz Zorn, Thomas Mann, Hermann Broch, Flannery O’ Connor, Malcolm Lowry, Artaud, etc. Je ne sais si leurs livres déclenchent les miens, du moins consciemment, mais ils m’ouvrent tout bêtement à de nouveaux territoires. Ce que je retiens aussi, en plus du contenu et de la forme de l’œuvre, c’est la liberté incroyable qu’ils se sont autorisés les uns et les autres dans leur travail, l’intransigeance dans la prise de risque, le refus de la simplification.
14 – Tu fais partie des fondateurs et des collaborateurs de la revue littéraire et philosophique Inculte qui regroupe Mathieu Larnaudie, Mathias Énard, Claro, Arno Bertina, entre autres. Parle-nous de cette aventure collective. Une revue est-elle encore un laboratoire de création essentiel pour la vie intellectuelle et une bonne vitrine promotionnelle ? Quel est ton rapport à la notion de groupe et de collectif alors que depuis la fin de Tel Quel, plus aucun groupe ne s’est imposé véritablement sur la scène littéraire et dans l’histoire de la littérature.
Les écrivains que vous venez de citer figurent parmi les jeunes auteurs français dont j’admire le travail. C’est peut-être pour cette raison-là, d’ailleurs, que nous sommes tous devenus amis et que la revue Inculte a été possible. Je ne sais si une revue, quelle qu’elle soit, peut être de nos jours un laboratoire indispensable à la vie intellectuelle dans son ensemble (les conditions historiques ne sont plus les mêmes pour aller vite, la situation moins polarisée, les centres plus nombreux et plus dispersés), mais pour nous, ceux qui y participons depuis maintenant cinq ans, trois fois oui. Ce que nous cherchons les uns et les autres, au-delà de l’amitié et de la massive absorption d’alcool dont elle est le prétexte, dans cette revue, est de produire une réflexion sur plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur (ou dont on découvre qu’ils nous tiennent à cœur, une fois mis sur la table), d’élaborer des outils en commun qui, en retour, alimenteraient nos travaux individuels – et ce à l’heure où, comme vous le dites, la possibilité, la notion même de collectif se portent plutôt mal, pour des motifs hélas beaucoup trop nombreux pour qu’on puisse en discuter ici.
15 – Tu as collaboré à des livres en commun : par exemple, aux recueils Devenirs du roman, et à l’ouvrage sociologique, Une année en France, ce dernier sur les événements marquants de l’année 2005-2006. Parle-nous de cette interrogation sur la littérature sans qu’il s’agisse de théorie au sens propre. Quel type d’analyse peut-on produire des enjeux romanesques et littéraires aujourd’hui alors qu’un peu partout est proclamé, depuis au moins vingt-cinq ans, l’abandon des outils linguistiques, psychanalytiques, esthétiques ou politiques susceptibles de théoriser l’écrit ?
Petite précision : Une année en France n’est pas à mon sens un ouvrage sociologique, mais typiquement littéraire (bien que son objet soit expressément politique) : il recourt autant à la fiction et au récit qu’au document brut, à la citation, à l’enquête, à l’essai, etc. ; cette hétérogénéité est sans doute un des privilèges de la littérature… Ceux qui ont enterré les instruments avec lesquels nous pouvons penser la littérature, qui appellent en tout cas à leur extinction, ne m’intéressent évidemment pas beaucoup, bien que certains de ces instruments nécessitent révision, actualisation ou refonte complète. Je ne peux imaginer une littérature qui ne poserait aucun problème aux autres domaines du savoir – et, de même, une littérature qui serait hermétique aux réflexions conduites sur elle par d’autres disciplines. Cela me paraît aussi inévitable que souhaitable… À titre personnel, trois problématiques me touchent particulièrement. Comment écrire après : après les révolutions esthétiques du début du 20e siècle, après le Nouveau Roman, après le reflux des années 80, etc. – comment élargir le territoire du roman aujourd’hui, l’élargir, l’étendre et pourquoi pas le complexifier (sa forme, sa structure, son matériau, son rapport à la langue et à l’Histoire). Ensuite, la question du sens : comment l’ébranler ou retarder son avènement, c’est-à-dire raconter (par le récit, par la fiction, par la description, par la digression, etc.) sans épuiser et enfermer dans le cadenas du sens. Enfin, et c’est là un problème peut-être plus concret, comment associer au mieux la sophistication narrative (qui induit un ordre) et la sauvagerie dans la transmission des sensations…
16 – Tu as aussi écrit Nous autres, une biographie fictive de David Bowie. Parle-nous de cette expérience et quelle est sa place dans ton œuvre car il nous semble que ton travail est l’un des plus liés qui soient aujourd’hui, alors qu’il emprunte des formes hétérogènes.
Le livre sur Bowie était une commande. Naïve venait de lancer une collection de fictions sur les grandes figures du rock. J’avais proposé David Bowie, que j’écoutais fanatiquement depuis l’enfance presque, et qui, jusqu’au milieu des années 70, avait fait cette chose assez splendide : créer plusieurs doubles et les faire plus ou moins cohabiter ensemble, un peu à la manière de Pessoa et de ses hétéronymes. C’est cet aspect-là, cet éclatement identitaire revendiqué, que j’ai voulu mettre en scène dans la première partie (épistolaire) de ce livre – avec, dans la deuxième partie, le revers de cet éparpillement schizophrénique, à savoir le repli identitaire, la paranoïa. J’avais trouvé dans tout cela une résonance évidente avec des préoccupations qui sont miennes, depuis mon premier livre. Ce détour par Bowie m’a aussi permis de préparer en quelque sorte le terrain à Un peuple en petit, dans la mesure où, un peu comme dans celui-ci, la structure de Nous autres est fragmentée, avec des personnages qui prennent la parole l’un après l’autre, se répondent et se contredisent, etc. Autre continuité : l’exergue en tête du premier chapitre, cette citation de Novalis, donnera le titre de mon dernier roman.
17 – Par ailleurs, tu as pu collaborer en tant que chroniqueur à un magazine culturel grand public et participer aussi à une émission culturelle sur une chaîne câblée. Au-delà de l’aspect alimentaire, que te permettent ces interventions ? Te permettent-elles de te positionner par rapport à des œuvres et des écrivains ?
En fait, mon expérience chez Chronic’art, qui s’est achevée un an avant la sortie de mon premier roman, m’a permis de me familiariser davantage avec la littérature contemporaine, et avec le fonctionnement du milieu éditorial. Bien que je ne me reconnaisse plus tout à fait dans ce que j’ai pu y écrire, dans l’ensemble, j’estime que ces deux années ont été constructives. C’est aussi chez Chronic’art que j’ai rencontré certaines des personnes, dont Mathieu Larnaudie, avec lesquelles nous avons fondé Inculte. Mon passage à Ça balance à Paris fut beaucoup plus expéditif : je n’ai, en effet, participé qu’à quatre émissions… Ce que je peux en dire, c’est que ce n’est pas un exercice pour moi ; je n’étais pas adapté à ce dispositif. Cela étant dit, là encore l’expérience n’était pas complètement stérile, car j’ai quand même pu y parler de deux ou trois livres qui me tenaient à cœur, comme Le Tunnel de William Gass.
18 – Tu fais partie de ces auteurs qui n’apparaissent qu’à l’écrit, dont les dates sont d’abord celles de leurs publications. Comment conçois-tu cet engagement dans l’écrit ? Peux-tu nous parler de ce rapport au quotidien par l’écriture ? Qu’est-ce que vivre aujourd’hui dans et de son écriture ?
Je conçois cet engagement avant tout comme un choix de vie assez libre (je dispose de mon temps) quoique organisé autour d’une discipline à laquelle j’essaye de m’astreindre. Une discipline de lecture surtout. Je n’écris, en effet, pas tous les jours, hormis les textes en revue, mais uniquement lorsque je travaille à un roman. Il peut donc s’écouler des mois avant que je me mette à écrire. Ces plages restent pour moi très fécondes, car consacrées davantage à la lecture, à la prise de note, à la discussion, à la maturation, etc. Je ne culpabilise donc pas forcément lorsque je n’écris pas, alors qu’une journée sans lecture me terrorise… Vivre de nos jours de son écriture, quand les droits d’auteur ne suffisent pas, veut dire vendre sa force de travail ou son maigre savoir-faire ailleurs. Comme à peu près tous les écrivains. C’est une obligation, pas toujours désagréable, loin s’en faut. Je collabore à quelques magazines (non littéraires, sauf exception), je fais quelques traductions, j’accepte des commandes, je postule à des résidences et pour des bourses.
19 – Tu habites à Berlin. Pourquoi avoir voulu t’éloigner de la France ?
Plusieurs raisons à cela. Je n’arrivais plus vraiment à écrire à Paris (ni vraiment à lire…). Le rythme de la ville, la multiplication des pressions qu’elle exerce, ne me convenaient plus, m’asphyxiaient même à un moment. La question matérielle, dont on se rend encore plus compte dès qu’on quitte Paris, m’a également motivé à venir m’installer ici. Berlin offre un cadre de vie confortable et abordable à la fois, ce qui me semble quasi unique en Europe. Écrire n’est donc pas un luxe ici. Et puis, la ville me plaît énormément : il y a là, en plus du rapport lourd et compliqué à l’Histoire, une grande hétérogénéité urbanistique qui parfois confine au chaos, une mixité sociale effective. Et puis encore, il y a une laideur très spéciale ! Une laideur âpre, vintage, avec beaucoup de caractère, du chien. Sur un plan plus politique, Berlin me paraît beaucoup plus égalitaire que Paris, beaucoup plus libertaire aussi ; on y croise très peu de véhicules de police, l’espace public appartient vraiment à tout le monde et les bars ne ferment presque jamais…
Entretien © Oliver Rohe & D-Fiction – Illustrations © DR – Vidéo © Isabelle Rozenbaum
(Berlin, déc. 2009- août 2010)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.