
BERTRAND LECLAIR s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son roman, PAR LA VILLE, HOSTILE (Mercure de France, 2016) :
1 – Bertrand, vous publiez un récit fictionnel d’un fait divers judiciaire : l’expulsion locative d’une cité HLM d’une femme vivant seule au nom du « trouble à l’ordre public » suite à la condamnation de ses deux fils pour trafic de stupéfiant au sein même de cette cité. Vous mettez en scène essentiellement deux personnages : cette femme et un huissier de justice qui doit procéder à l’expulsion de celle-ci. Qu’est-ce qui vous a poussé à traiter un tel sujet ? Est-ce pour vous encore, une manière agissante que de s’opposer ainsi, par un roman à la violence sociale comme l’auraient fait un Zola et un Steinbeck à d’autres époques ?
Après avoir lu l’ensemble de vos questions, je crains de répondre longuement à la première, et plus brièvement aux suivantes, en espérant que vous m’en excuserez. C’est que toutes se tiennent parfaitement entre elles, et qu’à rectifier l’angle de la première afin d’y répondre au mieux, j’empiète sur les suivantes. Dans l’avertissement qui ouvre le livre, je précise que je n’ai pas mené la moindre enquête avant de m’emparer des faits relatés par une brève de quelques lignes, dans un quotidien. Je n’ai même pas voulu savoir qui, « en réalité », étaient ces gens dont (ne) parlaient (pas) le journal : la femme expulsée, ses enfants, leur entourage. Cela veut dire que le sujet du livre, s’il en a un, n’est pas la réalité d’un fait divers qui s’est bel et bien produit, mais la réalité agissante d’une information provoquée par ce fait divers – et ce n’est évidemment pas du tout la même chose. En d’autres termes, je ne formule pas les enjeux de ce texte avec le type de problématiques qu’avance votre question ; non pas parce que les références littéraires citées sont anciennes, mais parce qu’elles ne concordent pas avec ces enjeux, tels que je me les représente. Il ne s’agit pas plus d’une approche « zolienne » que d’une approche « hugolienne », malgré les textes coups de poing de Hugo, assénés non pas tant contre la violence sociale effective que contre la bonne conscience de l’époque, bonne conscience partagée par nombre de lecteurs et qui aujourd’hui comme hier autorise et provoque la violence sociale en rendant aveugle à ses effets réels. La nécessité de ce texte, très différent de mes romans précédents ou de celui auquel je travaille actuellement, me semble d’un autre ordre quel que soit la manière que je choisis de vous répondre, puisque j’en ai deux, en vérité – comme c’est, je crois, toujours le cas en matière de création dès lors que le geste initial s’effectue en confiance, laissant libre cours à une forme d’instinct avant même d’en interroger les motivations. Une première réponse possible décrit la réalité et les conditions de ce geste au moment où il se produit ; la seconde repose sur la réflexion que le geste provoque après coup, venant éclairer sinon élucider ce qui s’est écrit, peut-être pour le justifier, en tout cas pour en dégager le sens. Je m’en tiens d’abord à la première façon de répondre. Je me souviens très précisément du moment où j’ai lu cette brève et du sentiment d’étouffement qu’elle a provoqué, qui a interrompu le cours ordinaire de la lecture du journal, celui que nous connaissons tous, qui laisse la capacité d’indignation elle-même se bercer de son rythme émoussé par le flot d’informations insoutenables. Cette fois au contraire, la lecture a été réellement interrompue, m’obligeant à lever le nez pour respirer et – c’est ainsi que je le formulerais – pour percer l’opacité limpide de l’information : pour essayer de me représenter dessous une réalité solide et sensible. Qu’est-ce que le journal nous raconte, exactement ? Qu’est-ce que cela réellement représente, non pas dans le journal, non pas même dans l’esprit du journaliste au travail ou de son lecteur, mais dans la réalité vécue, ce corps encombrant d’une mère qu’on expulse de chez elle, ce corps qui tombe (un corps qui tombe d’abord dans les mots : dans les mots des juges, huissiers, voisins, dans les mots de ses fils, dans les siens propres, minés par sa culpabilité de mère déchue) ? Disons que, loin de penser à enquêter, m’y refusant au contraire, j’ai aussitôt imaginé : éprouvé le besoin de mettre des images mentales sur le contenu de l’information, les images non pas d’une réalité socialisée mais d’un réel qui s’effondre. Disons encore : à cet instant de suffocation, les questions et les images déboulent en réaction, se bousculent, le texte me tombe dessus, tout habillé (il n’y a « plus que » à l’écrire…), parce que quelque chose en moi se révolte (ce quelque chose est certainement en rapport avec mon histoire personnelle, même si c’est une toute autre histoire : j’ai été emprisonné quelques semaines pour un soi-disant « trafic de stupéfiants » à 18 ans, et même si les conséquences heureusement n’eurent rien d’aussi tragique, j’avais une mère moi aussi). Quelque chose se révolte, non pas tant ou pas seulement contre le fait évoqué et les politiques qui y mènent (politiques actuelles en matière de logements, de drogues, de justice sociale auxquelles, faut-il le préciser, je suis viscéralement opposé), mais contre l’information elle-même, c’est à dire la façon dont est traité à travers elle notre réalité commune, celle que nous habitons bon gré mal gré, et je pourrais dire encore : se révolte contre le processus d’abstraction au sein même du langage de l’information des corps concernés par ce langage, se révolte contre leur réduction à des statistiques et des normes anonymes, dans la négation de toute forme de tragique au sens ancestral du terme. Informer, étymologiquement, c’est «donner une forme». Qu’est-ce que c’est que cette forme que le journal, serait-ce à son insu, prétend donner, non pas tant au fait réel qu’il traite, qu’aux représentations du monde et des êtres proposées aux lecteurs ? C’est bien pourquoi c’est tout autre chose qui est en jeu que la violence sociale (même si évidemment elle l’est aussi : elle ne peut pas ne pas l’être). Si j’en passe par la vieille histoire du sage, du doigt et de la lune, je pourrais aller jusqu’à dire, en l’occurrence, que ce qui m’intéresse, à cet instant, ce n’est pas la lune que l’on veut me faire regarder loin dans le ciel plutôt qu’autre chose qui est sous mes yeux (à commencer par tous ces laissés-pour-compte qui dorment dans la rue, dans le pays richissime qui est le nôtre), c’est le doigt qui s’y emploie. Qu’est-ce que c’est que ce doigt crochu, aseptisé mais retors, qui prétend formuler la manière juste et rationnelle et convenable de regarder la misère comme étant naturelle ? J’en viens à l’autre réponse possible, tout aussi sincère. A posteriori, ma réflexion m’entraîne sur un terrain différent. Ce qui différencie ce récit de mes autres livres, c’est que la problématique centrale ici n’est pas la langue, comme c’est d’ordinaire le cas (la langue, où comment y retrouver du jeu et donc de la vie, le vif du vivant, comment la remettre en jeu), mais le langage, ou plutôt les langages – comme l’écrivait Yves Bonnefoy, affronter le langage « et le mal qu’il fait à la vie ». D’où la réponse suivante…
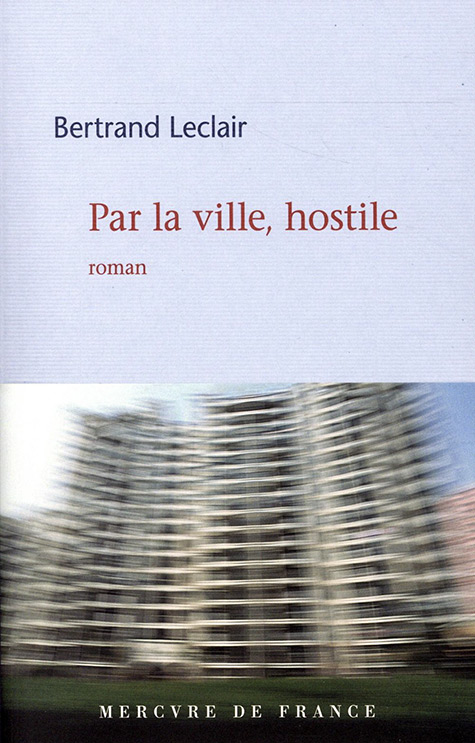
2– Votre roman se présente sous la forme de deux monologues, celui de cette femme expulsée et celui de l’huissier de justice. L’action se déroule ainsi principalement à l’intérieur – appartement ou voiture – présentant un contexte quasi de « huis clos ». Était-ce un moyen de faire monter la « pression » sur le lecteur ou de créer une ambiance quasi propre au roman noir ? N’avez-vous jamais pensé, précisément, à traiter des problèmes sociétaux de ce type plutôt sous la forme du roman noir ? Pourquoi ?
Encore une fois, la question pour moi n’est pas de traiter un problème sociétal, les journaux, les essais, les documents font ça très bien (potentiellement). Je ne crois pas que la littérature ait pour objet de donner des réponses ou d’asséner des certitudes et des vérités, mais bien plutôt de reformuler et plus encore d’inventer des questions, comme font les enfants, des questions qui auront le pouvoir de sortir de leurs gonds les réponses les plus communément admises au titre du « bon sens ». Une fois cela dit, il ne s’agit pas vraiment de monologues, ni de soliloques, puisque le récit s’écrit essentiellement à la troisième personne, en recourant à ce formidable outil narratif qu’est le discours indirect libre : une technique du « dedans – dehors » qui est surtout une façon d’accompagner les pensées d’un personnage sans usurper sa place. En l’occurrence, le discours indirect libre permet d’illustrer deux rapports au langage, que le roman oppose de facto : celui de l’huissier, celui de l’expulsée. D’une certaine manière, le personnage de l’huissier qui ouvre l’histoire, personnage que j’ai essayé de préserver du caricatural associé à sa fonction, est le représentant du lecteur, de l’homme ordinaire (vous ou moi) découvrant d’emblée l’information et sa cruauté (une femme va être expulsée, tout à l’heure) ; c’est d’ailleurs aussi le rôle réel d’un huissier, toujours mandaté et par qui, au bout du compte, sinon la collectivité toute entière, quoi que prétendent en vouloir un à un les individus qui la composent. Jeune et d’ordinaire à l’aise dans ses baskets, cette huissier maîtrise le vocabulaire et la syntaxe, elle se raconte sans cesse des histoires où justifier son rôle (comme nous faisons tous), mais en vérité elle glisse à la surface d’un langage qu’elle a choisi de faire sien, un langage sans aspérité, normalisé et anesthésié, le langage des classes sociales dominantes aujourd’hui. La nécessité où elle se trouve, ce jour là, de procéder à l’expulsion forcée d’une femme seule et coupable de rien d’autre que d’exister est l’écueil qui vient perturber et donc révéler brutalement la superficialité volontariste de son rapport au langage, un écueil qui l’empêche de s’accommoder aussi simplement qu’à l’ordinaire de son métier et du monde tel qu’il va. C’est dans ses mots et ses phrases que cette huissier peine à résister à l’épreuve de l’expulsion manu militari d’une femme seule et inoffensive pour « troubles à l’ordre public », qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Qu’est-ce qu’il se passe, quand la mécanique ordinaire du langage se grippe, lorsque les mots ne parviennent plus à maintenir la fiction sociale que nous habitons au quotidien des jours ? Le personnage de l’expulsée a un rapport au langage bien plus complexe et profond, et pour tout dire tragique. C’est pour cela qu’elle est une femme puissante, produisant des effets en chaîne autour d’elle par l’opacité, la résistance qu’elle ne peut pas ne plus opposer à la réalité, en la récusant. Elle a le sentiment d’être séquestrée par le langage, elle voudrait le fuir pour fuir la réalité qu’il trame, et du coup ne rêve que d’une seule chose, mais une chose impossible : sortir enfin du langage, lui échapper (afin de sortir de l’histoire, qui la tue). Ce n’est pas tout à fait un hasard si la phrase qui revient comme une ritournelle via la radio qui s’allume à l’improviste dans la tête de cette femme, est une citation empruntée à Beckett, puisque c’est, déformée tout à loisir, la première phrase de Malone meurt et sa magnifique pluie d’adverbes : « Je serai quand même bientôt tout à fait mort enfin ». Beckett poursuit, à la deuxième ligne : « Peut-être le mois prochain. Ce serait alors le mois d’avril ou de mai. Car l’année est peu avancée, mille petits indices me le disent ». Si j’ai joué déjà avec les codes du roman noir, dans L’Invraisemblable histoire de Georges Pessant, décrivant une toute autre forme de violence (une erreur judiciaire), je n’aurais pas trop su quoi en faire ici. Il n’y a de toute manière aucun suspens individuel: le suspens est collectif, et politique. On va où, comme ça ? Expulser des individus de leurs maisons, expulser des individus des pays où ils espéraient trouver un havre, c’est mettre au monde : mettre au monde des millions de spectres destinés à hanter de leur effacement le tissu commun de nos phrases. J’ajoute enfin, pour être complet, qu’écrivant ce texte bref et noir où l’on crache les mots qui entravent la glotte j’ai beaucoup pensé au théâtre – Par la ville, hostile devrait y être adapté et joué dans pas trop longtemps, si tout va bien.

3 – Le titre pose question : Par la ville, hostile… Qui est hostile ? La ville ou le personnage qui, dans et par la ville, est devenu hostile ? Quoi qu’il en soit, diriez-vous que la ville est aujourd’hui plus propice qu’autrefois à une nouvelle forme d’hostilité, voire de lutte, et de cruauté entre les hommes ? N’est-ce pas le système actuel du capitalisme – à la ville comme à la campagne et dans n’importe quel autre environnement ou territoire infra-urbain – qui fait survenir cette hostilité entre les hommes et met en péril ce qui reste encore de leur humanité ?
La virgule évidemment est essentielle, qui est facteur d’ambivalence : à la seule lecture du titre, nul ne peut décider si c’est celui ou celle qui va «par la ville» qui est hostile, ou si c’est la ville qui est hostile à l’individu laissé pour compte, comme la ville contemporaine sait l’être avec ses bancs où il est impossible de s’allonger, ses barrières destinées à « fluidifier » la circulation piétonne, ses arches de parking qui n’ont pas d’autre raison d’être que d’empêcher les caravanes (entendez : les Roms) de « s’infiltrer » dans les lieux, etc. Encore une fois, inventer des questions plutôt que des réponses toutes faites : au lecteur de s’emparer de cette ambivalence, de s’y colleter, de tenter de la résoudre s’il le désire. La littérature, de toute façon, est ambivalence, c’est à cela qu’on la reconnaît, à la différence du journalisme qui prétend ne jamais l’être, qui vise à imposer une transparence fallacieuse à la langue commune, qui veut absolument qu’un chat soit un chat. Maintenant, sur le fond de votre question, bien sûr je suis d’accord : le système dominant est évidemment responsable de l’état de guerre économique perpétuelle qui est notre lot de manière sans cesse accentuée. L’enjeu, à mes yeux, d’un texte comme Par la ville, hostile, n’est pas de dénoncer comme une tribune ou une analyse peuvent tenter de le faire, mais de rendre de la chair aux figures abstraites que manipulent les statistiques et les informations, dans l’espoir que ces dernières une fois chargées de chair humaine « passent mal » au broyeur idéologique : de se représenter la réalité de ce qui est fait à l’humain, en somme et pour tout dire – rendre chair et âme à la réalité décrite, dans l’espoir utopique ou non de réveiller la capacité d’empathie et de sensibilité à l’autre – la réveiller chez soi-même d’abord, chez le lecteur ensuite, quand la sensibilité est la seule possibilité de viser, non pas à une «intelligence du monde» qu’on assénera aux autres, mais à une forme d’intelligence au monde et aux autres. « L’art ne restitue pas le visible : il rend visible », disait Paul Klee.
4 – Cette forme de justice appliquée en prévention du « trouble à l’ordre public » contre une mère dont les fils ont été condamnés rappelle – toute proportion gardée – la politique de la société israélienne qui détruit les maisons des familles de kamikazes afin de dissuader ceux qui voudraient commettre un attentat estimant qu’un terroriste prêt à sacrifier sa propre vie y réfléchira peut-être à deux fois s’il sait que la maison de ses proches sera détruite car il semble entendu que si « la famille en paie le prix, c’est différent ». Il n’est pas dit que, là-bas, cette politique « fonctionne », mais que sait-on aujourd’hui, chez nous, d’une telle application de cette justice de « prévention » sur des personnes qui, sommes toutes, ne sont pas directement les « coupables » ? N’est-ce pas là une forme d’injustice perpétrée par la justice elle-même sachant que, en ce qui concerne les crimes et délits des « cols blancs », on ne s’attaque jamais à leur famille ?
Votre question fait sens, elle me semble rétrospectivement fondée, mais je dois avouer que je n’ai pas songé à ce parallèle avec la politique israélienne au moment où j’écrivais. Me préoccupait davantage le parallèle avec les migrants, eux aussi victimes d’une politique de « prévention » alors qu’ils ne sont (pour l’écrasante majorité) coupables de rien, sinon de ne plus pouvoir vivre dans leur pays en proie à la guerre ou à la famine, dans l’impitoyable jeu de dominos des politiques économiques mondiales. De fait, l’injustice est à son comble, dans une indifférence suffocante. Mais j’en profite pour terminer sur une toute autre question récurrente dans la plupart de mes livres, qui touche de manière très différente à la question de la responsabilité, qui est celle de la parentalité. Elle est ici abordée dans une situation à front renversé, là où le plus souvent la littérature préfère interroger le monde depuis la position des fils/filles : pour partie coupable ou non et de quoi, la mère est-elle victime aussi de ses enfants ? Et là encore, qu’est-ce qu’une telle question peut bien vouloir dire qui reste obscur ? S’il en est un, c’est, en creux, le vrai sujet du livre.

5 – Comment s’inscrit votre roman dans la généalogie de votre œuvre ? Quelle est cette part de réalité qui vous a poussé à fictionnaliser ces personnages impuissants et désespérés ? Pourquoi avoir choisi ces deux personnages de femmes ? Diriez-vous que le malheur, pour certains êtres, est inéluctable? Comment l’expliqueriez-vous ?
Comment répondre ? Le tragique est inéluctable, le malheur non, évidemment, et moins encore lorsqu’il a – ainsi que c’est le cas en l’occurrence – un rapport évident avec les choix et décisions politiques. La négation volontariste du tragique dans nos vies est sans doute l’un des plus puissants vecteurs du malheur contemporain. Je ne néglige pas, cependant, la puissance de l’amour… le grand absent de Par la ville, hostile.
Entretien © Bertrand Leclair & D-Fiction – Illustrations © DR
(Paris, nov. 2016)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
